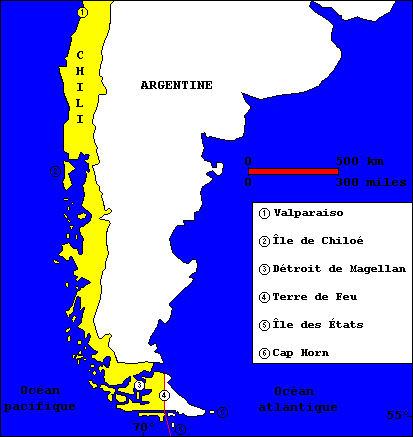
LE NOUVEAU GULLIVER,
ou
VOYAGE DE JEAN GULLIVER,
FILS DU CAPITAINE GULLIVER.
Traduit d'un Manuscrit Anglais,
Par Monsieur L. D. F.
______________________________________________________________
À PARIS,
Chez La veuve CLOUZIER, Libraire, à la descente du
Pont-neuf, près la rue de Guénégaud, à la Charité,
ET
FRANÇOIS LE BRETON, Libraire, à la descente du
Pont-neuf, près la rue de Guénégaud, à l'Aigle d'or.
______________________________________________________________
ÉPÎTRE À MADAME LA COMTESSE DE ***.
Madame,
Le jugement favorable que vous avez porté du premier Gulliver, et l'honneur que vous lui avez fait de la défendre souvent contre la critique, sont des motifs qui m'engagent à vous dédier celui-ci, dans l'espérance que vous voudrez bien continuer au fils la protection que vous avez accordée au père. Ce n'est pas que je croie leur mérite égal, mais il me semble que le fils a au moins quelque chose du père, et peut-être que par cet endroit il saura vous plaire. Vous ne verrez dans cet ouvrage qu'une critique générale des mœurs des hommes et une morale en action ; et vous n'y trouverez rien de ces romans, qui ont coutume de gâter le cœur et quelquefois l'esprit. Je souhaite que votre imagination soit agréablement amusée par les idées allégoriques que je lui offre, et qu'elles puissent servir à vous rappeler des vérités communes, mais solides, qui, exposées simplement et sans aucune enveloppe, vous paraîtraient insipides et ennuyeuses. Quoique cet ouvrage soit un peu satirique, vous n'y verrez personne offensé. C'est ce que l'auteur paraît avoir eu principalement en vue, il ne s'est pas même permis la critique littéraire, qui est néanmoins si permise, et si autorisée par l'exemple des plus grands écrivains. Comme votre modestie n'a pont souffert que je misse votre illustre nom à la tête de ce livret, ce serait vous donner des louanges perdues, que de suivre l'usage ordinaire, et de vous rendre la seule confidente des sentiments d'estime et d'admiration que votre mérite m'a inspiré. Je ne puis néanmoins m'empêcher de vous dire, Madame, que votre beauté et votre esprit, l'un et l'autre si connus dans le monde, sont à peu près du même caractère. qu'ils ont dans un degré égal, de la régularité, de l'éclat et de la finesse, et que la seule différence qu'on y remarque, est que l'un est beaucoup plus cultivé que l'autre, dont vous seule paraissez faire peu de cas. Souffrez la liberté que j'ai prise de profiter de cette occasion, pour publier les sentiments de respect et de vénération avec lesquels j'ai l'honneur d'être,
Madame,
Votre très humble et très obéissant serviteur, L.D.F.
______________________________________________________________
PRÉFACE DE L'ÉDITEUR.
Après le succès heureux des Voyages du premier Gulliver (*), c'est avec une véritable timidité qu'on ose publier cet ouvrage (†) ; et on ne se flatte point que le public prévenu avec justice contre les continuations des livres estimés, daigne faire grâce à celui-ci. Le monde se persuade aisément que tout continuateur est une espèce de copiste, qui marche servilement sur les traces d'un autre, qui ne fait que glaner après lui, et qui n'ayant point la force d'inventer, n'a que le faible talent de mettre à profit les idées de son original, pour les étendre, et y ajouter les siennes. Il est toujours soupçonné de vouloir faire réussir un nouvel ouvrage à la faveur d'un ancien : ignorant malheureusement, que plus le public a estimé un livre, moins il est disposé à en estimer un autre dans le même genre.
Cela supposé, on croit devoir dire ici, que quoique cet ouvrage soit intitulé, le nouveau Gulliver, il n'est point du tout la continuation du Gulliver, qui a paru il y a environ trois ans. Ce n'est ni le même voyager, ni le même genre d'aventure, ni le même goût d'allégorie. La seule conformité est dans le nom de Gulliver. L'un est le père, l'autre est le fils ; et on verra sans peine, qu'il eût été aisé de nommer tout autre nom au héros de cet ouvrage, et que si l'on a choisi ce nom préférablement à un autre, c'est parce qu'on a cru que le public familiarisé avec les idées philosophiques et hardies du premier Gulliver, serait moins surpris de celles du second, lorsqu'il les verrait en quelque sorte réunies sous un titre semblable ; car quoique les fictions fort différentes, elles ont néanmoins entr'elles une espèce d'analogie.
Dans le premier Gulliver, ce sont des Nains et des Géants prodigieux, des hommes immortels, une île aérienne, une république de chevaux raisonnables. Dans celui-ci, c'est un pays, où les femmes sont le sexe dominant ; un autre, où les hommes vieillissent de bonne heure, et dont la vie est très courte ; un autre, où ceux qui sont disgraciés de la Nature, paraissent bien faits, et plaisent de leurs semblables ; un autre enfin, où les hommes ont reçu du Ciel le don d'une longue vie, et celui de rajeunir, lorsqu'ils ont atteint le milieu de leur course. C'est par la singularité de ces suppositions que les deux ouvrages peuvent le ressembler en général ; mais ces suppositions en elles-mêmes sont très différentes, et les moralités qui en résultante, n'ont les unes aux autres aucun rapport particulier. Les aventures du fils n'ont rien de commun avec celles du père ; elles n'en dépendant en aucune sorte ; et elles n'en sont la suite (qu'on me permette cette comparaison) que comme les Avantures de Télémaque (‡) sont la suite de l'Odyssée (§). Tout le monde sait que ces deux poèmes (si l'on peut donner également ce nom à l'un et à l'autre) n'ont entre eux aucune dépendance, et n'ont ni la même forme, ni le même objet. Ce n'est qu'à cause de quelques légers rapports, et d'une conformité très superficielle, qu'on a qualifié l'ouvrage de M. de Fénelon, de suite de l'Odyssée d'Homère.
Comme toute fiction est méprisable, si elle n'est utile, et si elle ne sert à représenter la vérité, on se flatte que le lecteur découvrira aisément la morale cachée sous les images qu'on lui offre ici ; sans parler de celle qu'on a semée le plus qu'il a été possible dans les dialogues, lorsque l'occasion s'en est présentée : la première fiction, par exemple, fera voir que c'est une maxime bien condamnable, que celle qui est répandue parmi nous, et que la corruption du siècle autorise, par rapport à la pudeur. Nous nous figurons que c'est proprement la vertu des femmes seules, et sous ce prétexte les hommes ne croient se déshonorer, en la perdant, et en les pressant de la perdre. À la vue d'un pays où le contraire arrive, et où les femmes devenues le sexe dominant, sont ce que les hommes sont ici, et imitent leur corruption, nous ne pourrons nous empêcher de trouver ces mœurs très étranges, et de les condamner. Cependant dès que les femmes sont supposées supérieures aux hommes, on ne doit pas être fort étonné de ce renversement, qui fait connaître que les hommes parmi nous ne sont si corrompus sur cet article, que parce qu'ils abusent de leur supériorité. Mais faut-il que le sexe fort soit le plus faible en un sens, et qu'il veuille le prévaloir de sa force pour attaquer sans cesse, avec un mépris préparé pour celles dont il triomphera ? Cette moralité est connue de tout le monde ; il s'agissait de la mettre en action, ainsi que plusieurs autres qu'on verra ici.
Le pays, où les hommes vieillissant et mourant de bonne heure, vivent néanmoins en quelque sorte plus longtemps que nous, fournira par lui-même assez de réflexions, sans qu'il soit nécessaire de prévenir le lecteur sur le sens de cette allégorie, qui a rapport au vain usage que nous saisons de la vie.
Le séjour de Gulliver parmi des nations sauvages, et les entretiens qu'il a avec eux, n'ont rien d'aussi extraordinaire que le reste, et renferment une philosophie paradoxale, qui s'expliquera assez d'elle-même. On y verra la censure de toutes les nations policées dans la bouche d'un vertueux sauvage, qui ne connaît que la raison naturelle, et qui trouve que ce que nous appelons société civile, politesse, bienséance, n'est qu'un commerce vicieux, que notre corruption a imaginé, et que notre préjugé nous sait estimer.
La figure grotesque des peuples soumis à l'empereur Dossogroboskou, et la prévention qu'ils ont en leur faveur, nous fera connaître, que la beauté et la laideur, la bonne et la mauvaise grâce, sont des qualités purement arbitraires.
Enfin dans l'île des Letalispons, peuples qui rajeunissent à un certain âge et vivent fort longtemps, on aura à sentir le tort qu'ont la plupart des hommes, qui, faisant beaucoup de cas de la vie, prennent si peu de soin d'en prolonger le cours, et vivent comme s'ils se souciaient peu de vivre. Pour ce qui est de la philosophie singulière de ces peuples par rapport aux bêtes, et de leurs lois de santé, en profite qui voudra. Ce sont des opinions, qui peuvent avoir quelque fondement, mais qui ne courent aucun risque d'être suivies.
Il est inutile de parler des différentes îles qu'on suppose dans la Terre de Feu. On a jugé à propos d'en mettre la description dans la bouche d'un Hollandais, de peur que ces bizarres imaginations qui n'ont rien de vraisemblance, et qui sont purement allégoriques, n'eussent fait sortir notre voyageur de son caractère de sincérité, s'il eût raconté lui-même tout ce qui regarde ces îles.
La lettre du docteur Ferruginer, qu'on trouvera à fin du second volume, contribuera à donner un air de vraisemblance à toutes les choses qui auront paru extraordinaires dans l'ouvrage, et qu'on y raconte cependant comme véritables. Le profond savoir de ce docteur, qui fouille dans les livres anciens et modernes, pour en tirer de quoi appuyer sérieusement les idées badinées qui composent ce livre, sera peut-être un contraste assez agréable. Après tout ses savantes citations rendent un assez bon office à Jean Gulliver, ou à celui qui parle sous son nom. Car la vraisemblance est ce qu'on doit avoir principalement en vue, lorsqu'on entreprend d'envelopper la vérité sous des images.
C'est en quoi l'on admire le génie de M. Swift, qui dans le premier Gulliver, a eu l'art de rendre en quelque forte vraisemblances des choses évidemment impossibles, en séduisant le jugement de son lecteur, par un arrangement de faits finement circonstanciés et suivis. Comme les fictions de cet ouvrage sont moins singulières et moins hardies, il en a dû coûter moins d'efforts, pour venir à bout d'imposer.
On se borne à souhaiter que ce petit ouvrage ait une partie du succès qu'a eu en France la traduction de celui de M. Swift. Je n'ignore pas que le public a été fort partagé sur ce livre, que les uns ont mis au rang des meilleurs ouvrages qui eussent paru depuis longtemps, et que les autres ont regardé comme un recueil de fictions puériles et insipides. C'est que ceux-ci ne se sont attachés qu'aux simples faits, sans en considérer l'esprit et l'allégorie, qui est pourtant si facile à concevoir dans presque tous les endroits. Ils se sont plaints de n'y avoir point été intéressés par des intrigues et par des situations : ils voulaient un roman selon les règles, et ils n'ont trouvé qu'une suite des voyages allégoriques, sans aucune aventure amoureuse.
On a eu quelque espèce d'égard à leur goût dans celui-ci. Cependant on ne s'y est livré que médiocrement, de peur de sortir du genre. Voilà les réflexions que j'ai cru pouvoir placer à la tête de ce livre, conformément aux intentions de son auteur et de son traducteur. Ce dernier, qui m'a fait l'honneur de me charger de la publication de son ouvrage, m'a laissé entrevoir, qu'il pourrait bien être lui-même l'auteur. C'est néanmoins ce que je n'ose assurer positivement.
* Jonathan Swift (1667-1745), Travels into Several Remote Nations of the World, Londres, Motte, 1726 ; révisé et réimprimé comme Gulliver's Travels, Londres, Faulkner, 1735. — Jonathan Swift, Voyages de Gulliver, Paris, Guérin, tomes I et tome II, 1727 ; préface et traduction de l'abbé Desfontaines.
† Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745), Le Nouveau Gulliver ou Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver, Paris, Clouzier et Le Breton, tome I et tome II, 1730.
‡ François de Salignac de La Mothe Fénelon (1651-1715), Les Avantures de Télémaque, fils d'Ulysse, Paris, Delaulne, 1717.
§ L'Odyssée, poème épique attribué à Homère.
______________________________________________________________
CONTINUATION DU TRADUCTEUR.
Depuis 1720, que mon ami M. Jean Gulliver est de retour en Angleterre, j'ai entretenu avec lui un commerce de lettres assez régulier. À peine y fut-il arrivé, qu'il me manda qu'il avait trouvé son père, sa mère et toute sa famille en plaine santé, que son père écrivait actuellement la relation de ses voyages, et se disposait à la donner au public ; que lorsqu'elle serait prête à paraître, il me priait en attendant, de ne communiquer à personne la traduction que j'avais faite de la sienne, jusqu'à ce que celle de son père eût paru. Quelque temps après il m'écrivit qu'il avait eu la joie de retrouver son cher ami Harington, qu'il était prêt d'épouser une de ses filles.
Sur la fin de l'année 1726, il eut la bonté de m'envoyer les deux volumes imprimés des Voyages du capitaine Lemuel Gulliver, avant qu'aucun exemplaire n'en eût encore paru en Angleterre ; et il m'engagea à les traduire, ce qui je fis. Tout le monde sait quel fut le succès de cet ouvrage imprimé à Paris en 1727, et combien toute la France, à l'exemple de l'Angleterre, en goûta le hardi badinage. Je souhaite que l'ouvrage que je publie aujourd'hui réussisse également en français. L'original anglais doit paraître à Londres le même jour que cette traduction paraît à Paris. On ne manquera pas sans doute de comparer l'ouvrage du fils avec celui du père. Si l'on y trouve dans celui-ci moins de feu, moins de génie, moins de délicatesse que dans l'autre, on y trouvera peut-être en récompense des images un peu plus riantes, et une morale aussi utile, amenée par des récits moins extraordinaires.
L'auteur m'ayant fait la grâce de m'envoyer depuis peu une lettre d'un de ses amis, au sujet de son ouvrage, j'ai jugé à propos de la traduire et de la donner au public. Je n'ai jamais rien négligé de tout ce que peut faire honneur à mes amis.
______________________________________________________________
LETTRE DU DOCTEUR FERRUGINER À L'AUTEUR.
Je vous rends mille grâces, Monsieur, d'avoir bien voulu communiquer le manuscrit de votre relation, qui contient des faits que je crois aussi certains que curieux. Je ne suis point du nombre de ces esprits défiants et incrédule, qui traitent de supposition tout ce qui n'est pas conforme à leurs mœurs et à leurs préjugés. S'ils n'avaient jamais vu de Nègres, j'imagine que le rapport de ceux qui ont été sur les côtes de Sénégal et de Guinée les convaincrait à peine qu'il y en a. En vérité je ne connais point de marque plus sûre d'un esprit faible que l'incrédulité.
L'Histoire sacrée et profane nous apprend, qu'il a eu autrefois des géants et les relations de quelques voyageurs nous assurent qu'il y en a encore dans les Terres australes. Cependant presque personne n'a voulu aujourd'hui ajouter foi à ce que M. votre père a publié des géants de Brobdingnag, non plus qu'à ce qu'il a rapporté des petits hommes de Lilliput. Peut-on dire néanmoins que les combats d'Hercule avec les Pygmées soient fabuleux ; que Paul-Jove s'est trompé, lorsqu'il a assuré qu'il y en avait au nord de Laponie Moscovite et de la Tartarie Orientale ; que les Samojedes, peuples sujets du Czar, ne sont point tels qu'on nous les dépeint ; qu'enfin les Sauvages américains en imposent aux Européens, lorsqu'ils assurent qu'il y a de très petits hommes au nord de leur continent ? J'ai lu depuis peu dans une relation fidèle de l'Amérique, qu'une fille de la nation des Esquimaux fut prise et amenée en 1717 à la côte de Labrador ; qu'elle y resta trois ans, et qu'elle assura qu'il y avait au nord de son pays des nations entières, dont les hommes avaient à peine trois pieds et dont les femmes étaient beaucoup plus petites.
Il faut avouer, Monsieur, que les savants qui ont eu l'avantage de lire Ctesias, Herodore, Pline, Solin, Pomponius Mela, Orose, Manethon, sont bien plus disposez à croire les choses extraordinaires qu'on rapporte des pays éloignés, que la plupart des autres hommes, que l'ignorance et le préjugé rendent soupçonneux et difficiles. Quand on a lu, par exemples, dans ces auteurs respectables (1), qu'il y a des nations de Cynocéphales, c'est-à-dire, d'hommes à tête de chien ; d'Acéphales, ou d'hommes sans tête ; d'Enotocetes, comme les appelle Straborn, c'est-à-dire, d'hommes qui ont les oreilles si longues et si larges, qu'ils peuvent s'en envelopper (quelques auteurs les appellent Famesiens, d'autres Satmales) ; d'Arimaspes, qui n'ont qu'un œil ; de Monosceles ou de Sciopodes, qui n'ont qu'une jambe et un pied. Lorsqu'on lit dans ces mêmes auteurs, qu'il y a des pays, où les femmes n'accouchent jamais qu'une seule fois ; d'autres, où les enfants naissent tous avec des cheveux blancs ; qu'il y a des peuples qui n'ont point de nez ; d'autres qui n'ont ni bouche ni fondement, et par conséquent ne mangent point, mais se nourrissent d'une façon particulière. Quand on sait tout cela, on n'est plus étonné de rien, et on croit tout aisément. C'est pourquoi Pline (2) dit fort judicieusement, qu'avant que l'expérience nous eut appris que plusieurs choses étaient possibles, on les croyait impossible.
Mais quand même on serait assez téméraire, pour douter de ce que des auteurs si éclairés nous ont transmis, pourrait-on se défendre d'ajouter foi aux relations modernes des îles occidentales, qui confirment les témoignages de ces auteurs anciens ? Elles nous apprennent qu'il y a encore des hommes, dont les oreilles monstrueuses leur pendent jusqu'au-dessous des épaules, et qui prennent plaisir à les allonger à leurs enfants par des poids qu'ils y attachent : Qu'il y a des pays (3) où les hommes ont des mamelles, qui leur tombent jusqu'aux cuisses, en sorte qu'ils les lient autour de leur corps, quand ils veulent courir : Qu'il y a dans la Guyane des hommes qui n'ont point de tête ; qu'il y en a dans d'autres pays, les uns qui ne mangent point, les autres qui n'ont qu'une jambe et un pied très larges ; d'autres qui sont d'une hauteur et d'une grosseur incroyables, tel que le roi de Juda, qui ayant depuis peu chargé les Français qui commercent sur cette côte, de lui faire faire un habit en France, ne put jamais mettre celui qu'on lui apporta, quoiqu'on en eût pris la mesure sur un muid.
Venons maintenant aux faits curieux contenus dans votre relation. À l'égard des mœurs des usages de votre île de Babilary, il n'y a personne qui ne sache, qu'il y a eu en différentes parties du monde des pays, où les femmes avaient un courage viril, et où les hommes au contraire étaient lâches et efféminés. Les relations de l'Amérique nous représentent parmi les Illinois et les Sioux, dans le Jucaran, à la Floride, à la Louisiane, des hommes qui étaient autrefois habillés en femmes pendant toute leur vie, et vivaient comme elles : semblable à ces prêtres de Cybèle ou de Venus Uranie, dont parle Julius Firmicus (4), qui portaient toujours des habits de femme, qui avaient un soin particulier de leur beauté et de leur parure, qui se fardaient et s'efforçaient par toute forte de moyens de conserver la délicatesse de leurs traits, et la fraîcheur de leur teint. Heureux de n'avoir pas eu le sort de quelques-uns de ces hommes efféminés de l'Amérique dont je viens de parler, qui furent dévorés par les dogues, que les Espagnols lâchèrent sur eux (5).
On sait aussi la coutume de quelques anciens peuples, chez qui les maris se mettaient au lit, lorsque leurs femmes avaient accouché. En cet état ils recevaient les compliments de leurs voisins, et se faisaient servir par leurs femmes mêmes qui venaient d'accoucher. Cet usage était parmi les Ibérians, anciens peuples d'Espagne ; chez les habitants de l'île de Corse ; chez les Tibareniens en Asie ; il se conserve encore, dit-on, dans quelques provinces de France voisines de l'Espagne, où cette ridicule cérémonie s'appelait faire la couvade. Les Japonais, les Caraïbes, les Galibis, la pratiquent aussi. Tour cela fait connaître, qu'il n'est point étrange de voir des hommes contrefaire les femmes, et renverser des lois qui nous semblent naturelles.
Pourquoi donc serais-je surpris de voir dans votre relation touchant l'île de Babilary, des hommes entièrement féminisés, surtout lorsque vous nous apprenez l'origine de cet usage introduit autrefois dans cette île, par l'ignorance, l'oisiveté, et la mollesse où les hommes s'étaient plongés ? Je suis encore moins étonné de voir les femmes y dominer, faire le métier des hommes, et porter les armes : comme ces Ménades ou Bacchantes, qui suivirent autrefois Bacchus à la guerre, c'est-à-dire, Denis roi de Lybie, ou comme ces anciennes guerrières, qui s'établirent d'abord sur les bords du Tanaïs, et qui dans la suite étendirent leur empire, depuis le fleuve Caïque jusqu'aux extrémités de la Lybe. Par combien d'exploits ces illustres Amazones ne se signalèrent-elles pas ? Quelles héroïnes, que Ponthesilée et Talestris ! Quels combats ne soutinrent-elles pas contre Hercule, contre Thesée, contre Achille, et enfin dans les derniers temps contre Pompée, dans la guerre de Mithridate, où elles furent presque toutes détruites. Aujourd'hui encore, selon toutes les relations on trouve de ces femmes guerrières en Amérique, sur les bords du fleuve Maragnon, ou des Amazones ; et si l'on en croit un auteur italien, missionnaire de la Colchide, il y a encore des Amazones sur le mont Caucase.
La révolte des femmes de Babilary contre tous les hommes de cette île, ne ressemble-t-elle pas un peu à la conspiration d'Hypsipes et des femmes de Lemnos, qui, selon, les anciens historiens, coupèrent dans une nuit la gorge à tous leurs maris ? N'est-ce pas en quelque sorte avoir autant fait, que d'avoir eu, comme les Babilariennes, le courage et l'adresse de faire perdre aux hommes de leur pays la supériorité qu'ils avaient depuis longtemps sur elles ?
Cependant comme le sexe masculin est naturellement le plus fort, cette usurpation du sexe féminin aurait de quoi surprendre, si l'Histoire n'en fournissait pas plusieurs exemples :
"Les Lyciens, dit Hérodote (6), suivent en partie les lois des Crétois, et en partie celles des Cariens. Mais ils ont cela de particulier et qui ne s'observe point ailleurs, que c'est de leurs mères qu'ils prennent leurs noms, et que si quelqu'un demande à un autre de quelle famille il est, il cherche sa noblesse dans la maison de sa mère, et en tire sa généalogie. Si une femme noble épouse un roturier, les enfants qui en naissent, sont nobles : et si un homme noble et distingué entre eux épouse une étrangère, ou une femme qui ait été concubine, les enfants qui naissent de ce mariage, ne sont point nobles."
"Les Lyciens, dit Héraclite du Pont (7), n'ont point de lois écrites, mais seulement des usages établis parmi eux. Les femmes y sont maîtresses depuis leur première origine."
"Les Lyciens, dit Nicolas de Damas (8), sont plus d'honneur aux femmes qu'aux hommes. Ce sont les mères qui donnent le nom aux enfants, et les filles y sont héritières des biens, et non les garçons."
Cette Gynécocratie (ou empire des femmes) n'était seuls Lyciens. Les Scythes et les Sarmates étaient soumis aux femmes ; et dans toutes les contrées où les Amazones avaient étendu leurs conquêtes, elles avaient inspiré aux femmes le goût de maîtriser les hommes de leur pays. Isis, selon Diodore de Sicile, avait établi cet usage parmi les Égyptiens. Isis, dit-il, s'était acquis tant de gloire parmi eux, que les reines y étaient plus honorées et avaient plus d'autorité que les rois. On donnait dans les accords de mariage tout pouvoir aux femmes sur leurs maris, qui étaient obligés de faire serment qu'ils obéiraient en tout à leurs épouses.
Chez les Mèdes et les Sabéens, les femmes commandaient aussi hommes, et leurs reines les conduisaient à la guerre : ce que Claudien (9) a exprimé ainsi : Medis levibusque Sabaeis Imperat hic sexus, reginarumque sub armis Barbariae pars magna jacet.
Les enfants des Garamantes, peuple d'Afrique, étaient extrêmement attachés à leurs mères, et fort peu à leur père, qu'ils respectaient médiocrement, et qu'ils semblaient à peine reconnaître pour tels. On aurait dit, que les enfants étaient en commun, et appartenaient à tous les hommes de la nation en général : parce que les enfants ne pouvaient, selon leur idée, discerner leur véritable père, ou du moins s'en assurer positivement.
Chez tous les peuples d'Espagne, et en particulier chez les Cantabres, dit Strabon, le mari apportait une dot à sa femme ; les filles héritaient au préjudice des garçons, et étaient chargées du soin de marier leurs frères. On prétend qu'aujourd'hui encore les Basques, descendu des ces anciens Cantabres, ont retenu quelque chose de cet usage de leurs ancêtres, par rapport aux mariages et aux successions.
Plutarque (10) rapporte qu'une dame étrangère, logeant chez Leonidas à Lacedemone, dit un jour à sa femme, nommée Gorgo, comme une chose qui faisait honte à sagesse des Lacedemoniens, qu'il n'y avait que les seules femmes de Sparte, qui eussent un pouvoir absolu sur leurs maris (en quoi elle se trompait) et que Gorgo lui répliqua fièrement, qu'il n'y avait aussi que les femmes de Sparte, qui méritassent d'avoir cette supériorité, parce qu'elle seules mettaient au monde des hommes.
Je sais que toutes ces Gynécocraties étaient de différente espèce, et que les femmes exerçaient diversement leur supériorité chez tous les peuples dont je viens de parler. Mais il en résulte toujours, que ce n'est point une chose nouvelle et si contraire à la raison, de voir les hommes sous l'empire des femmes, et celles-ci maîtresses absolues du gouvernement.
Personne n'ignore aussi que chez presque tous les peuples nègres de l'Afrique, dans tout le Malabar, dans plusieurs pays des Indes orientales, et surtout dans l'Amérique, l'usage a établi dans la ligne collatérale maternelle la succession au trône, préférablement à la ligne directe, en sorte que les enfants sont toujours exclus de la succession de leurs pères. Pour conserver plus sûrement la couronne dans la famille royale (dit M. Owington au sujet du pays de Malemba) on a coutume de choisir pour succéder au prince le fils de sa sœur. Cette sœur du roi cherche pour cette raison à avoir des enfants le plus qu'elle peut, et quiconque s'offre à lui en faire est bien reçu de Malabar, lorsque le roi se marie, un brahmine, c'est-à-dire, un prêtre, couche la première nuit avec la reine, afin de faire voir à la nation que le fils dont elle accouchera ne sera point du sang royal, ce qui est cause que., pour succéder au roi, on prend ses enfants, mais ceux de sa sœur.
Conformément à cet usage, Nicolas de Damas dit que les Éthiopiens rendaient tout l'honneur à leurs sœurs, que les rois choisissaient, non leurs propres enfants, mais les enfants de leurs sœurs, pour les succéder ; et qu'en cas qu'elles fussent stériles, ou que leurs enfants mourussent, on choisissait alors dans la nation celui qui paraissait le plus accompli, le mieux fait, le plus belliqueux.
Je trouve, il est vrai, dans les usages que vous rapportez de l'île de Babilary, la Gynécocratie portée jusqu'à son dernier point. Les hommes y sont soumis aux femmes, jusqu'à en être quelque sorte les esclaves. On a bien vu des femmes gouverner [...] et conduire des armées d'hommes : on a vu aussi des armées de femmes, telles que les Amazones. Mais ce qui me surprend dans votre île, est d'y voir les femmes revêtues de toutes les charges de l'État, et tous les emplois de la magistrature et de la finance. Après tout ce n'est qu'une suite naturelle de la Gynécocratie, et quand on sait que des femmes ont gouverné des royaumes et ont livré des batailles, peut-on être étonné de les voir ministres État et magistrats, auteurs, et académiciennes.
Ce qu'il y a encore de différent entre l'état gynécocratique de Babilary, et celle qui a été autrefois chez les peuples dont j'ai parlé, est que parmi eux les hommes n'étaient ni lâches ni efféminés. Il semble même que l'empire des femmes contribuait à les rendre plus braves. Les Scythes, les Garamantes, les Spartiates, quoique soumis aux femmes, ont toujours passé pour des peuples très belliqueux. C'est que les femmes ne se mêlaient pas de la guerre, et que les hommes. malgré la supériorité des femmes, étaient néanmoins les guerriers de la nation. Mais je suis persuadé que dès que les femmes seules sont la guerre, les hommes doivent nécessairement devenir mous et timides. Aussi ne voit-on point que dans les pays, où les Amazones ont dominé, les hommes y aient fait aucun exploit de guerre.
Après tout, le courage viril des femmes s'accorde très bien avec l'esprit efféminé des hommes ; lorsque les actions sont d'un côté, il est naturel que l'oisiveté soit de l'autre. Les femmes parmi nous sont timides, faibles, paresseuses, parce que les hommes ont pris pour leur partage, la hardiesse, la force, l'activité.
J'ai lu dans une relation de Siam, que la langue de ce pays-là a la même perfection que vous attribuez à la langue babilarienne, qui à l'exemple de la langue anglaise, n'admet point la distinction ridicule des genres masculins et féminins, dans les noms qui expriment des choses inanimées ; ils n'ont pas même de genres pour l'expression des deux sexes. Lors même que, par exemple, les Siamois veulent attribuer à la femme une qualité, qui, prise toute seule, s'entend de l'homme, ils se contentent d'y joindre l'adjectif jeune. Par exemple, pour dire l'impératrice, ils disent, le jeune empereur. Pour exprimer la femme d'un ministre, ils disent, le jeune ministre, et ainsi des autres. Ce qui, comme on voit, est assez flatteur pour les femmes, qu'on appelle toujours jeunes, quelque âge qu'elles aient.
Venons maintenant à l'Oligochronisme, où à la vie courte des habitants de votre île de Tilibet. J'avoue que cela est plus singulier, que tout ce que j'ai lu jusqu'ici dans les anciens et dans les modernes. Il me semble cependant que cela est analogue à ce qu'on rapporte des habitants de la presqu'île occidentale de l'Inde, qui sont formés, dit-on, beaucoup plutôt que nous le sommes, et qui par conséquent finissent aussi plutôt que nous. On se marie parmi eux dès l'âge de cinq à six ans, et à cet âge les filles deviennent femmes.
Je trouve que les habitants de cette île raisonnent, non seulement d'une manière convenable à la durée de leur vie, mais encore conformément à l'idée que les anciens philosophes avaient de la durée de la nôtre. On sait que Caton d'Utique répondit à ceux qui voulaient l'empêcher de se tuer, qu'il n'était plus dans un âge, où l'on put lui reprocher d'abandonner trop tôt la vie. Cependant il n'avait alors que quarante-huit ans ; mais il regardait cet âge, comme un âge assez avancé, auquel la plus grande partie des hommes n'arrivait point. On dit souvent que le cours ordinaire et naturel de la vie est soixante-dix, soixante-quinze et quatre-vingts ans. Cependant comme il est bien plus rare de parvenir à cet âge, que de mourir à vingt et à trente ans, il me semble que notre idée devrait plutôt borner là le cours ordinaire de la vie humaine, qui de cette sorte est bien plus naturelle que le cours d'une vie dont la longueur est si peu commune. Ne peut-on pas conclure de-là que nous commençons à vivre trop tard, c'est-à-dire, que nous n'entrons point dans le monde assez tôt, et qu'on diffère trop de nous confier le maniement de nos biens et les emplois de la République ? Si on voulait changer la forme ordinaire de l'éducation des enfants, et les accoutumer de bonne heure au commerce du monde, au manège de la politique, aux affaires et aux soins domestiques, sans leur faire perdre les premières années de leur vie dans des études stériles, les hommes, dont la vie est si courte, pourraient alors jouir d'une vie un peu plus longue.
Selon les anciennes lois romaines, on ne pouvait posséder de magistrature qu'à trente-cinq ans. Auguste jugea à propos de retrancher cinq années, et déclara qu'il suffirait à l'avenir d'avoir trente ans. N'aurait-il pas bien fait d'en retrancher encore dix ? En vérité nous sommes à vingt ans à peu près ce que nous serons tout le reste de notre vie. Après cet âge l'esprit ne se développe plus : seulement l'expérience s'accroît et les passions s'affaiblissent ; et il est faux que dans la suite l'âme se déploie, l'esprit s'augmente, et le jugement se fortifie. Recueillez toutes les belles action des héros anciens et modernes, vous verrez que la plus grande partie de ces actions mémorables ont été faites par de jeunes gens, qui n'étaient pas encore parvenus à leur trentième année. Alexandre, Annibal, Scipion, le prince de Condé, se sont immortalités avant cet âge. Les plus célèbres ouvrages d'esprit ont été enfantés par de jeunes écrivains. Plus on vit, l'émulation, le courage, la vigueur, la fermeté, les grâces, et l'enjouement diminuent. Enfin je trouve que l'habitant de Tilibet fait un calcul très juste, lorsque'après avoir disputé le temps que nous perdrons dans l'enfance, celui que nous emporte une longue éducation, celui qui nous échappe pendant le sommeil, et celui qui est tristement rempli par les maladies, le chagrin, l'ennui, et enfin la vieillesse, il conclut que ceux qui parmi parviennent jusqu'à l'âge le plus avancé, n'ont pas vécu vingt années complètes.
Le mépris que les Tilibetains sont du sommeil, me rappelle un beau passage de Plutarque, qui compare agréablement le sommeil à un Maltôtier. "De même, dit-il, que ces gens-là dérobent toujours la moitié de ce qui passe par leurs mains ; aussi le sommeil nous dérobe la moitié de notre vie." Ce passage, Monsieur, prouve deux choses : la première, que du temps de Plutarque on dormait comme aujourd'hui : la seconde, que les Maltôtiers avaient alors la même réputation qu'ils ont à présent.
À l'égard de ces différentes îles de la Terre de Feu, dont vous rapportez qu'un Hollandais vous fit la description, permettez-moi de vous dire, que, quoiqu'à la rigueur cela puisse être vrai, cette description paraît néanmoins un peu dans le goût de l'Histoire véritable de Lucien, c'est-à-dire, fabuleuse et allégorique. Au reste, comme vous n'en garantissez point la vérité, je vous sais bon gré d'en avoir orné votre ouvrage, que cette fiction ne discréditéé point.
Mais ce qui loin de me paraître fabuleux, me paraît conforme à la raison et à l'expérience, est la Palinneasie ou le rajeunissement des Letalispons. Cette heureuse île méritait dans doute d'être consacrée aux deux filles d'Esculape, Hygie et Panacée. Je ne suis nullement étonné de la longue vie de ces insulaires, lorsque je me rappelle l'exemple de ces anciens Anachorètes, qui ne se nourrissant que de racines, d'herbes, et de dates, ont vécu un siècle entier, comme saint Jérôme le rapporte de saint Paul l'Ermite et de saint Antoine. C'est aussi de cette dernière qu'a vécu le noble Vénitien Louis Cornaro, qui fut toujours sain et robuste, jusqu'à l'âge de quatre-vingt-seize ans, qu'il mit au jour son livre, Des Avantages de la vie sobre (11), sur lequel j'ai formé le dessein de publier un jour des commentaires, dont chacun pourra faire usage, suivant son Idiosyncrasie, ou tempérament particulier. J'y ferai voir la vérité de ce que dit Celse (12) : Siquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adulescentiam reddit, et j'appliquerai au corps humain ce qui Virgile dit de la renommée : Mobilitate viget, viresque acquirit eundo (13).
Je ne manquerai pas de citer aussi ces lois de santé qu'observent les Letalispons, et que je préfère aux lois des douze tables (14).
Si quelqu'un regardait comme chimérique, ce que vous rapportez du rajeunissement régulier de ces insulaires, je le renverrais à la savante dissertation de M. Begon, médecin au Puy-en-Velay, imprimée en 1708. L'auteur y cite l'exemple de plusieurs personnes qui ont réellement rajeuni, et surtout celui d'une marquise, qui reprit ses règles dans sa centième année, après cinquante ans de suppression, lesquelles lui revenaient encore dans sa cent quatrième année (lorsqu'il écrivait ce fait) de même que dans la fleur de sa jeunesse. Tout le monde sait que le célèbre Guillaume Postel, à l'âge de cent vingt ans recouvra l'usage de sa raison affaiblie, que ses rides s'effacèrent, et que ses cheveux blancs devinrent noirs ; en un mot qu'il rajeunit, et que ses amis ne l'auraient point reconnu, s'ils n'eussent été eux-mêmes les témoins de cette admirable transformation. Or ce qui est arrivé à quelques-uns parmi nous, ne peut-il pas arriver à un peuple entier ?
Au reste je suis charmé, Monsieur, de l'exactitude géographique qui règne dans votre ouvrage. Elle ajoutera sans doute de nouvelles beautés, aux yeux de ceux qui sont instruits de la situation des différentes parties de la Terre, et cette attention scrupuleuse au vrai vous fera honneur. Je suis avec l'attachement le plus parfait et le plus tendre, etc.
[Notes de bas de page]
1. Voir : Caius Plinius Secundus, dit Pline l'Ancien (23-79), Naturalis Historia, l. VII, cap. 3 ; Gaius Julius Solinus, dit Solini, De mirabilibus mundi, cap. 44 ; Pomponius Mela (fl. 40), De Chorographia, l. I ; Pseudo-Augustinus, Sermones Ad fratres in eremo, 37 [cf., Jacques-Paul Migne (1800-1875), Patrologia Latina, t. 40].
2. Pline l'Ancien (23-79), ibid., l. VII, cap. 1.
3. Johannis de Laet (1582-1649), Novis orbis seu descriptiones Indiæ Occidentalis, Antwerp, 1633, lib. 17, cap. 7 [cf., Jean de Laet L'Histoire du Nouveau Monde ou Description des Indes occidentales..., Leyde, Bonaventure et Elseviers, 1640] ; Walter Raleigh (1552-1618), The Discovery Of Guiana, London, 1595.
4. Julius Firmicus Maternus Siculus, De Nativitatibus sive Matheseos, c. 337 ; Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum, c. 337-350.
5. Francisco Lopez de Gomara (1511-1564), Hispania Victrix. Primera y secunda parte de la historia general de las Indias..., Madrid, 1553.
6. Hérodote d'Halicarnasse (v. 480-429 av. J.-C.), Historiæ, l. I.
7. Herakleides Pontikos, dit Héraclite du Pont (entre 388-315 av. J.-C.), l. II.
8. Nicolas de Damas [historien, poète et philosophe grec, 1er siècle avant J.-C.], AYKIOI.
9. Claudius Claudianus, dit Claudien (v. 365-404), Invecta in Eutropium, l. I, v.¹ [¹ Medis levibusque Sabaeis Imperat hic sexus, reginarumque sub armis Barbariae pars magna jacet. — Ce sexe règne sur les Mèdes et les Sabéens légèrement armés ; et une grande partie des barbares est soumise aux armes des reines.]
10. Mestrius Plutarchus, dit Plutarque (v. 46-125), Moralia, In Lacon. Apotheg.
11. [Luigi Cornaro (1475-1566), Discorsi della vita sobria, Padova, 1558.]
12. Aulus Cornelius Celsus, dit Celse (25 av. J.-C. - 50 ap. J.-C.), Alethés Lógos, l. I, cap. 2 [ou bien De arte medica, l. I : Siquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adulescentiam reddit — Bien que l'inaction faiblisse le corps, du travail le fortifie ; la première provoque la vieillesse précoce, le dernier prolonge la jeunesse.]
13. [Publius Vergilius Maro, dit Virgile (v. 70-19 av. J.-C.), Énéide, l. IV, v. 175 : Fama, malum qua non aliud velocius ullum : Mobilitate viget viresque adquirit eundo — La renommée, de tous les maux le plus véloce : la mobilité accroît sa vigueur et la marche lui donne des forces.]
14. [Les «Lois des Douze Tables», rédigées en 451 av. J.-C, constitue le premier corpus de lois romaines écrites.]
______________________________________________________________
APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.
J'ai lu par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux un manuscrit, qui a pour titre : Le Nouveau Gulliver, ou Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver ; et j'ai trouvé dans cet ouvrage une imagination vive et agréable, des réflexions ingénues, et des traits de morale, qui peuvent même en rendre la lecture utile. Fait à Paris ce 13 septembre 1729.
DANCHET.
PRIVILÈGE DU ROI.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, et autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien-aimé FRANÇOIS LE BRETON père, libraire à Paris ; Nous a fait remontrer qu'il lui aurait été mis en main un ouvrage, qui a pour titre : Le Nouveau Gulliver, ou Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver, traduit de l'anglais ; qu'il souhaiterait faire imprimer et donner au public, s'il Nous plaisait lui accorder nos lettres de privilège sur ce nécessaires ; offrant pour cet effet de la faire imprimer en bon papier et beaux caractères, suivant la feuille imprimée et attachée pour modèle sous le contre sceau des présentes. À ces causes voulant traiter favorablement ledit exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces présentes de faire imprimer ledit livre ci-dessus spécifié en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, et autant de fois que bon lui semblera, sur papier et caractères conformes à ladite feuille imprimée et attachée pour modèle sous notre dit contre sceau ; et de le vendre, faire vendre et débiter par notre royaume pendant le temps de six années consécutives, à compter su jour de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi à tous imprimeurs, libraires et autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit livre ci-dessus exposé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse et par écrit dudit exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de quinze cents livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit exposant, et de tous dépens, dommages et intérêts. À la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression de ce livre sera faite dans notre royaume et non ailleurs, et que l'impétrant se conformera en tour au Règlements de la Libraire, et notamment à celui du 10 avril 1725 ; et qu'avant de l'exposé en vente, le manuscrit où imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit livre, sera remis dans la même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin ; et qu'il en sera ensuite remise deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notre dit très cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin ; le tout à peine de nullité des présentes. Su contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir l'exposant ou ses ayant cause pleinement et paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des dites présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit livre, soit tenue pour dûment signifiée, et qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés et féaux Conseillers et Secrétaires, soi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis et nécessaire, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, et Lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le seizième jour du mois de septembre, l'an de grâce mil sept cent vingt-neuf, et de notre règne le quinzième. Par le Roi en son Conseil.
SANSON.
Registré ensemble les deux cessions de l'autre part sur le Registre VII de la Chambre Royale des Libraires et Imprimeurs de Paris N. 451, fol. 398, conformément aux anciens règlements confirmés par celui du 28 février 1723. Fait à Paris le 10 octobre 1729.
Signé, P. A. LE MERCIER, Syndic.
Et le Sr. le Breton a cédé et transporté à Madame la veuve Clouzier le privilège ci-dessus, pour en jouir en son lieu et place, suivant l'accord fait entre eux. À Paris ce 19 septembre 1729.
LE BRETON.
Et ladite veuve Clouzier a cédé aux demoiselles le Breton la moitié de part au présent privilège, suivant l'accord fait entre elles. À Paris ce 19 septembre 1729.
La veuve CLOUZIER.
______________________________________________________________
TABLE DES CHAPITRES.
PREMIÈRE PARTIE : |
CHAPITRE 1. — Éducation de l'Auteur. — Son inclination naturelle pour les voyages. — Son application à l'étude. — Son dégoût pour la philosophie de l'école. — Il balance entre la profession d'homme d'affaires et celle à homme de lettres. — Il s'embarque pour la Chine. |
DEUXIÈME PARTIE : |
CHAPITRE 1. — L'Auteur fait naufrage et se sauve dans un canot. — Il aborde à l'île de Tilibet, où il est fait esclave. — Description des mœurs de ces insulaires. — Leur vie courte, et l'usage qu'ils en font. |
TROISIÈME PARTIE : |
CHAPITRE 1. — L'Auteur avec tous les Portugais s'embarque sur vaisseau hollandais. — La jeune sauvagesse amoureuse de l'Auteur se précipite dans la mer. — Il retrouve Harrington, qui lui raconte ce qui lui est arrivé dans l'île des Bossus ; construction d'une forge et d'un navire l'empereur de l'île des Bossus vient voir le vaisseau construit par les Hollandais ; leur départ ; combat naval, où ils remportent la victoire. |
QUATRIÈME PARTIE : |
CHAPITRE 1. — L'Auteur est sur le point d'être dévoré par des ours dans l'île des Letalispons. — Comment il est reçu par ces insulaires. — Son séjour parmi eux. — Ses entretiens avec Taïfaco. |
PARTIE 1 : RELATION DU SÉJOUR DE JEAN GULLIVER À L'ÎLE DE BABILARY.
CHAPITRE 1. — Éducation de l'Auteur. — Son inclination naturelle pour les voyages. — Son application à l'étude. — Son dégoût pour la philosophie de l'école. — Il balance entre la profession d'homme d'affaires et celle d'homme de lettres. — Il s'embarque pour la Chine.
J'ai observé que les enfants ont ordinairement les mêmes inclinations que leurs pères, à moins que l'éducation qu'ils ont reçue, n'ait changé en eux cette disposition naturelle. Je sais néanmoins que les enfants ne ressemblent quelquefois qu'à leurs mères ; d'où il arrive, par exemple, que le fils d'un poète est sage, que le fils d'un philosophe est petit-maître ou dévot, et que le fils d'un voyageur est sédentaire.
Pour moi je puis dire que je ressemble beaucoup à mon père, non seulement par mes qualités extérieures, mais encore par le caractère de mon âme ; et sur ce fondement j'ose me flatter d'être vraiment le fils du célèbre capitaine Gulliver et de Mary Burton son épouse, dont la conduite a toujours passée pour irréprochable. Ayant été élevé dans la maison de mon père, où j'entendais parler continuellement de ses voyages et des admirables découvertes, qu'il avait faites dans les différentes mers qui'avait parcourues, je me suis senti dès ma première enfance un désir de voyager sur mer, que rien n'a pu ralentir. En vain me peignait-on quelquefois les dangers des tempêtes et des rencontres, et me représentait-on les périls affreux où mon père avait été exposé. La curiosité l'emportait sur la crainte, et je consentais de souffrir comme mon père, pourvu que je pusse voir comme lui des choses aussi merveilleuses.
Il me trouva dans ces dispositions au retour de son troisième voyage, qui était celui de Laputa ; et charmé de voir en moi des inclinations si conformes aux siennes, il me promit de m'emmener avec lui au premier voyage qu'il ferait. Apparemment qu'il comptait de ne partir pas sitôt : car n'ayant quatorze ans, j'étais trop jeune pour le pouvoir suivre alors. Aussi ne me tint-il pas sa promesse ; car peu de temps après s'étant embarqué à Portmouth le 2 août 1710, il ne dit adieu qu'à ma mère, et me laissa inconsolable de son départ précipité.
Jamais enfant n'a plus souhaité que moi de devenir grand et d'avancer en âge, non pour être à couvert des disgrâces de l'enfance, ou pour jouir d'une agréable liberté, mais seulement pour être en état de supporter les fatigues d'un voyage sur mer, et d'être reçu dans un vaisseau. J'allais au collège malgré moi ; que m'importe, disais-je quelquefois en moi-même, d'apprendre des langues, qui ne me seront jamais d'aucun usage ? Les Indiens, les Chinois, les peuples du Nouveau Monde seront-ils plus d'estime de moi, parce que je saurai le grec et le latin ? Que ne puis-je apprendre plutôt les langues de l'Asie, de l'Afrique, ou de l'Amérique ? Cela me serait sans doute plus utile. Malgré ces réflexions, qui me causaient quelquefois du dégoût, je ne laissai pas de faire mes études avec succès.
Celle qui me rebuta le plus, fut l'étude de la philosophie telle qu'on l'enseigne dans les universités. Le fameux professeur sous lequel j'étudiais, nous débitait gravement que la logique de l'École était absolument nécessaire pour toutes les sciences, qu'elle dirigeait l'esprit dans ses opérations, et lui donnait une justesse, à laquelle on ne pouvait atteindre sans elle. Il faisait même soutenir des thèses sur cet article. Cependant il raisonnait lui-même si mal en toute occasion, et toutes les opérations de son esprit grossier et matériel étaient si mal dirigées, qu'on peut dire qu'il argumentait sans cesse contre sa ridicule opinion.
La métaphysique me parut plus propre à rendre l'esprit sec et stérile, qu'à lui donner de la précision ; je n'en pouvais soutenir les extravagantes subtilités. La morale qui est faite pour le cœur, était mise en problèmes et en questions épineuses. À l'égard de la physique, on en apprend si peu dans l'École, que le fruit qu'on en retire ne vaut pas le temps qu'on y consacre. L'étude des livres de Descartes et de Newton et de quelques autres philosophes modernes, est selon moi le meilleur des cours de philosophie ; on ne s'y gâte point l'esprit par un barbare tissu de distinctions scolastiques. Aussi je puis dire, que le peu de philosophie que je sais, je l'ai puisé dans ces livres, et l'ai beaucoup augmenté par l'oubli de tout ce que le collège m'avait appris.
Je m'appliquai extrêmement pendant le cours de mes études à la géographie ; par-là, ne pouvant voyager en effet, je voyageais en idée. Je lisais avec avidité toutes les relations des pays étrangers, qui me tombaient entre les mains. Je faisais mille questions à ceux qui avaient parcouru les mers ; je m'entretenais souvent avec des matelots, et la vue d'un vaisseau et de tous ses agrès excitait en moi des mouvements indélibérés, semblables à ceux d'Achille à l'aspect d'une épée ou d'une lance.
Ma mère, qui se voyait chargée de plusieurs enfants avec un revenu médiocre, m'excitait à chercher avec empressement quelque petit emploi de finance. Elle me mettait devant les yeux l'exemple d'un grand nombre d'opulents et superbes financiers, dont la modestie prudente avec d'abord accepté les plus minces et les humiliantes commissions. Mais quelque chose qu'elle me put dire, elle ne pouvait persuader d'embrasser un état incertain et peu honoré, où la friponnerie n'est pas toujours heureuse, et où l'on court risque de passer une triste vie dans l'insupportable dépendance d'une foule de maîtres plus impérieux que respectables, dont l'inconstance procure souvent à ceux qu'ils emploient le sort du malheureux et famélique Erysichthon (*).
Si j'avais pu me résoudre à une vie sédentaire, j'aurais, ce me semble, préféré à toutes les autres professions celle d'homme de lettres. Vous avez d'heureuses dispositions pour les sciences, me disait un jour un aimable savant ; la Nature vous a donné de la mémoire, de l'intelligence, du génie, de la fécondité et du goût ; vous pouvez par le rare assemblage de ces qualités et par l'exercice de vos talents rendre de grands services à la République des Lettres, et faire honneur à votre nom et à votre patrie. Vous savez quelle considération on a dans ce royaume pour les personnes qui se distinguent dans les sciences. L'Angleterre devient de jour en jour le siège glorieux de l'Empire des Beaux-Arts et de toutes les connaissances curieuses. On ne voit point ici le philosophe profond, l'historien docte et judicieux, l'écrivain délicat et sensé, languir dans une triste indigence ; les places dues aux savants et aux beaux esprits ne sont remplies que par eux. Le mérite littéraire y est toujours reconnu et récompensé. Embrassez, mon cher Gulliver, un état tranquille et honorable, où sans acquérir la richesse immense d'un partisan, vous obtiendrez celle qui par sa médiocrité est plus digne d'un honnête homme.
C'est ainsi que j'étais pressé tour à tour d'embrasser la profession d'homme d'affaires ou celle d'homme de lettres. Quelle différence néanmoins entre ces deux états ! L'un brûle d'amasser des richesses, l'autre ne songe qu'à acquérir des connaissances ; l'un fait fortune, l'autre ne se fait qu'un nom ; l'un s'enrichit de la dépouille des vivants, l'autre de celle des morts ; l'un méprise également la science et les savants, l'autre méprise plus les riches que la richesse ; l'un jouit de la vie, l'autre vit après sa mort.
L'année 1714, ayant alors dix-huit ans, une taille assez avantageuse et un air robuste, je fis un paquet de toutes mes hardes ; et sans prendre congé ni de ma mère, ni d'aucun de mes parents, ayant recueilli un peu d'argent, qui me fut prêté par de bons amis, et m'étant munis de quelques livres, je me rendis à Bristol, où j'avais appris qu'un vaisseau prêt à mettre à la voile pour un voyage à la Chine manquait d'un second écrivain. Quoique je n'eusse ni expérience ni recommandation, je me flattai de pouvoir obtenir cette place ; et dans cette vue je vins offrir mes services au capitaine Harrington qui devait monter ce vaisseau. L'emploi n'était ni fort lucratif ni fort honorable ; mais comme il me procurait le moyen de voyager sur mer, il était devenu l'objet de tous mes désirs. D'ailleurs je n'ignorais pas, que plusieurs de nos plus célèbres marins et de nos plus riches négociants avaient commencé par des emplois bien moins honnêtes.
Je dis au capitaine que j'étais un jeune homme sans fortune, qui n'avait pour toute ressource qu'un peu d'éducation et beaucoup d'honneur ; qu'ayant fait toutes mes études avec assez de succès, j'avais quelque intelligence ; que je me sentais une forte inclination pour les voyages de mer ; qu'enfin je me croyais capable de l'emploi que je le priais de m'accorder. Le capitaine faisant peu de cas de ce que je lui disais de mes études, se contenta de me demander si je savais l'arithmétique. Comme ma mère me l'avait fait apprendre dès ma première jeunesse, il me fut aisé de le contenter sur cet article. Il me fit encore quelques questions, auxquelles je répondis judicieusement et avec grâce ; encore que paraissant content de mon esprit, de ma figure, et de mes manières, il m'accorda la place que je lui demandais. Ma joie fut extrême, surtout le jour que nous levâmes l'ancre, qui fut le 3 octobre 1714.
Je m'appliquai d'abord à gagner les bonnes grâces du capitaine et de tous les officiers, et à m'acquérir l'estime de tout l'équipage. Quoique la figure d'un homme ne doive être naturellement considérée que par les femmes, il est certain néanmoins qu'un jeune homme beau et bien fait plaît généralement à tout le monde, lorsque les qualités de l'âme répondent à celle du corps, et qu'il a de l'esprit et de la vertu. Je ne sais si l'on trouva en moi cet heureux assortiment, et si mon extérieur avantageux ne contribua pas autant à me faire aimer, que ma sagesse, mes manières polies et mon humeur douce, égale et complaisante. Le capitaine Harrington me témoignait en toute occasion de l'estime et de l'amitié. Mon application et mon zèle par rapport à mon emploi, la facilité avec laquelle j'apprenais le pilotage, les raisonnements sensés que je faisais sur différentes matières, ma conduite prudente et circonspecte, et le courage que faisait paraître dans toutes les occasions, lui avaient fait dire plusieurs fois, que je ferais un jour une fortune considérable, et parviendrais peut-être aux premiers honneurs de la marine. Ces louanges me remplissaient d'émulation, et m'inspiraient un secret orgueil, que je cachais néanmoins prudemment ; persuadé que rien n'est plus capable de nous faire perdre l'estime des hommes, que de sembler croire qu'on l'a obtenu. Je me sentais déjà l'ambition d'un bachelier d'Oxford, qui se destine à l'évêché ; heureusement je n'avais ni ignorance ni vices à cacher.
CHAPITRE 2. — Le vaisseau est battu par une tempête, pousse dans l'océan Oriental et pris ensuite par des corsaires de l'île de Babilary. — L'auteur est conduit dans le sérail de la Reine.
Je n'entretiendrai point le lecteur des différents vents qui soufflèrent pendant le cours de notre navigation, du beau temps que nous eûmes, du mauvais que nous essuyâmes, des rencontres indifférentes que nous fîmes, ni des îles où nous fûmes obligés de mouiller pour faire eau, et renouveler nos vivres ; ce détail ne serait ni intéressant ni instructif, et mon dessein n'est pas d'ennuyer exprès le lecteur.
Nous avions passé le détroit de la Sonde, et nous nous trouvions vis-à-vis le golfe de Cochinchine, au mois de juin de l'année 1715, lorsque nous rencontrâmes un navire anglais qui était en retour, commandé par le capitaine Fesry. Nous mîmes alors la chaloupe à la mer, et envoyâmes lui demander des nouvelles de l'état du commerce à Canton, port de la Chine, où abordent l'ordinaire tous les vaisseaux d'Europe, pour y faire leur vente et leur cargaison. Il nous apprit qu'il y avait actuellement un grand nombre de vaisseaux européens dans ce port, en sorte que les marchandises d'Europe s'y vendaient à vil prix, et que celles de la Chine, surtout la soie crue de Nankin, y étaient fort chères ; il nous conseilla pour cette raison d'aborder à un autre port, et de nous rendre à celui d'Amoy dans la province de Fujian.
Nous fîmes réflexion que ce port nous convenait d'autant plus, que suivant l'ordre de nos armateurs, nous devions retourner par les mers du Sud. Nous suivîmes donc le funeste conseil du capitaine Fesry, et ayant laissé l'île de Macao et le port de Canton sur notre droite, nous entrâmes, vers le milieu de juillet, dans la mer de la Chine. Nous savions qu'il y avait du danger à naviguer sur cette mer, dans les mois d'août et de septembre, mais nous espérions arriver dans la rade d'Amoy au commencement du mois d'août, et n'avoir point de typhons à essuyer. Ces typhons sont des ouragans, qui commençant ordinairement du côté de l'est, mais qui font souvent en moins de quatre heures le tour de compas. Ils sont appelés taaîfung par les Chinois ; et c'est de-là que les Européens les appellent typhons.
Le 2 août nous n'étions qu'à trente lieues d'Amoy, et nous nous réjouissions de nous voir si près du port, lorsque nous fûmes tout à coup attaqués par ces redoutables coups de vent, dont je viens de parler. Il s'éleva en même temps un affreux orage, et jamais la mer ne parut si irritée. Notre grand mât fut emporté, la plupart de nos voiles furent déchirées. Nous nous vîmes pendant quarante-quatre heures de suite dans les ténèbres et dans les horreurs de la mort, et nous nous sentions poussés très loin sans savoir de quel côté. Notre capitaine fit paraître en cette occasion beaucoup de présence d'esprit, d'intrépidité et d'expérience il encourageait tout l'équipage par son exemple. De mon côté je travaillai avec beaucoup de zèle et de confiance ; ce qui augmenta dans la suite son estime et son affection pour moi. Enfin le vent tomba, et la tempête diminua peu à peu.
Le jour ayant paru, nous estimâmes que nous étions dans l'océan Oriental, au-delà de l'île d'Honshu, qui est la plus grande des îles du Japon. Alors nous jugeâmes à propos de faire voile au sud-ouest pour nous rendre à Amoy. Au bout de huit jours nous découvrîmes une île, qui nous parut grande et que nous prîmes pour l'île de Formose. Nous cinglions vers cette île, lorsque nous vîmes venir à nous un gros vaisseau, que nous parut un corsaire, et dans la disposition de donner la chasse et de nous attaquer. Il nous atteignit, et lorsqu'il fut à la portée du canon il nous salua de plusieurs bordées qui nous contraignirent de nous rendre après un combat d'une heure et demie. Les vainqueurs entrèrent dans notre navire le sabre à la main, et nous ayant tous liés, nous firent passer dans leur bord, où l'on fit trois classes des prisonniers, à savoir des hommes vieux, des hommes de moyen âge, et des jeunes gens : ceux-ci furent encore divisés en deux classes. On en fit une particulière de ceux qui étaient beaux et bienfaits, et on me fit l'honneur de me mettre dans celle-là. Ces barbares qui nous avaient parus terribles le sabre à la main, nous parurent alors avoir un air poli et humain ; aucun d'eux n'avait de barbe ; ils avaient de longs cheveux, et la plupart paraissaient petits, jeunes et très beaux.
Quelque temps après, le capitaine corsaire entra dans l'endroit où j'étais avec mes compagnons ; et après nous avoir tous considérés, s'approcha de moi, me baisa la main, et me conduisit dans la chambre de poupe, où il me fit des caresses, qui me surprirent extrêmement. J'ignorais que ce capitaine était une femme.
Je vis alors entrer un homme qui paraissait âgé. Son visage majestueux était orné d'une barbe vénérable : sa taille était beaucoup plus grande que celle de tous les autres barbares, et il avait l'air plus mâle. J'appris dans la suite que c'était un commissaire royal, revêtu de la charge d'Inspecteur des Prises. À sa vue le capitaine tâcha de déguiser sa passion, et bientôt après il me laissa seul avec lui. Zindernein, — c'était le nom de cet inspecteur — s'étant un peu aperçu des sentiments du capitaine, me fit entendre que mon intérêt était d'être sage, et de bien conserver mon honneur. Aussitôt il me fit passer dans sa chambre, m'y fit préparer un lit, et il sembla toujours me garder à vue jusqu'à notre arrivée dans l'île.
Cette île, ainsi que je l'entendis nommer alors, s'appelait l'île de Babilary — mot qui signifie dans la langue du pays «la gloire des femmes». Nous mouillâmes au port, au bout de deux jours, et aussitôt nous vîmes venir à nous un grand nombre d'insulaires, qui félicitèrent leurs compatriotes sur leur prise. Tous mes compagnons ayant été le lendemain exposés en vente, furent achetés à différent prix, selon leur âge et leurs qualités personnelles ; et Harrington fut vendu à plus bas prix que les autres, parce qu'il était le plus âgé. Pour moi je ne fus point proposé à l'encan. Au sortir du vaisseau, Zindernein monta avec moi dans une espèce de calèche tirée par quatre animaux assez semblables à des cerfs ; et en moins de deux heures nous arrivâmes à Ramaja, qui est la capitale de l'île et la ville royale, éloignée de douze lieues du port, où nous avions abordé. Une foule de peuple s'amassa autour de nous à notre arrivée, et j'entendais s'écrier de tous côtés Sa-balacouroucoutou, c'est-à-dire, «que cet étranger est beau».
Nous descendîmes à la porte d'un palais, dont l'aspect me parut superbe, et dont l'entrée était gardée par plusieurs jeunes soldats. Zindernein m'ayant introduit, me fit traverser plusieurs appartements, où quelques jeunes hommes magnifiquement habillés vinrent au-devant de moi ; tous me considérèrent en silence, à cause du respect que leur imprimait la présence de mon conducteur ; on me fit reposer ensuite dans une chambre où bientôt après une douzaine de vieilles femmes, que je pris pour des hommes, m'apportèrent des vêtements, et me firent signe de déshabiller. J'obéis avec le plus de décence qu'il me fut possible, et je fus aussitôt revêtu d'une veste blanche de fin lin, et d'une robe de soie de couleur de rose.
On me conduisit bientôt après dans une salle, où un magnifique repas était préparé ; on me fit asseoir à table dans la place la plus honorable. Zindernein se mit auprès de moi, et les autres places furent occupées par les jeunes gens, qui m'avaient abordé à mon arrivée dans ce palais.
On peut juger que j'étais fort étonné de tout ce que je voyais : je ne savais que juger de ma situation. Zindernein me rassurait par ses caresses et par des signes flatteurs, qui me faisaient comprendre que j'étais destiné à être heureux. Pendant le repas on s'entretint de diverses choses, que je ne pus entendre, en sorte que je m'ennuyai un peu ; mais comme j'avais un grand appétit, je mangeai beaucoup, ce qui parut faire plaisir à Zindernein. Je comprenais par le mouvement des yeux de ceux qui était à table, que j'avais beaucoup de part à leurs discours ; ils paraissaient quelquefois disputer ensemble en me regardant, ce qui me fit juger qu'ils ne pensaient pas tous sur mon sujet de la même manière. Sur sa fin du repas on nous fit entendre un concert de voix et d'instruments, qui ne me causa qu'un plaisir médiocre ; cette musique me parut sans force, sans génie, fade, uniforme, et d'une mollesse dégoûtante, telle que la musique des Français (†).
Comme j'étais fort fatigué, je fis comprendre à Zindernein que j'avais besoin de repos. Il me conduisit lui-même dans une chambre meublée magnifiquement, où deux vieilles femmes qui m'attendaient, me déshabillèrent. Je me mis au lit, et Zindernein me dit adieu, après m'avoir promis de me venir revoir le lendemain : je restai seul, et la porte de ma chambre fut fermée à la clef.
Je me livrai alors aux plus tristes réflexions ; me voilà, disais-je, dans une véritable prison, j'ai perdu ma liberté ; je passerai ici le reste de mes jours, sans aucun espoir de la recouvrer. Mais pourquoi ces délices et ces magnificences ? Quelle prison ! À quoi suis-je destiné ? N'est-ce point pour m'empêcher de mourir d'ennui et de douleur, qu'on me traite si bien ? On me réserve sans doute pour être immolé à la divinité qu'on adore dans ces lieux. Mais si cela est, pourquoi les autres jeunes gens, qui étaient à table avec moi, et qui vraisemblablement sont comme moi captifs en cette île, auraient-ils l'air si tranquille, et si gai ? Si je suis réduit seulement à l'esclavage, le traitement qu'on me fait ici, a-t-il quelque rapport à la condition d'esclave ? Tous ceux sont ici les compagnons de mon sort, n'ont point l'air servile. Où suis-je, que suis-je, que ferai-je ? Peut-être hélas qu'on prétend me faire renoncer à ma religion : mais il n'y a rien que je ne souffre plutôt que d'y consentit.
Ces pensées inquiètes retardèrent mon sommeil ; cependant je m'y abandonnai à la fin, et je dormis tranquillement. Le lendemain je m'éveillai à regret : le sommeil finit toujours trop tôt pour les malheureux.
CHAPITRE 3. — L'Auteur apprend en peu de temps la langue babilarienne par une méthode singulière et nouvelle ; ses entretiens avec le directeur du sérail, qui lui découvre que les charges et emplois de l'État sont exercés par des femmes. — Origine de cet usage.
Zindernein vint me trouver peu de temps après que je fus éveillé. Il me témoigna beaucoup de bonté, et me voyant triste et inquiet, il me fit comprendre que je n'avais aucun sujet de m'affliger. Un moment après, je vis entrer dans ma chambre un homme, qui avait un talent merveilleux pour apprendre la langue du pays aux étrangers, sans le secours d'aucune grammaire raisonnée. C'était un peintre en miniature, excellent dessinateur, qui avait recueilli dans deux gros volumes les images de toutes les choses naturelles, qu'il avait peintes lui-même, et qu'il avait fait graver. Tout son art consistait à présenter d'abord à ses écoliers les tableaux des choses les plus simples et les plus ordinaires ; à chaque estampe qu'il lui montrait, il lui prononçait le terme qui dans sa langue servait à l'exprimer, et le lui faisait écrire au bas, dans le caractère étranger que chaque écolier pouvait connaître, et qui lui était propre ; ce qui formait pour ses disciples une espèce de dictionnaire très commode.
Nous n'apprenons les langues étrangères, qu'en liant l'idée d'un mot, dont nous voulons retenir la signification, avec l'idée d'un autre mot qui nous est familier. Ainsi nous retenons un son par le moyen d'un autre son. Or ce qui entre dans notre esprit par l'organe de la vue, s'y imprime bien mieux que tout ce qui y entre par le moyen des autres ses, comme l'expérience le prouve. D'où je conclus, que la méthode de ce peintre-grammairien était excellente, et qu'on devrait s'en servir dans les universités pour apprendre le grec et le latin à la jeunesse. Les enfants n'apprennent si promptement la langue de leurs nourrices, que parce qu'ils voient et regardent attentivement tout ce qu'ils entendent prononcer. Je prévois néanmoins que ce nouveau système de grammaire ne sera pas plus goûté, que les nouvelles méthodes, qu'on invente tous les jours en Europe, pour abréger le chemin des sciences, et qui n'augmentent pas beaucoup le nombre des savants.
Je passai quinze jours à apprendre tous les noms substantifs de la langue babilarienne : à mesure que j'apprenais les substantifs, j'apprenais aussi les adjectifs, parce qu'il n'y avait point d'estampe, qui ne représentait la chose avec plusieurs attributs. Plusieurs de ces estampes étaient enluminées, sans quoi je n'aurais pu apprendre les noms des couleurs.
À l'égard des verbes, qui expriment une action de l'âme ou du corps, mon maître voyant que j'avais la mémoire très heureuse, et que je savais déjà les noms, me mit entre les mains le second volume de son recueil, qui contenait les verbes, c'est-à-dire, les tableaux de toutes les actions et de toutes les passions. Comme les noms de cette langue ne se déclinent point, les verbes ne se conjuguent point non plus : en quoi elle a beaucoup de rapport à la langue anglaise, plus parfaite en cela que la plupart des autres langues hérissées de difficultés inutiles. Elle n'a point, non plus que la nôtre, de noms masculins, ni de noms féminins, pour exprimer les êtres inanimés ; ce qui m'a toujours paru la chose du monde la plus absurde. Car pourquoi, par exemple, ensis en latin, qui veut dire une épée, est-il du genre masculin, et vagina, qui veut dire le fourreau, est-il du genre féminin ? L'épée et le fourreau ont-ils un sexe différent ? J'ajouterais plusieurs autres observations sur cette matière, si ces sortes de recherches convenaient à un voyager.
Les estampes destinées à exprimer les verbes, étaient pour la plupart assez composées ; mais en même temps, je ne vis jamais rien de si bien dessiné, surtout lorsqu'il s'agissait d'exprimer les mouvements de l'âme, comme la haine, le désir, la crainte, l'espérance, l'estime, le respect, le mépris, la colère, la soumission ; et les vertus, telles que la chasteté, l'obéissance, la fidélité ; et les vices, comme la fourberie, l'avarice, l'orgueil, la cruauté, etc.
Comme nous exprimons ces choses, par des termes métaphoriques et analogues aux mouvements et aux modifications de notre corps, il est clair que rien n'est plus aisé que de peindre tout cela aux yeux. Les adverbes, qui servent à augmenter, ou à diminuer la force des verbes, et à mettre des nuances dans idées, étaient peints aussi, et à mesure que j'apprenais les verbes, par l'expression des actions peintes, j'apprenais aussi les adverbes, par la peinture des modalités de ces actions. Par exemple, les différents degrés d'amour formaient autant de tableaux différents, auxquels répondait un terme commun, avec l'addition d'un autre terme, pour exprimer les degrés de la passion ; ce qui faisait l'adverbe.
Zindernein me rendait visite tous les jours, et était charmé du progrès que je faisais dans la langue babilarienne. Enfin au bout d'un mois je fus en état de m'entretenir avec lui, quelquefois l'expression propre me fuyait ; mais comprenant ce que je voulais dire, il me la suggérait. D'ailleurs cette langue se parle très lentement, en sorte qu'on a le temps de chercher les mots en parlant ; la prononciation en est fort aisée, parce que la langue est très douce : à l'égard de l'accent, je le pris peu à peu. Au reste ce qui fit que j'appris promptement la langue babilarienne, est que pendant deux mois je fus très retiré, ne parlant à personne, si ce n'était à mon maître et à Zindernein. C'est par le recueillement qu'on acquiert des connaissances, et qu'on s'orne l'esprit.
Dans les premiers entretiens que j'eus avec Zindernein, je lui demandai, pourquoi on avait tant d'attention pour moi, par quel motif j'étais si bien traité, quel était le lieu que j'habitais, à quoi j'étais destiné ? Il ne fit point difficulté de satisfaire ma curiosité, et me dit que j'étais dans le sérail de la Reine, où il y avait environ une douzaine de jeunes étrangers comme moi, qu'elle affectionnait, et qu'elle faisait élever pour ses plaisirs. Les hommes de cette île, ajouta-t-il, ne sont pas dignes d'elle. La Reine croit que ce serait offenser la majesté de son rang que de s'abaisser à aimer aucun de ses sujets, et qu'il y aurait même du danger du côté de la politique dans cet honneur qu'elle leur ferait, parce que les familles de l'île dans lesquelles elle choisirait des maris, pourraient se prévaloir de cette élévation. Eh quoi ! lui répondis-je, suis-je destiné à être le mari de la Reine ? Oui, me répliqua-t-il, si votre esprit et votre figure lui plaisent : mais tous les jeunes gens qui sont ici ont la même prétention. Voilà une étrange conduite pour une reine, repartis-je ; est-il possible que la pudeur d'une femme souffre une douzaine de maris ?
Elle n'en a jamais qu'un à la fois, me répondit Zindernein ; mais elle a le droit de le changer une fois toutes les années, dans le cas où elle le veut ; et alors elle choisit du sérail celui des jeunes gens qu'elle aime davantage, pour l'élever à cet honneur : et dans ce cas elle renvoie le mari, qu'elle quitte, dans ce même sérail d'où elle le retire quelquefois, si elle le juge à propos, pour l'épouser encore. Celui qu'elle a actuellement vit avec elle depuis dix mois, son temps va finir, et l'on croit qu'il ne sera pas continué ; il y a dans ce lieu un jeune homme pleine de mérite et d'appas, qui selon l'opinion commune lui succédera. Peut-être que votre tour viendra, et que vous aurez le bonheur de plaire à Sa Majesté. Qui sait même, si vous ne serez point préféré à ce jeune homme destiné à ses augustes embrassements ?
Cet honneur, repartis-je, aurait de quoi me flatter, s'il était durable, et si en devenant l'époux de la Reine, je devenais Roi. Cela est impossible, me répondit Zindernein ; la loi y est formellement contraire. Quoi, lui dis-je, il y a une loi dans cette île, qui interdit le trône aux hommes, et qui y élève les femmes, à l'exclusion de tous les mâles ? Cela n'est pas ainsi chez nous ; une femme (‡), il est vrai, est actuellement sur le trône d'Angleterre, mais ce n'est que par accident, et parce que la plus grande partie de notre nation l'a jugée la plus proche héritière de la Couronne. Après sa mort nous aurons un roi ; ce qui est plus convenable de toutes manières. Car nous sentons qu'il est honteux à des hommes d'être asservis à une femme. Les hommes forment le sexe dominant, c'est à eux de commander. Cela devrait être ainsi dans cette île, me répondit-il, et cela a été autrefois. Mais les mœurs sont changées, et aujourd'hui les femmes y sont les maîtresses. Elles y occupent toutes les charges de l'épée et de la robe : elles seules composent nos armées de terre et de mer ; les hommes en un mot sont ici ce que les femmes sont dans votre pays.
Eh quoi, lui répondis-je, vous qui présidez ici, et qui avez de l'autorité sur les vaisseaux, n'êtes-vous pas un homme ? Ceux qui nous ont pris sont-ce des femmes ? Oui, me répliqua-t-il, ce sont des femmes qui ont pris votre vaisseau. Elles sont habillées comme tous les hommes, à l'exception que leurs robes ne leur descendent que jusqu'à la moitié des jambes, et que les hommes ont une robe beaucoup plus longue, et qui a plus de circuit. Pour moi je suis homme, et le seul homme qui ait quelque autorité dans l'État, parce qu'il n'y a qu'un homme qui puisse exercer ma charge.
Je sentis alors une espèce de honte, en apprenant que j'avais été vaincu les armes à la main par des femmes, et je ne pus m'empêcher de rougir. Mais Zindernein, qui s'en aperçut, me dit que les femmes de l'île qui avaient embrassé l'état militaire, étaient très aguerries et très braves, qu'elles étaient furieuses dans les combats, et qu'il était difficile aux hommes de soutenir leurs efforts. Elles sont d'ailleurs fort vigoureuses, ajouta-t-il ; comme elles sont élevées de bonne heure à faire tous les exercices du corps, et qu'elles apprennent dans leur première jeunesse à monter à cheval, et à faire des armes, qu'elles vont souvent à la chasse, qu'elles boivent des liqueurs, qu'elles ont plus de vigueur que les hommes de ce pays, à qui tout cela est interdit suivant les règles de la bienséance. Nous n'avons pas toujours été dans cet usage, ajouta-t-il, et je vous en expliquerai l'origine, si cela excite votre curiosité. Je le priai de m'en instruire, et il commença ainsi :
Il y a environ sept mille deux cents lunes, qu'Amenéinin régnait dans cette île. Sous son règne les hommes commencèrent à avoir des égards infinis pour les femmes ; il semblait même que le règne des femmes fût déjà venu. Le Roi, et à son exemple, tous les hommes de l'île, négligeant toute affaire sérieuse, ne donnant plus aucune attention à l'étude des lois et de la politique, dédaignant la gloire, fuyant la guerre, n'administrant plus la justice, méprisant la science et les beaux-arts, plongés dans l'ignorance de l'histoire et de la philosophie, détestant tout genre de travail, sans honneur et sans émulation, étaient continuellement aux pieds d'une sexe enchanteur, qui naturellement ambitieux, entreprit de profiter de la honteuse mollesse des hommes, pour secouer le joug, que la sagesse des premiers temps leur avait justement imposé, et que la faiblesse du sexe dominant avait depuis rendu trop léger. Elles ne réussirent que trop bien dans cette funeste entreprise. La reine Aiginu, dont le Roi cultivait peu les appas, commença la trahison. Elle s'empara du trône, et en fit tomber un mari faible, négligent, noyé dans les plaisirs, et esclave d'une foule de maîtresses.
La conspiration de toutes les femmes éclata en même temps ; s'étant élevées au-dessus de leurs maris, elles s'emparèrent non seulement de la conduite des affaires domestiques, que ceux-ci négligeaient entièrement, mais encore du gouvernement de toutes les affaires publiques, de la politique, de la finance, de la guerre, de l'administration de la justice, dont on ne prenait plus aucun soin. Cependant elles n'osèrent d'abord usurper ouvertement le droit des hommes ; elles se continrent de travailler sous leur nom. Si elles eussent alors porté plus loin leurs attentats, les hommes se seraient peut-être réveillés de leur profond assoupissement, ou auraient au moins disputé un pouvoir absolu ; qu'ils tenaient de la nature et de la raison. Mais les femmes naturellement adroites et d'un esprit fin et subtil, s'y prirent autrement : elles flattèrent leurs époux, et séduisirent leurs amants. Elles trouvèrent enfin dans leurs attraits tous les préparatifs d'une fatale révolution.
On s'accoutuma peu à peu à recevoir la loi des femmes : comme elles gouvernaient assez bien, et qu'il y avait au moins beaucoup plus d'ordre dans l'État qu'auparavant, on ne murmura point. On s'imagina même avec le temps, que puisqu'elles réussissaient si heureusement dans le maniement des affaires, elles étaient nées pour commander. Cependant les hommes se plongeaient de plus en plus dans l'oisiveté et leur paresse croissait à mesure qu'elle était fomentée par leur inaction. Ce fut alors, dit-on, qu'il parut au ciel une comète extraordinaire, dont la chevelure semblait éclipsée : présage, que les femmes astrologues ne manquèrent pas d'interpréter en leur faveur.
Après la mort du roi Amenéinin, Aiginu fit mourir les parents de son mari, qui auraient pu lui disputer l'autorité, et renverser ses projets ; on croit même qu'elle sacrifia son fils à sa détestable ambition. Quelques vieillards devenus sérieux et inquiets, s'efforcèrent en vain de rappeler les anciens usages, et de rétablir le sexe masculin dans ses premiers droits. Ils furent bannis par un acte du Parlement, composé des femmes les plus distinguées de l'île. Quelques autres vieillards, qui auraient pu encore essayer de remuer, intimidés par cet exemple, prirent conseil de leur âge et de leur faiblesse, et demeurèrent tranquilles. Les autres, après avoir langui toute leur vie aux pieds des femmes, n'osèrent prendre les armes contre elles, et achevèrent le reste de leur vie sous un joug, qu'ils avaient volontairement porté dans leur jeunesse. À l'égard des jeunes, nés dans la servitude, il ne leur vint pas seulement dans l'esprit de tâcher de s'en affranchir.
Tandis que Zindernein me parlait ainsi, je faisais réflexion que les hommes d'Europe, par le genre de vie qu'ils mènent aujourd'hui, pourraient bien voir un jour arriver quelque révolution semblable parmi eux. Leur mollesse et leur ignorance préparent depuis longtemps cet événement, pourvu que les femmes sachent profiter de la disposition des hommes.
Cependant, continua Zindernein, les peuples du nord de cette grande île, qui formaient alors un royaume particulier et indépendant du nôtre, craignant la contagion d'un exemple si voisin, et appréhendant que leurs femmes ne formassent chez eux une pareille entreprise, envoyèrent secrètement des émissaires dans nos provinces, pour tâcher de soulever les hommes, et d'abolir le nouveau gouvernement. Vingt mille hommes s'étant révoltés, sommèrent la Reine de faire élire un roi par un parlement d'hommes, et la menacèrent d'en élire un, en cas de refus. La proposition fut fièrement rejetée par la Reine, qui menaça les rebelles de leur faire sentir le poids de son bras, s'ils ne se hâtaient de rentrer dans le devoir. Aussitôt elle assembla une armée de cinquante mille femmes, pour réduire les mutins. Ce qu'il y eut de plus honteux, est que trois mille jeunes gens entraînent par leur faiblesse, souffrirent d'être incorporés dans ces régiments féminins. L'armée était commandée par la Reine en personne qui avait sous elle douze lieutenantes générales, douze maréchales de camp, trente-six brigadières, et quarante-huit colonelles.
Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine de Camaraca. Les hommes étaient armés d'arcs et de flèches, et leur cavalerie était très bien montée. La Reine, qui jugea que ses troupes peu aguerries alors, et qui n'avaient jamais vu de combat, auraient de la peine à résister à une armée masculine, usa d'un stratagème digne d'elle. Elle mit à la tête de son armée rangée en bataille quatre mille femmes, des plus jeunes et des plus belles. De grands cheveux bouclés flottaient sur leurs épaules nues, leur gorge d'albâtre était découverte, aussi bien que leurs bras et leurs jambes. C'étaient là leurs seules armes, et ce fut dans cet état dangereux et terrible qu'elles se présentèrent aux yeux de l'armée ennemie, dont toute la fureur s'évanouit à cette vue : ils mirent bas les armes, et d'ennemis redoutables qu'ils étaient, ils devinrent tendres amants et humbles esclaves.
D'autres racontent que la chose se passa autrement. Ils disent, que la Reine ayant jugé à propos d'entrer en négociation, envoya dans le camp des rebelles vingt jeunes femmes d'une beauté parfaite, qui gagnèrent les cœurs de tous les conjurés, et ensuite semèrent la division parmi les chefs, et que par ce moyen l'armée ennemie fut dissipée. Cela paraît d'autant plus vraisemblable, que les femmes ont en effet un talent admirable pour brouiller les hommes.
Quoi qu'il en soit, les femmes tirèrent de cette victoire pacifique tout l'avantage qu'elles auraient pu se promettre d'un combat sanglant, où elles auraient eu la gloire de tailler l'armée ennemie. Depuis ce temps-là, leur autorité a toujours cru. Nous sommes exclus de toutes les charges et de tous les emplois de l'État : elles seules professent les sciences, et il n'est permis qu'à elles de les cultiver ; jusque-là qu'on se moquerait aujourd'hui d'un homme qui se donnerait pour savant, et qu'on le renverrait à son aiguille et à son ménage. Enfin elles sont les seules dépositaires du ministère des Autels, et des lois de la religion ; elles offrent dans nos temples des solennels à la Divinité, et président aux cérémonies religieuses.
Pour moi, ajouta-t-il, qui a le malheur d'être homme, et qui aurais néanmoins lieu d'en rendre grâce à la Nature, si j'étais né sous un autre ciel, je gémis en secret de cet indigne renversement de l'ordre naturel, et je ne souscrirai jamais intérieurement à cette fausse proposition enseignée par toutes nos savantes, qui prétendent que parmi toutes les espèces d'animaux, la femelle est plus parfaite que le mâle. C'est, selon moi, une doctrine nouvelle et erronée, contraire à l'ancienne tradition, et qu'on peut détruire par des arguments invincibles. Il est vrai que les femelles seules ont le pouvoir de mettre au jour leurs semblables, et que c'est de leur substance que sortent immédiatement toutes les substances animées ; mais pour mettre en œuvre cette puissance admirable, qui est en effet une excellente prérogative, peuvent-elles se passer des mâles ? On a beau dire que le principe fécond est dans elles, et que l'action des mâles ne fait que le préparer et le modifier, comme la rosée du printemps, qui pénétrant le sein de la terre, développe les germes et en fait sortir les plantes. Pour moi je soutiens que les mâles font tout ; que c'est dans eux que réside le germe primitif, et que les femelles ne font par rapport à eux, que ce que la terre est par rapport à une main industrieuse, qui la cultive. C'était les sentiments de nos anciens docteurs, dont les femmes ont brûlé les livres, où nous aurions trouvé des armes pour combattre leurs prétentions. Cependant personne n'ose aujourd'hui soutenir ce sentiment en public, sans passer pour un novateur dangereux, et sans être traité de perturbateur.
Voilà, mon cher Gulliver, le pays où vous êtes. Si vous pouvez renoncer à l'orgueil, que vous inspire justement l'excellence de votre sexe, et le préjugé légitime de votre éducation, vous serez heureusement. Étant aussi beau que vous êtes, toutes les femmes vous traiteront avec respect, et jetteront sur vous des regards flatteurs, qui satisferont votre amour-propre. Car quoique les femmes regardent notre sexe comme inférieur au leur, elles ont pourtant pour nous une infinité d'égards ; elles nous traitent avec respect, elles cèdent toujours le pas ; elles n'osent nous dire la moindre parole désobligeante ; et une femme à qui il échappait une malhonnêteté à notre égard, passerait pour une extravagante, et serait déshonorée. C'est un reste précieux de nous anciens usages, un droit naturel que l'orgueil des femmes n'a pu abolir, et un titre ancien que nous conservons contre elles. Elles prétendent néanmoins qu'elles n'ont pour nous tant d'égards qu'à cause de notre faiblesse qui exige d'être ménagée. Hélas ! ces déficiences, ces respects, ces complaisances ne sont aujourd'hui que des honneurs stériles. Les femmes, lorsqu'elles nous aiment, nous appellent leurs maîtres, et nous sommes néanmoins toujours leurs esclaves.
CHAPITRE 4. — Suite de l'entretien de l'Auteur avec le directeur du sérail. — Mœurs des femmes de Babilary, et des hommes de cette île. — Descriptions du sérail. — Portrait de ceux qui y étaient renfermés avec l'auteur, leurs occupations, leurs jalousies, etc.
J'écoutai avec beaucoup d'attention ce discours qui me surprit extrêmement ; lorsque Zindernein me parlait, il me prenait quelquefois envie de rire ; mais je me retenais le plus qu'il m'était possible, parce que je m'étais aperçu que mes ris le rendaient plus sérieux, et semblaient augmenter son humiliation. Lorsqu'il eut cesse de parler, je lui dis d'un air gai et assez franc, que puisque le sexe féminin était dans l'île où j'étais, le sexe dominant, je me conformerais aux usages établis, et tâcherais de compenser la perte de mon rang naturel par la jouissance aisée des plaisirs, qui s'offriraient à moi.
Si vous avez l'honneur d'épouser la Reine, me répondit-il, vous sortirez de ce sérail, et vous serez libre dans le palais de Sa Majesté, où vous aurez une foule innombrable d'officiers et de domestiques de l'un et de l'autre sexe. Mais gardez-vous alors de vous livrer à des désirs criminels, et de prendre de l'amour pour aucune femme : si vous témoignez la moindre faiblesse, vous tomberiez dans le mépris de la Nation. Car il est établi que la pudeur, qui n'est ici pour les femmes qu'une qualité médiocre, est pour nous une verte essentielle. Un homme qui a des amantes, et qui s'y abandonne, est déshonoré, lorsque ses dérèglements deviennent publics ; ce qui lui est fort difficile d'empêcher, parce que les femmes de ce pays sont très indiscrètes, et que leur vanité leur fait souvent publier les faveurs qu'elles reçoivent. L'époux de la Reine est surtout obligé à une circonspection scrupuleuse et à une conduite exempte de tout reproche. Il ne lui suffit pas d'avoir de la pudeur, il ne doit pas même être soupçonné d'en manquer.
Tous les courtisans sont donc d'une grande modestie, répliquai-je ? Oui, me repartit Zindernein ; mais la plupart de ces messieurs ne sont pas néanmoins toujours ce qu'ils veulent paraître, et il y en a peu qui ne passent pour avoir des amants. La gloire des femmes consiste à conquérir le cœur des hommes, et celle des hommes à savoir se défendre : elles veulent qu'on leur pardonne tout, quoiqu'elles se disent moins faibles que les hommes, à qui elles ne pardonnent rien. Cependant quand un homme n'a qu'une amante qu'il favorise, l'indulgence publique l'excuse ; mais s'il se livre à plusieurs, et que sa honte éclate, sa femme alors ridiculement déshonorée, prend d'ordinaire le parti de le répudier. Quelquefois aussi elle tolère la conduite de son époux et garde un silence prudent. D'ailleurs il n'est pas aisé de voir en ce genre ce qui manque à l'honneur d'un homme.
Les femmes, poursuivit-il, médisent ici beaucoup d'hommes, qui le leur pardonnent aisément, pourvu qu'elles n'attaquent ni leur figure, ni leurs talents, dont la réputation leur est beaucoup plus chère que celle de leur vertu. Ils regardent tous comme la première de toutes les qualités, celle de plaire aux femmes, et celle de s'en faire respecter comme la dernière.
Je lui demandai alors comme on se mariait dans l'île. Il n'y a point d'affaire, me répondait-il, qui se traite et se conclue avec tant de précaution et si peu de prudence. On voit des hommes surannés, dont le métier est d'être courtiers de mariage, et qui ne s'occupent qu'à assortir les filles et garçons. On n'examine d'ordinaire que l'extérieur d'un garçon, sa naissance, son bien, sa figure ; à l'égard du caractère et de l'humeur, ce n'est qu'après les noces que cet article se discute. Il est vrai que les femmes ont la commodité du divorce qui les dispense de prendre des mesures scrupuleuses par rapport à la conformité des humeurs, et des inclinations ; mais ce privilège étant refusé aux hommes, il est étonnant de les voir si peu précautionnés sur un point si important de la société conjugale.
Depuis que j'eus un peu appris la langue, afin de m'en faciliter l'usage, on m'accorde la liberté de voir tous mes compagnons du sérail et de me divertir avec eux. Ils se couchaient d'ordinaire et se levaient fort tard, et passaient une partie de la journée à se parer, et l'autre à se promener, à jouer, et à entendre des concerts, où la Reine assistait quelquefois avec toute la Cour. Il n'y avait aucune union parmi ces jeunes hommes, parce qu'ils aspiraient tous au même honneur, et croyaient tous le croyaient mériter préférablement à leurs concurrents. Ils médisaient sans cesse l'une de l'autre, et s'attachaient surtout à rabaisser celui qui passait pour le mieux fait, et qui, selon l'opinion commune, devait le premier épouser la Reine.
Cet heureux rival s'appelait Sirilou : un d'eux me disait de lui, qu'il avait l'air fade, que ses yeux étaient trop languissants ; un autre disait qu'il n'avait point d'esprit ; un autre prédisait que la Reine n'en serait point contente, et qu'elle ne le garderait peut-être pas huit jours. Si je louais quelqu'un d'eux, on lui trouvait de la mauvaise grâce, des yeux rudes, un mauvais caractère : enfin quoiqu'ils se traitassent l'un l'autre à l'extérieur avec assez de politesse et d'honnêteté, ils se haïssaient tous mortellement. Comme je passais pour être bien fait et assez beau, on peut juger qu'ils ne m'épargnaient pas entre eux.
Leurs conversations étaient fort ennuyeuses, si ce n'est lorsqu'ils médisaient l'un de l'autre. Souvent ils s'entretenaient de leurs parures et de leurs ajustements. Quelquefois ils disputaient ensemble ; mais les questions ordinaires qu'ils agitaient, étaient de savoir, si les cheveux longs et flottants sur les épaules avaient plus de grâce, qu'attachés avec un ruban ; si un rouge artificiel étendu sur leurs joues n'en relevait pas l'éclat, et si la couleur naturelle n'était pas moins brillante que les couleurs empruntées ; si un teint un peu brun n'était pas plus agréable aux femmes qu'un teint trop blanc et trop fleuri. Surtout cela chacun suivait la décision de son miroir.
Il y avait un assez grand nombre de femmes dans le sérail destinées au service de ceux qui y étaient renfermés, lesquelles étaient chargées d'en défendre l'entrée à toutes les femmes, sous peine de mort, à moins qu'elles n'y fussent amenées par la Reine, qui y venait de temps en temps. Ces femmes qui nous gardaient, étaient toutes fort laides, et à ce que j'appris hors d'état de faire usage de leur sexe. Elles avaient toutes différentes charges dans le sérail, et celle qui était la principale, et à qui les autres obéissaient, s'appelait la Grande Maramouque, elle et toutes les autres étaient soumises à Zindernein, Intendant-Général des plaisirs de la Reine, et Grand-Pourvoyeur de son sérail : charge à laquelle était attachée celle d'Inspecteur de toutes les prises sur mer. On juge aisément qu'il était plus à propos, selon leurs mœurs, qu'un homme fut revêtu de cette charge qu'une femme.
CHAPITRE 5. — La Reine vient visiter son sérail, l'Auteur lui est présenté ; il a le bonheur de lui plaire, et est nommé et déclaré épouse de la Reine pour l'année suivante ; il sort du sérail, et est logé dans le palais.
Lorsque Zindernein m'eut jugé assez habile dans la langue, pour pouvoir entretenir la Reine, et qu'il eut trouvé que j'avais attrapé un certain air nécessaire aux hommes du pays pour plaire aux femmes, il me dit de me préparer à voir la Reine, qui le lendemain viendrait au sérail. Il me recommanda de parler peu, lorsque je serais en sa présence, d'avoir un air simple et ingénu, de mettre beaucoup de douceur et de modestie dans mes regards, de ne faire aucun geste inconsidéré, d'avoir en même temps un air tranquille et serein, et de jeter quelquefois sur Sa Majesté des yeux vifs, tendres et respectueux. Je lui promis de profiter de ses leçons, et je me préparai à l'honneur que je devais recevoir le lendemain.
Je fus paré ce jour-là plus qu'à l'ordinaire ; on me couvrit de pierreries, et je fus revêtu d'habits magnifiques. On m'avait fait baigner dans des eaux parfumées, et Zindernein avoir eu la bonté de me faire boire d'une liqueur merveilleuse, qui répand la fraîcheur et l'embonpoint sur le visage, et rend les yeux humides et brillants. Mes compagnons me voient en cet état ne purent cacher leur dépit ; Sivilou appréhenda que je ne retardasse son bonheur et sa gloire. À travers un certain rouge léger, dont il avait toujours soin de couvrir avec art sa pâleur naturelle, je m'aperçus qu'il pâlissait en me regardant. Les femmes du sérail disaient entre elles, que j'avais la taille plus avantageuse que lui, la jambe plus fine, les cheveux plus beaux, le tour du visage mieux fait, les yeux plus grands, la bouche plus petite, les traits plus fins. Cependant Sivilou était bien pris dans sa taille, et était fort beau de visage ; mais il avait l'air mélancolique, et la physionomie peu spirituelle.
La Reine vint au sérail sur le soir, et Zindernein me présenta à elle en particulier, en lui disant que j'étais le jeune étranger, dont il lui avait souvent parlé, et qui était sur le dernier navire, qu'on avait pris. La taille de la Reine était majestueuse ; son air gracieux et noble était digne d'une grande princesse, elle avait, ainsi que la plupart des femmes de ce pays-là, ce que nous appelons en Europe une beauté mâle, mais ce qui ne s'appelle pas ainsi dans cette île, parce que les hommes y ont toujours l'air efféminé.
Elle me fit asseoir auprès d'elle et me demanda d'abord de quel pays j'étais ? lui ayant répondu que j'étais européen, né dans une île appellée la Grande-Bretagne, elle me dit qu'elle serait en sorte de me faire oublier ma patrie. Je lui repartis, que j'avais déjà commencé à en oublier les mœurs, et que je ne pensais qu'à suivre les usages du pays, où le Ciel m'avait conduit. Ces usages doivent sans doute vous paraître étranges, répliqua-t-elle, à vous qui avez été élevé dans des maximes si opposées. Mais vous éprouverez bientôt, que vous avez gagné au change. Les femmes sont chez vous plus heureuses que les hommes : ici les hommes sont plus heureux que les femmes ; vous ne vivez que pour le plaisir, vous passez votre vie dans une agréable vicissitude d'amusements, nulle affaire, nulle inquiétude ne trouble vos jours. Votre dépendance n'est qu'apparente et imaginaire : c'est nous qui au fond dépendons de vous ; nous ne songeons qu'à vous plaire ; vous recueillez tout le fruit de nos travaux ; nous ne vivons que pour vous rendre heureux.
Goûtez donc, ajouta-t-elle, un bonheur que votre séjour dans cette île vous assure, et consentez dans la suite à faire le mien, qui peut-être augmentera le vôtre. Mais quoi, vous rougissez ! Ah, que cette pudeur me charme ; vous semblez né dans cette île ; cependant vous êtres né dans celle de la Grande-Bretagne. Vous étiez sans doute le roi de cette île : un homme si parfait devait commander à tous les autres. Vous n'avez rien de l'immodestie d'un étranger ; vous semblez avoir fait un long séjour dans mon royaume, cependant vous n'y êtes que depuis trois mois.
Quoique je me fusse préparé à répondre avec esprit au discours de la Reine, j'avoue que je m'en sentis fort dépourvu alors ; la modestie qui m'avait été tant recommandée, jointe à l'étonnement me rendit muet et stérile. Je m'assure qu'il n'y a point en Europe de femme de condition qui ne fût d'abord un peu déconcerté, si un grand roi lui parlait sur ce ton. Comme homme et comme Européen, je ne me sentais point capable de répliquer à un pareil langage sorti de la bouche d'une auguste reine, dont l'air majestueux captivait mes respects, et dont les discours indécents blessaient mes préjugés ; car Sa Majesté ne se contenta pas de me dire une infinité de choses obligeantes, qui intéressait ma modestie, elle me prodigua les expressions les plus tendres et les plus passionnées. Mais si je parus peu enjoué, je parus judicieux et retenu ; je sus à propos baisser les yeux, les lever, les tourner de côté, sourire, pencher la tête, rougir. Enfin la Reine fut très satisfaite de ma figure et de mes manières, quoique j'eusse fait paraître peu d'esprit. Peut-être était-elle du goût de plaisirs hommes d'Europe, qui se mettent peu en peine que les femmes en aient, pourvu qu'ils trouvent en elles de la modestie, et de la beauté, avec une lueur de raison. En me quittant, elle me donna avec dignité un baiser tendre, où je sentis plus d'amour que de politesse.
Lorsque la Reine fut partie, Zindernein m'apprit que Sa Majesté lui avait témoigné beaucoup de satisfaction, et lui avait dit, qu'il n'y avait aucun jeune homme dans le sérail qui me valut. Si la Reine, ajouta-t-il, ne change point de pensée, et que vous ne mettiez aucun obstacle à votre élévation, vous serez vraisemblablement le premier qu'elle épousera ; et comme elle est extrêmement éprise de vous, peut-être vous jouirez pendant plusieurs années de l'honneur de son lit.
Comme cette princesse, en sortant du sérail, n'avait cessé de parler de moi aux dames et même aux seigneurs de sa Cour, le bruit se répandit bientôt que j'avais plu infiniment à Sa Majesté. Je commençais alors à être haï et déchiré par tous mes compagnons ; Silvilou devint inconsolable, sa mélancolie naturelle se changea en noires vapeurs : il ne mangeait plus, le sommeil le fuyait ; il négligea le soin de se parer, et de cultiver sa beauté. Il devenait de jour en jour plus maigre et plus pâle : ma gloire avait défiguré ses traits. Les autres qui se voyaient également reculés par mon avancement, et qui sachant que dans le cas dont il s'agissait, l'ancienneté dans le sérail n'était rien moins qu'un titre pour parvenir, ne pouvaient cependant traiter de passe-droit la préférence qui m'était donnée, et étaient réduits à la triste consolation, qu'offre la patience dans tous les revers de la vie.
Cependant la Reine informée par Zindernein de l'état de son sérail, depuis la dernière visite qu'elle y avait faite, fit dire à tous mes compagnons, qu'ils ne s'affligeassent point ; qu'elle songerait à leurs intérêts, et les rendrait heureux avec le temps ; mais qu'il fallait attendre : discours ordinaires des Grands.
Mais afin de ne point laisser languir le sérail dans une cruelle incertitude, Sa Majesté jugea à propos de faire savoir son choix. Je fus donc nommé sans les formes époux de la Reine, pour le cours de l'année 1716. On en fit des réjouissances publiques ; et ayant été tiré du sérail, pour loger dans le palais de Sa Majesté, je reçus les compliments de toute la Cour et de tous les corps du royaume.
Je passai, selon la coutume, quinze jours dans le palais, avant la célébration des noces. Tantôt je me promenais en calèche dans la compagnie de Zindernein, de quelques dames et de quelques seigneurs de la Cour, qu'il me plaisait de choisir, et je visitais les belles maisons de plaisance des environs. Tantôt je tenais appartement chez moi, où les Paratis, qui sont les plus grands seigneurs du royaume, avaient coutume de se rendre, et avaient droit à être assis devant moi sur un tabouret. J'étais traité en roi sans l'être, parce que j'étais destiné à l'honneur d'épouser une reine, et d'en donner peut-être une à l'État, si le Ciel eût secondé les vœux des peuples.
CHAPITRE 6. — Littérature des femmes de Babilary. — Tribunaux des hommes. — Religion différente des deux sexes. — Manière dont les femmes rendent la justice, administrent les finances, et font le commerce. — Académies différentes.
Comme dans ces premiers jours j'exerçai beaucoup ma curiosité, je dirai ici en peu de mots tout ce que je remarquai de singulier dans les usages de l'île de Babilary. Étant un jour allé à la Comédie avec Zindernein, je vis sept femmes qui avaient l'air extrêmement spirituel, assises sur un banc distingué. Au sortir du spectacle, ayant demandé à mon conducteur qu'elles étaient ces sept personnes, il me dit qu'elles composaient un tribunal littéraire, érigé depuis peu par la Reine, pour juger souverainement de toutes les pièces de théâtre. Auparavant cette érection, ajouta-t-il, le public était accablé de mauvaises pièces, que d'insipides plumes avaient l'audace de lui présenter, sous le bon plaisir des actrices et des acteurs, sans avoir auparavant consulté les personnes délicates et judicieuses, versées dans la science profonde de la dramatique. Mais depuis que toutes celles qui composent pour le théâtre, par un règlement nouveau, sont obligées d'obtenir l'approbation de ce savant et ingénieux tribunal, avant que de faire représenter leurs pièces, on n'en voit plus aucunes tomber ; elles sont toutes applaudies, selon leur différent degré de mérite, et le public n'est plus trompé aux premières représentations.
L'établissement de ce tribunal, lui dis-je, est digne de la sagesse de votre gouvernement : mais pourquoi, ajoutai-je, n'en érige-t-on pas un semblable pour tous les livres qu'on met au jour ? La Reine y a pourvu, me réplique Zindernein. Autrefois il suffisait que les livres ne continssent rien d'opposé aux intérêts du gouvernement ou aux bonnes mœurs. Mais on prend garde aujourd'hui qu'ils ne puissent corrompre le goût, et gâter l'esprit ; et on ne permet point de publier des livres inutiles ou mal construits. On a pour cela établi une compagnie de personnes prudentes et profondes dans chaque genre de littérature, qui ne sont ni bizarres ni pointilleuses ; et ce sont elles qui permettent et autorisent la publication des ouvrages d'esprit. Depuis cette sage institution, on ne voit plus de livres absolument mauvais, et ce qui est un grand bien, les livres nouveaux sont plus rares.
D'ailleurs on accorde une grande liberté aux lettres, de peur de retarder le progrès des sciences et des arts. Pour augmenter de plus en plus les lumières de la nation, la Reine comble de bienfaits quiconque publie quelque livre excellent ; ce qui répand l'émulation, multiple les talents et fait éclore les bons ouvrages. Sous le règne précédent les lettres étaient extrêmement négligées : on y regardait le métier pénible de faire des livres, comme le dernier de tous. La Reine volée et pillée impunément par les Marajates chargées du soin de recueillir les impôts, pensait s'en dédommager par le retranchement économique de toutes les récompenses du mérite. Il est vraisemblable que les mœurs et la politesse se seraient bientôt perdues avec les lettres, si la Reine qui règne aujourd'hui n'avait ouvert les yeux sur une conduite si préjudiciable à l'État.
Je demandai alors à Zindernein, si les livres estimés de la nation étaient fort ingénieux. Nous estimons moins, me dit-il, ceux qui sont purement ingénieux que ceux qui sont judicieux. Nous voulons en général dans les ouvrages du génie et de la raison ; mais nous aimons mieux tout sans esprit que tout avec esprit (§). On a dans ces derniers temps mis à la mode un certain style épigrammatique et affecté, qui a d'abord ébloui le public, mais qui est à présent extrêmement méprisé ; en sorte que courir après l'esprit, est aujourd'hui courir après le ridicule. Ce style fade et puéril est cependant encore admire de quelques personnes, qui brouillés avec la raison, ont fait entr'elles une espèce d'union, pour en perpétuer la précieuse semence. Les hommes ont ici plus goûté ce style que les femmes : signe de leur légèreté et de leur esprit superficiel.
Il est étonnant, dis-je à Zindernein, que femmes aient ainsi cultivé la littérature parmi vous, et que ce sexe, qui dans tous les pays du monde, est paresseux et ignorant, et qui regarde même comme une fatigue le soin de penser, soit si laborieux et si savant dans votre île. La science, me répondit-il, est la fille de l'amour-propre et de la curiosité. Faut-il s'étonner que les femmes à qui tout est permis dans ce royaume, désirent l'acquérir, et se fassent une occupation sérieuse de l'étude ? Le travail que la science exige, ne leur coûte rien, parce qu'elles sont soutenues par la vanité, et excitées par l'inquiétude ambitieuse de leur esprit. Elles étudient pour avoir droit de mépriser celles qui n'étudient point.
Si dans le reste du monde les femmes sont ignorantes, comme vous dites, c'est que les hommes, pour de justes raisons, les empêchent de parvenir à des connaissances, qui enflent le cœur. Ils jugent sagement que femmes ont déjà trop de penchant à la vanité, et que si elles s'adonnaient sérieusement à l'étude, leur curiosité naturelle leur ferait trop pénétrer, trop approfondir ; que leur délicatesse et leur subtilité pourraient faire naître entr'elles mille questions dangereuses : que leur opiniâtreté rendrait leurs erreurs incurables, qu'elles seraient insatiables d'apprendre, et qu'enfin elles perdraient un peu de ce goût vif que le Ciel leur a donné pour le devoir capital et indispensable de leur sexe, ce qui porterait préjudice à l'humanité.
C'est ce que nous voyons arriver dans cette île. Celles qui cultivent les sciences sont d'un orgueil extrême ; la plupart se perdent dans des spéculations abstraites ; elles renoncent quelquefois au bon sens, en faveur du bel esprit ; elles remuent des questions qui étonnent la raison ; elles s'avisent de composer de gros volumes sur la nature des choses impossibles, et sur les propriétés du néant. Lorsqu'elles se trompent, jamais elles n'en conviennent ; enfin non seulement elles méprisent celles de leur sexe qui ne s'adonnent qu'aux exercices du corps, mais elles dédaignent encore la société des hommes, qu'elles semblent ne regarder que comme des animaux bruts, qui ne possèdent tout au plus que la partie inférieure de l'âme humaine ; si elles se marient, ce n'est, pour ainsi dire, que malgré elles et pour obéir à la loi qui défend le célibat. Encore s'en est-il trouvé parmi elles, qui ont osé avancer que ce n'était point un crime de l'enfreindre. Car il y en a qui mettent tout en problème.
C'est sans doute depuis la Révolution, répliquai-je, que plusieurs des femmes de cette île ont pris ce goût extrême pour les sciences. Hélas, répartit Zindernein, la Révolution ne serait peut-être pas arrivée, s'il n'y avait pas eu parmi nous des femmes savantes, longtemps avant cette fatale époque.
Le savoir des femmes, qui s'appliquaient à l'étude, tandis que les hommes étaient plongés dans l'ignorance, a été une des principales causes de notre abaissement. Les connaissances qu'elles avaient acquises, leur donnèrent une funeste supériorité sur nous. Comme en général l'homme n'est le maître de tous les animaux, que par son esprit industrieux, qui lui fournit des moyens sûrs pour dompter les plus fiers et les plus féroces : de même l'esprit de la femme devenu supérieur à celui de l'homme, par le soin qu'elle avait pris de le cultiver, de le subtiliser, de l'étendre, vint aisément à bout de nous subjuguer. C'est ainsi que me parlait Zindernein, et qu'il me découvrait ingénument tout ce qu'il pensait des mœurs, et des usages de sa patrie.
Que les hommes de mon pays, qui liront cette relation véritable, craignent de voir un jour arriver dans la Grande-Bretagne, ce qui est arrivé dans l'île de Babilary, et que leur médiocre savoir ne les rassure point. Que les dames néanmoins ne se flattent pas de parvenir sitôt à la gloire des femmes babilariennes : l'heureuse aversion qu'elles ont pour toute sorte d'application et d'étude, assure aux hommes, au moins encore pour un siècle, la conservation de leur naturel droit, et de leur supériorité légitime sur elles. Mais l'ignorance fait aujourd'hui tant de progrès parmi les hommes d'Europe, que je ne voudrais pas répondre, qu'après avoir déjà rangé une partie de nos voisins sous son empire, elle n'entreprît de passer la mer, et de venir aussi mettre les Anglais au nombre de ses esclaves. Dans cette fâcheuse extrémité, si les dames anglaises s'avisaient d'imiter les femmes de Babilary, que deviendrions-nous ?
Je demandai encore à Zindernein, si les hommes de son pays n'avaient pas quelque tribunal, où ils exerçassent une espèce de juridiction ? Ils en ont sans doute, me répliqua-t-il, mais des tribunaux ridicules, qu'on aurait abolis il y a longtemps, s'ils n'avaient supplié qu'on les leur conservât, comme un reste précieux et une faible image de leur ancienne autorité. Il y a donc dans cette île six tribunaux composés d'hommes surannés et presque décrépits. Le premier est pour juger avec précision du degré de blanc et de rouge, que chaque homme, selon la nature de son teint et le nombre de ses années, peut mettre en usage, pour plaire aux femmes en général, avec le droit d'imposer une amende à ceux qui outrent ce ridicule vernis, fruit du caprice et de la folie. Le second est chargé de juger des modes, d'en approuver le changement, et de fixer le nombre de jours, que doit régner une certaine couleur, une étoffe de certain goût, ou une certaine façon de s'habiller. Le troisième est pour régler le rang que les hommes doivent tenir entr'eux, et leurs prééminences respectives, dont ils sont très jaloux. Le quatrième, qui est le plus respecté, juge de leurs querelles, de l'innocence ou de la malignité de leurs railleries et de leurs médisances, et les leur fait rétracter ou adoucir, selon qu'il est convenable. Le cinquième est pour faire le procès aux hommes d'un âge avancé, qui se donnent pour jeunes. Il ne leur est permis que de se retrancher dix années ; lorsqu'ils sont convaincus de s'en être ôté davantage, on les condamne à porter une médaille pendue à leur cou, et qui leur descend jusqu'au-dessous du nombril, l'année, le mois, et le jour de leur naissance écrits en gros caractères. Ceux qui par malignité ont dans leurs discours calomnieux augmenté l'âge des autres, sont condamnés à ne jamais mettre de rouge, et à paraître le reste de leur vie à visage découvert. Le sixième est pour punir ceux qui négligent le culte du dieu Ossokia.
Qu'est-ce que ce dieu, dis-je à Zindernein ? Est-il le seul que vous rêveriez en cette île ? C'est le dieu des hommes, me répondit-il, comme Ossok est la déesse des femmes : déesse imaginaire et inconnue sur la Terre, avant qu'elles se fussent emparées de toute l'autorité dans ce royaume. On n'adressait autrefois des vœux qu'à Ossokia, et on ignorait qu'il eût une femme. Les nôtres se sont avisées de le marier à une déesse, qui selon leur opinion moderne lui est fort supérieure, comme si cette prétendue déesse avait pu secouer le joug d'un dieu, avec la même facilité qu'elles ont secoué le nôtre. Quel aveuglement ! Les hommes faibles et imparfaits ont pu se laisser vaincre par elles ; mais Ossokia, qui est parfait, et qui peut renverser le Ciel et la Terre, est trop puissant et trop éclairé pour avoir été subjugué par sa femme.
Telle est la corruption de l'esprit humain, répondis-je, qui se fait souvent une religion conforme à ses intérêts et à ses préjugés. Mais puisque vous m'avez parlé de vos tribunaux masculins, rendez-moi compte aussi de vos tribunaux féminins, et apprenez-moi comment les femmes rendent la justice dans ce pays. Elles la rendent avec beaucoup de lumières et d'équité, repartit Zindernein ; si ce n'est que quelques vieilles dévorées d'une soif insatiable du simao (c'est-à-dire, de l'or) souffrent qu'on en mettre quelquefois dans leur balance, et que les jeunes paraissant aussi quelquefois plus favorables aux plaideurs jeunes et bienfaits qu'à ceux qui sont vieux et laids. C'est un abus, répliquai-je, qui ne doit point être imputé au sexe de vos juges. Il est dans des pays où vos maximes ne sont point établies, des juges également suspects de ces petites prévarications, que l'éclat éblouissant du simao et de la beauté leur fait paraître excusables. Il n'est que trop vrai, repartit Zindernein, que les différends seront rarement bien jugés, tant qu'ils seront portés à des tribunaux humains. Plût au Ciel qu'Ossokia voulût prendre le soin de juger lui-même tous les débats, qui naissent trop souvent entre les mortels ! Nos femmes qui exercent la magistrature, ont beau dire qu'elles sont sur la Terre les images vivantes de leur déesse Ossok. Si cela est, Ossok, qui, à les en croire, les a fait telles, ne s'entend guère faire des portraits.
Il y a encore, poursuivit-il, dans cette île d'autres tribunaux féminins, chargés de maintenir le droit public, et de veiller sur l'administration des finances. Jamais règne ne fut plus doux, plus sage, plus équitable, que celui de notre auguste Reine, depuis qu'elle gouverne par elle-même. Aidés des seuls conseils de sa nourrice, dont tout le monde vante le zèle et le désintéressement, elle fait des efforts pour ranimer le commerce languissant, et rendre les peuples heureux. On se flatte que sa sagesse confondra l'orgueil d'une foule de Marajates, qui ont été bâtis des palais égaux au sien ; et qu'au moins son équité politique et les réduira à être un peu moins riches que les princesses de son sang. Car on a vu ici des Marajates de la plus basse extraction, sans mœurs et sans honneur, acquérir par des avances usuraires des richesses immenses, éclipser par leur magnificence les dames les plus illustres, s'approprier les plus hautes dignités et les plus belles terres, et avoir même l'odieuse ambition de devenir la tige d'une postérité de Paratis.
Il n'y a aujourd'hui d'autre impôt dans l'État, ajouta-t-il, qu'une capitation générale, proportionnée aux facilités de chaque personne : ce qui rend beaucoup dans épuiser l'État. Sous les règnes précédents, vingt mille Marajates, sous prétexte de lever les droits royaux, pillèrent les peuples, et n'en rapportaient pas le tiers au trésor de la Reine. Par un règlement nouveau est très sage, c'est aujourd'hui celle qui préside aux mystères d'Ossox en chaque ville, qui reçoit les revenues de l'État. Par ce moyen l'exactitude et la fidélité à payer les tributs légitimes est devenue une espèce de vertu religieuse, parce que ces ministres d'Ossox ont soin de prêcher aux peuples qu'ils seront punis par la déesse, s'ils médirent, sans s'être acquittés de ce devoir. Les personnes les plus qualifiées et les plus riches paient le plus ; chacun déclare ses facultés ; et comme il y a toujours beaucoup de vanité dans les femmes, on en voit qui paient de leur plein gré une capitation qui excède le tarif, dans la vue de passer pour plus riches qu'elles ne le sont en effet. Pour augmenter la félicité publique, toutes les marchandises étrangères ne paient plus aucun droit d'entrée dans cette île ; le commerce y est libre et florissant ; les banqueroutes n'y sont plus d'usage, parce que tout le corps des négociants a fait un fond public pour dédommager les marchands des pertes qu'elles ont faites, sans qu'il y ait eu de leur faute, et pour réparer les malheurs qu'elles n'avaient pu prévoir.
J'écoutais avec attention toutes ces particularités. Je ne pouvais comprendre que des femmes eussent eu des idées si sages, et que leur gouvernement fit honte à celui des hommes. Je souhaitai avec ardeur, non que les femmes gouvernassent en Angleterre, comme dans cette île ; mais que les hommes au moins y gouvernassent aussi bien, et suivissent des maximes si judicieuses. Pour moi je m'imagine que la raison principale qui fait que les femmes gouvernent si bien, est que lorsqu'elles ont l'autorité en main, elles se laissent conduire par les hommes. Au contraire lorsque des hommes commandent, ils suivent aveuglement les désirs et les conseils des femmes. Peut-être que dans l'île de Babilary les hommes commandent, comme en Europe ce sont les femmes qui gouvernent les plus souvent. Je communiquai cette pensée à Zindernein, qui me parut la goûter.
Le lendemain je lui dis que je voulais aller visiter la grande place de la Ville. Nous nous y rendîmes, et j'avoue que je vis une place qui n'a rien d'égal dans aucune des plus belles villes d'Europe. Elle est octogone et a trois cents toises de largeur ; toutes les maisons y font d'une architecture noble et d'une structure symétrique. Au milieu est la statue équestre de la reine Rafalu, qui régnait il y a cinquante ans, et qui a fait construire cette place superbe, autour de laquelle on voit les statues de toutes les femmes, qui depuis la Révolution se sont distinguées par un mérite rare. Ces statues représentent non seulement de grandes générales d'armées, mais de savants jurisconsultes, de fameuses mathématiciennes, des femmes illustres, ou poètes, ou oratrices, etc. À chaque côté de l'octogone est placée une académie. La première regarde les Mathématiques ; la seconde, la Physique ; la troisième, la Morale ; la quatrième, l'Histoire ; la cinquième, l'Eloquence et la Poésie ; la sixième, la Peinture, la Sculpture et l'Architecture ; la septième, la Musique ; la huitième, les Mécaniques en général. Toutes ces académies sont remplies de personnes d'un mérite distingué. Les dames de la première qualité y sont quelquefois admises, moins pour leur naissance et leur rang, que pour leur mérite personnel et leur savoir. Chaque académicienne, avant que d'être reçue, est obligée d'avoir donne une preuve publique de sa capacité.
CHAPITRE 7. — Mejax, gouvernante du premier port de l'île, est amoureuse de l'Auteur, qui devient aussi amoureux d'elle ; elle l'enlève, délivre en même temps tous ses compagnons de l'esclavage, et s'enfuit avec eux sur un navire qu'elle avait fait préparer.
Quoique je fusse souvent dans la compagnie de Zindernein, il me quittait quelquefois, pour aller donner ses ordres au sérail. Pendant ce temps-là je n'étais point seul : j'avais toujours une cour nombreuse, composée de femmes et d'hommes. Quelquefois aussi je m'entretenais en particulier avec quelques dames distinguées par leur naissance et par leur dignité. Celle qui paraissait la plus assidue à me faire sa cour, était la gouvernante du port de Pataka, situé à deux lieues de la ville royale : femme d'une très haute naissance, riche, jeune, vive, spirituelle, d'une beauté parfaite, et d'un caractère très aimable. Elle me plaisait tellement, que j'étais devenu insensible à la gloire d'épouser la Reine. Mais je ne pouvais, sans blesser les règles de la bienséance, lui déclarer mes sentiments ; je connaissais aussi, combien il était dangereux pour moi de les avoir ; d'autant plus que je m'étais aperçu qu'elle sentait pour moi ce que je sentais pour elle. Malgré ces réflexions, je prévis que mon cœur ne pourrait longtemps se défendre contre un si charmant objet.
Elle entra mon appartement une fois que tout le monde en était sorti, et que j'étais resté seul avec quelques esclaves, qui aussitôt qu'ils la virent, se retirèrent par respect. Mejax — c'est ainsi qu'elle s'appelait — profita de ce moment, pour me dire d'un air tendre, qu'elle était bien malheureuse que je fusse si beau ; que mes charmes, qui lui avaient fait naître des sentiments respectueux, la mettaient hors d'état de pouvoir jamais être heureuse, puisqu'ils avaient touché le cœur de la Reine. Hélas, ajouta-t-elle d'un ton animé, pourquoi faut-il que vous ayez entré dans le sérail de Sa Majesté ? Que ne l'ai-je prévenue, que vos perfections n'ont-elles échappées à Zindernein ? Que me l'ai-je gagné au moins, lorsqu'il débarqua dans l'île, après la prise de votre vaisseau ! Seule j'aurais eu le bonheur de vous connaître, et peut-être de vous plaire.
Comme cette déclaration me faisait un extrême plaisir, je ne jugeai pas à propos de me contrefaire, en feignant la sévérité simulée des femmes d'Europe, qui dans ces occasions délicates affectent d'ordinaire de se mettre en courroux. Puisque vous me faites, répondis-je, un aveu si tendre et si libre, mais que je crois sincère, je ne ferai point difficulté de vous avouer à mon tour, que je sens tout le prix de vos sentiments ; que votre mérite fait sur moi une vive impression, et que si Sa Majesté ne m'avait pas destiné à la gloire d'être son époux, je me serai cru très heureux d'être à vous, et de pouvoir épouser ; d'autant plus que cet établissement, quoique moins glorieux, aurait été peut-être plus solide et plus durable. Mais il n'y faut plus penser. Étouffez des désirs qui offensent ma gloire, et qui vous peuvent devenir funestes.
Ah, cruel, répliqua-t-elle, voulez-vous causer ma mort ? La Reine ne vous a point encore donné sa main ; vous pouvez me rendre heureuse sans détruire votre bonheur ; épousez la Reine, puisqu'il le faut, et que je ne puis m'opposer à l'accomplissement de votre destin, mais souffrez au moins mon amour et mes tendres respects, et laissez moi me flatter que votre cœur les avoue.
Jamais je ne vis tant de passion dans une femme que Mejax m'en témoigna dans ce moment. Comme de côté je brûlais d'amour pour elle, il me prenait de temps en temps envie de suivre les mœurs de ma patrie, et de me comporter en galante homme et en Européen. Tantôt la nature m'avertissait que j'étais homme : tantôt le lieu et l'état où j'étais me le faisaient oublier ; en sorte que j'étais extrêmement embarrassé de mon rôle d'homme féminisé, ne sachant si je devais témoigner de la hardiesse ou de la crainte, de la vivacité ou de la retenue. Cependant Mejax continuait de me tenir les discours les plus tendres et les plus animés, et je continuais de défendre ma vertu qu'elle s'efforçait de séduire. Je prie les dames anglaises de me pardonner ces images et ces expressions contraires à nos mœurs, mais conformes à celles de l'île de Babilary, et à la situation équivoque, où j'étais alors.
Cependant il me vint dans l'esprit de profiter de la disposition de Mejax, et de sa passion violente ; non pour la satisfaire et contenter la mienne, mais pour recouvrer ma liberté, s'il était possible. Mejax, lui dis-je, il est impossible que j'accorde jamais rien à vos vœux, ni que je souffre que vous soupiriez désormais pour moi. Dès que j'aurai eu l'honneur d'entrer dans le lit de la Reine, si vous avez la témérité de m'entretenir encore de votre passion, vous vous verrez à jamais bannie de ma présence. Cependant je ne vous cache point que je vous aime tendrement, et que malgré le sort glorieux qui m'est réservé, je ne souhaiterais rien avec plus d'ardeur, que de me voir votre époux. Après tout ce ne serait point un désir stérile et chimérique, si de votre côté vous aviez le courage de la seconder et de choisir l'un des deux partis que j'ose vous proposer. Le premier, serait de détourner la Reine, s'il était possible, du dessein qu'elle a formé de me donner la main. En vous sacrifiant l'illustre rang, que Sa Majesté me destine, c'est vous prouvez assez combien vous avez su me plaire : mais comme ce moyen vous semblera peut-être impraticable, et qu'il est dangereux d'entreprendre de guérir le cœur passionné d'une princesse, j'aime mieux vous proposer un autre parti. Vous êtes la gouvernante du port de Pataka, et tout ce qui est dans ce port dépend de vous. Ordonnez qu'on y arme incessamment un vaisseau, sur lequel je monterai secrètement avec vous ; et alors m'ayant soustrait à la puissance de la Reine, je remplirai vous vœux et les miens, sans craindre de nous perdre l'un et l'autre. Je sais qu'il vous en coûtera tous les biens et tous les titres que vous possédez en cette île, dont par cette démarche vous vous bannissez pour toujours : mais si vous m'aimez véritablement et sans réserve, votre générosité vous coûtera moins.
Mejax, qui m'avait écouté avec attention, tomba dans une rêverie profonde : après avoir été longtemps sans parler, elle rompit son silence en soupirant, et me répondit qu'il s'agissait de prendre une résolution bien étrange, mais que le vrai amour ne connaissait ni politique, ni intérêt, ni dangers ; que puisque j'avais le courage de lui sacrifier la main de la Reine, elle devait avoir celui de me sacrifier ses richesses et ses honneurs ; qu'il n'y avait point de périls, où elle ne fût résolu de s'exposer, pour me marquer la reconnaissance qu'elle avait de mes bontés pour elle ; que son parti était pris ; que comme je devais incessamment épouser la Reine, il n'y avait point de temps à perdre, et qu'elle ferait ses efforts pour m'enlever la nuit du jour suivant, et me mettre sur un vaisseau, qui heureusement était prêt à lever l'ancre dans la rade de Pataka.
Ce n'est point assez, lui dis-je ; il faut que vous m'accordiez la liberté de tous mes compagnons de voyage, esclaves de plusieurs habitants de cette ville, qui les ont achetés. Je souhaite qu'ils montent avec nous sur le vaisseau, et qu'une partie de mon bonheur puisse rejaillir sur eux. J'exécuterai tout ce que vous exigez de moi, répondit-elle, je veux vous conduire triomphant dans votre patrie, trop heureuse de passer avec vous le reste de ma vie dans les terres les plus éloignées.
Comme je savais la demeure du capitaine Harrington, qui était venu me saluer, depuis qu'il avait appris mon sort, j'en instruisis Mejax, qui me promit de l'envoyer chercher secrètement, et de l'avertir de se trouver sur le chemin de Pataka, le jour suivant, avec tous ceux de ses compagnons captifs qu'il pourrait rassembler. Alors elle me quitta, en me jurant un amour éternel et une fidélité inviolable, et alla donner ordre à tout pour notre départ.
Je passai le reste de la journée dans une extrême agitation causée par la crainte que notre complot ne put réussir ; car en ce cas je prévoyais les plus affreux malheurs. J'aurais été perdu, aussi bien que Mejax, et j'aurais eu à me reprocher d'avoir été le téméraire auteur de sa perte. De peur de me trahir malgré moi, et afin de cacher mon trouble aux yeux importuns d'une Cour clairvoyante, je jugeai à propos de supposer une indisposition et de me mettre au lit. Dans cet état d'inquiétude et de perplexité j'étais en quelque sorte — s'il m'est permis d'employer cette bizarre comparaison — tel que l'auteur d'une tragédie nouvelle, qui va être représentée pour la première fois sur le théâtre de Londres ; caché au fond d'une loge obscure, agité tour à tour par l'espérance et par la crainte, dès que la pièce est commencée, il est rempli de joie, ou de tristesse, selon les divers mouvements des spectateurs, dont dépend son sort. Les ris l'affligent, les pleurs le réjouissent. Le désir du succès le transporte, l'appréhension de la chute le glace : il flotte dans l'incertitude jusqu'au cinquième acte qui décide de son sort. Hélas ! rien n'était plus tragique que pour moi que ce que j'avais osé tramer. Il s'agissait de recouvrer ma liberté, et de me voir bientôt avec Mejax au comble de mes vœux, ou de nous voir l'un et l'autre livrer à la vengeance redoutable d'une reine méprisée et trahie.
Tandis que j'étais dans ce cruel état, la Reine alarmée de ma prétendue indisposition, me fit l'honneur de me venir voir, accompagnée de Zindernein ; l'époux qu'elle avait depuis un an, venait d'être remercié, et reconduit dans le sérail ; en sorte qu'elle attendait avec une extrême impatience le jour destiné à la célébration de son nouveau mariage. M'ayant trouvé fort abattu, elle craignit que mon indisposition ne retardât l'accomplissement de ses désirs. Sa Majesté me parla avec beaucoup de bonté et d'affection ; et je ne puis dissimuler qu'en ce moment je sentis quelques remords de ma perfide ; ce qui fut pour moi un nouveau surcroît de peine, qui augmenta mon trouble. Mais le désir de la liberté, l'espoir de revoir ma patrie et ma famille, et la passion violente que je sentais pour l'adorable Mejax, eurent plus de force que ma sensibilité et ma reconnaissance, et je persistai constamment dans le périlleux dessein de me faire enlever.
Sa Majesté me pria de vouloir bien avoir soin de ma santé et de ne me point lasser abattre ; et après m'avoir témoigné le tendre intérêt qu'elle prenait à ma guérison, elle sortit avec un air triste et inquiet, et me laissa avec Zindernein. J'avais conçu pour lui beaucoup d'estime et d'amitié ; en sorte que l'idée d'en être bientôt séparé redoubla ma tristesse et me peine. J'aurais voulu lui pouvoir faire confidence de mon projet, et lui persuader de me suivre ; mais je n'osai lui en parler, craignant que sa vertu austère et sa fidélité incorruptible ne mît un invincible obstacle à l'accomplissement de mes desseins. J'apprendrais aussi à commettre mon amante à qui j'avais tant d'obligation, et que j'aimais de l'amour le plus tendre et le plus vif.
Les Rebecasses de la Reine — ce sont des femmes savantes qui exercent la médecine — entrèrent alors dans ma chambre, et après m'avoir tâté le pouls, qu'elles trouvèrent très agité, se mirent à consulter entr'elles sur ma prétendue maladie. Les unes soupçonnèrent que j'avais un abcès dans la tête, les autres dirent que j'avais des squirres dans le foie, les autres que c'était une indigestion. L'une me voulait faire saigner au pied, et l'autre me faire prendre une espèce d'émétique. Si j'avais déféré à leurs avis, j'aurais pris mille remèdes, et j'aurais peut-être eu le sort de tant de princes et de seigneurs d'Europe, dont un zèle excessif pour la conservation de leur précieuse vie a souvent procuré la mort. Je déclarai hautement à toutes les Rebecasses que je n'étais point malade, et que ma légère indisposition serait bientôt guérie sans leurs secours.
En effet je me levai le lendemain et m'entretins d'abord avec Mejax, qui vint me voir le matin. Elle me dit que tout était préparé ; qu'elle avait donné ses ordres, qu'Harrington était averti, et lui avait promis de se trouver le soir avec tous ses Anglais sur le chemin de Pataka ; elle ajouta, qu'elle ne voyait aucun obstacle au succès de l'entreprise ; que l'après-dîner je proposerais une partie de promenade en calèche du côté de Pataka, que Zindernein et elle aurait l'honneur de me tenir compagnie... Eh quoi, interrompis-je, est-ce que Zindernein est du complot ? Non, me répondit Mejax ; mais vous ne pouvez, selon la bienséance, faire une partie de promenade avec moi seule, sans un homme qui vous accompagne ; et cet homme, qui ne peut être suspect à la Cour, sera Zindernein. Lorsque nous serons près du port, plusieurs de mes femmes qui nous suivront à cheval, mettront l'épée à la main, à un certain signal dont je suis convenue avec elles. Aussitôt Harrington, que j'ai instruit de tout ce qu'il avait à faire, paraîtra avec tous ses gens bien armés. Joints à nos femmes, ils dissiperont aisément la garde royale, et bientôt nous étant rendus au port, nous monterons sur le vaisseau prépare, et nous renverrons Zindernein. Le temps et le lieu sont marqués pour l'exécution, et si Harrington est fidèle à la parole qu'il m'a donnée et a du courage, notre entreprise ne peut manquer de réussir. Puisque Harrington vous a donné sa parole, lui répartis-je, vous pouvez compter sur lui et sur ses gens ; il n'est pas homme à reculer ; il est d'ailleurs trop intéressé, ainsi que tous ses compagnons, au succès de l'entreprise.
J'affectai de faire paraître beaucoup de gaieté le reste de la journée, et toute la Cour me fit des compliments sur le rétablissement de ma santé. On me fit l'honneur de me dire que mon indisposition de la veille m'avait embelli, et on se moqua fort des Rebecasses, qui avaient voulu épuiser sur ma personne toutes les ressources de leur art.
Mais pendant que toute la Cour se réjouissait de ma prétendue convalescence, et qu'elle s'entretenait avec plaisir des superbes préparatifs ordonnés pour la cérémonie de mon auguste mariage, la nouvelle d'un accident funeste plongea les espoirs dans une triste extrême, par la crainte de l'impression fâcheuse que ce malheur pouvait faire sur Sa Majesté. Le beau et infortuné Sivilou, qui s'était flatté de l'honneur d'épouser la Reine préférablement à tous les autres, craignant pour ses charmes quelque déchet, par le retardement d'une année, honteux de se voir frustré de son attente, et se figurant peut-être que Sa Majesté extrêmement amoureuse de moi, pourrait me retenir longtemps auprès d'elle, s'était abandonné au dernier désespoir, et dans les transports de sa douleur extrême, augmentée par sa mélancolie naturelle, il s'était pendant la nuit plongé un poignard dans le sein ; en sorte qu'on l'avait trouvé le matin baigné dans son sang et sans vie. On apprendrait que la Reine qui paraissait l'aimer tendrement, et qui avant qu'elle m'eût connu, avait été dans la disposition de l'épouser cette année, ne fût vivement frappée de sa mort tragique dont elle était la cause, et que comme elle avait le cœur très bon, elle ne s'abandonnât trop à ses regrets. Mais Sa Majesté ayant appris cet accident en fut bien moins affligée, qu'une dame anglaise ne l'est d'ordinaire de la mort de son chien favori. Cette médiocre sensibilité de la Reine, fut une preuve éclatante de l'empire que j'avais sur son cœur.
Sur le soir Mejax s'étant rendue auprès de moi, comme en était convenue, je proposai à Zindernein d'aller nous promener tour trois vers Pataka. Bientôt après nous montâmes en calèche, suivis d'une vingtaine de gardes, auxquelles se joignirent sur le chemin de cinquante cavalières, qui firent semblant de vouloir prendre part au plaisir de la promenade, et avoir l'honneur de nous escorter. Cependant j'étais très inquiet, aussi bien que Mejax ; et Zindernein ne savait à quoi attribuer la morne silence que nous gardions l'un et l'autre. Il nous voyait jeter sans cesse les yeux ça et là, et il remarquait dans nos regards une espèce de trouble et de crainte, qu'inspirent toujours les entreprises hardies et périlleuses.
Lorsque nous fûmes à la vue du port, près d'un petit bois, nous en vîmes sortir un grand nombre d'hommes, qui vinrent au-devant de nous. Les gardes royales parurent surprises de voir un si grand nombre d'hommes, sans avoir aucune femme parmi eux, et ne purent s'empêcher d'en rire. Mais elles furent bien autrement étonnées, lorsqu'à un certain signe que fit Mejax, elles virent tous ces hommes, dont elles se moquaient, tirer des sabres de dessous leurs robes, et s'avancer d'un menaçant et guerrier. La garde voulut fondre sur eux ; mais toutes les autres cavalières, qui étaient du complot, ayant mis le pistolet à la main, les arrêtèrent, et bientôt après les mirent en fuite.
Zindernein paraissait au désespoir, et voulait se donner la mort. Mais Mejax lui déclara en ce moment qu'elle avait résolu de m'enlever pour m'épouser dans une terre étrangère. Elle lui conseilla de nous suivre ; aussi bien, lui dit-elle, la Reine qui vous a confié le soin de ce beau garçon, ne vous pardonnera jamais son enlèvement. Elle vous croira complice de mon attentat, ou au moins coupable de négligence et de lâcheté. Le moins vous puisse arriver, sera de perdre votre charge avec ses bonnes grâces. Pour l'ébranler davantage, je lui dis que quand la Reine l'excuserait, et qu'il se pourrait justifier auprès d'elle, il ne devait point rester dans un pays où les hommes étaient indignement dominés par les femmes. Ne vous ai-je pas vu, ajoutai-je, gémir de ce honteux renversement des lois de la Nature ? Venez avec nous ; et souffrez d'être conduit avec moi en Angleterre, où vous serez honoré comme vous le méritez. J'ai fait mettre sur le vaisseau, interrompit Mejax, une cassette pleine de pierreries ; ainsi en quelque lieu nous fassions notre séjour, nous serons toujours heureux, parce que nous serons riches. Je partagerai mes richesses avec vous, et Gulliver qui vous aime et que vous aimez fera votre bonheur.
Zindernein ayant fait quelques réflexions, nous dit, que c'en était fait, qu'il était résolu de nous accompagner ; qu'aussi bien il y avait trop de danger pour lui à rester dans l'île ; que comme il n'avait point d'enfants, rien ne l'attachait à ce séjour, et qu'il suivrait volontiers notre destinée.
Étant tous arrivés au port, nous mîmes pied à terre ; nos Anglais arrivèrent presqu'aussitôt que nous, et toutes les cavalières ayant alors quitté leurs chevaux, se mirent dans une chaloupe et allèrent s'emparer du vaisseau qui était à l'ancre. Ils y firent ensuite entrer tous nos Anglais. Les matelots et toutes les femmes de l'équipage voulurent en vain faire quelque résistance : Mejax ayant paru, tout plia sous ses ordres, et les cavalières avec nos matelots demeurent les maîtres du vaisseau, sur lequel nous montâmes aussitôt Mejax, Zindernein et moi. En même temps on leva l'ancre et on tira du côté de l'Est. Il fut arrêté que Mejax aurait le commandement du navire pendant toute la route, et qu'Harrington serait capitaine en second. Nos matelots furent seuls chargés de la manœuvre, sous la conduite de notre pilote, homme habile et expérimenté ; et les femmes babilariennes furent chargées du soin de nous défendre, en cas qu'on vînt nous attaquer.
CHAPITRE 8. — La Reine de Babilary envoie deux vaisseaux à la poursuite de Mejax. — Combat sanglant. — Mejax victorieuse est blessée et meurt. — Le vaisseau mouille à une île. — Danger où l'Auteur se trouve.
Nous n'avions pas le vent fort favorable, et le lendemain de notre départ, nous étions encore qu'à six lieues du port, lorsque nous vîmes de loin deux vaisseaux qui nous poursuivaient. Nous redoublâmes nos voiles, et résolus de nous abandonner au vent, nous gouvernâmes au sud, le vent soufflant du nord. Cependant les deux vaisseaux nous poursuivaient toujours, et comme ils étaient plus légers que le nôtre, nous les voyons s'approcher sensiblement. Nous jugeâmes qu'ils nous atteindraient avant la fin de la journée, et nous nous préparâmes au combat. En effet sur les quatre heures du soir, ils nous joignirent, et nous vîmes alors, comme nous l'avions pensé, que c'étaient deux vaisseaux babilariens, montés par des femmes selon l'usage du pays.
Lorsque les deux vaisseaux furent près de nous, ils nous envoyèrent une chaloupe pour signifier les ordres de la Reine, et nous sommer de rentrer dans le port ; en cas de refus on menaça de nous attaquer. Nous déclarâmes que nous n'obéirions point, et que nous étions résolus de nous défendre si on nous attaquait. Cependant nous étions tous rangés sur le pont : Mejax à la tête de toutes les femmes de sa suite, le sabre à la main : Harington et moi à la tête de tous les hommes de l'équipage, qui n'étaient occupés ni au canon ni à la manœuvre. Après plusieurs volées de canon tirées de part et d'autre, les deux vaisseaux ennemis nous accrochèrent, et on en vint à l'abordage. Le combat fut terrible et sanglant ; Mejax fit des prodiges de valeur, aussi bien que toutes les femmes qui combattaient avec elle. Comme le fort de l'attaque était de son côté, nous nous mêlâmes tous, hommes et femmes, et je combattis avec fureur à côté de Mejax, qui paraissait moins craindre pour elle que pour moi. Enfin nous repoussâmes les ennemis, qui désespérant de nous vaincre, et craignant que nous n'entrelaçassions dans leurs vaisseaux, et que nous nous n'en rendissions les maîtres, jugèrent à propos de s'éloigner.
Cependant nous n'avions perdu que quatre hommes et dix femmes, qui avaient été tués en combattant courageusement, et nous n'avions qu'environ vingt blessés tant hommes que femmes. Mais ce qui me perça de douleur, fut de voir Mejax toute couverte de son sang. Elle avait toujours combattu jusqu'à la fin, et l'ardeur du combat l'avait empêchée de s'apercevoir de trois coups d'épée qu'elle avait reçues, dont le plus dangereux lui avait percé les deux mamelles, depuis le côté droit, où le coup avait été porté, jusqu'au côté gauche. Notre chirurgien ayant visité ses plaies, m'assura qu'elle n'en réchapperait point ; elle-même sentit qu'elle n'avait plus que peu de temps à vivre. Je ne la quittai point dans cette extrémité : comme elle me vit répandre beaucoup de larmes, elle prit soin elle-même de me consoler.
Pouvais-je prétendre, me dit-elle, à une mort plus glorieuse ? Je péris, il est vrai, les armes à la main contre ma souveraine : mais est-ce un crime à une sujette de disputer à sa reine l'empire d'un cœur ? J'ai défends ma conquête ; l'amour a secondé ma valeur ; j'ai vaincu : le Ciel ne permet pas que je cueille le fruit de ma victoire. Vivez, adorable Gulliver ; je meurs, hélas ! dans la crainte de vivre toujours dans votre cœur. Je me sens affligée des vifs regrets que ma mort vous causera. Efforcez-vous, je vous prie, de m'oublier, et livrez-vous dans la suite à tout ce qui pourra effacer de votre mémoire le souvenir douloureux de la tendre Mejax. Que m'importera d'être dans votre esprit, lorsque je ne serai plus rien. Vos regrets ne me rappelleront pas à la vie, et ne serviront qu'à troubler le vôtre.
Au milieu de ces adieux héroïques, elle me donna toutes ces pierreries, en me conseillant de les vendre, lorsque j'en trouverais l'occasion, de peur que la vue de ce présent ne me rappelât la triste idée de celle qui m'avait tant aimé. En même temps elle recommanda à ses femmes de me suivre partout, et de me défendre courageusement contre tous les ennemis qui voudraient m'attaquer. Peu de temps après elle expira, regrettée de toutes les femmes de sa suite et de tout notre équipage anglais, que sa générosité avait tiré d'esclavage, et que sa valeur avait empêché d'y retomber.
Je fus extrêmement affligé de sa mort, et il me fut impossible d'atteindre à cette insensibilité philosophique qu'elle m'avait recommandée en mourant. Je perdais une bienfaitrice généreuse et une amante accomplie. Harington et Zindernein n'omirent rien d'adoucir ma douleur, qui pendant trois jours me fit verser un torrent de larmes. Il fallut me contraindre dans ces premiers jours à prendre un peu de nourriture pour me soutenir ; je souhaitais de rejoindre Mejax, et la vie m'était devenue odieuse. Toutes les femmes qui étaient sur le vaisseau admirèrent la bonté de mon cœur, et redoublèrent leur attachement pour moi.
Cependant nous cinglions toujours du côté du sud, où le vent nous portait, et nous tâchions de découvrir quelque île, pour y faire eau, parce que notre vaisseau avait été armé à la hâte, et que notre départ précipité ne nous avait pas donné le temps de nous en fournir suffisamment. Enfin au bout de huit jours, nous en découvrîmes un forte petit, et ayant conjecture que c'était une des Moluques, nous résolûmes d'y mouiller. Nous entrâmes dans une petite baie, qui était à l'ouest de cette île, et une partie de nos hommes et de nos femmes s'étant mise dans la chaloupe, nous descendîmes à terre.
Nous avançâmes environ une demie-lieue, pour tâcher de découvrir quelque source, et ayant approchés d'un bois, qui était près d'une montagne, nous nous écartâmes un peu les uns des autres. Harington alla d'un côté avec dix ou douze Anglais, et moi de l'autre avec environ autant de femmes, sans aucun homme. Les Babilariennes qui avaient un extrême attachement pour moi, ne voulurent point me laisser aller avec les Anglais, me croyant plus en sûreté avec elles. Nous étions tous bien armés, et en état de nous défendre, en cas que nous eussions été attaqués par les insulaires. Cependant nous marchions avec beaucoup de précaution, et nous tâchions de nous tenir sur nos gardes.
À peine ma petite troupe eut-elle fait un quart de lieue le long du bois, qu'elle fut aperçue par une centaine de sauvages, qui étaient assis sur le sommet de la montagne. Aussitôt nous les vîmes descendre rapidement, et accourir de notre côté. Comme ils étaient en plus grande nombre que nous, et la partie ne paraissait pas égale, nous jugeâmes à propos de nous retirer à la hâte du côté du rivage. Mais ils nous coupèrent le chemin. Nous vîmes alors de grands hommes nus, dont la plupart avaient plus de six pieds de hauteur, qui n'avaient ni barbe ni poil, mais la peau toute rouge.
Nous ayant enveloppés, ils menacèrent de nous assommer, si nous ne nous rendions pas. Ayant même tiré quelques flèches, ils blessèrent deux de nos Babilariennes. Aussitôt ils se jetèrent sur nous, nous désarmèrent, et se mirent à nous dépouiller. Comme j'étais à la tête de la troupe, je fus le premier qu'ils désarmèrent et à qu'ils ôtèrent les habits. Mais quelle fut leur surprise, lorsqu'ils virent que les autres qui m'accompagnaient étaient des femmes, dont la plupart étaient jeunes et assez jolies. Cette découverte parut les réjouir beaucoup, et ils se mirent tous à rire et à danser.
Cependant je fus attaché à un arbre, avec des branches d'osier, et je fus alors le triste spectateur d'une scène horrible. Ces sauvages grossiers, semblables aux satyres fabuleux de l'antiquité, se jetèrent impitoyablement sur les femmes, et satisfirent avec tant de fureur leur passion toujours renaissante, que les malheureuses victimes de leur brutalité succombèrent pour la plupart et s'évanouirent entre leurs bras. Comme ils n'étaient occupés que de l'assouvissement de leurs désirs, et qu'ils ne faisaient aucune attention à moi, je détachai peu à peu l'osier qui me tenait lié, et m'étant glissé dans le bois, sans qu'ils s'en aperçussent, je me mis à courir de toute ma force vers le rivage, où j'aperçus avec une grande consolation la chaloupe qui le côtoyait.
Dès que nos gens me virent, ils s'approchèrent de terre, et étant aussitôt sauté dans chaloupe, je leur racontai le péril où j'avais été, et le malheur arrivé aux Babilariennes, qui m'accompagnaient. Nous jugeâmes à propos quelque temps dans la baie et de côtoyer encore le rivage, pour voir si nos compagnes ne pourraient point avoir le même que moi, et s'échapper des mains des barbares. Mais nous attendîmes en vain, et nous nous rendîmes à bord.
Les Babilariennes qui étaient restées dans le vaisseau, ayant appris ce qui était arrivé à leurs compagnes, en voulurent tirer vengeance, et prièrent le capitaine de les mettre à terre, pour aller attaquer les insulaires. On tint conseil, et comme nous n'avions pu faire eau dans cette île, il fut délibéré qu'il fallait tout risquer. Nous descendîmes donc à nombre de cent trente, dont il y avait quarante femmes et quatre-vingt-dix hommes, tous armés de sabres, de fusils et de baïonnettes.
Nous marchâmes en bon ordre vers l'endroit où les sauvages nous avaient surpris, et n'y trouvâmes que deux Babilariennes mortes de leurs blessures. Nous allâmes alors vers la montagne, et montâmes jusqu'au sommet, où nous découvrîmes plusieurs cabanes. Nous ne doutâmes point que cet endroit ne fût le lieu de la retraite des sauvages ; cependant il y régnait un grand silence. Nous nous approchâmes, sans faire de bruit, et nous aperçûmes d'abord quelques insulaires endormis. Nous pénétrâmes plus avant et nous vîmes de loin nos Babilariennes liées ensemble et couchées près d'une cabane. Nous marchâmes de leur côté, et aussitôt quelques sauvages qui n'étaient point endormis, se mirent à hurler de toute leur force, et à faire un bruit qui réveilla tous leurs compagnons.
À l'instant nous fondîmes sur eux, et ayant cassé la tête aux premiers, les autres prirent la fuite. Mais nos Babilariennes ayant entouré l'habitation, les arrêtèrent, et en massacrèrent un grand nombre. Les prisonnières qui furent aussitôt délivrées par nos Anglais, ayant repris leurs habits, et s'étant saisies de leurs armes, qui'ils retrouvèrent dans la cabane prochaine, se joignirent à nous, et achevèrent la défaite des barbares. Comme elles étaient transportées de fureur, elles voulurent réserver pour un supplice cruel ceux qui leur avaient paru les plus ardents à les tourmenter. Elles en lièrent dix, qu'elles conduisirent sur le rivage, où, malgré nous, elles les brûlèrent sans pitié.
Après cette expédition, nous nous avançâmes dans le bois le long de la montagne, et nous trouvâmes une fontaine où nous étanchâmes notre soif, et où nous fîmes conduire des tonneaux pour les remplir d'eau. Pendant qu'une partie de nos gens était occupée à cela, les autres se mirent à chasser dans le bois, où ils tuèrent beaucoup de gibier, qui ayant été porté à bord, servit à célébrer notre victoire.
Nous ne jugeâmes à propos de rester plus longtemps dans cette île, de crainte que quelque nouvelle troupe d'insulaires ne vînt nous attaquer, et que leur nombre ne nous accablât. Nous nous retirâmes donc tous à bord, après y avoir fait conduire nos tonneaux remplis d'eau, et nous levâmes l'ancre.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
* Voir les Métamorphoses d'Ovide, livre VIII. [Publius Ovidius Naso, dit Ovide (43 avant J.-C. - 18 ap. J.-C.).]
† C'est un Anglais qui parle conformément aux idées de sa nation.
‡ Anne Stuart qui régnait alors. [Celle-ci régna de 1702 à 1714.]
§ C'est un proverbe anglais.
PARTIE 2 : RELATIONS DES SÉJOURS DE JEAN GULLIVER À L'ÎLE
DE TILIBET ET, PAR LE SUITE, À L'ÎLE DE MANOUHAM.
CHAPITRE 1. — L'Auteur fait naufrage et se sauve dans un canot. — Il aborde à l'île de Tilibet, où il est fait esclave. — Description des mœurs de ces insulaires. — Leur vie courte, et l'usage qu'ils en font.
Le dessein d'Harrington, à qui j'avais fait part d'une partie des pierreries, que Mejax m'avait laissées en mourant, était de retourner en Angleterre, très satisfait de cet avantage beaucoup plus grand, que s'il avait ramené son vaisseau chargé de marchandises. Comme nous n'en avions aucunes sur notre navire, il nous aurait été inutile de nous rendre ailleurs ; je fus de son avis, et nous prîmes la route d'Europe. Au bout de six semaines de navigation, pendant lesquelles nous avions eû le vent assez favorable, nous fûmes accueillis d'une violente tempête, étant environ à douze degrés de latitude septentrionale, et cent quatre de longitude. Les vents déchaînés, après avoir brisé nos voiles, emportèrent notre mât de misaine, et celui de beaupré eut endommagé fort. Les vagues funestes ayant inondé notre navire, nous éprouvions suffire à pomper, et puisqu'il était heurté contre des rochers, il était fracassé et fait eau dans plusieurs endroits. Nous vîmes alors que le naufrage était inévitable.
Cependant les rochers contre auxquels nous nous étions brisés, nous laissâmes voir que nous n'étions pas éloignés de quelque terre, que l'obscurité nous empêchait de voir. Dans cet extrémité, nous jugeâmes à propos d'abandonner le vaisseau et d'échouer. Nous descendîmes la chaloupe, dans laquelle tout l'équipage, hommes et femmes, se jetèrent aussitôt. J'étais prêt de m'y jeter aussi, lorsque malheureusement il me vint en pensée d'aller chercher ma boîte de pierreries, qui était dans une armoire de la chambre du capitaine. Je courus donc vers cette armoire ; je l'ouvris, en tirai ma boîte. Mais à l'instant le vaisseau commença à s'enfoncer : je me crus perdu, et je me mis à courir de toute force pour gagner la chaloupe. Mais ceux qui étaient dedans, étaient si troublés, et il y avait parmi eux tant de confusion, que sans songer que je n'étais pas avec eux, ils coupèrent le câble qui attachait la chaloupe au vaisseau, et à l'instant la violence des flots les emporta si loin, qu'il ne leur fut plus possible de me secourir.
Dans ce péril extrême, je ne délibérai point, je sautai dans un des canots ; et sans perdre de temps, je coupai le câble qui l'attachait au vaisseau, qui un moment après s'abîme dans les flots. Ce fut en vain que je voulus ramer pour atteindre la chaloupe ; la mer était si agitée, et le temps si sombre, que je la perdis bientôt de vue.
Je ramai longtemps, sans savoir si je m'éloignais, ou si je m'approchais de la terre. Je ne songeais qu'à lutter contre les flots et à me garantir du naufrage. Cependant l'obscurité se dissipa peu à peu ; le vent tomba, et la mer devient assez calme. Je vis terre, et cette vue rendit aussi un peu le calme à mon âme. Je pris courage, et je ramai de toutes mes forces pour pouvoir aborder. Je me flattais de retrouver mes compagnons sur le rivage. Mais, hélas, je ne les ai jamais vus depuis, si ce n'est le capitaine Harrington, comme je dirai dans la suite. Ils furent engloutis dans les flots, et je ne cesserai jamais de regretter ces chers compagnons de voyage, surtout Zindernein, et les braves Babilariennes.
Après avoir ramé cinq heures, j'aborderai enfin et descendis à terre avant le coucher du soleil. Comme j'étais épuisé, je me mis à cueillir quelques fruits, que je trouvai heureusement à quelque distance du rivage. Je montai sur une éminence, d'où je vis des terres bien cultivées et aperçus quelques villages. Je jugeai alors que les habitants étaient policés ; ce qui me donna quelque consolation. Je voulus m'avancer du côté de ces villages ; mais la nuit me surprit en chemin, et ne sachant plus de quel côté aller, je m'arrêtai et montai sur un arbre, pour y passer la nuit à l'abri des bêtes féroces. On devine aisément que je dormis peu, et que je fis beaucoup de réflexions, dont je ferais part à mon lecteur, si les réflexions des malheureux n'étaient pas toujours ennuyeuses.
Le lendemain, dès que le jour commença à paraître, je m'éveillai au bruit de quelques chiens, que j'entendis aboyer autour de mon arbre. Je vis en même temps un jeune homme bienfait, portant un arc et un carquois, s'avancer de mon côté. Déjà il était assez proche, il se mettait en état de me tirer une flèche, lorsque je jetai un cri horrible. Le jeune homme, qui peut-être m'avait pris d'abord à travers les branches, pour quelque gros oiseau, ayant entendu le son d'une voix humaine, baissa aussitôt son arc et s'approcha tout auprès de l'arbre. Voyant que ce chasseur avait de l'humanité, je descendis, me jetai à ses genoux, et me mis en diverses postures suppliantes, pour lui marquer mon respect, ma soumission, et le besoin que j'avais de son secours.
Il me considéra quelque temps, et par plusieurs gestes gracieux, me fit connaître qu'il aurait soin de moi, et qu'il ne m'arriverait aucun mal. Cependant il m'ordonna de le suivre, et me montrant une maison, qui me semble grande et bien bâtie, il m'y conduisit. Étant entré, je vis une femme qui me parut la sienne, des enfants et des domestiques, qui tous me témoignèrent beaucoup de bonté, et m'offrirent à manger. Comme je portais ma boîte de pierreries sous mon bras, la dame du logis désira voir ce que c'était ; je la lui présentai, et je crus ne pouvoir me dispenser de la lui offrir en présent. Mais l'ayant ouverte, et ayant considéré ce qu'elle renfermait, elle me la rendit, sans daigner toucher aux diamants. Voyant que je la lui offrais honnêtement, et que je la pressais d'accepter au moins les diamants les plus précieux, elle se mit à sourire d'un air dédaigneux, en me faisant entendre que ce n'était pas là des choses dignes d'êtres offertes ni acceptées. J'appris dans la suite que les habitants de ce pays ne faisaient aucun cas des diamants, comme n'étant d'aucune utilité pour les besoins et les agréments de la vie : Étrange aveuglement, de ne pas connaître le prix de ces pierres luisantes, qui ayant le mérite de réfléchir la lumière plus vivement que les autres corps naturels, sont avec raison si estimées et si recherchées en Europe, que les femmes les préfèrent souvent à tout ce qu'elles ont de plus précieux.
Ayant fait entendre à mes hôtes, que j'étais un étranger d'un pays très éloigné, et que j'avais fait naufrage sur leur côte, ils parurent me plaindre, et tâchèrent de me consoler, en me faisant comprendre, qu'ils auraient de la bonté de moi, pourvu que je les servisse avec affection et avec fidélité. Peu de jours après on m'habilla comme les autres esclaves de la maison, et on me confia le soin des bains de Jalassou — c'était le nom de la maîtresse du logis — cet emploi me fit trembler, et je m'imaginai que puisqu'on me le confiait, on me destinait le sort des esclaves, qui chez les Turcs sont chargés d'un pareil soin. Mais ma crainte était mal fondée. Les hommes de ce pays, ainsi que je l'appris dans la suite, exempts de jalousie, ont une si haute idée de la vertu de leurs femmes, qu'ils ne prennent aucune précaution pour s'en assurer. Cette généreuse confiance des maris fait que les femmes en effet leur sont constamment fidèles, et n'abusent jamais d'une liberté, qui rendrait insipides pour elles des plaisirs criminels, dont la jalouse défiance d'un époux ombrageux est souvent le seul assaisonnement.
Il y avait à peine un mois que j'étais dans la maison, que je fus réveillé sur le minuit, ainsi que les autres esclaves, parce que Jalassou venait d'accoucher. Nous entrâmes tous dans son appartement pour être en état de la secourir, s'il était nécessaire. L'accouchement fut heureux, et ce fut un garçon qu'elle mit au monde. Mais quelle fut ma surprise, lorsque je vis l'enfant, dont elle venait d'accoucher depuis une heure, assis sur une chaise, ouvrant déjà les yeux, jetant des regards curieux de tous côtés, et articulant quelques mots que personne n'entendait. Au lieu de pleurer, comme tous les enfants qui viennent au monde, il riait, chantait, et témoignait la joie qu'il avait à se voir hors du ventre de sa mère, comme un prisonnier nouvellement élargi. Il paraissait charmé d'être sorti du néant et de se voir au nombre des créatures.
Je le vis aussitôt se lever, et courir vers sa mère, qui lui donna à téter. Quelques heures après, on fit venir un tailleur pour prendre sa mesure et lui faire un habit, qu'on ordonna d'achever le plus promptement qu'il serait possible, parce que l'enfant croissait et grossissait presque à vue d'œil, ce qui fut cause que tous les mois il fallut dans la suite lui en faire un neuf. J'admirais la Nature qui dans ce pays était si favorable aux hommes et qui les faisait vivre dès qu'ils naissaient.
Le même jour on fit venir un maître de langue pour apprendre à parler au nouveau-né. Ce maître ne faisait qu'articuler le mot qui signifiait une chose ; l'enfant le répétait après lui, et dès lors il savait pour ne le plus oublier. Aussi au bout de quinze jours, il parla comme tous les autres enfants de la maison. Je me servis de cette occasion favorable pour apprendre aussi la langue. Mais quelque heureuse qui soit ma mémoire, j'avoue qu'il me fallut beaucoup plus de temps pour apprendre tous les termes. Cependant au bout de trois mois, j'en sus assez pour me faire entendre, et pour comprendre tout ce qu'on me disait.
À peine pus-je expliquer mes pensées, que je demandai à un des esclaves, qui était le plus ancien et le plus accrédité dans la maison, si tous les enfants du pays étaient comme le dernier dont notre maîtresse venait d'accoucher ; si à cet âge ils apprenaient tous la langue aussi facilement, et si au bout de trois mois ils avaient l'esprit aussi ouvert et aussi formé. Que dites-vous, me répondit-il ? Celui-ci ne sait encore que la langue, tandis qu'il devrait savoir déjà un peu de danse et de musique : je fus assuré qu'à l'âge de deux ans, il ne saura pas encore faire ses exercices ; il est petit pour son âge, et il a à peine quatre pieds de hauteur. Les enfants, lui répliquai-je, croissent en bien peu de temps dans ce pays-ci. Est-ce que ce n'est pas de même dans le vôtre, me répartit-il ? Non vraiment, lui répondis-je. Par exemple qu'âge croyez-vous que j'ai ? Cinq ans, me répondit-il ; car vous paraissez à peu près de même âge que moi. Vous vous trompez, répartis-je, j'ai vingt ans. Ah Ciel, s'écria-t-il, vingt ans ! cela n'est pas possible. C'est l'âge le plus avancé où nous puissions parvenir. Au moins jamais aucun homme dans cette île n'a vécu au-delà de vingt-quatre ans, et cependant vous paraissez aussi jeune et aussi robuste que moi. L'ayant assuré que ce que je disais de mon âge était vrai, et que dans mon pays on vivait quatre-vingt, et quelquefois cent ans, il se leva et courut vers Furosolo — c'est ainsi que s'appelait notre maître — pour lui rapporter ce que je venais de lui dire.
Toute la famille se mit alors à me considérer, comme s'ils m'eussent vu pour la première fois. Ils ne pouvaient comprendre ce que je leur disais, et ils me firent cent questions pour s'assurer de la vérité. Un mathématicien habile qui était dans la maison, et qui enseignait les mathématiques aux deux derniers enfants, me demanda adroitement, si je me souvenais d'avoir vu dans mon pays quelques éclipses de soleil. Comme je me souvenais distinctement d'en avoir vu six, et que je n'avais oublié ni l'année, ni le mois, ni le jour, ni l'heure de ces éclipses, parce que dès ma première jeunesse j'avais aimé à me mêler un peu de tout ce qui se passe dans le ciel, je lui dis exactement ce qui ma mémoire me rappelait. Aussitôt il consulta son livre astronomique, il trouva que les éclipses devaient être arrivées au temps précis que je lui avais marqué. (C'est ainsi que les Chinois prétendent prouver, dit-on, l'antiquité de leur empire et l'authenticité de leur Histoire, en faisant voir que dans leurs anciens livres, il est fait mention de plusieurs éclipses conformes aux règles du mouvement des planètes, et en prouvant que les auteurs de ces livres ont dû les avoir vues, parce que ces livres existaient déjà dans un temps où leurs ancêtres ignoraient l'astronomie, et étaient incapables de faire avec justesses des calculs rétrogrades sur la combinaison antérieurement possible des mouvements célestes.)
Le mathématicien frappé de mes réponses, dit à la famille qu'il fallait que j'eusse effectivement l'âge je me donnais, et qu'il n'y avait plus lieu d'en douter. Qu'avez-vous donc fait, me dit mon maître, depuis tant de temps que vous vivez ? J'ai passé, lui répondis-je, les six ou sept premières années de ma vie, sans faire aucun usage ni de ma raison, ni de ma liberté. Je bégayais encore à trois ans ; à l'âge de quatre ans j'ai commencé à parler un peu, alors on m'a appris à lire et ensuite à écrire : après cela on m'a envoyé au collège, où j'ai étudié plus de sept ans.
Qu'étudiez-vous pendant un si long espace de temps, interrompit Furosolo ? J'étudiais, lui répondis-je, les langues latine et grecque. Ce sont apparemment, me répartit-il, les langues de quelques peuples voisins de votre pays ? Non, lui répliques-je ; ce sont les langues éteintes qu'aucun peuple ne parle plus. Pourquoi donc les faisait-on apprendre, me dit-il ? N'auriez-vous pas mieux employé votre temps à étudier des choses utiles à votre famille et à votre patrie, ou capables de vous rendre la vie plus agréable ? Je lui répondis, qu'il y avait des hommes parmi nous, qui consacraient les trois-quarts de leur vie à l'étude de ces langues ; qu'ils en apprenaient outre cela plusieurs autres également éteintes, telles que l'hébreu, le samaritain, le chaldéen ; qu'à la vérité ces linguistes n'étaient pas les savants les plus considérés parmi nous ; que nous faisions beaucoup plus de cas de ceux qui avaient le courage de passer toute leur vie à remplir leur mémoire de la date et des circonstances de tous les événements, et à apprendre tout ce qui s'était passé dans le monde, avant qu'ils y fussent, depuis la création de l'univers jusqu'à présent.
Que vous profitez mal de la longue vie que le Ciel vous a accordée, répartit Furosolo ! Je vous que quoique vous viviez quatre fois plus longtemps que nous, vous ne vivez pas davantage, puisque les trois-quarts de votre vie sont perdus. N'est-ce pas une folie de passer tant de temps à apprendre l'art d'exprimer une même chose en plusieurs termes différents ? Vous ressemblez à un ouvrier, qui au lieu d'apprendre son métier et de s'y perfectionner, emploierait un grand nombre d'années à mettre dans sa mémoire les noms différents que les anciens peuples donnaient aux instruments de sa profession. À l'égard de l'application sérieuse que vous donnez à l'Histoire, pourquoi vous mettez-vous tant en peine de ce qui est arrivé depuis le commencement du monde ? Ce qui se passe sous nous yeux n'est-il pas un spectacle suffisant pour nous occuper, ou nous amuser ? Que nous importe ce qui a été, lorsque nous n'étions point ? Le passé n'est plus ; s'en occuper, n'est-ce pas s'occuper de rien ? Le passé n'a pas plus de réalité que l'avenir, qui n'en a point encore, et je trouve qu'il est aussi inutile de songer à l'un, que de songer à l'autre.
Telle était la philosophie paradoxale de Furosolo, conforme aux idées singulières des habitants de cette île, appelé en leur langue Tilibet. Comme le peuple de cette île vit peu de temps, il met à profit ce court espace. Il ne songe qu'à jouir, sans se mettre en peine de connaître ; et il ne passe point, comme nous, un temps considérable de la vie, à faire des provisions superflues pour un voyage, qui est toujours achevé avant qu'elles soient entièrement faites.
Quelles sont encore les autres occupations des hommes de votre pays, me demanda une autre fois Furosolo ? Les uns, lui répondis-je, s'adonnent au commerce, les autres à la guerre, les autres... Quoi, interrompit-il, vous faites assez peu de cas de votre longue vie, pour vous exposer à la perdre dans les combats ? Nous, dont la vie est si courte, nous regardons néanmoins la guerre comme une folie, quoique nous ne laissions pas de la faire quelquefois, lorsqu'il s'élève entre nous quelque division. Mais si nous pouvions espérer de vivre aussi longtemps que vous, je suis assuré que personne parmi nous ne serait assez insensé, pour risquer un bien si précieux et si durable. Je vous que ces jours trop longs vous sont à charge, et que vous cherchez tantôt à en dissiper une partie, et tantôt à vous en délivrer tout à fait.
Ce que vous dites n'est que trop vrai, répondis-je. Nous jugeons que le plus grand malheur qui nous puisse arriver, est d'être réduit à penser que nous sommes : pensée, qui nous détruit en quelque sorte. C'est pour cela que nous nous formons mille occupations différentes, afin d'éviter cette affreuse idée, qui n'est autre chose que l'ennui, que nos philosophes définissent : «l'attention aux parties successives de notre durée». J'eus assez de peine à faire comprendre à Furosolo ce que c'était que l'ennui ; parce que, comme ces peuples ne s'ennuyaient jamais, ils n'ont point de termes en leur langue pour exprimer cette maladie de l'âme, et n'en ont pas même la première idée. Ils ne sont pas, comme une grande partie des Européens, mélancoliques par tempérament, et tristes par caprice. La joie et la satisfaction de leurs âmes est empreinte sur leurs visages toujours ouverts et sereins ; et ils semblent pratiquer à la lettre, le précepte d'Horace : Dona præsentis rape lætus horæ (‡). Occupés du présent qui les remplit, ils oublient le passé et méprisent l'avenir ; et leur cœur est également fermé aux craintes frivoles, et aux espérances chimériques. La vie leur paraît trop bornée, pour se livrer à des désirs sans fin, et pour consumer le présent en idées de l'avenir. Ils sont heureux aujourd'hui, et ne songent point à l'être demain.
Pendant mon séjour dans l'île de Tilibet, je n'omis rien pour m'informer des mœurs de ces insulaires, et de la nature de leur gouvernement. La partie de l'île où je faisais mon séjour, était alors gouvernée par un monarque, qui était à la fleur de son âge, et âgé de quatre ans. Son Premier ministre en avait seize, et dans sa vieillesse il conservait un corps sain et un esprit vigoureux. Il conduisait le Prince et l'État avec une extrême sagesse ; les peuples et même les Grands applaudissaient à son heureux ministère, et souhaitaient qu'il durât toujours. Uniquement attentif à ses devoirs, et aux intérêts de l'État inséparables de ceux du Prince, modeste, poli, affable, désintéressé, il était extrêmement chéri du Roi, qui aimant la vérité et la justice, ne pouvait s'empêcher de suivre exactement tous les conseils d'un ministre si prudent et si modéré. Par ses soins la vérité régnait à la Cour, et la justice dans les tribunaux. Il y a dans la même île deux autres royaumes, qui ont chacun un prince particulier, auquel ils sont soumis. La sagesse du ministre entretenait la paix entre les trois monarchies, et il était l'arbitre de tous les différends qui naissaient entre ces peuples.
Les arts et les sciences utiles à l'homme, et tout ce qui est capable de perfectionner l'humanité, est estimé avec raison chez les peuples de cette île, et ceux qui se distinguent entr'eux par des talents, sont toujours favorisés par le ministre, qui a remarqué, que dès qu'on avait cessé de les protéger, les lettres et les arts, manquant d'émulation, et de motifs pour être cultivés, étaient tombés dans l'oubli, et que l'ignorance et la stupidité s'étaient emparé des esprits. Aussi le Roi veille-t-il soigneusement à l'entretien de tous les génies distingués de son royaume.
Ce qu'il y a de singulier à la Cour de ce Prince, et ce qui au moins n'a point d'exemple dans les Cours de l'Europe, est qu'on y a moins d'égard à la noblesse du sang qu'à celle de l'âme, et que la vertu et le mérite y fait la seule illustration des sujets. On est élevé aux chargés de l'État, non par des brigues puissantes, ou par des vertus simulées, mais par la droiture et la capacité. La Cour du Prince n'est composée que de personnes d'un mérite supérieur, et on peut dire de lui, qu'il voit la meilleure compagnie de son royaume.
Les Tilibetains ignorent absolument la navigation, parce qu'ils trouvent la vie trop courte, et trop précieuse, pour en consumer la meilleure partie dans des voyages pénibles, et pour l'exposer aux fureurs de la mer. On comprendra aisément, pourquoi ces insulaires fuyant le sommeil, et dorment bien moins que nous. Furosolo, me voyant dormir sept à huit heures de suite, me dit un jour : vous dormez le tiers de votre vie ; ainsi elle n'est pas si longue que je l'avais cru d'abord. Pour nous, dont la vie est plus bornée, nous mettons tous les moments à profit ; et comme le sommeil est une espèce de mort, nous le fuyons le plus qu'il nous est possible, et nous nous accoutumons à ne dormir qu'une heure tout au plus chaque nuit.
Je lui dis alors, que les femmes parmi nous, et même quelques hommes, dormaient souvent dix et douze heures de suite, ou au moins passaient la moitié de la journée au lit, afin de la trouver moins longue ; que nous regardions comme un bonheur de savoir passer temps : en sorte même que le mot de passe-temps était le nom que nous donnions à nos plaisirs les plus doux ; qu'un jour long et un jour triste étaient pour nous des termes synonymes, et que le plus heureux était celui qui avait longtemps vécu, et avait trouvé sa vie courte.
Furosolo surpris de ce que je lui disais, me demanda à quel âge nous commencions à jouir de notre liberté, et à entrer dans le monde : si nous n'étions pas sujets à de longues maladies et de violents chagrins : si dans notre vieillesse, et lorsque nous avions atteint l'âge de soixante ans, nous jouissions d'une santé parfaite, et étions encore agréables dans la société.
Je lui répondis, que nous ne commencions à être libres et à entrer dans le monde, qu'environ à l'âge de vingt ans : qu'il nous arrivait d'ordinaire d'essuyer des maladies et des chagrins pendant le cours de notre vie, surtout, si nous nous livrions trop à nos passions ; que vieux, nous étions sujets à mille incommodités fâcheuses ; que nous devenions chagrins et incommodes, et que les jeunes gens avaient coutume de fuir la compagnie des vieillards.
Tout cela n'est point parmi, me répliqua-t-il. Nous sommes libres, et entrons d'ordinaire dans le monde à l'âge de quatre ans : nos corps ne sont sujets à aucunes infirmités ; si ce n'est dans une extrême vieillesse, vers l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, où nous conservons néanmoins toute la gaieté de la jeunesse ; en sorte que, calculant le temps que vous donnez au sommeil, celui qui est perdu pour vous avant que d'entrer dans le monde, celui que vos maladies et vos chagrins vous rendent insupportable, et les tristes années qui composent votre vieillesse, je trouve que nous vivons encore plus longtemps, que ceux d'entre vous à qui le Ciel accorde la vie la plus longue.
CHAPITRE 2. — L'Auteur se sauve de l'île de Tilibet, et monte sur un vaisseau portugais qui relâche à une île. — Il est pris par les sauvages qui se préparent à l'assommer, et à le manger. — Comment il est délivré.
Quoique Furosolo eût beaucoup de bonté pour moi, ainsi que sa femme et toute sa famille, je m'ennuyais néanmoins beaucoup de mon séjour dans cette île, où j'étais depuis un an, et du triste état auquel j'étais réduit ; en sorte que je pensais nuit et jour au moyen d'en sortir ; je regrettais l'île de Babilary, et je faisais la triste comparaison de ma honteuse condition d'esclave, avec l'auguste rang auquel j'avais renoncé.
Un jour que je me promenais seul au bord de la mer, dont la maison Furosolo n'était pas fort éloignée, j'aperçus une chaloupe amarrée, et dix ou douze hommes bien armés qui venaient de descendre à terre, et qui paraissaient chercher une fontaine. La vue de leur habillement européen me cause de la joie, mais je craignis qu'ils ne me prissent pour quelque espion des insulaires, et que peut-être ils ne me tuassent. Cette crainte fit que je me cachai dans un petit bois qui était proche, afin que je pusse les observer sans être aperçu d'eux. Cependant ils s'approchèrent tellement du lieu où j'étais, que je pus les entendre parler, et que je connus qu'ils parlaient portugais. Alors je ne fis point de difficulté de sortir de l'endroit où j'étais caché, de les saluer honnêtement, et de leur parler dans cette langue que j'avais apprise d'un Portugais, qui était sur notre vaisseau, lorsque nous partîmes d'Angleterre.
Les Portugais, s'imaginant que j'étais un de leurs compatriotes, m'embrassèrent, et m'ayant témoigné beaucoup d'amitié, me demandèrent ce que je faisais dans cette île, où ils croyaient qu'aucun Européen n'avait encore abordé. Je leur dis que j'avais été jeté sur cette côte par une tempête qui avait fait périr le vaisseau où j'étais, et que depuis un an je me voyais réduit à la condition d'esclave parmi ces insulaires ; que je les suppliais de vouloir bien me délivrer ; qu'ils me paraissaient chercher une source pour faire eau ; que j'allais leur en montrer une, et que pendant qu'ils rempliraient leurs tonneaux, j'irais à la maison où je demeurais, qui n'était pas éloignée de plus d'une lieue, pour y chercher ce que j'avais pu sauver de mon naufrage.
Ils me promirent obligeamment de ne point retourner à bord, que je ne fusse revenu ; alors, après leur avoir indiqué une source, je courus vers le logis pour y prendre mes pierreries. Lorsque j'y fus arrivé, je trouvai par malheur que Furosolo, à qui je les avais données à garder, était absent. Ce fut un triste contretemps pour moi, je craignais extrêmement qu'il ne revînt de longtemps : en ce cas j'étais résolu d'abandonner mon trésor. Mais heureusement mon maître revint peu de temps après ; et aussitôt je le priai de me donner ma boîte. Que veux-tu faire, me dit-il, de ces pierres luisantes ? As-tu trouvé quelque imbécile qui les veuille acheter ? Je lui répondis d'un air embarrassé que j'avais trouvé une occasion favorable, pour en tirer dans la suite quelque profit. À la bonne heure, me répondit-il, je suis ravi que tu retires quelque utilité d'une chose si inutile.
Je pris ma boîte, et aussitôt étant sorti de la maison, sans dire adieu à personne, je me rendis par un chemin détourné à l'endroit où les Portugais m'avaient promis de m'attendre. Je leur aidai à faire leur provision d'eau, et étant entré avec eux dans leur chaloupe, je me rendis à bord du vaisseau, qui était à l'ancre, environ à une demie-lieue du rivage.
Le capitaine me reçut avec beaucoup de politesse, et quoique je lui eusse dit, que j'étais Anglais, il me traita comme si j'eusse été de sa nation. Ayant appris de moi tout ce qui m'était arrivé depuis trois ans que j'avais quitté l'Angleterre, il me félicita du bonheur que j'avais de me voir délivré de tant de dangers, et me dit que je devais me consoler du naufrage que j'avais essuyé, et de l'esclavage où j'avais été réduit, puisque j'avais sauvé une marchandise aussi précieuse que celle dont j'étais possesseur. Grâce à mes pierreries, je me vis considéré, non seulement du capitaine, mais encore de tous les autres officiers et de tout l'équipage, qui me regardèrent comme un homme, qui allait bientôt faire dans mon pays une figure brillante. Je tirai de ces pierreries un autre avantage, qui fut de leur faire ajouter foi au récit de mes aventures dans l'île de Babilary. Sans cela j'aurais peut-être passé pour un menteur, ou au moins pour un fabuliste.
Le vaisseau était en retour de Macao, île dépendante de la Chine, à l'entrée du golfe de Quang-Cheu, où les Portugais qui y ont une forteresse, font un assez grand commerce, moins considérable néanmoins depuis que les Hollandais les ont chassés de la plus grande partie des Indes orientales. La cargaison du vaisseau était riche, et il était muni suffisamment de vivres, pour le voyage qu'il devait faire au Brésil, avant que de retourner à Lisbonne.
Il y avait environ trois mois que nous naviguions, et nous étions dans la mer du Paraguay, vers le trente-cinquième degré de latitude de méridional, lorsqu'on s'aperçut que le navire faisait eau en deux endroits. On tâcha d'abord de boucher les voies avec de l'étoupe, et on crut y avoir réussi. Mais le lendemain on trouva plus de quatre pieds d'eau dans le fond de cale. On mit alors les pompes en usage, et tout le monde travailla. On pompa cinq heures de suite, et les voies furent mieux bouchées que la première fois. Cependant comme on craignait qu'elles ne se rouvrissent, et qu'il s'en faisait tous les jours de nouvelles, on résolut, afin de pouvoir radouber le vaisseau, de mouiller à une île que nous découvrîmes avec le télescope, quoiqu'elle ne fut point marquée sur notre carte.
Le lendemain, comme nous avions le vent favorable, nous nous en vîmes fort proche. Ayant alors mis la chaloupe à la mer, nous entrâmes dans une baie, et sur les quatre heures du matin nous nous trouvâmes à l'embouchure d'une rivière. Ayant amarré, nous descendîmes dans notre chaloupe au nombre de vingt-cinq, dont je fus un, et nous remontâmes la rivière environ l'espace de deux lieues. Nous mîmes pied à terre, et bientôt nous trouvâmes une vaste plaine au détour d'une colline, sur laquelle ayant monté, nous vîmes au pied une longue suite de cabanes. Nous nous tînmes alors sur nos gardes, de peur d'être surpris. Nous étions armés de fusils, de baïonnettes, de pistolets et de sabres, en sorte que si l'on fut venu nous attaquer, nous étions dans la disposition de nous bien défendre.
Bientôt après nous vîmes sortir des cabanes et d'un petit bois qui les environnait un grand nombre de sauvages armés de massues, qui nous ayant aperçus, s'avancèrent vers nous d'un air fier et menaçant, et en jetant de grands cris. Nous nous rangeâmes alors sur une ligne et nous nous préparâmes à les recevoir. Dès qu'ils furent à la portée du fusil, nous fîmes une décharge sur eux, et en tuâmes quinze ou seize ; alors quelques-uns d'eux qui étaient armés de flèches, nous en décochèrent, et blessèrent légèrement un de nos camarades. Nous ne nous effrayâmes point, et nous les laissâmes s'avancer jusqu'à la portée de nos pistolets, que nous déchargeâmes si à propos, que nous en tuâmes encore une douzaine, et en blessâmes autant. En même temps nous mîmes la baïonnette au bout du fusil, et nous fondîmes sur eux. Ils se défendirent avec leurs massues le mieux qu'il leur fut possible, et quoiqu'ils eussent déjà perdu plus de quarante hommes ils ne reculaient point, mais jetaient des cris horribles, qui retentissant au loin, furent accourir d'autres sauvages de tous côtés, en sorte que qu'en un moment nous en vîmes plus de deux cents venir à leur secours. Alors nous jugeâmes qu'il nous serait difficile de résister à un si grand nombre, et nous songeâmes à nous retirer. Les sauvages voyant que nous reculions, avancèrent sur nous. Ayant formé une espèce de bataillon carré, nous nous battîmes en retraite l'espace d'un quart de lieue, et leur tuâmes encore beaucoup de monde, sans perdre aucun de nos gens, parce que nous tenants serrés et leur présentant toujours la baïonnette, il leur était impossible de nous atteindre.
Enfin nous gagnâmes notre chaloupe avec bien de la peine. Comme je fus des derniers à y entrer, et que les sauvages, quoique toujours repoussés, ne cessaient de nous poursuivre, je fus malheureusement pris avec trois de mes camarades, et tout ce que purent faire pour nous secourir ceux qui étaient entrés dans la chaloupe, fut de charger leurs fusils à la hâte, et de tirer sur les sauvages des coups qui ne portèrent point.
Cependant ils nous conduisirent vers leur habitation, avec des hurlements affreux ; et aussitôt que nous y fûmes arrivés, leurs femmes vinrent danser autour de nous, et nous ayant dépouillés jusqu'à la ceinture, nous peignirent le dos et la poitrine avec des couleurs rouges et bleues. Le même soir les sauvages qui nous avaient pris, nous firent un grand festin, ce qui nous surprit extrêmement. Mais nous le fûmes encore davantage, quand nous vîmes plusieurs d'entre'eux venir à la fin du repas nous toucher les uns les bras, les autres la jambe, ceux-ci la cuisse, ceux-là les épaules, et en même temps faire un présent au maître de la cabane, où nous étions régalés. J'appris dans la suite que ceux qui nous touchaient ainsi, retenaient chacun les membres de notre corps qui étaient le plus selon leur goût, afin de les manger lorsqu'on nous aurait assommés. On nous donna une natte pour nous coucher et passer la nuit. On peut juger que ni moi, ni mes compagnons ne dormîmes guère, persuadés que cette nuit était la dernière de notre vie.
Le lendemain matin, on apporta en cérémonie les corps de tous ceux qui avaient été tués dans le combat du jour précédent. Nous vîmes alors un grand nombre de femmes assises à la porte de leurs cabanes pousser des gémissements, et jeter des cris lugubres, accompagnés de ces tristes paroles, qu'elles répétaient souvent : Stulli baba coubico somac barahou fuhanahim ; him him ! fartana frebicachou rabapinouficou, courtapa sallourik, him him ! C'est-à-dire, comme je l'ai su depuis : «Mon amour, mon espoir, charmant visage, œil de mon âme, hélas hélas ! jambe légère, beau danseur, vaillant guerrier, tard au lit, éveillé le matin, hélas, hélas !» Après espèce de Nenie, ou de chant funéraire, plusieurs hommes sortirent de leurs cabanes, d'un air triste et abattu, la tête baissée, et gardant un profond silence. Ils semblaient regarder les cris plaintifs et les gémissements des femmes comme indignes de leur courage, et renfermer une douleur vive au fond de leur cœur.
Cependant les femmes se levèrent, se prenant toutes par la main, se mirent à danser autour des morts en chantant d'un ton lugubre plusieurs chansons funèbres ou thrènes ; ce qui me rappela ce que j'avais lu dans un ancien auteur (*) ; que ce qui a fait instituer les chants funéraires, a été l'idée que les hommes avaient, que les âmes séparées des corps remontaient au Ciel, lieu de leur origine, et où est celle de toute l'harmonie qui conserve l'univers ; c'est pour cela que ces sauvages chantaient en l'honneur de leurs morts, et dansaient aussi en cadence, pour imiter le mouvement régulier et harmonique des corps célestes.
Peu de temps après on frappa sur des écorces d'arbres et l'on fit un grand bruit, dans la vue, comme je l'ai su depuis, d'obliger les âmes des défunts de s'éloigner de leurs corps et de se rejoindre à celles de leurs ancêtres : ce qui fut suivi d'un long discours que fit un des chefs pour célébrer les vertus des morts, et consoler les vivants de leur perte. Après cela on se mit à creuser un grand nombre de fosses rondes, semblables à des puits, et l'on y enterra les morts, en les mettant dans la même situation, où sont les enfants dans le ventre de leurs mères ; pour signifier que la terre est la mère commune de tous les hommes : usage conforme à ce qu'Hérodote (†) rapporte des Nasamons. On mit dans les fosses de petit pain, de la sagamité, du tabac, une pipe, une courge pleine d'huile, un peigne, avec diverses couleurs, dont les sauvages ont coutume de se peindre le corps.
Après l'enterrement il y eut un festin public, où nous n'assistâmes point, et où nous vîmes cependant qu'on servit tous les chiens des morts, qu'on avait cuits et préparés. Le repas étant fini, un des chefs qui présidait à la cérémonie, jeta au milieu des jeunes gens un bâton de la longueur de quatorze pouces, dont tous s'efforcèrent de se rendre les maîtres, en se culbutant les uns sur les autres, et en se donnant mille coups de poing. On en jeta un semblable au milieu d'une troupe de jeunes filles qui firent de pareils efforts pour le saisir, et n'épargnèrent ni les coups de poing, ni les coups de pied. Ce combat, ou plutôt ce jeu funèbre, qui dura environ une demi-heure, après avoir réjoui tous les spectateurs, et leur avoir fait perdre les tristes idées de l'enterrement, fut terminé par la distribution des prix, qui furent donnés à celui et à celle qui avaient remporté la victoire : après quoi chacun se retira.
Pendant ce temps-là nous étions renfermés dans une cabane, d'où nous pouvions voir néanmoins toute cette cérémonie. On nous en fit sortir, et tous les sauvages s'étant alors rangés autour de nous, armés de bâtons et de rondaches, on nous rendit nos pistolets, en nous faisant entendre qu'on allait nous assommer ; mais que l'usage était parmi eux, de rendre aux prisonniers une partie de leurs armes, afin qu'ils pussent périr bravement en vengeant leur mort ; qu'ainsi nous n'avions qu'à frapper comme nous pourrions, avec ces instruments, tous ceux qui s'approcheraient de nous, et que tout nous était permis. Nous priâmes que, cela étant, on eût aussi la bonté de nous rendre nos sabres ; mais on nous les refusa, parce que cette arme leur parut trop meurtrière. Ceux qui nous les avaient enlevés, les tenaient en leur main et se glorifiaient extrêmement de les avoir.
Cependant nous tirâmes chacun de notre poche de la poudre et des balles, dont nous chargeâmes nos pistolets. Les sauvages voyant ce que nous faisions, ne savaient quel était notre dessein. Quoique nous eussions tué plusieurs d'entre'eux à coups de fusil et de pistolet, ils s'imaginaient que nous avions lancé du feu sur eux, et ils ne concevaient pas qu'à moins d'en mettre dans nos pistolets, nous puissions leur faire aucun mal, avec de la poussière noire et de petites balles.
Je dis alors à mes camarades qu'il fallait d'abord casser la tête aux quatre sauvages qui étaient les plus proches de nous, et qui avaient nos sabres ; qu'il fallait en même temps les leur enlever et se saisir de leurs rondaches ; que peut-être en nous défendant avec courage, sans nous séparer, et en nous secourant adroitement l'un l'autre, nous sauverions notre vie, ou qu'au moins nous la perdrions avec honneur. Ils me promirent de faire ce que je leur recommandais, et de se battre courageusement, jusqu'à ce qu'ils rendissent le dernier soupir.
Nous bandâmes alors nos pistolets, et nous étant approchés de fort près des quatre sauvages, qui tenaient nos sabres, nous leur cassâmes la tête de trois balles, dont chacun de nos pistolets était chargé. Ils tombèrent à la renverse, et à l'instant nous leur enlevâmes leurs rondaches avec nos sabres. Quelques autres sauvages étant accourus aussitôt, pour nous empêcher de désarmer ceux qu'ils voyaient étendus par terre, dans le temps qu'ils levaient leurs bâtons pour nous frapper, nous leur fîmes subir le même sort. Alors nous jetâmes nos pistolets, qui ne pouvaient plus nous être d'aucun usage, et nous étant mis tous les quatre dos à dos, nous nous mîmes en devoir de résister à tous les sauvages qui nous environnaient, et d'en massacrer le plus qu'il nous serait possible. Nous en tuâmes et blessâmes un assez grand nombre. Quelques-uns ayant ramassé nos pistolets, s'avisèrent de vouloir faire comme nous, et crurent pouvoir nous tuer, en nous présentant le pistolet de fort près, et en faisant leur bouche un bruit approchant de celui que fait la poudre enflammée en sortant du canon. Leur épreuve leur coûta cher, et nous leur fendîmes la tête avec nos sabres.
Cependant le nombre des sauvages et notre lassitude nous accablaient. Plusieurs voyant qu'avec leurs bâtons, dont nous parions les coups adroitement avec nos rondaches, ils ne pouvaient venir à bout de nous assommer, allèrent chercher leurs massues ; ce qui était néanmoins contraire à l'usage. Cependant il était difficile que nous puissions résister plus longtemps, et nous étions près de succomber, lorsqu'un secours inopiné arriva, et nous délivra du péril.
Ceux de nos compagnons qui s'étaient sauvés dans la chaloupe, avaient porté au vaisseau la nouvelle du combat, et du malheur qui nous était arrivé. Le capitaine au désespoir de ce funeste accident, parce que son neveu était des quatre prisonniers, exhorta tous ceux qui étaient sur le vaisseau, dont la plupart était de fort braves hommes, à retourner à la charge et à faire leurs efforts pour nous retirer des mains des sauvages. Tous les passagers, avec la meilleure partie de l'équipage, s'offrirent courageusement pour cette expédition. Le capitaine leur dit qu'il ne fallait point s'effrayer du grand nombre des ennemis, qui n'avaient que de mauvaises armes, et qui ne sachant point combattre, seraient aisément défaits.
Cent hommes bien armés, ayant à leur tête le capitaine du vaisseau, descendirent dans la chaloupe, et ayant remonté la rivière, abordèrent près de l'habitation des sauvages, qui ayant vu venir à eux un si grand nombre d'ennemis, prirent tous la fuite et se dissipèrent dans le bois. Cependant nos gens s'avancèrent et mirent le feu à leurs cabanes abandonnées. Pour nous rien ne nous empêcha de nous aller joindre à tous nos compagnons, qui nous revirent avec une grande joie, et auxquels nous témoignâmes toute la reconnaissance, que méritait leur générosité.
CHAPITRE 3. — Tandis qu'une partie de l'équipage est à terre, ceux qui étaient restés sur le vaisseau, lèvent l'ancre. — L'Auteur avec plusieurs Portugais est obligé de rester longtemps dans l'île de Manouham. — Ils font alliance avec une nation sauvage.
Le capitaine ayant alors fait prendre les haches et les scies, qui'il avait fait mettre dans la chaloupe, ordonna d'abattre deux gros arbres, de les scier, et d'en faire des planches, pour radouber notre vaisseau. Mais dans le temps que nous étions occupés à cet ouvrage, sous la conduite d'un nommé Oviélo, qui s'entendait fort bien dans la charpente des navires, nous vîmes arriver deux de nos gens dans le canot, qui étant descendus à terre, nous apprirent une triste nouvelle. Ils nous dirent que les trente hommes que nous avions laissés sur le vaisseau, pour le garder en notre absence, voyant le capitaine et tous les officiers à terre, avaient formé le dessein de dessein de s'emparer du navire et de toute sa cargaison ; que ma boîte de pierreries les avait extrêmement tentés, et qu'ils avait levé l'ancre et mis à la voile ; que comme le capitaine leur avait donné à l'un et à l'autre le commandement du vaisseau dans son absence et dans celle de tous les officiers qui étaient à terre, ils avaient tâché de s'opposer de toutes leurs forces à cette coupable résolution, mais qu'on ne les avait point écoutés ; qu'on les avait même menacés de les poignarder ; qu'ils avaient alors jugé à propos de se jeter dans le canot et de nous venir rejoindre, pour ne se voir pas obligé de tremper dans un crime si horrible.
Cette nouvelle nous jeta dans la consternation, et en mon particulier je regrettai fort ma boîte, où était enfermée toute ma fortune. Nous n'avions aucuns vivres, et il ne nous restait pour toute ressource, que nous fusils avec deux barils de poudre, et un sac rempli de balles de plomb qu'on avait mis dans la chaloupe, pour nous en servir en cas que la guerre contre les sauvages eût plus duré. Nous n'avions donc d'autre parti à prendre, que celui de rester dans l'île et d'y vivre de notre chasse. Dans cette extrémité nous tînmes conseil, et il fut délibéré que nous tuerions d'abord le plus de gibier que nous pourrions ; que nous le boucanerions, et que l'ayant porté dans la chaloupe, nous côtoierions l'île, et tâcherions ensuite de nous établir dans quelque endroit, où nous n'eussions rien à craindre, jusque'à ce que nous pussions trouver quelque moyen de retourner en Europe, car il n'était pas possible avec la chaloupe qui nous restait de faire une si longue route, ni même de nous rendre à aucune côte du continent de l'Amérique, dont nous nous jugions trop éloignés.
Nous nous mîmes donc à chasser, mais sans nous séparer, de crainte d'être surpris par les insulaires. Nous tuâmes assez de gibier que nous boucanâmes, et dont chacun de nous mangea le soir avec un grand appétit. Nous passâmes la nuit dans le bois, où après avoir établi deux sentinelles, qu'on devait relever toutes les heures, nous nous endormîmes sous les arbres. Le lendemain matin nous portâmes le reste de notre gibier dans la chaloupe, et y étant tous entrés, nous côtoyâmes l'île toute la journée.
Vers le soir nous descendîmes à terre, dans un endroit qui nous parut agréable, et où nous crûmes pouvoir passer la nuit. Un ruisseau que nous avions aperçu, nous fit choisir ce lieu. Nous mangeâmes comme le jour précédent de nos viandes boucanées, et nous nous couchâmes ensuite sous des arbres, avec les mêmes précautions.
Nous dormîmes assez tranquillement ; mais dès que le jour commença à paraître, les sentinelles nous éveillèrent, en criant, aux armes. Quatre sauvages avaient auprès d'eux, et s'étaient approchés de nous, pour nous reconnaître. Nous nous éveillâmes à l'instant, et ayant pris nous fusils, nous courûmes et enveloppâmes les quatre espions que nous prîmes. D'abord nous leur fîmes entendre que nous ne leur ferions aucun mal, et que nous étions dans la résolution de ne point nuire aux habitants de l'île, pourvu qu'ils ne nous attaquassent point : nous leur offrîmes à manger ; et après les avoir beaucoup caressés, nous les priâmes de dire à ceux de leur nation que nous étions leurs amis, s'ils voulaient être les nôtres, et que nous leur rendrions tous les services dont nous serions capables. Nous tâchâmes de leur faire entendre cela par des signes qu'ils parurent comprendre. Charmés de nos manières, ils nous firent entendre aussi par d'autres signes que nous n'aurions rien à craindre de leur nation. Nous les renvoyâmes, après avoir donné à chacun le petit couteau, que nous leur avions prêté pour manger, et qu'ils avaient plusieurs fois considérés avec attention.
Cependant nous ne jugeâmes pas à propos de nous fier entièrement à leur parole, et nous continuâmes de nous tenir sur nos gardes. Nous nous avançâmes dans le pays sans nous éloigner beaucoup de notre chaloupe, que nous ne voulions pas abandonner.
Vers le midi, nous vîmes venir à nous une grosse troupe de sauvages, portant des fruits et toute sorte de rafraîchissements. Dès que nous les aperçûmes, nous les saluâmes de la manière que nous avions vu que les quatre sauvages nous avaient salués ; c'est-à-dire, en croissant nos deux mains sur notre tête, et en faisant un souri gracieux. Ils nous rendirent de loin le même salut, et s'étant alors approchés de nous, ils nous offrirent leurs présents, que nous acceptâmes en les embrassant.
Nous leur montrâmes notre chaloupe, et leur fîmes entendre que nous venions d'un pays très éloigné, et que c'était par un malheur extrême que nous étions obligés de séjourner dans leur île ; que nous les prions de nous recevoir, comme leurs alliés et leurs frères, ils nous firent signe alors de les suivre, et de venir vers leur habitation, qui n'était pas fort éloignée ; ce que nous fîmes volontiers.
Lorsque nous y fûmes arrivés, les femmes et les enfants se mirent à danser devant nous, et bientôt après on nous présenta à manger d'une espèce de gâteau, avec de la viande et des fruits, et on nous fit boire d'une liqueur, qui nous parut assez agréable. Comme nous avions un peu d'eau-de-vie, nous leur en fîmes goûter, ce qui leur fit un grand plaisir. Mais ayant vu qu'ils voulaient en boire un peu trop, nous leur fîmes entendre que l'excès de cette boisson les ferait mourir, et qu'il n'en fallait prendre que fort peu. Ils nous crurent, et les chefs de la nation défendirent aux autres d'en boire davantage. Tout l'après-dîner se passa à danser et à chanter ; le soir on nous donna des nattes pour nous coucher, et on nous mit tout ensemble dans une grande cabane.
Comme plusieurs d'entre nous avaient été blessés dans le dernier combat, les sauvages nous firent entendre qu'ils voulaient les guérir. En effet ils allèrent chercher un homme qu'ils paraissent regarder comme un saint, et pour qu'ils témoignaient une grande vénération. Cet homme extraordinaire visita nos blessés, et ensuite s'enferma seul dans une cabane que nous vîmes trembler violemment pendant deux ou trois heures, sans pouvoir comprendre comment cela se faisait. Il revint ensuite retrouver les malades, se rinça la bouche, suça leurs plaies, et leur appliqua une certaine herbe inconnue en Europe. Au bout de vingt-quatre heures tous nos blessés furent parfaitement guéris. Cette preuve de la bonté de nos sauvages nous ôta tout soupçon, et fit que nous commençâmes dès lors à les regarder comme nos vrais amis.
Le lendemain ils nous proposèrent d'aller à las chasse avec eux, et nous présentèrent des arcs et des flèches. Mais nous leur fîmes comprendre, en leur montrant nos fusils, que nous avions des armes qui valaient bien les leurs. Ils se mirent alors à les considerer attentivement. Ils paraissaient ne pouvoir comprendre comment avec de pareils instruments, il était possible d'attendre des objets éloignés. Mais lorsqu'ils nous virent tuer avec nos fusils des oiseaux et abattre de loin des bêtes fauves, ils furent extrêmement surpris, et jugèrent, comme avaient fait les autres sauvages de l'île, auxquels nous avions eu affaire, qu'il y avait du feu caché dans le canon de nos fusils, et que nous avions l'art de lancer ce feu à notre gré. Nous les détrompâmes, et leur fîmes comprendre ce que c'était, en leur montrant notre poudre et nos balles, et en chargeant devant eux deux ou trois fusils, que nous leur fîmes décharger. Cette confiance que nous leur marquions les charma ; ils nous regardèrent comme des hommes extraordinaires qui avaient des lumières supérieures et une grande affection pour eux.
Au retour de cette chasse nous mîmes en délibération conjointement avec les sauvages, si nous bâtirions une grande cabane qui pourrait nous contenir tous, ou si nous en bâtirions une pour chacun de nous en particulier, dont les femmes et filles des sauvages voudraient bien prendre soin, pour nous y préparer à manger, en les mettant toutes les unes auprès des autres, ce qui agrandirait l'habitation. Les femmes que nous consultâmes aussi bien que les hommes, furent, je ne sais pourquoi, unanimement de ce dernier avis. Nous mîmes donc tous la main à l'ouvrage, et les insulaires charmés de voir croître leur village, travaillèrent avec nous ; en sorte qu'au bout d'environ un mois nous fûmes tous logés et meublés.
Il y avait parmi nous un Espagnol, nommé Rodriguez, qui avait passé plusieurs années à la Terre de San Gabriel ; il nous dit qu'il n'y avait pas plus de différence entre la langue des peuples de cette côte et celle de nos insulaires, qu'entre l'espagnol et le portugais ; qu'il entendait la plupart des choses qu'ils disaient, et qu'avant qu'il fût huit jours, non seulement il serait en état de les entendre parfaitement, mais même de leur parler assez bien pour être entendus d'eux. Comme nous ignorions le temps que nous aurions à passer dans cette île, et que nous avions besoin du secours continuel des insulaires, avec lesquels nous étions liés, nous l'exhortâmes à s'appliquer à leur langue, afin qu'il pût leur parler en notre nom et nous servir d'interprète. Il nous le promit, et effectivement au bout de peu de jours, il commença à parler la langue de Manouham — c'était le nom de l'île où nous étions — nos insulaires furent charmés de pouvoir par ce moyen s'entretenir avec nous, et nous en témoignèrent une joie infinie. Comme j'avais une grande disposition pour les langues, il me prit envie, pour me désennuyer, d'apprendre celle de Manouham ; et pour cet effet je priai l'Espagnol, qui avait autrefois ses études, de m'en dresser une espèce de grammaire, et de me donner de temps en temps des leçons. Je m'y appliquai tellement, qu'au bout de quelque mois je commençai à entendre un peu la langage de nos sauvages, et que je me hasardai même quelquefois de leur parler en leur langue ; ce qui m'y fit faire de plus grands progrès.
Dès que notre Espagnol avait été en état de s'entretenir avec eux, il leur avait appris que nous étions des hommes d'un pays très éloigné, qui courions les mers depuis plusieurs années ; que pour radouber notre vaisseau, nous avions été obligés de relâcher à l'île où nous étions ; qu'étant descendus à terre nous avions été attaqués par les habitants méridionaux de l'île, qui avaient voulu nous massacrer ; mais que nous les avions repoussés et en avions fait un grand carnage ; que pendant ce temps-là, ceux à qui nous avions confié la garde de notre vaisseau, avaient disparu ; en sorte que nous avions été réduits à la nécessité de demeurer dans l'île. L'Espagnol raconta notre combat et notre victoire avec un air de vanité et de complaisance qui nous déplut ; en sorte que nous le priâmes d'ajouter que c'était malgré nous, que nous avions causé ce désordre, qui n'était arrivé, que parce qu'on nous avait attaqués injustement, et que nous avions été dans la nécessité de nous défendre.
Nos sauvages écoutèrent avec beaucoup d'attention le détail que Rodriguez leur fit de notre aventure, du péril que nous avions couru, et de la victoire que nous avions remportée. Ce sont, dirent-ils, de très méchants hommes que ceux que vous avez vaincus ; et nous vous savons gré de les avoir punis. Nous sommes depuis longtemps en guerre avec eux, et peut-être que Halaimi — c'est le nom du principal dieu que ces insulaires adorent, et qui est sans doute une corruption du mot hébreu Elohim — vous a exprès conduites en cette île pour nous aider à exterminer cette nation injuste : Soyez toujours nos frères, nous serons les vôtres : Vivez parmi nous, comme si vous étiez les enfants de nos mères et de nos femmes : Nous n'omettrons rien, pour vous procurer toutes les satisfactions qui dépendront de notre nation.
CHAPITRE 4. — L'Auteur devient amoureux d'une jolie sauvagesse. — Ses entretiens avec elle et son père, qui censure les mœurs européennes.
Nous nous accoutumâmes peu à peu à la vie des sauvages, et nous commençâmes même à la goûter, passant tout notre temps à boire, à manger, à dormir et à chasser. Nous n'avions d'autre inquiétude, que celle que nous causait de temps en temps le désir de revoir notre patrie, que malheureusement nous ne pouvions oublier. Pour en affaiblir l'idée, et me lier en quelque sorte au pays où j'étais, je m'attachai à une jeune sauvagesse, qui avait beaucoup d'agréments et d'esprit, et que j'aurais même épousé, si notre capitaine et tous mes amis m'en eussent détourné. Elle m'aimait éperdument, et je puis avouer aussi que je passai avec elle des moments bien doux.
Soit que son père, qui avait beaucoup de bon sens, eût pris un soin particulier de son éducation, soit que la Nature lui eût donné une raison supérieure, jamais je n'avais vu de femmes raisonner de toutes choses, avec tant de justesse et de pénétration. Ni les femmes de Babilary qui ont l'esprit si orné, ni celles d'Angleterre qui l'ont si délicat, n'approchaient point à mon gré de cette ingénieuse et aimable sauvagesse.
Je faisais mon possible pour lui plaire, et la plupart de nos entretiens roulaient sur des paradoxes galants, que je lui débitais pour l'amuser et la flatter. Je me souviens, qu'elle me demanda un jour, si les femmes de mon pays étaient plus belles que celles du sien. Les femmes d'Angleterre sont très blanches, lui répondis-je, et c'est en quoi consiste leur principale beauté, si on peut dire néanmoins que c'en soit une : car cette blancheur est, selon moi, un avantage très médiocre ; et je vous avoue même que depuis que j'ai le bonheur de vous connaître, je commence à douter, si ce n'est pas une véritable laideur.
Les femmes de mon pays, dégoûtées elles-mêmes de la couleur naturelle de leur teint, font aujourd'hui leur possible pour la changer. De-là vient qu'elles se couvrent le visage d'une rouge très foncé ; et je m'imagine qu'avec le temps elles pourront bien se faire peindre en noir, pour mieux déguiser la couleur de leur peau. Après tout, si cet usage venait à s'établir dans notre île, elles pourraient alors d'un avantage dont vous jouissez. Elles ont le malheur de ne pouvoir sortir de leurs maisons, lorsqu'il fait soleil ; ou si elles sont absolument obligées de le faire, il leur faut prendre mille précautions gênantes. Au contraire le soleil le plus ardent ne fait que vous embellir, en donnant à votre teint un plus beau noir. La blancheur de nos dames, quand elle est à un certain degré, a quelque chose de fade et d'insipide : aussi préférons-nous toujours les brunes aux blondes dont la blancheur est extrême. Par-là vous voyez, que ce qui approche un peu de votre couleur, ou du moins ce qui s'en éloigne moins, est plus goûté même parmi nous.
Comme nous préférons, poursuivis-je, les brunes aux blondes, les femmes de mon pays ne manquent pas aussi de préférer les hommes, dont le visage est fort brun, à ces hommes extrêmement blancs, dont le teint ménagé est un signe de mollesse, et annonce ordinairement peu de vigueur. À l'égard des parures de toute espèce, que les femmes de mon pays employaient, pour relever leur beauté, je puis vous assurer qu'il n'y a point d'hommes parmi nous, qui ne souhaitât sincèrement qu'elles ne fussent pas plus parées que vous. Elles cachent souvent mille défauts sous leurs vastes et pompeux habits, qui ne servirent qu'à déguiser leur tailler et à nous tromper. Mais elles entendent si peu leurs intérêts, qu'elles portent de grandes pièces d'étoffe plissée, qui leur descendent depuis la ceinture jusqu'aux pieds, d'énormes cercles de fanon de baleine revêtus de toile, qui les font paraître grosses et prêtes d'accoucher. Elles marchaient au milieu de ces mobiles cerceaux, qui les entourent sans cesse, comme vous petits enfants, à qui vous apprenez à marcher, et que vous emboîtez dans de petites machines, qu'ils font avancer ou reculer, par mouvement qu'ils font.
Je demande pardon aux dames anglaises, d'oser rapporter cette réponse, que je fis à la question de ma petite sauvagesse. Un amant trouve toujours sa maîtresse la plus belle de toutes les femmes ; et comme la mienne était extrêmement noire, et n'avait d'autre parure que ce simple habit d'été que les sauvages des pays chauds portent en toutes les saisons, je ne pouvais, selon les règles de la bienséance et de la politesse, m'empêcher de préférer son teint et son habillement au teint à l'habillement de toutes les femmes de l'Europe. Si quelques-unes d'elles s'en scandalisent, je les prie de faire grâce à la sincérité d'un voyageur, qui ne veut rien omettre ni déguiser.
Son père nommé Abenoussaqui, avait, comme j'ai dit, beaucoup de raison et de bon sens, mais de ce bon sens, tel qu'il sort des mains de la Nature, sans être poli et façonné par les passions. Comme j'allais souvent à sa cabane où sa fille m'attirait, j'avais de temps en temps avec lui des entretiens, qui valaient peut-être les Dialogues de Platon. Pourquoi — me dit-il un jour dans une promenade que nous fîmes, tandis que tous nos gens à la chasse avec les sauvages — vous autres Européens quittez-vous le pays où la Nature vous a fait naître, et risquez-vous sur la mer le petit nombre de jours que vous avez à vivre ? Ne seriez-vous pas mieux de les passer dans le sein de votre famille, ou dans compagnie de vos amis, et de vous occuper de la chasse, qui est un exercice aussi utile qu'agréable ? Si vous aviez suivi ce genre de vie, vous n'auriez point été exposé à tous les périls et à tous les malheurs, que vous a fait essuyer une vaine curiosité.
Il est vrai, lui répondis-je, que je n'ai quitté ma patrie, et que je ne me suis embarqué, que par le désir curieux de voir des pays éloignés, et de connaître les peuples divers répandus sur la surface de la terre. Mais si j'ai beaucoup souffert dans ce voyage, et si je me suis vu exposé aux plus grands dangers, j'ai eu aussi la satisfaction de voir des choses très singulières ; je me saurai toujours bon gré d'avoir été conduite par la fortune dans l'île de Babilary et dans celle de Tilibet, dont je vous ai raconté plusieurs particularités, qui vous surpris et réjoui.
Ce que vous m'avez dit de votre pays, me repartit-il, m'a paru pour le moins aussi étonnant et ne m'a pas moins diverti. Mais après tout je ne puis comprendre, que pour le seul plaisir de s'instruire des mœurs et des usages de différents peuples, on prenne la peine de bâtir de grandes cabanes flottantes, et qu'on ait la témérité d'affronter les tempêtes et d'essuyer tant de fatigues et de périls.
J'étais jeune, lui répliquai-je, lorsque je quittai mon pays, et j'avoue qu'une vaine et folle curiosité fut le seul motif de mon embarquement. Mais ceux qui avaient bâti le vaisseau, et ceux qui y montèrent avec moi, avaient des motifs plus solides et plus raisonnables. C'était pour commencer, et rapporter des pays étrangers des marchandises, qui à leur retour étant vendues dans notre pays devaient leur produire beaucoup d'argent. Pour avoir de cet argent, et en amasser le plus qu'il est possible, nous travaillons toute notre vie, et nous nous rendons actuellement malheureux, dans l'espérance d'être un jour heureux ; persuadés que sans l'argent nous ne pouvons l'être.
Qu'est-ce donc que cet argent, s'écria le sauvage, qui a la vertu de vous rendre heureux, dès que vous le possédez ? Voyez, lui dis-je, en lui montrant une pièce d'or et une autre d'argent que j'avais depuis longtemps dans ma poche : voilà ce qui nous procure toutes les nécessités de la vie, et ce qui nous fait jouir de toutes les commodités et de toutes les délices que nous pouvons souhaiter. La possession de ces deux métaux règle les rangs parmi nous, nous fait considérer et respecter, et même nous donne du mérite et de l'esprit.
Abenoussaqui voyant qu'il y avait sur mes pièces d'or et d'argent des figures et des caractères, s'imagina qu'ils avaient peut-être une certaine vertu magique, et me pria de lui en prêter une, pour éprouver si en effet elle pourrait donner de l'esprit à son fils, qui selon lui en avait fort peu. Je veux voir, ajouta-t-il, si vous ne me trompez point, et si cette pièce aura le pouvoir que vous dites.
Elle ne fera aucun effet sur lui, répartis-je, quand même il aurait assez de ces pièces pour en remplir la plus grande de vos cabanes. Il n'y a donc que dans votre pays, interrompit-il, où ces pièces aient de la vertu ? Cela est vrai, lui répondis-je ; parce que nous y attachons de concert des idées que vous n'êtes pas capables d'avoir. Par exemple, lorsqu'un grand nombre de ces pièces se trouve dans un coffre, nous nous imaginons qu'il y a dans ce coffre de grandes terres des maisons commodes, des habits magnifiques, des honneurs et des rangs, un grand nombre de domestiques, de belles femmes, des mets exquis. Ce qui vous paraîtra surprenant, est qu'en ouvrant ce coffre, nous y trouvons en effet tout cela, si nous voulons. Alors en acquérant ces choses, qui sont en quelque sorte adorées dans notre pays, parce qu'elles sont ardemment souhaitées, chacun nous estime, nous révère, nous fait la cour, nous donne du mérite et de l'esprit.
Abenoussaqui ne comprenant rien à cette énigme, crut que je lui débitais des chimères, et que je me voulais jouer de sa crédulité. Mais lui ayant ensuite expliqué, comment tout cela arrivait, il trouva nos mœurs très méprisables, et l'usage de l'or et d'argent utile peut-être et commode dans sa première institution, mais pernicieux par l'abus déraisonnable que nous en faisions : en sorte que qu'il conclut, que puisqu'il nous en coûtait tant de peines et de fatigues pour être heureux, et que nous attachions follement notre bonheur à une chose qui ne dépendait point de nous, nous étions malheureux de notre propre gré et méritions de l'être. On n'est heureux, disait-il, qu'autant qu'on ne désire rien ; et cependant toute votre vie se passe à désirer. Pour nous, nous avons tout, parce que rien de ce que nous désirons ne nous manque.
Mais, poursuivit-il, ces hommes qui parmi vous ont beaucoup plus d'argent que les autres, se voyant estimés et révérés, comme vous dites, n'ont-ils pas le cœur enflé d'un ridicule orgueil, et ne méprisent-ils pas ceux qui moins de richesse qu'eux ? C'est ce qui arrive presque toujours, lui répondis-je ; un riche est le plus souvent un sot, un homme sans vertus et sans talents : n'importe, il croit que sa richesse supplée à tout et lui donne une supériorité incontestable sur l'homme d'esprit et de mérite, qui, quoique peur à son aise, ne lui demande rien. S'il arrive par hasard qu'ils se trouvent ensemble, on s'aperçoit que l'un, quelques honnêtetés qu'il daigne faire à l'autre, ne lui parle point comme à son égal. Mais si l'homme de mérite est d'une indigence malheureusement exprimée par ses trop modestes habits, il lui serait bien moins préjudiciable d'avoir une réputation flétrie. La pauvreté aux yeux d'un riche est de toutes les qualités la plus déshonorante, et le premier de tous les ridicules.
Ce qui ne se conçoit pas, est que l'homme opulent, qui a été pauvre lui-même et nourri dans le sein de misère — comme il y a en beaucoup — est ordinairement de tous les riches le plus impertinent et le plus insupportable. Il oublie la bassesse de sa naissance et de sa première condition, et jamais celle de son éducation, qui fait celle de ses mœurs. Enfin ces nouveaux riches, que nous appelons hommes de fortune, se distinguent d'ordinaires des nobles, et de ceux dont la richesse est héréditaire et ancienne, et se font reconnaître à ces marques. Ils saluent ceux qu'ils rencontrent, et qui les saluent les premiers, par une légère inclination de tête, en souriant d'un air content ou distrait : ils parlent haut et mal : tous leurs meubles sont toujours la dernière mode : ils régalent magnifiquement les personnes de condition et d'un rang distingué, dont la table leur est néanmoins interdite : ils ne sont libéraux qu'à l'égard de leurs maîtresses. Comme la vertu n'enrichit personne, et que le crime est d'ordinaire l'auteur de leur fortune, on ne les voit jamais rendre hommage à la Divinité, qu'ils savent irritée contre eux, à moins qu'ils ne le fassent par une odieuse hypocrisie, pour imposer au public. Ils ont honte de leur nom, qu'ils éclipsent d'ordinaire par un surnom magnifique, et ils tâchent de faire oublier ce qu'eux ou leurs pères ont été, par un nuage bigarré de domestiques qui les suivent partout.
Expliquez-moi, interrompit, Abenoussaqui, ce que vous entendez par ce mot de domestique. Est-ce que l'argent vous sert à multiplier le nombre de vos enfants ? Ce ne sont pas nos enfants qui nous servent, lui répartis-je, à moins que nous ne soyons extrêmement pauvres. Pour peu que nous soyons à notre aise, nous donnons de l'argent à des hommes et à des femmes que nous logeons, et que nous engageons à nourrir, pour nous rendre les plus bas offices ; à qui nous faisons faire tout ce qu'il nous plaît, qui essuient tous nos caprices, et qui n'osent nous désobéir. Sont-ce, me demanda-t-il, des hommes d'un autre pays que le vôtre, des prisonniers de guerre ? Non, lui répondis-je, ce sont nos compatriotes, ceux de notre nation, qui, manquant de cet argent dont je vous ai parlé, se soumettent à nous, et se rendent en quelque sorte nos esclaves, pour en acquérir une petite portion, capable de les faire subsister.
Comment se peut-il faire, s'écria Abenoussaqui, qu'il y ait des hommes parmi vous d'un cœur assez bas, les uns pour se rendre les esclaves de leurs compatriotes, et les autres pour souffrir que leurs compatriotes soient leurs esclaves ? Je vois que l'argent est votre ennemi, puisqu'il vous réduit à l'esclavage, et qu'il vous asservit à ceux qui le possèdent. Il est vrai, répondis-je, que l'argent est une espèce de tyran, et que c'est un grand malheur pour nous que d'être nés dans la disette des choses nécessaires à la vie.
Votre pays, me répliqua-t-il, est donc ou trop petit, ou trop peuplé ; puisqu'il ne peut nourrir ses habitants, et qu'ils y a parmi vous des hommes qui n'y peuvent subsister, ou qui n'y subsistent que par des moyens vils et indignes. Je lui répondis que notre pays était très fertile, et capable de nourrir deux fois plus d'hommes qu'il ne contenait ; mais qu'il y avait parmi nous des hommes puissants, qui s'étaient emparés de la plus grande partie de la terre que nous habitons ; en sorte qu'il ne restait plus rien pour les autres, qui, afin de pouvoir vivre, étaient obligés de travailler pour eux nuit et jour.
Abenoussaqui me demanda alors si ces hommes puissants, qui dominaient ainsi sur les autres, étaient en plus grand nombre que ces hommes pauvres, qui étaient obligés de mener une vie si humiliante et si misérable. Je lui répondis, que le nombre des pauvres surpassait de beaucoup le nombre des riches. Si cela est, répliqua-t-il, les pauvres parmi vous n'ont guère d'esprit et de courage, de souffrir paisiblement qu'un nombre d'hommes moins que le leur envahisse tout et ne leur laisse rien. Les lois les en empêchent, lui repartis-je. Qu'est-ce que ces lois, interrompt le sauvage ? Sont-ce des hommes armés de fusils et de sabres, qui servent de sauvegarde aux riches, pour les maintenir dans la possession de leurs richesses, et pour les défendre contre les justes prétentions des pauvres ?
Les lois, lui répondis-je, sont des règles et des maximes publiques, reçues depuis longtemps parmi nous, et que les pauvres et les riches révèrent également ; parce qu'elle sont, selon nos idées, les liens et les garants de notre société civile ; les uns et les autres se liguent donc ensemble, pour les soutenir et les faire observer : en sorte qu'un pauvre, qui, par exemple, aurait dérobé quelque chose à un riche, serait très rigoureusement puni. Non seulement les riches exigeraient cette punition ; mais tous les pauvres l'approuveraient, et même quelques-uns d'entre'eux seraient les ministres et les exécuteurs. Il n'est pas étonnant, comme vous sentez bien, que les riches vengent un pareil attentat, et qu'ils l'appellent une action basse, honteuse, et criminelle, comme elle l'est en effet. Mais vous êtes peut-être surpris, que ceux qui ne sont pas riches, condamnent autant cette action que ceux qui le sont, et qui y ont beaucoup plus d'intérêt qu'eux. Mais deux motifs les engagent à la détester, s'ils ont de la probité et de l'honneur, et par conséquent à maintenir les riches dans la possession des biens qui leur sont échus en partage, de quelque façon que ce soit. Le premier est, que s'il était permis au pauvre de s'approprier ce qui appartient au riche, le peu de chose que possède le pauvre, pourrait aussi lui être enlevé, ou par un riche, ou par un autre pauvre : il est donc intéressé à maintenir la loi qui défend toute sorte de larcin. Le second motif est fondé sur un grand principe de morale, que nous regardons comme le pivot de notre société civile : ce principe est de ne point faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fit à nous-mêmes. En sorte que le pauvre sentant bien qu'il serait très fâché qu'on lui enlevât ce qu'il a pu gagner par son travail, s'abstient, pour ne point fâcher le riche, de lui dérober quoique ce soit.
Nous reconnaissons aussi bien que vous, me repartit Abenoussaqui, ce principe morale de toute justice, qui est né avec nous, et que nous portons toujours dans le cœur, quelque corrompus que nous soyons. Mais il me semble qu'il n'est point dans vos idées, et suivant que vous venez de me dire, aussi pur et aussi sacré que dans les nôtres. Votre manière de vivre, et ce que vous appelez votre société civile, vous le fait observer avec une espèce de partialité, qui le défigure ; parce que, selon vos mœurs et vos usages, il est évidemment plus favorable aux uns qu'aux autres. Il est bien aisé aux riches de dire : j'ai beaucoup de bien, je serais fâché qu'on me l'enlevât ; il ne faut donc pas que je ravisse le bien de ceux qui en ont. Le pauvre au contraire, qui manque de tout, ne peut dire autre chose, que ceci : si j'avais du bien, je serais fâché qu'on me le ravît ; il ne faut donc pas que je m'empare de celui qui appartient à autrui. Remarquez la différence qu'il y a entre le j'ai que dit le riche, et le si j'avais que dit le pauvre, et vous conviendrez que l'application du principe est parmi vous très différente ; que par conséquent votre morale est défectueuse par sa partialité, puisqu'elle n'est point égale pour tous les hommes et pour toutes les conditions, et que le riche et pauvre sont obligés de raisonner différemment.
Quelque chose que vous disiez, repartis-je, cette loi naturelle est parmi nous également révérée de tous ; elle maintient l'ordre dans tous les États, chacun s'y soumet, et personne n'ose réclamer contre elle. Il est vrai qu'elle n'est pas toujours religieusement observée. Le pauvre dérobe souvent ce qui appartient au riche, et le riche s'empare quelquefois, non seulement des biens du riche, mais il envahit aussi ce que le pauvre a pu acquérir par son travail ; mais alors si la loi est enfreinte, elle est aussitôt vengée, avec cette différence toutefois, que le pauvre est toujours rigoureusement puni, comme il le mérite, et que le riche ne l'est pas toujours.
Pourquoi cette honteuse distinction, interrompit le sauvage ? C'est que les riches parmi nous, répondis-je, sont les arbitres et les dispensateurs de la justice, et que les riches penchent d'ordinaire à favoriser les riches ; ce qui fait que le pauvre opprimé juge souvent plus à propos d'étouffer ses plaintes. D'ailleurs ces ministres respectables de la justice, que nous appelons magistrats, sont naturellement portés à rendre à chacun ce qui lui appartient, lorsque rien ne vient traverser leurs idées d'équité. Mais comme d'un autre côté il est naturel de s'aimer encore plus soi-même que les autres, lorsqu'il arrive que leur intérêt est flatté par un peu d'injustice, ils sont alors un peu tentés de s'y livrer. Si, par exemple, ils se voient sollicités par une jolie femme, leur premier mouvement est certainement toujours pour elle ; mais heureusement le second est quelquefois pour l'équité. La crainte du déshonneur a coutume de les retenir ; il y a néanmoins de fâcheuses circonstances, où cette crainte n'a point lieu : ce sont celles où l'iniquité peut demeurer secrète : alors malheur à celui qui n'a que raison, et qui n'a d'autre protecteur que son innocence ou son bon droit. Dans la crainte du Ciel, ajoutai-je, ce désordre serait parmi nous beaucoup plus commun qu'il ne l'est. Mais notre religion, dont les préceptes sont conformes à ceux de la loi naturelle, nous fait regarder la prévarication d'un juge comme le plus énorme de tous les crimes que l'humanité puisse commettre ; en sorte que pour peu qu'un magistrat craigne la Divinité, il s'abstient toujours prononcer contre sa conscience. Mais quelquefois il en a une, qui le fait ressembler à ceux qui n'en ont point.
Le sauvage me demanda en cet endroit si toutes nos lois n'étaient pas renfermées dans la conscience. Comme la conscience, lui répondis-je, ne suffit pas pour retenir ceux qui veulent commettre le mal ; et que ceux mêmes qui le commettent, se persuadent aisément qu'ils ne le commettent point, nous avons une infinité de lois, qui défendent une infinité de choses, qui forment une multitude de décisions sur des cas innombrables, et qui imposent différentes peines à ceux qui les violent. À quoi servent tant de lois, répliqua Abenoussaqui, lorsque vous avez la loi naturelle, qui est si simple et si décisive ? Nos lois, lui répliquai-je, ne sont autre que cette loi naturelle étendue et appliquée à différentes espèces de cas particuliers.
Mais, ajoutai-je, malgré la sagesse de nos législateurs et la sagacité de leurs interprètes, il règne parmi nous un monstre ardent à gueule béante, qui protégé et chérit d'une foule de têtes cornues, qui le nourrissent et qu'il nourrit, brave la justice dont il se moque, dévore la substance des familles, et s'efforce d'anéantir ou d'éluder toutes les lois.
Ce monstre dangereux s'appelle la chicane, plus à craindre mille fois que l'injustice même, qui, en nous opprimant ouvertement, nous laisse au moins le droit vindicatif de murmurer et de nous plaindre. Mais la chicane est si enveloppée dans ses replis, et si artificieuse dans ses détours, qu'à la faveur de certaines formalités, qui sont des chaînes, qu'il nous a plu de donner à la justice, elle nous fait tout perdre par les oracles des juges, jusqu'à la consolation de pouvoir dire qu'ils ont mal jugé. Les redoutables ministres de la chicane assiègent tous les tribunaux, les échauffent par un feu continuel qu'ils y entretiennent, et les sont sans cesse retentit de leurs cris perçants, qui néanmoins n'ont pas toujours la force de troubler le sommeil des juges ; ce qu'il y a de fâcheux, est que ce sont les vieux seuls qui dorment, et qui les jeunes sont éveillés.
Il faut avouer, continuai-je, que la justice est plus révérée et peut-être mieux administrée, parmi vous autres sauvages que parmi nous. À l'occasion de ce mot de sauvage qui m'avait échappé, Abenoussaqui m'interrompit, et me demanda ce que j'entendais par ce terme, et pourquoi je l'appelais sauvage ? C'est, lui dis-je, parce que vous et vos compatriotes n'êtes point civilisés et façonnés comme nous, que vous vivez dans l'indépendance, et que vous ne suivez que le seul instinct naturel, que vous n'observez que très peu de règles de bienfaisance, que vous manquez de ce que nous appelons monde et savoir-vivre, qui sont des lois essentielles parmi nous, que nous égalons presque aux lois de la Nature ; enfin parce que vous êtes nus, et que vous n'avez ni princes et magistrats comme nous.
Quel est votre aveuglement, s'écria alors Abenoussaqui ! Quoi, parce que nous nous contentons de suivre l'instinct de la Nature, et que nous ne connaissons que sa loi, vous nous appelez sauvages ! Vous vous croyez plus formés, plus polis, plus civilisés que nous, à cause de mille institutions arbitraires, auxquelles vous avez sacrifié votre liberté. Pour nous, qui conservons la nôtre, et qui la regardons comme le plus beau présent de la Nature, nous croirions l'avoir perdue, si nous étions assujettis à cette multitude de règles superflues, qui forment votre société civile. Quelque chose que vous pensiez, nous trouvons que notre société est beaucoup plus civile que la vôtre, parce qu'elle est plus simple et plus raisonnable ; nous n'y souffrons ni injustice, ni partialité ; nous nous croyons tous égaux, parce que la Nature nous a fait tels, et que nous nous gardons bien d'altérer son arrangement. Nous obéissons à nos pères, nous révérons les anciens, qui ont plus d'expérience, et par conséquent plus de raison, que ceux qui sont nés depuis eux. C'est, comme vous voyez, la Nature seule qui a établi parmi nous ces prééminences. Nous avons un chef principal, que nous élisons ; parce que nous avons remarqué, que tous les hommes, quoiqu'ils naissent égaux en dignité, ne naissent pas tous égaux en génie, en talents, en bravoure, en force de corps.
La Nature, ajouta-t-il, qui a fait elle-même cette distinction entre ses enfants, nous apprend donc à nous y conformer, et par conséquent à mettre à notre tête celui qui parmi nous a été plus favorisé d'elle. Est-ce la règle que vous suivez dans l'attribution des honneurs et dans la distinction des rangs ? À l'égard de toutes vos lois de bienséance, dictées par le caprice, elle ne servent qu'à fomenter votre corruption et votre orgueil, et qu'à flatter toutes vos passions. De la manière dont je vous vois vivre ici les uns avec les autres, ce que vous appelez politesse et savoir-vivre n'est que mensonge et dissimulation. Vous vous gênez réciproquement pour vous tromper ; et ce soin assidu, est une servitude continuelle, que vous vous imposez. Vous regardez comme des devoirs importants mille choses, dont l'observation n'est plus raisonnable que l'omission.
Prétendriez-vous, continua-t-il, être plus civilisés que nous, parce que vous portez des habits ? Mais si nous étions nés dans un pays éloigné du Soleil, comme le vôtre, n'aurions-nous pas le soin de nous couvrir le corps, comme vous. Nous nous contentons de cacher à la vue, ce que la Nature a destiné pour la continuation de notre espèce, de peur d'accoutumer nos yeux à des objets, qui vus sans cesse plairaient moins. Nous ignorons ces arts, que vos besoins vous ont fait inventer, et qui tirent leur origine de la bizarre inégalité de vos conditions. Car quel est l'homme parmi vous, qui pouvant subsister sans travail, s'aviserait de travailler ? Ces arts, dont vous vous prévalez, sont donc la preuve de votre misère, et comme ils ne produisent que des commodités arbitraires, ou des plaisirs superflus, nous ne vous les envions point ; nous ne désirons que ce que nous connaissons ; et ce que nous connaissons suffit à nous rendre heureux.
Enfin, ajouta-t-il, nous ne voyons point ici un homme demander à un autre homme de quoi vivre, travailler lui en mercenaire, ou le servir lâchement ; nos femmes cultivent nos terres, dont le fond n'appartient pas plus à l'un qu'à l'autre, et dont la culture seule, à laquelle nous avons part, nous donne droit à ce qu'elles rapportent. Notre arc et nos flèches nous amusent, et nous font vivre sans soins et sans inquiétude. Nous n'avons pas votre industrie pour bâtir de grandes cabanes sur terre et sur mer : nous sommes contents sous les nôtres, et jamais nous n'avons eu la pensée de nous éloigner de notre île. Nous n'avons que de petits canaux d'écorces d'arbre pour la côtoyer, pour descendre et remonter nos rivières. Si nos cabanes tombent, il nous coûte peu de peine pour les relever. Tout croît dans notre île, parce que tout ce qui n'y croît pas nous semble inutile. Voyez à présent la différence, qui est entre vous et nous, et quel est le sauvage de nous deux. Vous semble-t-il que celui suit les traces de la Nature, est plus sauvage, que celui qui s'en détourne et l'abandonne, pour suivre l'Art ? Ces arbres, qui sans culture et sans soin produisent dans cette île des fruits délicieux que vous mangez sans aucun assaisonnement, sont-ce des arbres sauvages ? Faites-vous plus de cas de certaines plantes qui ne portent des fruits qu'à force de travail et de culture ? Si cela est, je consens que vous vous préfériez à nous.
Je ne prétends pas néanmoins, continua-t-il, que quoique nous soyons les partisans de la simple Nature, nous en suivons toujours exactement les lois sacrées, ni que nos mœurs soient toujours pures, et tous nos usages irrépréhensible. Nous avons des passions comme vous ; et ces passions corrompent la Nature, après avoir altère la raison. Par exemple, nous sommes trop cruels envers nos ennemis : c'est un vice ancien, qui a jeté de profondes racines parmi nous, et dont la coutume et le préjugé nous dérobent la difformité. Peut-être qu'un jour nous ouvrirons les yeux.
J'étais charmé de la profonde sagesse qui régnait dans les discours de cet insulaire : mais j'étais en même temps humilié par ses raisons, que je ne pouvais néanmoins m'empêcher de goûter. Je rêvai quelque temps, sans répondre aux dernières paroles d'Abenoussaqui, ce qui l'engagea à me parler ainsi : «Ne croyez pas, ô Gulliver, que je sois irrité du nom de sauvage que vous m'avez donné. Au contraire, si par considération pour moi, vous vous suffisez abstenu de ce terme, j'aurais toujours passé pour sauvage dans votre esprit, et je n'aurais point eu occasion de vous désabuser. Je sais que l'amour-propre nous sollicite toujours en faveur de notre pays, et je vous pardonne volontiers d'avoir paru vous préférer à nous.»
En parlant de cette sorte, notre promenade s'acheva ; et nous revînmes à l'habitation, où nous trouvâmes nos compagnons avec plusieurs des insulaires, de retour de la chasse, et chargés de gibier, dont ils nous firent part. Les femmes l'apprêteront, et nous fîmes dans la cabane d'Abenoussaqui, où plusieurs des chasseurs furent invités de se trouver, un repas presqu'aussi agréable que je l'aurais pu faire en Angleterre au milieu de mes amis ; après quoi, nous prîmes tous le calumet, et ne le quittâmes que fort avant dans la nuit.
CHAPITRE 5. — Combat des Kistrimaux et des Taouaous. — Ceux-ci remportent la victoire par le secours des Portugais. — Discours de l'Auteur pour empêcher le supplice des prisonniers. — La paix est conclue les deux nations.
En ce temps-là nous apprîmes que les Kistrimaux, qui étaient ces sauvages contre qui nous avions combattu à notre arrivée dans l'île, ennemis depuis longtemps de ceux parmi lesquels nous vivions, et qu'on nommait Taouaous, avaient depuis peu fait des dégâts sur leurs terres, et s'étaient avancés en grande nombre, dans le dessein de venir brûler leur habitation, et de tuer ou enlever tous les Taouaous qu'ils pourraient rencontrer. Dans cette conjoncture nous offrîmes nos services à nos alliés, et nous les pressâmes de souffrir que nous les aidassions à repousser des ennemis, qui avaient déjà senti la puissance de nos armes.
Les Taouaous ayant accepté nos offres avec reconnaissance, nous leur dîmes de s'assembler le lendemain, parce que nous voulions leur apprendre à combattre en bon ordre, ce qui leur donnerait une grande supériorité sur leurs ennemis. Ils consentirent que notre capitaine fut leur général, et ils promirent d'exécuter tous ses ordres, et d'obéir dans le combat à ceux d'entre nous qu'il choisirait pour être officiers, et commander sous lui. Notre petite armée était composée de neuf cents hommes, nous compris ; notre général s'appliqua d'abord à faire faire l'exercice aux sauvages pendant quelques jours, le mieux qu'il lui fut possible, sans prétendre néanmoins en faire des soldats disciplinés comme les nôtres. Au bout de quelques jours les jugeant suffisamment instruits, il les mena aux ennemis. Nos sauvages étaient armés d'arcs, de flèches, et de haches faites avec des pierres noires dures comme le fer. Pour nous nous avions nos fusils, nos pistolets et nos baïonnettes. Nous n'eûmes pas fait une lieue, que nous arrivâmes au pied d'une colline, où notre général accompagné de son neveux, et de moi, monta pour reconnaître les ennemis, que nous coureurs nous disaient campez dans la plaine. Nous les découvrîmes environ à une demie lieue de distance, et nous jugeâmes par la manière dont ils étaient portés, qu'ils étaient plus forts que nous ; car ils avaient fort étendu leurs ailes pour nous envelopper, ayant apparemment appris notre petite nombre. Ils avaient encore l'avantage du lieu ; un bois fort épais les couvrait à la gauche, et un large ruisseau était à la droite. Notre général ayant attentivement considéré la disposition des ennemis, changea celle de son armée et la rangea ainsi. Comme les ennemis ne pouvaient être pris en flanc, et qu'il leur eût été aisé de nous envelopper par leur grand nombre, si nous les eussions attaqués de front, il fit trois bataillons de son armée ; le premier était commandé par Cuniga, Portugais, d'une grande bravoure et d'une expérience consommé, qui avait servir sur les frontières de Portugal sous milord Galloway dans la dernière guerre des alliés contre les deux Couronnes ; ce corps était composé de deux cent sauvages et de vingt-cinq Portugais. Le second bataillon était commandé par le neveu du capitaine, et composé de même celui de Cuniga ; quatre cents sauvages et cinquante Portugais composaient le troisième où j'étais, et dont le général se réserva le commandement.
Nous marchâmes en cet ordre, et nous nous aperçûmes que les Kistrimaux avaient encore élargi leurs ailes ; nous nous arrêtâmes pour voir s'ils ne viendraient point nous attaquer ; mais voyant qu'ils ne branlaient point, nous avançâmes jusqu'à deux portées de fusil des ennemis, qui jetèrent alors mille cris affreux. Cuniga et le neveu du capitaine commencèrent l'attaque par deux côtés différents, et notre général envoyait du secours à l'un et l'autre, selon qu'il le jugeait nécessaire. Voyant que la troupe de son neveu ne se combattait qu'en retraite, il me commanda avec cent sauvages, et vingt-cinq Portugais pour le soutenir. À coups de sabre, et par le feu de notre mousqueterie, nous fîmes changer la face du combat. Le neveu du capitaine et sa troupe reprirent cœur, et chargeant de nouveau les sauvages avec furie, nous en fîmes un grand carnage ; ils ne reculaient pas malgré leur désavantage ; il semblait au contraire que plus on leur tuait d'hommes, plus ils avaient de courage ; Cuniga et sa troupe faisaient des merveilles, et ce brave homme taillait en pièces les ennemis de l'aile gauche, pendant que nous les repoussions à l'aile droit, les Taouaous nos amis montraient une joie sans égale de nous voir si bien combattre pour eux et pour leur patrie ; mais il faut ici avouer, qu'ils se battirent eux-mêmes avec un courage extraordinaire.
Cependant le général n'appréhendant plus qu'on nous enveloppât, marcha lui-même aux ennemis. Ce fut alors que la mêlée devint sanglante, les Kistrimaux ne fuyaient point, quoiqu'ils eussent déjà perdu beaucoup de monde. Ils se battaient avec une valeur, et une opiniâtreté qui auraient encore fait balancer la victoire, s'ils n'avaient eu affaire qu'aux Taouaous. Nous les entendions s'écrier les uns aux autres, Can, obami paru, nate fris miquie ; ce qui signifie, «Mourons donc tous, puisqu'il nous faut céder» ; il ne s'en sauva guère du combat et on fit beaucoup de prisonniers.
Après une victoire où nous avions eu tant de part, les Taouaous ne purent plus douter que nous fussions leurs véritables amis ; et ils nous rendirent mille grâces. Mais pendant qu'on était occupé à se féliciter de la victoire, Abenoussaqui, qui ne m'avait point quitté durant le combat, me fit remarquer la cruauté de ses compagnons, qui égorgeaient tous les blessés des ennemis ; et il me témoigna la peine que lui causait une pareille inhumanité. Cependant on songea à s'en retourner à l'habitation, et il fallut faire panser nos blessés, qui étaient en grand nombre. J'avais moi-même une légère blessure à l'épaule d'un coup de hache qui avait glissé. Ma petite sauvagesse voulut elle-même être ma chirurgienne, et étant allé chercher des plantes, dont elle connaissait la vertu, elle les applique sur ma plaie, qui fut guérie promptement.
La nuit étant venue, on nous fit assembler dans la grande cabane, et là on nous donna un grand souper dont les prisonniers furent ; ils ne mangèrent pas avec moins d'appétit que nous, et ne parurent aucunement touchés de leur triste sort. Nous nous séparâmes tous après le souper, et nous convînmes de nous rendre le lendemain au même endroit.
Le lendemain nous étant assemblés, un des chefs s'approcha de nous, et nous demanda si nous étions d'avis de brûler ou d'assommer les prisonniers. Il ajouta poliment, que comme nous avions eu tant de part à la victoire, il était juste de nous déférer l'honneur d'être les principaux exécuteurs du supplice des vaincus ; et en même temps on présenta à notre capitaine une massue et une torche, afin qu'il marquât par son choix le genre de mort, auquel il condamnait les prisonniers. On peut juger que notre capitaine se garda bien d'accepter l'horrible emploi dont on voulait l'honorer. Pour moi me ressouvenant alors que j'avais été dans la même situation que ces misérables, je parlai ainsi à tous les sauvages assemblés :
«Est-il possible, ô généreux Taouaous, que des hommes si éclairés, si sages, si vertueux, aient tant d'inhumanité ? N'est-ce pas assez que vous ayez vaincu vos redoutables ennemis, que vous ayez abaissé leur orgueil, que vous les ayez mis en fuite, et que vous ayez couvert de leurs bataillons terrassés la plaine sanglante, où vous ayez si généreusement combattu ? Le carnage a cessé ; faut-il que de malheureux vaincus, échappés à vos armes dans la fureur du combat, soient après la victoire les victimes de votre courroux ? Que ne les avez-vous immolés sur le champ de bataille, lorsqu'ils avaient les armes à la main, et qu'ils pouvaient se défendre ? Quelle gloire trouvez-vous à faire mourir cruellement un ennemi désarmé ? Si en sauvant la vie dans le combat à ces malheureux, vous avez prétendu les faire servir à votre triomphe, que ne rendez-vous ce triomphe plus durable, en conservant ceux dont vous avez triomphé, qui, tant qu'il respireront, publieront malgré eux votre gloire et leur défaite ? Quels avantages ne retirez-vous pas cette conduite modérée ? La fortune des armes change ; si vos ennemis remportent quelque jour une victoire sur vous, et que ceux de votre nation aient le malheur de tomber entre leurs mains, vous pourrez proposer un utile échange et les délivrer. C'est donc en quelque sorte vous sauver la vie à vous-mêmes, que de la sauver à ces captifs. Mais je sens, ô généreux Taouaous, que ce motif vous intéresse trop pour toucher vous cœurs magnanimes. Il faut à vos grandes âmes des motifs plus nobles, et des objets plus grands. Signalez donc aujourd'hui votre générosité par une action digne d'elle. Ne vous contentez pas d'abolir parmi vous un usage barbare, contraire à la raison et à la vertu, et de sauver la vie à des guerriers infortunés qui ne peuvent plus vous nuire ; faites plus : rendez-leur la liberté et renvoyez-les généreusement à leurs compatriotes, qui frappez de cette action héroïque avoueront que votre vertu est encore au-dessus de votre bravoure, et qui, autant par estime que par reconnaissance, rechercheront votre amitié. Est-il un bien plus précieux que la paix ? On ne doit faire la guerre pour y parvenir. Or cette paix, qui ne s'achète d'ordinaire que par le sang, vous pouvez aujourd'hui vous la procurer, en vous abstenant de le répandre. Cette liberté dont vous êtes si jaloux, et que la guerre expose si souvent, vous allez l'assurer pour toujours, en la rendant aujourd'hui à ceux qui sont en votre pouvoir. Si vos ennemis sont assez dépourvus de raison, pour refuser à votre action magnanime la justice et les éloges éclatants qui sont dûs, ils seront forcés au moins de juger alors que vous les avez assez méprisés pour vous mettre peu en peine de les affaiblir en diminuant leur nombre ; et cet aveu qui sera pour eux le comble de l'humiliation, sera pour vous la source d'une gloire immortelle.»
Dès que j'eus fini mon discours, Abenoussaqui, qui était extrêmement respecté de sa nation, se leva, se tournant du côté des ses compagnons, leur dit : qu'il y avait longtemps qu'il condamnait dans sons cœur cette coutume barbare que je les exhortais d'abolir ; que rien n'était plus contraire à la vertu, dont ils faisaient profession ; que la gloire d'une nation était de vaincre ses ennemis, et non de les accabler ; qu'il y avait de la faiblesse à vouloir les détruire autrement que dans les combats, et de l'inhumanité à faire souffrir un cruel supplice à des guerriers pris les armes à la main, et réduits à l'esclavage pour avoir généreusement combattu. Qu'au reste, puisqu'ils étaient redevables de leur victoire aux braves Européens qui les avaient si bien secondés, il était juste qu'au moins en cette occasion on leur fit présent de tous les prisonniers, et qu'on les rendit les arbitres du sort de ces malheureux.
Il se leva alors un grand murmure parmi nos insulaires, qui se mirent à délibérer sur ma harangue, et sur le discours d'Abenoussaqui. Les femmes plus vindicatives et plus cruelles que les hommes, avaient médiocrement goûté nos raisons. Elles insistaient fortement pour l'observation de l'ancien usage, et demandaient la mort des captifs. Mais malgré leurs cris, l'avis d'Abenoussaqui prévalut ; et il fut décidé, que tous les prisonniers nous seraient remis, avec pouvoir d'en disposer à notre gré. Aussitôt on les alla tirer de la cabane où ils étaient enfermés ; ils parurent, et croyant qu'on les allait faire mourir, ils demanderont d'abord leurs haches, suivant la coutume, pour venger leur mort. Se voyant ensuite livrés à nous, ils nous regardèrent fièrement, et commencèrent par nous accabler d'injures et de reproches. Ils nous disent, en nous bravant, que si le puissant Démon qui nous favorisait, n'avait pas rempli d'un feu liquide et impétueux les longs tubes que nous poussions, ils nous auraient coupé en pièces sans peine ; que nous étions des lâches, qui avions combattu avec plus d'artifice que de valeur.
Un chef des Kistrimaux, qui était parmi ces prisonniers, m'ayant reconnu, s'adressa à moi et me dit : «C'est toi qui a autrefois échappé au supplice que tu avais mérité, et que j'aurais rendus le plus cruel qu'il m'aurait été possible, si le Démon qui te protège ne t'avait pas arraché de nos mains ; et je t'aurais fait brûler à petit feu, et j'aurais eu soin qu'aucune partie de ton corps n'eut été exempte de douleur. Je te défie aujourd'hui d'être aussi ingénieux dans les tourments que tu me prépares, que je l'aurais été dans ceux que je destinais. Mais avant que j'expire, peut-être serai-je assez heureux, moi et mes compagnons, pour vous faire tous partir. Oui, c'est sur vous, étrangers odieux, que nous allons venger notre mort, puisque ce sont vos armes meurtrières et infernales, qui ont été la cause de notre défaite.»
Ce discours barbare nous étonna tous, et déjà je commençais presque à me repentir de ma harangue, lorsque notre capitaine s'approchant de ce chef, avec un air de douceur et d'humanité, qui parut le surprendre, lui parla ainsi : «Braves insulaires, nous avons été les défenseurs de nos généreux alliés, et nous sommes à présent les arbitres de votre sort : mais vous nous connaissez mal. Nous détestons l'usage de faire mourir un ennemi désarmé, et encore plus celui de la faire souffrir. Aucun de vous ne mourra par nos mains ; loin de vous condamner à des tourments douloureux, nous voulons même vous épargner celui de la captivité, et vous renvoyer libres. Allez dire à ceux de votre nation, que nous savons encore mieux pardonner que vaincre, ou plutôt que nous ne savons vaincre que donner la paix : Dites-leur, qu'armés ils nous trouveront toujours aussi terribles qu'ils l'ont éprouvé ; mais que désarmés, ils verront toujours en nous des vainqueurs humains, compatissants et incapables d'abuser de la victoire. Partez, vous êtes livres : mais souvenez-vous que nous ne vous craignons, ni ne vous haïssons.»
Ce discours également plein de douceur et de fierté, causa de l'admiration à tous les prisonniers, qui nous regardant comme des hommes extraordinaires, aussi bienfaisants que formidables, demeurent quelque temps interdits, jusqu'à ce que leur chef s'étant incliné devant nous, nous regarda avec un visage, où l'estime et la reconnaissance étaient peintes.
«Magnanimes étrangers, dit-il, votre générosité qui n'a point d'exemple, et qui captive nos cœurs en nous rendant la liberté, est une seconde victoire que vous remportez sur notre nation, en lui faisant voir que votre valeur, qui a surpassé la nôtre, cède encore à votre humanité. Ne croyez pas que l'ingratitude nous fasse jamais oublier cette action généreuse, ni que le ressentiment des maux que vous nous avez causé, essaie jamais d'en travestir le mérite. Votre haine éteinte étouffe la nôtre, et votre générosité efface nos ressentiments. Je vais avec mes compagnons inspirer à ma nation que sa défaite n'aura point abattue les sentiments d'une magnanimité qui puisse égaler la vôtre. Je l'exhorterai à pardonner en votre considération aux Taouaous vos alliés.»
«C'est ce que nous désirons le plus ardemment, répondit le capitaine. Après vous avoir vaincus, après vous avoir rendu la liberté, il ne manque plus à notre gloire, que de vous rendre la paix, et de vous réconcilier avec les généreux Taouaous, qu'une haine invétérée et injuste vous fait regarder comme vos ennemis. Nous nous offrons pour être les médiateurs d'une paix solide et durable.»
Les prisonniers ayant été mis en liberté, nous leur donnâmes un repas le plus magnifique qu'il fut possible ; nous comblâmes leur chef de caresses et d'honneurs ; et on n'omit rien pour les gagner. Nous sentîmes alors la raison reprendre ses droits sur ces âmes féroces et barbares, et nous éprouvâmes, qu'où elle n'est point entièrement éteinte, il y a toujours des ressources pour la vertu.
Cependant les prisonniers partirent, et au bout de trois ou quatre jours, nous les vîmes revenir en qualité d'ambassadeurs, chargés de présents, et de pouvoirs pour conclure la paix, non seulement avec nous, mais encore avec les Taouaous nos amis. Elle fut enfin résolue et jurée solennellement. Il y eut de grandes réjouissances en cette occasion, et je remarquai qu'on traita de part et d'autre avec beaucoup de droiture et de franchise.
Les Kistrimaux nous dirent que si nous voulions les aller voir, ils nous recevraient avec tous les honneurs qui nous étaient dûs ; mais nous les remerciâmes de leurs offres, et nous ne jugeâmes pas à propos de leur promettre notre visite. Ils me firent des présents beaucoup plus considérables qu'à tous les autres, parce qu'ils avaient appris le discours que j'avais prononcé dans l'assemblé en leur faveur, et que j'avais été le premier auteur de l'avis salutaire, qui leur avait sauvé la vie. Les présents consistaient en fourrures, en paniers délicatement travaillés, et en fruits de toute espèce. Après cela ils reprirent le chemin de leur village, très satisfaits de nos honnêtetés, et du succès de leur ambassade.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
* Ambrosius Theodosius Macrobius, dit Macrobe (fl. 430), In Somnium Scipionis, l. 2, cap. 3. [Philosophe et gouverneur de Carthage et de l’Espagne, auteur païen, farouche adversaire du christianisme.]
† Hêrodotos d'Halicarnasse, dit Hérodote (vers 484-420 av. JC), Historiæ, l. 4.
‡ [Quintus Horatius Flaccus, dit Horace (65-8 av. J.-C.), Odes, l. 3, ode 8, v. 27 : Dona præsentis rape lætus horæ, linque severa. — Saisis avec joie les dons de l'heure présente, laisse toute affaire sérieuse.]
PARTIE 3 : RELATION DU SÉJOUR DU CAPITAINE HARRINGTON À L'ÎLE DES
BOSSUS, PUIS CELLE DE JEAN GULLIVER À L'ÎLE DES ÉTATS, ET ENFIN
UNE DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES ÎLES DE LA TERRE DE FEU.
CHAPITRE 1. — L'Auteur avec tous les Portugais s'embarque sur un vaisseau hollandais. — La jeune sauvagesse amoureuse de l'Auteur se précipite dans la mer. — Il retrouve Harrington, qui lui raconte ce qui lui est arrivé dans l'île des Bossus ; construction d'une forge et d'un navire ; l'empereur de l'île des Bossus vient voir le vaisseau construit par les Hollandais ; leur départ ; combat naval, où ils remportent la victoire.
À peine les Kistrimaux furent-ils partis, que six de nos compagnons, que nous avions coutume d'envoyer tous les jours dans un canot à la découverte, vinrent nous rapporter, qu'ils avaient vu un vaisseau à l'ancre, environ à trois lieus ; que l'ayant aperçu avec le télescope, ils avaient ramé vers lui ; et qu'ayant ensuite remarqué qu'il portait pavillon hollandais, ils n'avaient point fait de difficulté d'aller à bord, et de demander à parler au capitaine ; qui leur avait dit qu'il était prêt à nous recevoir tous sur son vaisseau, pourvu que nous lui apportassions des vivres, dont il commençait à manquer.
Cette nouvelle nous combla de joie. Nous renvoyâmes le canot, pour prier le capitaine hollandais de vouloir bien nous attendre, et lui dire que nous allions faire une chasse générale, afin de fournir à son vaisseau une abondance de vivres, dont il serait content. Cependant les sauvages apprirent que nous nous disposions à les quitter ; et cette nouvelle parut les affliger extrêmement. Nous leur dîmes qu'il fallait que nous retournassions dans notre patrie pour consoler nos femmes, nos enfants, tous nos parents et tous nos amis, qui nous croyaient peut-être ensevelis dans le sein des flots, que nous n'oublierions jamais l'amitié qu'ils nous avaient témoignée ; et nous les priâmes aussi de vouloir bien se souvenir de nous.
Ces bons insulaires, quoique très touchés de notre départ, se mirent alors à chasser pour nous, et tuèrent une quantité prodigieuse de gibier. Leurs femmes prirent le soin d'en faire boucaner une partie, en sorte que pendant plusieurs jours on ne cessa de porter au vaisseau des vivres, dont on chargeait les canots à chaque instant : on eut soin aussi de renouveler l'eau. Enfin au bout de cinq jours, nous prîmes congé de nos chers alliés, et nous entrâmes tous dans la chaloupe.
Non seulement les Taouaous, mais encore les Kistrimaux, qui avaient appris la nouvelle de notre départ, vinrent pour nous dire adieu, et nous donner des vivres, en sorte que la mer paraissait en cet endroit tout couvert de canots. Lorsque notre chaloupe m'était plus environ qu'un quart de lieu du vaisseau, le capitaine hollandais nous envoya demander, si les sauvages ne seraient point effrayés du canon, qu'il avait envie de faire tirer, en signe de réjouissance. Avant que de donner la réponse, nous communiquâmes la proposition aux principaux des Kistrimaux et des Taouaous, qui en ayant donné part à ceux de leur Nation, nous dirent, que cela leur ferait un grand plaisir ; et que puisque nous avions eu la bonté de les avertir, ils n'auraient aucune défiance. Nous fîmes donc dire au capitaine, que nous le remercions de l'honneur singulier, qu'il voulait bien nous faire, et que les sauvages qui nous accompagnaient, prendraient à cette salve un plaisir dont nous lui saurions gré.
À peine la réponse lui eut-elle été portée, qu'on entendit une décharge, dont le bruit égalait celui du tonnerre. Ce fut un plaisir pour nous, de voir alors la contenance des sauvages, dont les uns ravis d'admiration restaient immobiles, et les autres frappés de peur, quoique prévenus, semblaient vouloir s'enfuir dans leur île. Enfin nous vînmes à bord et fûmes reçus des Hollandais avec toute la civilité possible.
Je ne puis omettre ici les larmes et les regrets dont l'aimable fille d'Abensoussaqui honora mon départ. Le jour que nous partîmes elle s'échappa de la cabane, où son père l'avait enfermée, et m'accabla de reproches. Jamais la reine de Carthage ne fut plus désespérée au départ du capitaine troyen, et jamais mon cœur n'éprouva de plus rude combats ; je regrettais autant l'île que je quittais, que dans le long séjour que j'y avais fait j'avais regretté ma patrie. J'assurai ma maîtresse que jamais je ne l'oublierais ; je lui promis, pour calmer son âme, de la revenir voir dans quelque temps. Mais rien ne fut capable de la consoler ; et lorsqu'elle vit la chaloupe s'éloigner du rivage, elle se précipita dans la mer, et s'y noya : spectacle qui me fit verser des larmes en abondance, et qui m'aurait peut-être coûté la vie, si le capitaine portugais et tous mes amis ne m'avaient fait rougir d'une faiblesse indigne d'un vrai marin.
Le capitaine hollandais ayant appris que j'étais anglais, me dit qu'il avait sur son vaisseau un homme de mon pays, qui avait beaucoup de sagesse et d'expérience ; que ce serait une grande satisfaction pour moi, de me trouver avec un compatriote de son mérite, qui d'ailleurs avait séjourné dans des pays inconnus, dont il racontait des choses étonnantes. En même temps il fit chercher cet Anglais pour me présenter à lui.
Ô mon cher lecteur, quelle fut ma surprise et ma joie, lorsque cet Anglais parut à mes yeux, et que je reconnus Harrington ! Nous nous embrassâmes étroitement, et nous ne pûmes l'un et l'autre retenir nos larmes. Nous ne pouvions parler, parce que nous avions trop de choses à nous dire, et que nous étions saisis et transportés. Cependant nous rompîmes le silence tous deux à la fois, et nous nous demandâmes réciproquement, comment il se pouvait faire, que nous nous trouvassions actuellement ensemble, et comment nous étions échappés du naufrage. Je répondis le premier, et lui fis un fidèle récit de tout ce qui m'était arrivé. Je lui dis comment j'étais abordé dans l'île de Tilibet avec mon canot ; comment j'étais sorti de cette île par le moyen d'un vaisseau portugais, qui y était venu faire eau ; comment ensuite nous avions abordé dans l'île dont nous sortions ; et comment nous avions été obligés d'y séjourner plus d'un an, par la perte de notre vaisseau, nos matelots ayant levé l'ancre, pendant que nous étions à terre. Je lui racontai les peines que nous avions eues dans cette île, les périls que j'y avais courus, les victoires que nous y avions remportées, et enfin le genre de vie que nous y avions mené.
Harrington m'ayant écouté avec une attention, qui marquait la part qu'il prenait à ce qui me touchait, me parla ainsi : «Apprenez aussi, mon cher Gulliver, ce qui m'est arrivé depuis notre triste séparation. Lorsque la violence de la tempête nous eût contraints d'abandonner notre vaisseau, et de nous jeter avec précipitation dans la chaloupe, nous vous cherchâmes parmi nous, et ne vous trouvant point, nous voulûmes nous rapprocher du vaisseau pour vous prendre. Mais un coup de vent nous éloigna tellement, qu'il nous fut impossible de le faire, malgré tous nos efforts. Le péril affreux où nous étions, ne nous empêcha pas d'être sensibles à votre perte.
Cependant la mer se calma un peu, et après avoir longtemps vogué, nous aperçûmes terre avec le télescope, et cette vue nous rendit l'espérance que nous avions perdue. Alors nous fîmes force de rames, pour nous approcher du rivage que nous voyons, et déjà nous en étions assez près, lorsque notre chaloupe, qui avait plusieurs fois heurté contre les rochers, et qui était très endommagée, s'ouvrit tout à coup sur la pointe d'un rocher qui était à fleur d'eau, et que malheureusement nous n'avions point aperçu. En un instant elle se remplit d'eau, et coula à fond avec tout l'équipage qui se noya. Pour moi ayant par bonheur saisi une planche, je me sauvai comme je pus, et je fis des efforts extraordinaires pour gagner le rivage. J'y abordai enfin, accablé de lassitude, et du poids de mes vêtements tout mouillés, mais beaucoup plus encore de la douleur où j'étais plongé.
Dans ce triste état pressé d'une soif extrême, je fis plus de trois lieues, pour tâcher de découvrir quelque ruisseau ; mais, sans avoir pu rencontrer, je me vis surpris de la nuit, et obligé de me coucher dans une plaine, où le mal que je souffrais et la crainte des bêtes féroces ne me permirent point de dormir. Le lendemain dès que le jour commença à paraître, je me mis en marche, et trouvai heureusement sur mon chemin des arbres qui portaient un fruit pareil à la cerise, mais d'un bien meilleur goût. Je mangeai de ce fruit avec un plaisir extrême, parce qu'il me rafraîchissait et me rassasiait en même temps. Je continuai ma pénible marche et arrivai sur le bord d'une rivière assez large et très rapide.
Je suivis son cours environ deux lieues, en remontant. Enfin j'aperçus quelques paysans qui travaillaient dans la campagne. Je m'approchai d'eux, et par mille postures humbles, je tâchai de m'attirer leur protection. Mais au lieu de répondre à mes honnêtetés, ils se mirent à faire de grands éclats de rire, en me regardant. Cependant après avoir beaucoup ri, ils me firent signe de me rendre dans un village, qui n'était pas éloigné ; où dès que je fus arrivé, je vis tous les habitants sortir de leurs maisons et venir en foule et en riant, me considérer comme un homme d'une espèce rare et curieuse.
Je ne pouvais comprendre le sujet de leur empressement et de leurs risées ; mais ayant remarqué que tous ces hommes étaient bossus, je m'imaginai qu'ils étaient peut-être étonnés de ma figure, et de ce que je n'avais point de bosse comme eux. Je ne me trompai point dans ma conjecture. On me fit entrer dans une maison, où les valets ne se lassèrent point de me regarder et de me rire au nez. Je remarquai pourtant qu'une femme me considérait sans rire, et j'en sus la raison dans la suite.
Cependant le maître du logis, homme grave et prudent, mais plus bossu encore que tous les autres, fit entendre à tous ceux de sa maison, qu'il ne fallait point ainsi insulter un pauvre étranger disgracié de la Nature. Mais malgré ses remontrances, on continua toujours de rire, et lui-même, avec toute sa gravité grotesque, ne pouvait de temps en temps s'en empêcher. Ayant fait signe que j'avais faim, ils me donnèrent un morceau de gâteau, avec un verre d'une boisson si mauvaise, que j'aimai mieux boire de l'eau.
Après ce mauvais repas, qui marquait le peu de cas qu'on faisait de moi, on me laissa seul, et on me conseilla de ne point me montrer, de peur d'être insulté par la canaille. Le soir on me donner à manger un morceau de pâte mal cuite, et on me conduisit ensuite dans une espèce de grenier, où je trouvai un méchant grabat, sur lequel je me couchai, sans autre couverture que mes habits que j'avais un peu séchés.
Le lendemain matin j'allai remercier de ce bon traitement le maître et la maîtresse du logis, qui me demandèrent par signes, si j'étais né dans un pays fort éloigné du leur. Je leur fis comprendre que j'avais traversé plusieurs mers, et que je venais de fort loin. Le maître me dit alors, qu'ils avaient ouï dire qu'à l'extrémité de l'île, vers le sud, il y avait des étrangers faits à peu près comme moi, et qui venaient aussi d'un pays très éloigné ; que le lendemain il aurait soin de s'en mieux informer, ne le pouvant ce jour-là, parce que sa fille se mariait.
En effet, l'amant de cette fille vint un moment après, pour rendre visite à sa future épouse ; et je vis un petit homme bossu par-devant et par-derrière, qui avait pourtant l'air assez galant, et qui paraissait très persuadé de sa bonne mine et de son mérite. La jeune fille, qu'il devait épouser, n'avait qu'une bosse entre les deux épaules : mais elle était si pointue et si haute, qu'en la regardant par-derrière, on ne voyait que le sommet de sa tête. Les deux amants se firent beaucoup de politesses, et parurent charmés l'un de l'autre. Tout le monde les félicitait sur le bonheur dont ils allaient jouir, et on ne pouvait surtout se lasser d'admirer la taille charmante de la future épouse. On disait que le père m'avait exprès reçu chez lui, pour mettre mieux en jour les tailles parfaites de sa fille et de son gendre, et pour les rehausser par la comparaison de ma figure avec la leur. Pour moi, malgré le triste état où j'étais, je ne pouvais quelquefois m'empêcher d'éclater de rire, en voyant une assemblée de tant de bossus de deux sexes ; et de leur rendre intérieurement une partie des moqueries, dont ils m'avaient accablé la veille, où l'abattement de mon esprit et de mon corps m'avait empêché de rire aussi bien qu'eux.
Cependant on sortit pour aller faire la célébration du mariage, et je voulus y assister. Mais on ne jugea pas à propos de me le permettre, de craindre que ma figure extraordinaire n'excitât des ris indécents, et ne troublât la cérémonie. Je restai donc au logis avec la mère de celle qu'on allait marier, qui se mit à sa toilette, et qui, avec les secours de sa femme de chambre, se para de son mieux. Elle s'était enfermée avec elle, et comme je ne savais que faire, en attendant le retour des nouveaux mariés, je m'avisai de regarder par le trou de la serrure. Je vis d'abord sur la toilette deux bosses artificielles de grosseur honnête. La dame se dépouilla d'abord jusqu'à la ceinture inclusivement, et fit mettre par sa femme de chambre, sur son dos et sur son estomac, les deux bosses dont je viens de parler, qu'elle fit attacher à sa chemise avec beaucoup d'adresse et de propreté. Je conçus alors, pourquoi elle n'avait point ri la veille comme les autres, son amour-propre, ou plutôt sa conscience l'avait rendu sérieuse.
Les nouveaux mariés étant revenus, avec tous les parents et tous les amis, on fit de grandes réjouissances ; et après le repas, qui fut magnifique, on m'obligea de danser pour divertir la compagnie. J'étais pour eux une espèce de polichinelle : aussi ma danse les fit-elle beaucoup rire. Quelques-uns d'eux, plus honnêtes et plus charitables que les autres, s'approchèrent de moi, et me firent comprendre qu'il fallait un peu excuser leurs ris involontaires ; qu'au reste je devais me consoler de mes épaules unies, et de ma poitrine plate, tout le monde ne pouvant pas être bien fait, et notre figure ne dépendant point de notre choix. Tant il est vrai que rien en foi n'est difforme ou ridicule, et que ce qui nous semble tel n'est que singulier par rapport à nous. Cependant la dame du logis qui s'était toujours abstenue de rire, pria la compagnie de me ménager, et de ne me témoigner aucun mépris. Nous aimons toujours ceux qui nous ressemblent, même par les défauts.
Le lendemain on voulut bien me donner un paysan pour me conduire vers l'endroit où étaient ces étrangers semblables à moi, qu'on disait être au nord de l'île. Je pris donc congé de mes hôtes, après les avoir remerciés de leurs bons traitements. Je me mis en campagne, accompagné du paysan qui m'ayant montré la route que je devais tenir, me quitta au bout de deux lieues. Mon voyage fut de sept jours, et enfin après m'être égaré, et avoir beaucoup souffert de la faim, de la soif, de la lassitude et de l'ennui, j'arrivai près de l'habitation qui m'avait été indiquée.
Je fus agréablement surpris d'y trouver des amis et des voisins de notre nation, je veux dire des Hollandais. Comme la plupart entendait ma langue, je leur exposai mon infortune, et les priai de vouloir bien me permettre de rester avec eux. Ils me reçurent avec honnêteté, et me dirent qu'ils étaient au nombre de cent cinquante, qui avaient été comme moi maltraités par une tempête, et obligés d'échouer sur les côtes de cette île ; que depuis six mois qu'ils y faisaient leur séjour, ils n'avaient point quitté le rivage où ils étaient, se tenant toujours sur leurs gardes ; que personne ne les avait inquiétés jusqu'alors, et que tout le mauvais traitement qu'ils avaient reçu des habitants du pays, qui leur avaient paru difformes et contrefaits, était d'avoir souvent excité leur risées : ce qui leur faisait juger que ce peuple était présomptueux, méprisant, railleur et malin : qualités ordinaires aux hommes d'une figure telle que la leur.
Cependant, ajoutèrent-ils, nous sommes condamnés à passer peut-être le reste de notre vie dans ce triste séjour, parce qu'il ne nous reste qu'une mauvaise chaloupe, sur laquelle nous n'osons nous mettre en mer. Nous avons de bons charpentiers, mais qui ne peuvent la radouber, n'y ayant point de fer dans cette île, et nous étant par conséquent impossible de couper des arbres. Quand même nous le ferions avec des pierres tranchantes, à la manière des habitants du pays, à quoi nous servirait le bois que nous pourrions abattre et mettre en œuvre, puisque la plupart des veilles ferrures de la chaloupe sont brisées, et ne peuvent plus servir ?
Ce discours, qui m'ôtait presque toute espérance de revoir ma patrie, m'affligea extrêmement ; mais enfin je pris mon parti, et je résolus de vivre comme tous ceux avec qui j'étais, c'est-à-dire, de passer les jours entiers à chasser, à manger et à boire. Combien de gentilshommes de mon pays, me disais-je, mènent une vie pareille ? Que font-ils autre chose ? Cependant ils sont satisfaits, tandis que les habitants des villes, dont les occupations sont différentes, les méprisent, et les regardent comme une espèce d'hommes aussi brutes que les animaux à qui ils font la guerre ; de même à peu près que les habitants de cette île nous méprisent et se moquent également de notre figure et de notre genre de vie. Après tout, puisque je suis réduit à ce misérable état, il est inutile de m'en affliger.
Je me mis donc à chasser avec tous les autres compagnons de mon exil ; et l'habitude me fit goûter peu à peu un exercice, où je ne concevais pas auparavant, qu'un homme un peu raisonnable put prendre beaucoup de plaisir.
Un jour en revenant de la chasse, et me trouvant dans une vallée assez profonde, j'aperçus quelques fentes (R), signes ordinaires, qui, comme on sait, indiquent des dépôts de mineral de fer. J'allai aussitôt porter cette nouvelle à mes compagnons, et les engageai à venir le lendemain fouiller dans la terre, pour voir si en effet il n'y avait point de fer dans l'endroit où j'avais remarqué ces fentes. Nous n'eûmes pas creusé environ un pied, que nous fûmes surpris et charmés tout ensemble, de trouver la plus belle mine ronde que nous pussions souhaiter. À quelque distance de-là, nous eûmes encore le bonheur de trouver, après quelques recherches, une castine excellente. Cette heureuse découverte nous engagea quelques jours après à bâtir un petit fourneau. Comme nous n'avions aucune fonte, pour en construire les voûtes, nous nous servîmes de pierres. À l'égard des soufflets, nous prîmes quelques planches de notre chaloupe, que nous ajustâmes, et que nous garnîmes de peaux, attachées avec des chevilles de bois. Les buses de ces soufflets grossiers furent faites avec des canons de pistolets. La difficulté était de faire jouer ces soufflets, n'ayant point d'eau qui passât auprès de notre fourneau, nous fûmes obligés de les ajuster, de façon que nous les puissions faire mouvoir à force de bras, ainsi qu'il se pratique en Europe chez les serruriers et les maréchaux-ferrants.
Comme nous avions du bois en abondance, nous fîmes du charbon, à peu près ce qu'il en fallait pour mettre notre fourneau en feu. Nous tirâmes du mineral de fer à proportion ; et après avoir fait le travail ordinaire, nous coulâmes une gueuse d'environ trois cents livres ; cette opération était d'autant plus surprenante, que nous n'avions pu travailler qu'avec des ringards et des fourgons de bois.
Quand nous eûmes notre gueuse, nous fîmes des marteaux, des heusses, des taquets, des enclumes, et nous continuâmes de couler le fer, afin d'être en état de travailler bientôt à une forge. Pour cela nous construisîmes une chaufferie, où nous employâmes nos taquets et nos soufflets ; nous mîmes une base de fonte, et fîmes des barres de différente grosseur, des coins, des haches, des scies, des tenailles, des étaux, des clous, et tout ce qui nous était nécessaire pour la construction de notre vaisseau. Un serrurier, que nous avions parmi nous, nous fut d'un grand usage pour façonner diverses pièces de fer, et former l'acier nécessaire pour tous nous outils. Ce qui nous coûta le plus de peine furent les ancres, que nous vînmes cependant à bout de forger, comme le reste.
Nous allâmes ensuite couper plusieurs grands arbres, que nous sciâmes, et que nous accommodâmes avec nos outils, afin qu'ils pussent nous servir de mâts et de vergues. Nous sciâmes des planches de différente grandeur ; et alors nos charpentiers, qui étaient fort habiles, se mirent à commencer la construction du vaisseau, qui en peu de mois fut assez avancé. Cependant il nous manquait des câbles, du goudron, de la toile pour faire des voiles. Afin de nous en procurer nous donnâmes des pièces différente de fer de fonte, et de fer forgé aux insulaires, qui étaient venus en foule admirer notre travail, et dont les yeux s'étaient tellement accoutumés à notre figure, qu'ils n'étaient plus tentés de rire en nous voyant. Nous leur donnâmes, dis-je, des pièces différentes de notre fer ; et en échange ils nous fournirent en abondance de la corde et des toiles, avec du goudron composé d'une résine excellente, qui croissait sur de grands sapins situés au nord se l'île.
Notre vaisseau étant entièrement construit, nous le goudronnâmes parfaitement, aussi bien que nos cordages, dont nous fîmes des câbles de toute grosseur. Nous plantâmes les mâts avec leurs hunes et leurs haubans, et y attachâmes les vergues, les voiles, et tous les cordages ordinaires. Enfin après un travail de plus d'une année, nous lançâmes à la mer le navire que nous appelâmes le Vulcain, parce qu'il était redevable de son origine à la forge, que nous avions si heureusement construite dans un pays où il n'y en avait jamais eu.
Ce fut alors que la curiosité des insulaires augmenta. Un d'entre'eux nous offrit une somme considérable, à condition d'avoir le droit de montrer notre vaisseau en cet état pour de l'argent, et d'en retirer le profit. Nous y consentîmes, et il y eut un concours extraordinaire d'habitants du pays, qui témoignèrent autant d'admiration que d'empressement ; ce qui rendit beaucoup d'argent.
Il y avait parmi un jeune homme, qui avait beaucoup de disposition pour apprendre les langues, et qui ayant un peu appris celle du pays où nous étions, nous avait été d'une grande utilité dans le commerce, que nous avions été obligés d'avoir avec les naturels de l'île, afin de pouvoir fournir de tout ce qui nous était nécessaire pour notre départ. Ce fut lui qui nous servit d'interprète dans la visite, que nous reçûmes alors d'un envoyé de l'empereur de l'île, nommé Dossogroboskovv LXXVII. du nom, qui régnait avec beaucoup de gloire depuis trente années.
L'envoyé nous dit, que Son Indépendance — c'est le titre d'honneur qu'on donne à cet empereur — ayant ouï parler du grand et vaste canot que nous avions construit, souhaitait que nous le lui apportassions pour le voir ; que pour cet effet, elle nous enverrait autant de chameau que nous voudrions pour nous faciliter le moyen de le transporter à la Cour. Nous lui répondîmes par notre interprète, que ce que Son Indépendance souhaitait était impossible ; et que si Elle était curieuse de voir notre ouvrage, il fallait qu'Elle prit la peine de se transporter Elle-même sur le rivage, et que nous tâcherions de la recevoir avec tous les respects et tous les honneurs dus à un aussi grand prince.
Il nous réplique, qu'il fallait donc qu'il toisât le grand canot, pour faire goûter notre réponse à l'empereur, qui ne consentirait jamais à prendre la peine de le venir voir, qu'après qu'on lui aurait démontré l'impossibilité absolue de le transporter par terre. Il entra aussitôt dans notre vaisseau, et après en avoir pris exactement toutes les dimensions, et en avoir estimé la pesanteur, il nous promit d'en faire un rapport fidèle à Son Indépendance, et de tâcher de Lui faire entendre que le transport par terre était impraticable. Il partit, et revint quelques jours après pour nous annoncer que l'empereur en personne viendrait le lendemain avec toute sa Cour, et que c'était à nous de nous préparer dignement à un si grand honneur.
Par malheur nous n'avions point de canons, et nous étions au désespoir, de nous voir hors d'état de briller dans une occasion si glorieuse. L'envoyé nous dit, que dès que l'empereur serait arrivé à cent pas de distance, il suffirait de nous prosterner tous la face contre terre, pour l'adorer ; qu'après cela nous nous relèverions, et que notre chef, ou l'interprète en son nom et au nom de toute la troupe Lui serait compliment court, pour Lui témoigner l'admiration que nous causait son auguste présence, et la reconnaissance dont nous étions pénétrés de l'honneur singulier qu'il voulait bien nous faire. En même temps il remit entre les mains de notre premier capitaine, nommé van Land, une espèce de sarbacane ou porte-voix, en nous avertissant, que lorsque l'empereur donnait audience, ceux à qui il accordait cette grâce, ne pouvaient s'approcher de sa personne sacrée qu'à la distance de cent pas ; qu'il fallait par conséquent qu'ils Lui parlassent par le moyen d'une sarbacane, et que son chancelier répondit de même.
Il nous avertit encore, que lorsque l'empereur s'approcherait pour voir de près le grand canot et le visiter, nous devions alors éloigner à gauche à cent pas de distance ; que cependant il nous enverrait ses ministres et ses courtisans pour nous entretenir. Lorsqu'il nous eut instruits de ce bizarre cérémonial, nous demandâmes à l'envoyé, si en parlant aux ministres du prince et à ses courtisans, il fallait leur donner quelques titres d'honneur, comme votre Grandeur, votre Excellence. Il nous répondit, que l'usage était parmi eux, de donner des titres à chacun, non selon ses qualités personnelles, mais selon les qualités qui convenaient à son rang et à sa profession. Par exemple, dit-il, lorsque vous parlerez aux ministres, vous leur direz, votre Affabilité ; aux gens de guerre vous direz, votre Humanité ; aux administrateurs des Finances vous direz, votre Désintéressement ; aux magistrats de Cour, votre Intégrité ; aux Bracmanes de la suite de l'empereur, votre Science ; aux dames, votre Rigueur ; aux jeunes seigneurs, votre Modestie ; et à tous les courtisans en général, votre Sincérité. Notre interprète retint toutes ces formules, et promit de les observer le mieux qu'il lui serait possible.
Le lendemain, l'empereur monté sur un superbe chameau, précédé d'une foule de Gardes, et suivi d'une Cour nombreuse, arriva sur les trois heures après midi. Lorsqu'il fut environ à cent pas de nous, il s'arrêta, et aussitôt nous nous prosternâmes, comme on nous l'avoir prescrit. Nous nous relevâmes, et alors notre interprète prenante la sarbacane complimenta Son Indépendance durant cinq minutes. La réponse du chancelier qui fut très polie et très éloquente dura trente seconds ; après quoi nous retirâmes sur la gauche, pour laisser avancer l'empereur, qui étant descendu dans notre canot, avec quelques-uns de ses favoris, se mit en devoir de monter sur le navire. Son Indépendance, qui était grosse et pesante, eut besoin du secours de tous ceux qui l'accompagnaient, pour pouvoir passer du canot dans le vaisseau, et elle pensa tomber dans la mer. Elle nous fit l'honneur d'être deux heures sur notre navire ; et tous les courtisans y étant montés les uns après les autres, témoignèrent tous beaucoup d'admiration.
L'empereur passait pour un des princes les mieux faits qui eût jamais été assis sur le trône de cette île ; il était fort grand et fort gros ; il avait de très larges épaules, au milieu desquelles s'élevait une bosse parfaitement convexe, qui effaçait entièrement son omoplate, et qui pouvait faire honte à tous les chameaux de sa suite. Une autre bosse naturelle qu'il avait par-devant, lui tombait jusque sur l'estomac et était presque contiguë à son gros ventre : ce qui lui donnait une gravité très majestueuse aux yeux de ses sujets.
Notre interprète s'entretint avec plusieurs des courtisans, qui nous dirent poliment, qu'ils prenaient part à la joie que nous ressentir d'avoir pu procurer à leur auguste maître un plaisir nouveau. Cependant l'empereur ayant vu et examiné à loisir le vaisseau, et ayant eu la bonté de nous donner quelques éloges, descendit dans le canot, et ensuite remonta sur son chameau, puis s'en alla avec toute sa suite. Avant que de partir, il voulut bien envoyer à notre capitaine son portrait garni de diamants et d'émeraudes. Il était très fidèle, excepté que le peintre, pour flatter le monarque, avait un peu enflé ses deux bosses.
Cependant comme nous ne pouvions partir que dans un mois, et que nous n'avions plus chacun que cinq ou six coups de poudre, il fut résolu que nous ménagerions nos provisions jusqu'au temps de notre embarquement, et que nous garderions notre poudre, pour tuer du gibier deux jours avant que de partir, afin de pouvoir l'embarquer, sans qu'il fût nécessaire de le boucaner. Nous prîmes donc le parti de vivre de poisson jusqu'à notre départ ; mais nous n'avions point de filets pour pêcher. Comme nous étions un peu embarrassés, je trouvai ce moyen pour attraper du poisson.
J'allai dans la forêt qui n'était pas éloignée, et y coupai huit branches fort droites, dont je fis autant de perches hautes de dix pieds. Je fis ensuite faire par notre serrurier cinq ou six cents petits crochets très pointus. J'attachai tous ces crochets garnis d'un peu de viande à mes dix perches, et les allai planter sur la grève dans le temps du reflux, sachant que l'endroit devait être inondé lorsque le flux arriverait. Je voulus l'attendre pour voir si les premières vagues ne renverseraient point mes perches ; mais j'eus la satisfaction de les voir rester de bout et immobiles, parce qu'elles étaient solidement plantées. Trois heures après, lorsque la mer commençait à se retirer, je vis toutes mes perches chargées de poissons de différente grosseur. J'allai alors chercher plusieurs de mes camarades, et les priai de venir m'aider à apporter une charge de gibier que j'avais pris. Ils furent agréablement surpris de voir l'heureuse pêche que j'avais faite. Nous la réitérâmes plusieurs fois jusqu'au jour de notre départ ; et nous prîmes assez de poisson, pour en pouvoir charger une grande quantité sur notre vaisseau.
Le navire étant suffisamment lesté et en état de nous transporter, nous fîmes une chasse générale pendant trois jours, et nous eûmes le bonheur de tuer des bœufs sauvages, des biches, et plusieurs autres animaux, que nous portâmes sur le vaisseau. Enfin le vent étant favorable pour retourner en Europe, nous levâmes l'ancre et mîmes à la voile.
Au bout de huit jours nous prîmes hauteur, et nous estimâmes que nous avions fait cent trente lieues. Nous ne manquions point de boussole, notre contre-maître nous ayant fourni une excellente pierre d'aimant, qu'il avait heureusement sauvée du naufrage, et avec laquelle il frotta une aiguille, que notre serrurier nous avait faite. Mais malheureusement nous n'avions point de canons, et nous n'avions pour toutes armes, que nos sabres, nos baïonnettes avec nos fusils et nos pistolets, qui ne pouvaient nous être d'aucun usage, n'ayant plus de poudre, en sorte que nous craignions extrêmement les rencontres ; mais ce fut une rencontre même qui nous fournit ce qui nous manquait, comme je vais vous le dire.
Il y avait environ deux mois que nous naviguions, lorsqu'un corsaire d'Achem parut, et nous donna la chasse. Nous fîmes forces de voiles, pour nous en éloigner ; mais ce fut en vain, et il nous atteignit. Nous nous préparâmes alors à la défense, et nous convînmes avec le capitaine van Land, le pilote, et le contre-maître, qu'il fallait faire nos efforts pour accrocher le navire ennemi, qui était petit et paraissait faible d'équipage.
C'est en effet ce que nous fîmes. Après avoir essuyé quelques bordées de canon, qui ne nous firent que peur de tort, nous prîmes le dessus de vent, et tombâmes sur le corsaire, que nous accrochâmes ; aussitôt nous sautâmes à l'abordage, les premiers le sabre à main, et les autres la baïonnette au bout du fusil. Cette action rapide et vigoureuse ayant étonné les barbares, dont le nombre n'égalait pas le nôtre, nous en massacrâmes la plus grande partie, et nous nous rendîmes maîtres de leur vaisseau, dont nous prîmes les vivres, les marchandises, tous les agrès qui pouvaient nous convenir, la poudre, et surtout les vingt-quatre pièces de canon, qui nous firent un grand plaisir : après quoi nous renvoyâmes les corsaires dans leur vaisseau, ne jugeant pas à propos de nous charger de tels prisonniers.»
Il y a environ deux mois que cette action s'est passée, et comme nous avions à présent sur notre vaisseau par moyen de cette prise, des marchandises très précieuses de l'Orient, telles que toiles de Bengale et de Surate, et des soies de la Chine, nous avons jugé à propos d'aller aux mers du Sud, pour y commercer en interlope. Nous avons heureusement passé près de l'île, où la fortune vous avait conduit ; et un calme de quelques jours nous ayant retenus dans cette plage, vous nous avez aperçus, et avez imploré notre secours. Bénissons à jamais l'adorable Providence, mon cher Gulliver, et espérons toujours en elle, dans nos plus grands malheurs.»
Je vous ai raconté, ajouta-t-il, ce qui m'est arrivé depuis notre séparation, et vous voyez que j'ai mené une vie assez triste : mais votre rencontre m'a rendu toute la joie que j'avais perdue. Cependant apprenez-moi pourquoi vous semblez regretter le séjour que vous venez de quitter : l'amour de la liberté et de la patrie, qui touche si sensiblement tous les hommes, ne fait-il sur vous aucune impression ? Avez-vous contracté une funeste habitude de mélancolie, par cette suite de malheurs que vous avez essuyés ?
Je ne pus alors me défendre de lui faire confidence de la passion violente, que m'avait inspiré la fille d'un sauvage, et de la douleur dont j'avais été pénétré, en la voyant périr à mes yeux, par le désespoir que lui avait causé mon départ. Harrington n'omit rien pour me consoler, et me dit obligeamment, qu'il avait en Angleterre deux filles qui passaient pour belles ; que si nous étions assez heureux pour revoir notre patrie, il m'en donnerait le choix, avec la moitié de son bien ; qu'il m'avait obligation de la liberté qu'il avait perdue dans l'île de Babilary, et que par mon moyen il avait recouvrée, et qu'il ne pouvait trop faire pour payer ce bienfait.
CHAPITRE 2. — L'Auteur aborde à l'île des États. — Description des différentes îles de la Terre de Feu ; îles des Poètes, des Philosophes et des Géomètres, des Musiciens, des Comédiens, des Médecins, et des Gourmands.
Les entretiens fréquent que j'eus avec Harrington, calmèrent un peu ma douleur ; peu à peu ma raison prit le dessus, et les troubles de mon cœur se dissipèrent. Deux jours après notre arrivée dans le vaisseau, il s'éleva un vent, qui quoique médiocrement favorable, nous fît lever l'ancre. Nous déployâmes nos voiles, et fîmes toute en louvoyant ; le vent devint ensuite très favorable, en sorte qu'au bout de six semaines nous entrâmes dans le détroit de Magellan, entre la Terre de Feu et la Patagonie. On sait que cette Terre de Feu fut découverte en 1520 par le célèbre Ferdinand Magellan, qui la prit pour une grande île ; mais il est certain aujourd'hui, par les découvertes des voyageurs, que cette Terre n'est pas une seule île, mais un nombre considérable d'îles très hautes, dont on n'a pourtant encore qu'une connaissance peu distincte. Les habitants de ces îles, si l'on en croit les espagnols, sont des géants ; mais si l'on en croit les relations des autres nations, qui ont passé souvent dans les mers du Sud par le détroit de Magellan, ces îles sont habitées par des hommes, qui à la vérité sont robustes, mais d'une taille ordinaire, qui vivent comme des bêtes, et qui malgré le froid du climat sont nus, et habitent les cavernes des montagnes.
Pour moi je crois que les uns et les autres nous en ont imposé, et que ces peuples sont très civilisés, comme l'ont été de tout temps les nations de l'Amérique méridionale, qui n'en sont séparées que par un espace fort étroit. Quoiqu'il en soit, les découvertes que nous fîmes dans notre passage par le détroit de Magellan, pourtant servir à corriger l'erreur où nous avons été jusqu'ici, par rapport à ces îles, que nous avons cru peuplées d'hommes grossiers et sauvages. Il y en a au moins dont les habitants ne sont nullement barbares, comme on le verra dans la suite.
Les gens de notre vaisseau voulurent s'approcher de l'île des États, qui est la plus méridionale de toutes ces îles. Elle fut autrefois découverte par les Hollandais, qui ne nous en ont donné qu'une idée générale et confuse : ce qui fait croire qu'ils la connaissaient peu. La curiosité nous porta à nous instruire si cette île était véritablement stérile et inhabitée, comme on le disait, et s'il était impossible d'y former une habitation et d'y établir quelque commerce. Nous côtoyâmes plusieurs îles, et lorsque nous fûmes près de celle des États, nous fûmes fort surpris de voir venir à nous une petite chaloupe remplie de gens habillés à l'Européenne, et qui, s'étant approchés de notre vaisseau, nous parlèrent hollandais, et nous invitèrent à mouiller dans leur port ; ils nous guidèrent à travers mille rochers qui formaient une espèce de boulevard autour de leur île, et qui, sans le secours de la chaloupe, nous en auraient empêche l'entrée. Comme c'était au mois de janvier, nous trouvâmes le climat fort chaud ; mais on nous assura qu'aux mois de juin et de juillet il y fallait un froid considérable. Nous entrâmes dans une petite baie, qui formait une rade assez sûre, et nous jetâmes l'ancre dans un enfoncement qui est à gauche.
Bien loin de trouver une île stérile et inhabitée, nous vîmes un pays très fertile et bien peuplé. Je puis dire que je ne vis jamais de si beaux hommes ni de si belles femmes, et j'ose assurer que je n'en vis aucune, dont la figure approchât tant fois peu de la laideur. Un vaisseau hollandais, selon ce qu'on nous raconta, ayant abordé dans cette île, je ne sais par quel motif, en 1673, trouva le pays si riant et si fertile, les habitants si honnêtes et si polis, et les femmes surtout si douces et si charmantes, que l'équipage ne voulut jamais quitter un pays si délicieux, où toutes les commodités de la vie se trouvaient en abondance, et où l'amour plus fort que tous les autres motifs les attachait malgré eux. Ils oublièrent donc leur patrie et leur famille ; et s'étant mariés avec plusieurs femmes du pays - car la polygamie y est autorisée par les lois et par l'usage — ils en eurent des enfants, ce qui les attacha encore davantage à cet heureux séjour.
On peut juger que nous y fûmes bien reçus. Dans tous les endroits où j'avais été, je ne m'étais jamais si bien trouvé. En vérité nous fûmes tentés d'imiter les Hollandais, qui à la vue de ce pays avaient autrefois perdu la mémoire du leur. Mais notre capitaine, aussi bien que tous nos autres officiers, qui étaient d'un âge où l'on est peu épris des femmes, résistèrent aisément à la tentation. Pour moi j'avoue que j'y aurais succombé, sans les sages remontrances de mon cher Harrington, qui me dit que la beauté des femmes ne devait jamais être un motif, qui nous portât à prendre des engagements durables ; que je me devais à ma patrie et à ma famille ; que mon père n'était peut-être plus ; et que j'en devais servir à mes frères et mes sœurs, qui étaient encore fort jeunes.
Pendant le séjour que je fis en cette île, je vis une foule de naturels du pays venir au port et s'embarquer sur des chaloupes avec empressement. J'en demandai la raison à jeune Hollandais né dans l'île, nommé Wanoüef, que me parla ainsi : Sachez, me dit-il, qu'autour de cette île il y en a plusieurs autres avec lesquelles nous commerçons, et où il se fait plusieurs trafics de différente espèce. Il va s'ouvrir incessamment dans l'île de Foollyk, située à cinq lieues d'ici au nord-ouest, une foire fameuse, qui se tient toutes les années en ce temps-ci. Pour comprendre en quoi consistent les marchandises curieuses de cette célèbre foire, il faut d'abord vous dire que les plus considérables habitants de cette île sont tous Poètes, et se disent inspirés du Ciel. Ils prétendent être descendus d'un certain Herosom, poète illustre et très ancien, fils du Soleil et de la Lune, dont ils publient que la céleste race est sans cesse favorisée de l'influence de ces deux puissants astres. Ils adorent cet Herosom et lui rendent un culte solennel. À son imitation, ils passent toute leur vie à composer des vers de toute espèce, qu'ils sont noblement débiter à la Foire dont il s'agit.
Je demandai alors à Wanoüef, si ce commerce était utile et lucratif. Fort peu, me répondit-il, en général cette île est fort stérile, et les habitants sont très pauvres, mais heureusement on y méprise la richesse, et le commerce de vers, qui est le seul qu'on y fasse, suffit à la subsistance du peuple, et à la dépense médiocre des Grands, c'est-à-dire, des poètes. Comme le royaume est électif, c'est toujours parmi eux que le roi est choisi ; mais les électeurs sont tirés du corps du peuple : autrement il serait impossible aux Grands de s'accorder sur l'élection ; chacun d'entre'eux voudrait être élu, parce qu'il n'y en aurait aucun qui crut mériter de l'être.
Les Grands, lui répartis-je, n'excitent-ils pas quelquefois des troubles dans l'État ? Cela arriva fort souvent, me répliqua-t-il, et le gouvernement est sujet à fréquentes révolutions, causées par l'ambition des Grands, qui sont vains, superbes, jaloux, envieux, inconstants, factieux, et toujours inquiets. Il y a environ vingt-quatre ans qu'on élut un roi, nommé Hostoginam, il avait alors une grande réputation parmi le peuple ; son esprit juste, pénétrant et sublime, sa profonde sagesse, sa politesse extrême lui concilièrent tous les suffrages. Cependant il parlait un peu mal sa langue, et c'était le seul défaut qui put lui fermer le chemin du trône. La langue des Grands de ce royaume est fort difficile à parler, parce qu'ils sont obligés de la parler en cadence, en mesure et en rimes, et d'employer un langage détourné, et très éloigné de celui du vulgaire.
Malgré son défaut Hostoginam fut élu. D'abord on n'eut point lieu de se repentir de ce choix : car il gouverna très sagement, et régna avec beaucoup de politique et de modération ; il ménageait les Grands, il les flattait et dissimulait toutes leurs fautes ; à l'égard du peuple, il en était devenu l'idole. Cependant ce prince si spirituel et si judicieux éprouva les vicissitudes de la fortune. Comme il était très éclairé, et un ennemi de la nouveauté, il essaya de supprimer le culte de HEROSOM, qu'il affirma pour être un simple homme; et a dit qu'il ne l'a pas mérité les autels devraient être érigés dans son honneur. Il publia une proclamation pour la suppression de ce culte ; mais cela a été considéré comme l'impiété la plus effrontée, et dégoûta les Grands non moins que le peuple. Ils convoquèrent un Parlement, représentant toute la nation, qui fut d'avis que comme Hostoginam a été reconnu coupable d'une conception pour renverser la religion ancienne du pays, ils devraient donc l'appeler pour révoquer son décret scandaleux et reconnaître immédiatement HEROSOM comme Dieu. Hostoginam refusa de se soumettre et s'est opposé aux conspirateurs avec un petit nombre de sujets fidèles, qui avaient approuvé son innovation ; et furent aussi incrédule, au moins, que lui-même, touchant la prétendue divinité du père des poètes. Alors tous les esprits s'agirent ; Hostoginam compta vainement sur son autorité affaiblie, sur l'amour de ses sujets refroidis et dégoûtés.
Celui des Grands qui était alors le plus puissant et le plus accrédité dans l'État, s'avisa de rechercher la généalogie de Hostoginam, et soutint qu'il n'était point de la race poétique d'Herosom : on ne sait si ce fut une accusation bien fondée. Quoiqu'il en soit, cette prétendue découverte servit de prétexte pour le perdre. On fit le procès au prince, qui fut déclaré déchu de la couronne. Comme il avait des partisans redoutables, quelques Grands opinèrent pour lui ôter la vie. Mais cet avis fut unanimement rejeté, et Hostoginam fut seulement relégué dans une maison royale située au bord d'un fleuve qui arrosé la capitale. C'est-là qu'il passe ses jours dans la compagnie de ses anciens amis, hommes de mérite comme lui, qui malgré sa chute ne l'ont point abandonné. Exemple de constance et de fidélité, dont on trouve peu de modèles dans l'Histoire.
Cependant Bastippo, qui avait le plus contribué au détrônement d'Hostoginam, fut mis en sa place et couronné solennellement. Ce prince aurait été mis au rang des plus grands rois de l'île, s'il avait eu plus de politique et de modération. Mais il ne ménagea point les Grands ; au contraire il s'étudia à les rabaisser, et en toute occasion il leur marqua du mépris et même en maltraita plusieurs. Les amis du roi détrôné profitèrent alors du mécontentement des Grands, pour former une ligue contre lui, et entraînèrent même dans leur parti ceux qui l'avaient élevé sur le trône. La révolte éclata de toutes parts, et le nouveau roi se vit obligé de sortir de l'île, de crainte d'être immolé à la vengeance des Grands. Depuis ce temps-là le Gouvernement est réduit à une espèce d'anarchie, le peuple ne s'étant pu accorder sur l'élection d'un nouveau roi.
Ce détail me fit un extrême plaisir. Je demandai alors à mon Hollandais, si la foire de l'île, qui attirait tant de marchands, était bien fournie. On y trouve, me répondit-il, des assortiments de toute espèce. Dans une boutique ces sont des tragédies ; dans une autre des comédies ; dans celle-ci des paroles d'opéra, des cantates, des idylles ; dans celle-là des poèmes épiques ; ici des satires, des épîtres et des élégies ; là des fables, des contes, des épigrammes, des vaudevilles. Il y a des boutiques si bien garnies, qu'on y trouve de tout, depuis le poème épique et la tragédie, jusqu'à la chanson et à l'énigme. Il y a aussi des manufactures à toutes sortes de prix, et surtout des cantiques à bon marché.
Les marchands, lui dis-je, qui achètent tout cela, en font-ils un heureux débit ? C'est selon, me répondit-il ? Comme la plupart des acheteurs, qui sont marchands en détail, ne sont point connaisseurs, ils se voient souvent trompés et réduits à vendre à vil prix ce qu'ils ont acheté assez cher. Au reste le commerce de ces marchands, ajouta-t-il, n'est pas fort avantageux ; parce que les marchandises qu'ils ont achetées à la foire de Foollyk, sont toujours exactement visitées lorsqu'on les débarque dans les autres îles, et que ce qu'il y a de plus piquant est quelquefois confisqué par les inspecteurs.
Mais, interrompis-je, n'y a-t-il point dans cette île des orateurs, des philosophes, des géomètres ? S'il y en a, comment souffrent-ils la domination des poètes ? Il y en avait autrefois un grand nombre dans l'île, me répliqua le Hollandais, mais ils en ont été chassés, comme des perturbateurs de la tranquillité publique ; parce qu'ils méprisaient la race d'Herosom, c'est-à-dire, les enfants du Soleil et de la Lune, eux qui n'étaient que les enfants de la Terre et de l'Air ; ils ne cessaient de déclamer contre la poésie ; ils décriaient les meilleurs manufactures, et en mettaient les plus illustres ouvriers au rang de ces vils sauteurs, dont l'art pareil au leur était, disaient-ils, aussi difficile qu'inutile.
Les orateurs se sont heureusement retirés dans un pays abondant et fertile, où néanmoins la plupart sont ou maigres ou bouffis. Mais les Philosophes et les Géomètres ont été réduites à faire leur séjour dans un pays sec et aride, où il ne croît que des fruits amers, au milieu des ronces et des épines. Là, les géomètres passent le jour à tracer des figures sur le sable, et à se démontrer clairement à eux-mêmes, qu'un et un sont deux, et la nuit à observer les astres. On les prendrait pour des êtres inanimés ; il règne dans leurs villes un silence éternel ; à force de penser à la ligne courbe, à l'angle obtus, au trapèze, leur esprit semble avoir pris ces figures.
Pour les philosophes, les uns s'occupent à peser l'air, les autres à mesure le chaud, le froid, le sec, et l'humide ; à comparer deux gouttes d'eau, et à examiner si elles se ressemblent parfaitement ; à chercher des définitions, c'est-à-dire, remplacer un mot par plusieurs autres équivalents, à disputer sur la nature de l'être, sur l'infini, sur les entités modales, sur l'origine des pensées, et autres pareilles matières qu'ils croient extrêmement dignes d'occuper l'esprit humain.
Ils se plaisent surtout à entreprendre de vastes édifices, qu'ils appellent des systèmes. Ils les commencent d'abord par le faîte, qu'ils étaient le mieux qu'ils peuvent, en attendant que les fondements soient posés ; mais souvent dans cet intervalle le bâtiment s'écroule, et l'architecte est écrasé. Ils ne parlent, les uns que de tourbillons et de matière subtile, les autres que d'accidents absolus et de formes substantielles ; ce qui fait que ceux qui ont eu la curiosité d'aborder dans cette île, pour apprendre quelque chose, en reviennent toujours presqu'aussi ignorants, que ceux qui n'y ont jamais été. Au reste ce pays est toujours couvert de neige, les chemins en sont difficiles et l'on s'y égare souvent.
Si les habitants de Foollyk, dis-je alors, n'ont pu souffrir dans leur île les philosophes, les orateurs et les géomètres, ils n'ont pas eu sans doute les mêmes sentiments à l'égard des musiciens, dont l'art a tant de rapport à celui des poètes. Les Musiciens ne demeurent point dans leur île, me répondit-il, ils habitent une île très voisine, où ils vivent paisiblement, en payant un tribut au roi de Foollyk. Leur île est très agréable ; on n'y entend d'autre bruit que celui des voix et des instruments, qui y forment un concert perpétuel ; les parterres de leurs maisons de plaisance sont figurés de façon, qu'en les considérant, on croit voir un papier réglé et noté ; tous leurs jardins sont des partitions de musique, où l'on trouve à livre ouvert des airs de toute espèce ; de sorte que c'est en ce pays-là qu'on peut dire avec vérité, qu'on chante les fleurs, la verdure et les bocages. Toutes leurs maisons sont tapissées d'opéras, de cantates, de ballets et de sonates ; le peuple ne parle qu'en chantant, et les choses les plus communes donnent lieu à des récitatifs et à des airs de mouvement. Ils sont gouvernés par un prince, dont le sceptre est en forme de cylindre ; il l'a toujours à la main, et il s'en sert pour réprimer leurs failles et mettre un frein à leur caprice. Enfin ils sont tout voix ou tout oreille, et ils semblent ne faire aucun usage de leurs autres sens, et moins encore de leur raison. Cependant si le raisonnement se pouvait noter, on assure qu'ils seraient fort raisonnables. Ils sont une grande consommation des marchandises de la foire de Foollyk ; mais ordinairement ils font l'emplette de ce qu'il y a de plus mauvais, parce qu'ils ont l'art de faire paraître tout bon, en le frelatant savamment ; alors ils vendent fort cher ce qui leur coûte peu.
Une autre espèce d'hommes, qui habite une île peu éloignée, suit à peu près la même méthode, et y trouve également son compte, ce sont les Comédiens, gens polis et aimables et qui ne cherchent qu'à plaire. Ils se répandent dans toutes les îles de leur voisinage, et y bâtissent des théâtres, sur lesquels ils passent leur vie à parler en public ; ils n'ont point de gouvernement fixe, mais une espèce d'anarchie ; on assure qu'ils possèdent au souverain degré l'art de donner de l'élégance aux vers plats, de la force aux pensées faibles, de la sublimité aux extravagances, de la grâce aux choses communes. Enfin je ne sais si les habitants de Foollyk pourraient subsister, sans les musiciens et sans les comédiens, qui font un heureux débit de la plus grande partie de leurs manufactures.
Après ce détail qui me parut amusant, et dont je n'ose garantir entièrement la vérité, ne sachant tout cela que par ouï-dire, le Hollandais continua ainsi — je rapporte en historien tout ce que ma mémoire me fournit. Puisque je vous ai parlé de toutes ces îles, me dit-il, je ne dois pas omettre de vous entretenir d'une autre île très célèbre et très riche, qui est encore au nombre de celles que les Européens ont appelé mal à propos la Terre de Feu. Cette île est l'île des Médecins. Il n'y croît que de la manne, de la rhubarbe, de la casse, du séné et autres pareilles plantes médicinales ; tous les ouvriers sont apothicaires, ou faiseurs de seringues, de bistouris et de lancettes ; toutes les eaux qui y coulent sont minérales ; de sorte que la terre n'y produit rien de tout ce qui est nécessaire à la nourriture du corps et à l'usage de la vie.
Cependant les habitants sont très riches et ne manquent de rien ; les peuples des autres îles s'imaginant avoir besoin de leur secours y viennent en foule chargés d'argent, et s'en retournent ordinairement nus et mains vides, s'ils peuvent s'en retourner : car plusieurs meurent. Aussi leurs campagnes ne sont-elles que de vastes cimetières, parce que, malgré la salubrité des plantes, l'air y est très dangereux surtout pour les étrangers. Les habitants de Foollyk disent qu'il y a dans cette île un souterrain, qui conduit aux enfers par des chemins très courts, et qu'on y trouve la source de l'Achéron et du Léthé.
Le gouvernement de cette île est semblable à celui de l'ancienne Rome. Les médecins qui y dominent, représentent les patriciens ; et les chirurgiens qui sont le second corps de la république représentent les plébéiens. Les uns et les autres s'assemblent tous les jours dans un palais lugubre, tapissé de velours noir. C'est-là se tiennent toutes les délibérations, avec cette différence que les premiers, qui composent la Chambre haute, font leurs essais et leurs discours sur les vivants, et les seconds sur les morts.
Ces deux corps se haïssent à l'imitation du Sénat et du peuple romain, l'un a aussi ses consuls et l'autre ses tribuns. Les premiers cherchent sans cesse à humilier les seconds ; mais ceux-ci étant en plus grand nombre et munis de la puissante protection des prêtresses de la déesse d'Amour, qui est fort révérée en cette île, se soutiennent courageusement, et bravent les vains efforts de leurs adversaires, bien qu'ils les reconnaissent pour les maîtres.
Les premiers voyant que les seconds commençaient à prévaloir, ont publié depuis quelques années un gros volume in quarto intitulé : Les Meurtres et homicides des chirurgiens, contenant la liste de ceux qu'ils ont estropiés ou massacrés depuis un siècle. Les chirurgiens, par représailles, ont publié la liste de ceux que les médecins ont assassinés, depuis dix ans : ce qui forme, dit-on, vingt volumes in folio, en caractères très menus, apostillés et paraphés par tous les parents des morts. L'édition de ces vingt volumes, fruit de leur guerre civile, leur a fait quelque tort dans les îles voisines, où plusieurs les regardent comme les destructeurs de l'humanité. Cependant leur réputation se soutient toujours, et on continue d'avoir confiance en eux, parce que l'amour de la vie est plus fort que tous les raisonnements et que toutes les expériences, et qu'un seul homme qu'ils guérissent, efface l'idée d'un million qu'ils ont fait périr.
Après tout il faut convenir que ce n'est pas toujours leur faute, s'ils ne rendent pas la santé à tous les malades ; le monde est si injuste, qu'il voudrait que personne ne mourût entre leurs mains, comme s'ils étaient les maîtres absolus de la Nature, et qu'il fût on leur pouvoir de changer les lois de la destinée. Ils ont entr'eux une espèce de Coran, ou de Talmud, qu'ils suivent à la lettre, et dont, selon leurs statuts, il leur est défendu de s'éloigner. Tant pis pour ceux, que ce Coran ou ce Talmud condamné à mourir.
Outre les chirurgiens révoltés sans cesse contre les médecins, il y a dans l'île une autre espèce de mutins réfractaires, également haïs des uns et des autres. Ce sont les charlatans, qui exercent la médecine en fraude ; ils sont traités comme des faussonniers ; et quand ils sont pris sur le fait, leur supplice ordinaire est de leur faire avaler à la fois tout l'aloès, tout le mercure, et toutes les pilules qu'on peut saisir chez eux. Au reste les médecins de cette île déclamer, dit-on, contre le célibat ; on croit qu'ils le font ou par conscience ou par politique, afin de réparer le tort que leur art fait à la Nature.
Ceux qui contribuent le plus à la richesse de cette île, sont les habitants d'une île voisine, située au couchant, dont le gouvernement est purement hiérarchique, c'est-à-dire, entièrement sous la puissance des prêtres du dieu Ventre, appelé dans leur langue Baratrogulo : ce dieu ridicule y est représenté dans son temple sous une figure monstrueuse. C'est une statue d'une grandeur médiocre, mais extrêmement grossière et matérielle, dont le ventre large et pointu à quatre aunes de circonférence. Ses yeux sont très grands, à proportion de sa tête, qui est étroite, plate, et sans oreilles ; ses mâchoires paraissent larges et armées de dents aiguës et tranchantes : sa bouche, qui s'ouvre à chaque instant par le moyen d'un ressort caché dans son estomac, fait entendre un claquement de dents continuel.
Il est assis devant une table, sur laquelle le peuple superstitieux a la dévotion de mettre sans cesse des viandes et des mets de toute espèce, lesquels servent à la nourriture des prêtres de son temple, qui par leur embonpoint, leur épaisseur, et leur menton à triple étage, ressemblent assez aux chanoines d'Europe. Ce qu'il y a de singulier, est qu'ils sont ce qu'on appelle Gastrimythes ou Ventriloques, c'est-à-dire, que lorsqu'on les consulte, ils rendent leurs réponses, non par la bouche, mais par le ventre. Au reste ils sont oisifs, lourds et paresseux, et on les trouve presque toujours à table : c'est-là qu'ils traitent toutes les affaires de la religion et de l'État. Ils y chantent souvent les louanges du dieu qu'ils adorent ; et ces pieux fainéants n'ont point de honte de publier le dieu Ventre est le premier auteur de tous les arts et de toutes les sciences ; et que c'est lui qui a appris aux hommes à travailler pour sustenter leur vie. Sans se mettre en peine d'en donner l'exemple aux autres, ils recommandent extrêmement le travail au peuple, et n'en dispensent que les riches.
Au reste les principaux métiers qu'on exerce dans cette île, se rapportent tous à la table, et on y trouve une foule de cuisiniers, de rôtisseur et de pâtissiers. Les prêtres élisent toutes les années un doge ou doyen tiré de leur chapitre, mais cette dignité est au concours ; et celui, qui a le talent de manger le plus vite et le plus longtemps, a l'honneur d'être élu. Le pays est très fertile en pâturages : on y voit paître une infinité de troupeaux, et on y trouve toutes fortes de volaille et de gibier. Cependant il règne sans cesse dans ce pays une maladie dangereuse, qui, sans l'usage fréquent de la seringue, de la rhubarbe, de la casse, de la manne, du séné et de l'antimoine, aurait il y a déjà longtemps dépeuplé l'île, et en aurait principalement détruit tous les prêtres du dieu qu'on y adore.
Est-il possible, interrompis-je alors, que ces infatigables mangeurs ne soient pas la victime d'une intempérance si outrée ? Mais d'un autre côté, comment ces hommes sensuels et esclaves de leur goût ne préfèrent-ils pas une diète salutaire, prudemment observée de temps en temps, à l'usage fréquent des potions fades et dégoûtantes, que la médecine leur fournit ? Pour empêcher, me répondit-il, que leur embonpoint excessif ne leur cause des maladies mortelles, et surtout des apoplexies, ils usent quatre fois chaque année d'une excellente précaution, qui est de se faire dégraisser par d'habiles chirurgiens, lesquels par de légères incisions dans les parties charnues, par des topiques corrosifs, par des frictions réitérées, et par l'usage de la panacée, ont l'art de diminuer la massive épaisseur de leur volume, et les dispensent par ce moyen de l'affreuse nécessité d'avoir recours à l'abstinence.
À l'égard de la préparation des remèdes purgatifs qu'ils sont obligés de prendre fréquemment pour guérir les obstructions et suffocations dont ils sont attaqués, elle se fait d'une manière qui ne blesse point leur sensualité. On fait infuser de la manne, de la grande tithymale, et de la scammonné dans leur portage : on leur sert un coulis de rhubarb ; une fricassée de julep ; des pigeonneaux au séné ; des pilules en ragoût ; une éclanche saupoudrée de kermès minéral et végétal ; des salades de fleurs de pêche, et de follicules assaisonnées de sel stibié, de tartre soluble, d'huile de vitriol, et de vinaigre scillitique ; des tourtes de coloquinte cuites avec le coing, et faites de pâte de ricin, ou pignon d'Inde ; des fromages et des jambons empreints de sel d'epsom, de sel ammonia et polychreste ; et enfin des confitures de sureau, d'amandes douces, de roses pâles. Tout cela est savamment préparé, et si merveilleusement assaisonné par leurs cuisiniers très versés dans la pharmacie, qu'ils se trouvent purgés sans le savoir, et sans s'en apercevoir autrement que par des nausées plus fortes, des vents plus fréquents et plus tumultueux, et des déjections plus impétueuses et plus abondantes qu'à l'ordinaire, qu'ils ont soin d'aider par quelques remèdes de tabac. Avant que de se coucher, ils prennent souvent un bouillon fait avec la jusquiame, la madragore, et le stramonium, qui les fait dormir profondément, et rêver qu'ils sont à table.
PARTIE 4 : RELATION DU SÉJOUR DE JEAN GULLIVER À L'ÎLE DES LETALISPONS.
CHAPITRE 1. — L'Auteur est sur le point d'être dévoré par des ours dans l'île des Letalispons. — Comment il est reçu par ces insulaires. — Son séjour parmi eux. — Ses entretiens avec Taïfaco.
Après avoir séjourné quelque temps dans l'île des États, où nous eûmes le temps de nous rafraîchir, et où plusieurs de notre équipage qui étaient malades, recouvrèrent la santé, nous prîmes congé des Hollandais, qui nous avaient si bien reçus. Ils nous fournirent des vivres en abondance, et nous firent promettre de les revenir voir à notre retour des mers du Sud, pour leur apporter diverses choses dont ils avaient besoin, et que nous espérions trouver aisément sur les vaisseaux européens, qui font le commerce en interlope sur les côtes du Chili et du Pérou.
Nous mîmes donc à la voile le dix-septième août mil sept cent dix-huit, et nous poursuivîmes notre route par le détroit de Magellan, que nous passâmes heureusement et en peu de temps, à cause de la rapidité des courants. Après avoir rangé sur notre droite le cap de la Victoire, et ensuite l'île de Madre de Dios, lorsque nous fûmes à la hauteur du cap San Diego, il s'éleva un vent du sud-est, qui nous fit prendre la résolution de nous éloigner un peu des côtes, pour éprouver si nous ne pourrions point avoir la gloire de découvrir quelques îles nouvelles dans cette partie de la mer Magellanique, où les géographes n'en placent aucunes. Ce fut moi qui donnai ce conseil au capitaine Van Land et ses principaux officiers, en leur représentant qu'il était honteux que depuis cinquante ans les vaisseaux européens n'eussent fait aucunes découvertes. Hélas j'eus bientôt sujet de me repentir d'avoir donné ce funeste conseil.
Nous découvrîmes vers le quarante-cinquième degré de latitude de méridionale, et le deux cent soixante-neuvième de longitude, une île qui nous parut grande, et digne de notre curiosité. Nous ne fûmes point surpris que les vaisseaux de l'Europe qui vont au Chili et ai Pérou ne l'eussent point encore découverte, parce qu'ils côtoient d'ordinaire les côtes de cette mer Pacifique, où ils ne redoutent point les tempêtes qui y sont aussi rares que les écueils.
Nous étant approchés de cette île, appelée l'île des Letalispons — comme je l'appris dans la suite — environ à la distance de deux lieues, nous jetâmes l'ancre ; et le capitaine Van Land avec quelques officiers hollandais, plusieurs de nos Portugais, le capitaine Harrington et moi, descendit dans la chaloupe, qui nous conduisit à terre sans aucun danger. Nous trouvâmes d'abord un pays désert, et couvert d'épaisses forêts. Cependant nous aperçûmes un petit chemin battu, qui nous fit juger que cette île était habitée. Nous suivîmes ce chemin sans nous séparer, et fîmes environ une demie-lieue sans rien rencontrer. Je précédais les autres d'assez loin, accompagné d'un jeune Portugais très brave, qui à mon exemple prenait plaisir à marcher, et était impatient de satisfaire sa curiosité. Nous quittâmes le chemin, et étant montés l'un et l'autre sur une montagne assez escarpée, pour mieux découvrir le pays, nous laissâmes les autres derrière nous dans la vallée.
À peine eûmes-nous atteint le sommet, que nous vîmes plusieurs ours d'une grandeur démesurée descendre du côté gauche de la montagne. Nos gens qui les aperçurent n'osèrent ni avancer ni les attendre, et jugement à propos de retourner sur leurs pas et de se retirer. Nous voulûmes alors descendre de la montagne et suivre leur exemple, mais les ours nous coupèrent le chemin. Leur nombre et leur grandeur nous effraya : nos sabres ni nos fusils ne nous rassurèrent point. Dans cette triste conjoncture, me souvenant d'avoir ouï-dire, que le moyen d'échapper à la fureur de ces animaux, est de se coucher sur le ventre, et de s'y tenir sans faire aucun mouvement, et sans paraître respirer ; je pris ce parti, et dis à mon compagnon d'en faire autant, et il me crut. Les ours s'approchèrent de nous, et nous trouvant sans mouvement, comme si nous eussions été morts, ne nous firent aucun mal, et nous laissèrent. Cependant nos camarades qui fuyaient de toute leur force, nous voyant de loin couché par terre au milieu de ces bêtes cruelles, crurent que c'était fait de nous, et ne songèrent qu'à se rembarquer. Nous demeurâmes donc seuls dans ce pays inconnu, livrés à la douleur et au désespoir.
Je dis à Silva — c'était le nom du jeune Portugais — qu'il fallait nous éloigner de cet endroit dangereux, et suivre le chemin battu. Nous marchâmes cinq heures, sans trouver aucune habitation, ni aucun homme. Enfin sur la fin du jour, lorsque la nuit approchait, nous fîmes la rencontre d'un homme, qui paraissait âgé d'environ vingt-huit ans. Il portait un bonnet de maroquin rouge fait en forme de cône, dont les bords étaient relevés et attachés par une agrafe ; une espèce de casaque de satin vert lui descendait jusqu'au-dessous des genoux ; et sous cette casaque il avait un pourpoint rouge, des culottes et des bas de la même couleur attachés ensemble. Nous le saluâmes profondément, et nous étant approchés de lui, nous lui fîmes entendre par des gestes expressifs, que nous étions des étrangers malheureux, qui avaient besoin de son secours. Mais quelle fut notre surprise ! Cet homme nous parla espagnol, et nous ayant dit que nous lui paraissions des Européens, il nous demanda de quelle contrée d'Europe nous étions venu dans un pays si peu connu du reste du monde. Nous lui répondîmes en cette même langue, que l'un de nous était né en Angleterre, et l'autre en Portugal ; et en même temps nous lui apprîmes le long voyage que nous avions fait, le motif qui nous avait engagés à aborder dans cette île, et enfin le triste accident qui nous avait séparés de nos compagnons.
Ô infortunés voyageurs, nous dit-il, ne vous affligez point du malheur qui vous retient sur ce rivage ; vous êtes au milieu d'une nation bienfaisante, dont la première des lois est d'exercer l'hospitalité et de soulager les malheureux. Suivez-moi, ajouta-t-il, il y a un village qui n'est éloigné d'ici, où je vais vous conduire ; calmez la crainte et l'inquiétude peintes sur vos visages ; je vous logerai chez moi, et vous pouvez compter que ma femme, mes enfants, et mes petits-enfants seront ravis de vous voir, et vous procureront tous les secours que vous pourrez souhaiter.
Nous fûmes charmés de ce compliment, et nous rendîmes mille actions de grâce au généreux inconnu, qui nous faisait un si bon accueil ; mais nous ne concevions pas, comment un homme si jeune pouvait avoir une pareille postérité. Cependant nous prîmes le chemin du village, et en marchant nous demandâmes à notre conducteur s'il était né en Espagne ou en Amérique. Je suis natif du village même où je vous mène, nous répondit-il, et si je parle espagnol, n'en soyez point étonnés ; c'est que j'ai autrefois été dans le Chili il y a environ soixante-dix ans, et que le commerce que j'y ai eu avec les Espagnols, m'a fait apprendre leur langage ; je suis bien aisé que vous ne soyez point d'une nation, dont la cupidité a fait périr un million d'hommes dans le Chili, qui était autrefois le plus beau pays de l'univers, et qui n'est plus aujourd'hui qu'une terre dépeuplée et inculte soumise à leur tyrannie. Nous sommes heureux d'en être préservés, et nous rendons grâces au Ciel de n'avoir dans notre pays que des mines de fer et de cuivre ; cependant nous y possédons des avantages mille fois préférables à ces biens imaginaires ; nous y respirons un air pur ; la terre féconde nous fournit une nourriture saine, qui nous fait jouir d'une longue vie, exempte de toute infirmité. Dans les autres pays on meurt de vieillesse ; ici, après avoir longtemps vécu, on meurt de jeunesse. C'est ce que vous comprendrez, et ce que vous admirez, lorsque vous aurez demeuré quelque temps parmi nous.
Nous arrivâmes au village, où, comme il était déjà nuit, nous entrâmes incognito ; notre conducteur nommé Taïfaco — c'est ainsi que nous l'entendîmes appeler dans la suite — nous l'ayant fait traverser, nous fit entrer ensuite dans une grande maison qui était la sienne, et nous présenta d'abord à un enfant vêtu de satin noir, qui nous sembla âgé de dix ou douze ans, pour qui il paraissait avoir beaucoup de respect. Cet enfant, qui avait un air de maître, et dont l'esprit paraissait mûr, nous reçut très civilement, et après que Taïfaco lui eut parlé, il donna ses ordres pour nous faire bien traiter. En même temps toute la famille parut ; Taïfaco en me montrant une femme qui nous sembla âgée de trente ans, me dit que c'était son épouse et la fille de celui à qui il venait de nous présenter. Nous lui fîmes une profonde révérence, et la priâmes de vouloir bien nous accorder sa généreuse protection et nous honorer de ses bontés. Son mari ayant bien voulu nous servir d'interprète, lui dit que nous étions des Européens abandonnés par nos compagnons, et laissés par eux sur le rivage, par la crainte des ours de la forêt d'Arisba, qui les avaient contraints de s'enfuir, et de se réfugier dans leurs canots. Elle répondit avec une politesse extrême, qu'elle savait bon gré à son mari de l'honneur qu'il lui procurait ; qu'elle prenait toute la part possible à notre peine, et qu'elle n'oublierait rien pour nous consoler de cet accident. Taïfaco fit en même temps approcher sa fille, qui paraissait avoir quarante-cinq ans, et qui après nous avoir faire une révérence très modeste, nous présenta ses enfants, dont l'aîné nous parue aussi âgé que son grand-père, et moins que jeune son bisaïeul.
Nous nous regardions l'un et l'autre, Silva et moi, et nous ne pouvions concevoir cet ordre généalogique. Silva me dit à l'oreille, on veut ici se divertir à nos dépens, on nous prend pour des étrangers imbéciles, et pour hommes sottement crédules : il faut voir si cette comédie sera longue. Comme j'étais fait aux choses extraordinaires, et que j'avais beaucoup plus d'expérience que lui, je lui dis de suspendre son jugement, jusqu'à ce que nous fussions plus éclaircis.
Taïfaco nous conduisit alors dans une chambre, où des domestiques nous attendait pour nous laver, et pour nous donner du linge blanc et des robes de soie à la mode du pays, ce qui nous fit un extrême plaisir, parce que nous étions l'un et l'autre un peu malpropres, et que nous avions bien de la honte de paraître en cet état devant des dames. Nous fûmes baignés dans des eaux parfumées, et lorsqu'on eut achevé de nous habiller, nous vînmes retrouver la compagnie, et peu de temps après on vint avertir qu'on avait servi.
Aussitôt on ouvrit la porte d'une grande salle agréablement illuminée, où les petits-enfants passèrent les premiers, ensuite les enfants, puis le grand-père et la grand-mère, et enfin le jeune bisaïeul, qui nous prit l'un et l'autre par la main, s'assit le premier à table, et nous fit asseoir, moi à sa droite, et mon compagnon à sa gauche. Comme les enfants avaient passé avant leurs pères et leurs mères, et qu'on ne nous avait fait aucunes instances pour nous faire entrer les premiers dans la salle, je conçus qu'on avait prétendu nous faire honneur, en passant devant nous : ce qui ne me surprit point, sachant que cela se pratique en plusieurs autres pays.
Taïfaco, qui était assis à table à côté de moi, eut soin de me rendre en espagnol la plupart des choses qui se dirent pendant le repas. On s'entretint entr'autres choses d'un mariage qui devait se faire au premier jour, entre un homme de trente ans et une femme de soixante. On plaignit fort cette femme d'épouser un homme de cet âge, qui selon le cours de la Nature s'affaiblirait tous les jours pendant l'espace de trente années. On parla aussi d'un homme sexagénaire, qui était sur le point de prendre pour femme une fille de vingt-cinq ans ; on ajouta que cette fille était trop jeune ou trop âgée pour lui, qu'il aurait mieux fait de choisir une fille de soixante-dix ans ou de quinze. Quelles énigmes pour des étrangers comme nous, qui n'avions aucune idée de la prérogative singulière des habitants de cette contrée !
Au reste, quoique je ne puisse dire précisément ce que nous mangeâmes, et que je n'en puisse aucunement définir le goût, je serais fâché néanmoins que le lecteur ignorât, que nous fîmes un repas très délicat. Cependant il est certain qu'on ne nous servit aucunes viandes, parce que ces peuples qui croient la transmigration des âmes, ne donnent jamais la mort à aucun animal, à moins qu'il ne leur soit nuisible ; et en ce cas ils ont horreur de s'en nourrir.
Ce fut dans ce premier repas même, que j'appris leur opinion sur cette matière ; car ayant demandé à Taïfaco de quelle nature étaient les mets excellents, qu'il nous présentait, il me répondit, que ce n'étaient que des légumes singuliers qui croissaient dans le pays, et qu'on avait l'art d'assaisonner. Nous n'imitons pas, ajouta-t-il, les Espagnols et les autres Européens, qui se repaissent de la chair des animaux : funeste habitude qui les a en quelque sorte familiarisés avec l'effusion du sang des hommes. Les bêtes n'ont-elles pas une âme ? Quel droit à l'Homme de la séparer de leur corps et de s'approprier leur substance pour sustenir la sienne, tandis que la terre libérale lui offre une infinité de grains, de racines et de fruits dont il peut se nourrir légitimement.
Silva écoutait ce discours d'un air dédaigneux, et en souriait en ignorant. Comme il n'avait aucune teinture des lettres, il trouvait dans les préjugés de son enfance la réfutation complète de la doctrine de Taïfaco. Pour moi, qui dans ma première jeunesse m'étais appliqué à la philosophie, et qui comptais pour rien les idées populaires et nationales, si elles n'étaient conformes à la raison naturelle, je crus que la doctrine de notre hôte méritait d'être un peu autrement réfutée.
Je lui exposai d'abord les deux systèmes qui régnaient parmi nous touchant l'âme des bêtes. Le premier, lui dis-je, qui n'a que peu de partisans, refuse aux bêtes tout sentiment et toute sorte de connaissance. Selon les défenseurs de cette opinion, les bêtes sont des êtres inanimés, incapable de plaisir et de douleur, de crainte ou d'amour. Vous voyez que, selon ce système, la charité que vous avez pour elles est assez mal placée, et qu'il est aussi permis de les tuer, que d'abattre des arbres, de couper des herbes, ou de déraciner des plantes. Mais comme ce système où les bêtes sont traitées de pures machines, n'est adopté que par des hommes subtils, et peu attentifs à la voix de la Nature, je n'ai garde de m'y appuyer, pour la justification de l'usage où nous sommes de tuer les bêtes et de les manger. L'opinion la plus commune aujourd'hui, et qui paraît la plus solide sur cette matière, est que les bêtes ont une âme, mais une âme très inférieure à la nôtre, en ce qu'elle ne réfléchit point, et ne délibère point ; qu'elle est déterminée par les objets, maîtrisée par ses passions, et invinciblement emportée par tous ses mouvements. Les bêtes, comme vous voyez, sont donc extrêmement inférieures à l'Homme ; doué d'une âme qui pense, qui réfléchit, qui compare, qui délibère, qui est la maîtresse de toutes ses actions, qui connaît la vertu et le vice, et qui a la liberté de choisir entre l'un et l'autre.
Quand je vous accorderais tout cela, répliqua Taïfaco, je ne vois pas que vous en puissiez rien conclure en faveur du droit que vous vous attribuez, de tuer les bêtes et de vous en nourrir. Si les bêtes, lui répartis-je, font si inférieures à nous, elles ne sont pas nos semblables ; et par conséquent rien ne nous engage à les épargner. C'est par cette raison même, répondit Taïfaco, que vous devez le faire ; il y a une espèce de bassesse à abuser de leur faiblesse, et à vous prévaloir de votre supériorité pour les opprimer. Pourquoi vous comportez-vous envers elles d'une manière, dont vous seriez très fâchés qu'elles se comportassent envers vous. Vous détestez ces ours cruels, qui vous ont attaqués près de la forêt d'Arisba, et qui ont été sur le point de vous déchirer ; nous les regardons aussi comme nos ennemis, et nous ne faisons point difficulté de les tuer quand nous le pouvons, parce qu'il est conforme à la raison de détruire son ennemi. Mais est-il raisonnable d'avoir à l'égard de tant de bêtes innocentes, qui ne font aucun mal à l'Homme, et surtout à l'égard des oiseaux, dont le plumage est aussi agréable à nos yeux, que leur chant l'est à nos oreilles ?
Je lui répondis que tous les animaux avaient été créés pour l'Homme ; que par conséquent il était lui était permis de les tuer et de s'en nourrir ; que la Providence avait établi entre tous les animaux une subordination économique, qui faisait que quelques-uns servaient de pâture aux autres ; que l'âme de toutes les bêtes périssait avec elles ; au lieu que celle de l'Homme était immortelle ; qu'ainsi elles ne nous ressemblaient proprement, que par l'organisation de leurs corps. Taïfaco, en philosophe pythagoricien, voulut alors me prouver que l'âme des bêtes ne périssait point à leur mort. Mais toutes ses raisons me parurent de pures suppositions dénuées de preuves, et je puis dire que je l'ébranlai beaucoup, en lui faisant voir, que le système de la transmigration des âmes ne pouvait s'accorder avec la sagesse du Créateur.
CHAPITRE 2. — Questions que l'on fait à l'Auteur, et ses réponses. — Il apprend que dans l'île des Letalispons les gens ont le privilège de rajeunir.
Cette matière ayant conduit la conversation jusqu'à la fin du repas, on quitta la table, et on nous invita à venir nous promener au clair de la lune dans un grand parterre, pour y respire un air pur et frais ; les habitants de ce pays par une loi expresse sont obligés de se promener l'espace d'une heure après leur repas. Persuadez que cet exercice est favorable à digestion, ils trouvent cette loi très sage, ainsi que toutes leurs autres lois, qui se rapportent la plupart à la conversation et la prolongation de la vie.
Les dames nous ayant priés poliment de leur raconter quelques circonstances de notre voyage, je satisfis leur curiosité avec le secours de Taïfaco, qui me servait toujours d'interprète. Elles écoutèrent avec plaisir le récit de mes aventures dans l'île de Babilary, et elles me firent à ce sujet une infinité de questions : elles me demandèrent surtout, si la mollasse et l'oisiveté, où la supériorité des femmes avait plongé les hommes, n'était pas contraires à l'intérêt même des femmes qui les avaient réduits à cet état.
Des hommes efféminés, disaient-elles, ne sont point des hommes ; ils doivent s'acquitter bien mal des fonctions de leur sexe, et le pays ne soit pas être fort peuplé. J'admirai comme ces dames avait tout d'un coup saisi le point défectueux du gouvernement de Babilary ; ce qui me fit connaître la solidité et la pénétration de leur esprit. Je leur répondis, qu'il était vrai que depuis la révolution arrivée dans cette île, elle était beaucoup peuplée qu'autrefois : mais l'ambition des femmes avait regardé cela comme un léger inconvénient, auquel elles s'étaient imaginé pouvoir remédier avantageusement, par la liberté de répudier leurs maris, lorsque leur âge, leur tempérament, ou leur conduite cesserait de leur convenir. Ce droit des femmes, ajoutai-je, tient leurs maris dans un exercice continuel de complaisance et d'assiduité, et les maintient sur le pied d'amants. Mais tous leurs soins empressés et toute leur attention à plaire, ne sert qu'à reculer le divorce, dont ils sont toujours menacés, et dont la saison fatale arrive enfin au bout d'un certain nombre d'années. Car il n'y a qu'un très petit nombre de femmes constantes, qui aient le courage de conserver de vieux maris ; les vieilles mêmes s'accommodent du changement.
Les dames ne purent s'empêcher de sourire. Alors la plus jeune des petites-filles de Taïfaco, qui paraissait avoir environ quatorze ans, pria son grand-père de me demander à quel âge les filles étaient nubiles dans l'île de Tilibet. Je n'emploie point ici les termes dont elle se servit ; ce qui blesse la bienséance dans notre langue, est indifférent dans la leur, où toutes les paroles sont honnêtes. Taïfaco me rendit sa question fidèlement ; et j'y satisfis, en disant, que dans cette île on mariait d'ordinaire les filles à l'âge de trois ans. Ciel ! interrompit-elle avec vivacité, si j'étais née en ce pays-là, il y aurait donc déjà onze ans que j'aurais un époux. J'en ai vu à votre âge, lui répondis-je, qui étaient déjà veuves de quatre maris ; mais elles n'étaient pas alors aussi jolies que vous. Que les femmes heureuses en ce pays-là, reprit-elle, si en commençant d'être femmes de si bonne heure, elles pouvaient vivre longtemps et rajeunir comme nous.
Ce fut alors que Taïfaco, qui ne m'avait point encore donné d'éclaircissement sur cet article, m'apprit que dans le pays où j'étais, les hommes et les femmes vivaient d'ordinaire cent vingt ans ; qu'ils ne vieillissaient que jusqu'à l'âge de soixante ans ; et qu'après cela, loin de s'affaiblir comme les autres hommes, ils reprenaient de nouvelles forces et rajeunissaient. Nous ignorons, ajouta-t-il, si les habitants de ce pays sont une espèce particulière d'hommes, à qui l'éternel Seigneur du monde a daigné accorder cette prérogative, ou si nous en sommes seulement redevables à la pureté de notre air, à la salubrité de nos plantes et de nos fruits, à la vie douce et tranquillité que nous menons, et à nos lois qui défendent également l'excès du repos et du mouvement, et de nous livrer à aucune passion. Quoiqu'il en soit, c'est un précieux avantage, que nous possédons depuis un temps immémorial, et qui, comme vous voyez, met notre nation fort au-dessus de tous les autres peuples de l'univers. Regardez-moi, poursuivit-il, j'ai quatre-vingt-dix ans passés, et mon père que vous voyez, en a cent neuf.
Silva entendant ces dernières paroles, se mit à regarder fixement le petit bisaïeul de cent neuf ans ; et à force de l'examiner, il découvrit sur son visage jeune et même fleuri des marques imperceptibles d'un âge avancé, qu'il me fit secrètement remarquer. Sa peau paraissait un peu desséchée, et n'avait point ce suc vital qui caractérise la jeunesse ; il paraissait comme un fruit cueilli de la veille, qui n'a plus cette fleur qu'il conserve sur l'arbre. La comparaison que nous fîmes de lui avec son arrière-petit-fils, nous en fit sentir la différence. Taïfaco lui-même, malgré son air sain, frais, et vigoureux, à le considérer de près, montrait un teint un peu usé. Il ressemblait en un sens à ces femmes de mon pays, qui malgré leur âge prétendent toujours plaire, et ont l'art de perdre tous les matins vingt années, qu'elles retrouvent le soir en se couchant.
Je ne suis point surpris, dis-je à Taïfaco, que l'air que vous respirez, la vie douce et tranquille que vous menez, et le régime de vie que vous observez, vous fassent vivre plus longtemps que tous les autres hommes, qui semblent faire des efforts pour abréger leurs jours. Ce qui m'étonne, est de voir que la vieillesse n'est pour vous qu'une éclipse, et que vous rétrogradez, pour ainsi dire, et recouvrez toutes les années que vous avez perdues, en retournant à la jeunesse et même à l'enfance.
La lumière, répondit Taïfaco, est l'image de notre vie : elle naît le matin sur notre hémisphère, elle augmente peu à peu par l'élévation du flambeau qui la produit ; et quand l'astre du jour a touché le méridien, elle décroît insensiblement et revient au même degré et au même point où elle avait paru en naissant. La cause de votre étonnement est, que vous bornez la puissance du Seigneur éternel du monde, et que vous vous êtes imaginés jusqu'ici, que la Nature observe partout les mêmes règles ; mais à force de la rendre régulière et uniforme, vous la rendez stérile et impuissante. Par exemple, si nous n'avions jamais vu d'autres hommes que nos compatriotes, nous ne pourrions nous-mêmes nous persuader, qu'il y eut des hommes sur la Terre, qui mourussent de vieillesse.
Eh quoi, interrompis-je, n'est ce pas de vieillesse que meurent tous les animaux et toutes les plantes ; et leur exemple ne vous suffirait-il pas, pour vous faire juger de la destinée de tous les autres hommes ? Nous faisons une grande différence, repartit Taïfaco, entre la vieillesse et l'ancienneté. Les animaux et les plantes meurent, comme nous, d'ancienneté, mais non de vieillesse, à moins que quelque cause particulière ne change ce cours ordinaire de la Nature. Il en est ainsi des hommes : si nous n'observons point les lois de santé établies depuis longtemps dans ce pays : si nous nous livrons à un travail immodéré, ou à un repos trop durable : si nous ne réprimons point nos passions qui allument dans nos corps et y nourrissent un feu qui les consume ; il arrive alors que nous mourons neufs ou vieux, mais jamais anciens.
Nous entendîmes alors le bruit d'une espèce de violon, qui fit rentrer toute la compagnie dans la salle où nous avions soupé. Taïfaco nous apprit, que l'usage était parmi eux de danser tous les jours après les repas du soir ; et que ce n'était pas une des moins importantes de leurs lois de santé. Il ajouta, que ce serait un grand plaisir pour les dames de nous voir danser à la manière d'Europe, si nous voulions bien leur donner cette satisfaction. Nous répondîmes, Silva et moi, que nous danserions volontiers, mais que nous souhaitions ne le faire que les derniers ; afin de voir d'abord le goût de leurs danses, et d'être animés par leur exemple. Alors les plus jeunes de la famille commencèrent cette espèce de bal domestique, où tous dansèrent successivement, tantôt seuls, tantôt deux, tantôt quatre, et tantôt tous ensemble, et toujours avec beaucoup de justesse et de grâce. Lorsque notre tour de danser fut venu, je priai celui qui jouait du violon, de répéter un certain air que je lui avais entendu jouer, et dont le mouvement était celui de la gigue, que je dansai avec applaudissement de toute la compagnie. Pour Silva, il dansa un pas de deux, où il brilla moins par sa bonne grâce que par sa légèreté.
Les dames prirent alors congé de nous, et se retirèrent. Pour nous, nous fûmes conduits par Taïfaco dans un appartement composé de deux chambres agréablement meublées, mais sans magnificence, où nous trouvâmes d'excellents lits. Voilà, nous dit-il, où je souhaite que vous goûtiez les douceurs d'un profond sommeil. Dormez tranquillement, aimables étrangers ; et que les regrets et inquiétudes ne viennent point troubler votre repos.
À ces mots il nous salua civilement et nous fit adieu. Comme Silva et moi étions extrêmement fatigués, après avoir rendu grâce à la Providence du soin qu'elle prenait de nous, nous nous couchâmes, et fûmes aussitôt ensevelis dans un profond sommeil, dont nous ne sortîmes que le lendemain assez tard.
CHAPITRE 3. — Taïfaco explique à l'Auteur les lois de santé établies parmi les Letalispons.
Les aliments épurés que nous avions pris la veille, quoiqu'en grande quantité, à cause de notre appétit extrême, n'excitèrent pendant la nuit aucun tumulte dans notre estomac. Quelque temps après que nous fûmes éveillés, Taïfaco vint nous retrouver, et après nous avoir demandé obligeamment des nouvelles de la manière dont nous avions passé la nuit, il nous fit déjeuner ; puis il nous proposa une promenade vers un endroit agréable, où il nous assura que nous aurions du plaisir.
Aussitôt nous sortîmes de notre appartement et le suivîmes, il nous fit d'abord remarquer la beauté champêtre de plusieurs maisons qui s'offraient à nos yeux. Ce n'est point l'usage parmi nous, dit-il, de bâtir des villes comme vous. On dit que vous en avez en Europe de très grandes ; pour moi qui n'ai vu que les petites villes, que les Espagnols ont bâties dans le Chili, je m'imagine que ces grandes villes d'Europe doivent plutôt être un amas de prison et de cachots, qu'une suite de logements commodes. Comment pouvez-vous conserver un esprit libre, au milieu d'une si grande multitude d'hommes. N'y êtes-vous pas sans cesse assiégés de visites et d'affaires, qui souvent ne sont point les vôtres ? Il me paraît que les villes sont aux hommes ce que les cages sont aux oiseaux. Ce feu céleste qui est dans nous ne veut point être enfermé ; il aime l'air et les champs. C'est-là qu'il pense librement et à loisir, et qu'il est plus à couvert des préjugés et des passions. Dans les grandes villes, les vices en foule ne doivent point se sentir, mais se glisser par tout, sans qu'on s'en aperçoive. La vertu y doit être éclipsée et y périr presque toujours par la contagion de l'exemple. La vie champêtre est toute en exercice et en action ; ce qui aiguise l'appétit, endurcit et fortifie le corps. C'est donc avec beaucoup de sagesse que nos lois nous défendent de bâtir des villes. Si nous le faisons, il est vraisemblable que nous perdrions bientôt le don d'une longue vie et le privilège de rajeunir.
Taïfaco nous demanda alors, en quoi consistaient nos lois de santé. Nous lui répondîmes, que nous n'en avions aucunes, et que nos législateurs n'avaient jamais songé à prolonger notre vie ; qu'au contraire la plupart de nos lois ne servaient qu'à en abréger le cours, par les fâcheuses affaires qu'elles occasionnaient. D'ailleurs, ajoutai-je, nous estimons et révérons un homme qui dort peu, qui travaille beaucoup, qui mène une vie austère, qui brave les injures de l'air, le chaud, le froid, la faim, la soif, et qui ne nourrit que de mers sans suc, qui échauffent son sang et altèrent sa santé.
La vie n'est donc pas, selon vous, répliqua Taïfaco, le fondement de tous les biens, ni la santé le premier de tous les avantages. Le Seigneur éternel du monde vous a-t-il donné une vie, pour la ménager si peu ? Est-ce ainsi que vous respectez ce don céleste ? Pourquoi nous, qui regardons la vie comme le plus grand de tous les biens, nous tâchons d'en prolonger la durée le plus qu'il nous est possible, et de tenir notre âme le plus longtemps que nous pouvons dans le corps humain qu'elle anime actuellement ; et pour cela nos lois contiennent des préceptes admirables.
Nous lui demandâmes alors, en quoi principalement elles consistaient, et si elles étaient fort étendues. Elles ne comprennent, nous répliqua-t-il, que quatre ou cinq articles, que je vais vous expliquer en peu de mots. La première loi concerne l'air nous devons respirer. Par cet article important, il nous est ordonné expressément, de choisir toujours celui qui convient le plus à notre tempérament, sans considérer si c'est notre air natal ou non : car l'air que nous avons commencé à respirer en naissant, ne peut nous être salutaire qu'autant qu'il a le degré de température qui nous convient. Pour connaître la qualité de l'air qui nous environne, nous avons des thermomètres, des baromètres, des hygromètres, et des anémomètres ; et pour discerner celui qui nous convient davantage, nous avons parmi nous des hommes habiles, qui, en observant attentivement la respiration de ceux qui les consultent, jugent infailliblement de la nature de l'air que leur tempérament exige. Il est démontré que l'air est l'auteur de la fermentation qui arrive dans toutes les substances fluides : jugez du pouvoir qu'il a sur nos corps, où il entre non seulement par la bouche et par les autres conduits naturels ; mais qu'ils pénètrent encore par tous les pores extérieurs de la peau. Aussi en comparant les changements que l'air cause dans le corps humain à ceux qu'y produisent les aliments, on trouve que ceux que l'air cause sont beaucoup plus considérables. En général un air sain nous est recommandé ; et c'est pour cela qu'il nous est extrêmement défendu, comme je vous l'ai dit, de bâtir des villes, qui élèvent nécessairement des vapeurs chargées de corpuscules grossiers, capables de corrompre la masse du sang. Un air trop subtil, tel qu'on le respire sur les hautes montagnes, peut être aussi très nuisible, parce que la colonne n'y ayant pas assez de hauteur, et par conséquent la compression de cet air étant faible, les poumons s'enflent, et la respiration devient plus difficile. — J'avertis ici en passant le lecteur curieux, que dans les baromètres dont on se sert en ce pays-là, on emploie l'eau et non le mercure, conformément à l'opinion du savant Boyle qui dit avoir expérimenté que la compression de l'atmosphère est bien plus sensible dans le baromètre, lorsque l'on se sert d'eau, que lorsqu'on y emploie le mercure.
Le second article, poursuivit-il, regarde les aliments dont nous devons faire usage ; je vous ai déjà dit, que par l'art de la chimie nous avions trouvé le secret de les épurer et de les réduire à une espèce de quintessence. Ce n'est pas qu'il nous soit absolument défendu de manger les herbes, les légumes, les grains, et les fruits, tels que la Nature nous les offre, après les avoir assaisonnés. Mais en ce cas il nous est recommandé de ne point nous en rassasier, et d'éviter la trop grande variété, qui fait que la fermentation est plus difficile, la digestion plus lente, et que le chyle composé de trop de particules hétérogènes, ne peut que difficilement arriver à cette mixtion parfaite, qui est nécessaire à la nourriture de toutes les parties du corps. À l'égard de la boisson, notre usage est de ne boire jamais l'eau froide, mais de la mêler avec de l'eau qui a bouilli. Je sais que dans les ardeurs brûlantes de l'été, il est plus agréable de boire, l'eau non seulement froide, mais glacée ; mais nous éprouvons que la glace, loin d'éteindre la soif, ne fait que l'augmenter ; elle ferme par sa froideur les pores du palais, et bouche les fontaines salivaires, d'où coule cet humide radical qui tempère la chaleur du sang.
Le troisième article regarde l'exercice du corps. La loi nous recommande de le proportionner toujours à la nourriture que nous prenons ; en sorte que si nous mangeons peu, nous travaillons peu, et que si nous travaillons beaucoup, nous mangeons aussi beaucoup. C'est cette harmonie judicieuse entre le travail et la nourriture, qui fait les maladies sont très rares parmi nous, et que nous nous mettons en état de jouir du privilège singulier que la Nature nous a donné de rajeunir. Le mouvement des muscles réveille la chaleur assoupie, excite la circulation du sang, favorise la distribution des aliments, prévient et dissipe les obstructions, et augmente la transpiration.
Le quatrième article concerne la veille et le sommeil. La loi nous défend de renverser l'ordre que prescrit la Nature, et nous ordonne de donner la nuit au repos, et le jour au travail. Elle nous recommande de garder par rapport à l'un et l'autre la proportion de trois à un. Car si le sommeil est nécessaire pour délasser le corps fatigué des travaux de la journée, et pour détendre les fibres, il est certain que rien n'est plus capable de nous affaiblir, qu'un trop long sommeil, qui nous fait perdre dans le repos beaucoup plus d'esprits, que nous n'en pouvons dissiper par l'exercice.
Le cinquième article, continua-t-il, regarde les mouvements déréglés de l'âme, aussi contraires à la santé, que les exercices modérés du corps lui sont favorables. Pour en prévenir les funestes effets, on nous accoutume dès l'enfance à réprimer nos passions, et à dompter l'amour-propre qui en est toujours le principe. On punit surtout très sévèrement la colère, qui de toutes les passions est celle qui agit le plus sur le corps ; car c'est alors que l'âme offensée, réunissant en un instant toutes ses forces, pousse le sang et les esprits au dehors, et agite le cœur, dont les systoles sont si violentes, par le flux impétueux des esprits animaux, que le sang précipité dans les artères, au lieu d'entrer dans les veines, s'extravase en quelque sorte, et cause cette rougeur subite, qui éclate sur la peau d'un homme extrêmement irrité. Le contraire arrive dans la crainte, où il se fait une contraction générale de toutes les fibres, et où le sang est reporté vers le cœur par les artères ; ce qui est cause que la pâleur faisait toujours le visage d'un homme effrayé. C'est ainsi que par la liaison mécanique qui est entre l'âme et le corps, les mouvements de l'âme agitant toute la masse des fluides, l'économie naturelle est renversée. C'est donc avec raison que pour conserver la santé, et parvenir à une longue vie, nous nous exerçons de bonne heure à dompter nos passions ; et que notre principale éducation consiste dans une étude pratique des préceptes de la morale. Nous instruisons surtout les jeunes gens à faire un usage modéré des plaisirs de l'amour, dont l'excès est si nuisible et si honteux.
Vous autres Européens au contraire, ajouta-t-il, vous vous contentez d'appliquer d'abord la jeunesse à l'étude de plusieurs langues ; et vous songez bien davantage à cultiver l'esprit des enfants qu'à leur former le cœur et à déraciner leurs passions. Il arrive même que par une excessive application à l'étude, vous altérez leur constitution. Sous prétexte d'imprimer profondément dans leur cerveau les traces d'une infinité de mots et de règles grammaticales, vous en ébranlez les fibres tendres et délicates : leur mémoire surchargé appesantit leur imagination, et affaiblit leur jugement ; et la science que vous faites d'ordinaire entrer dans leur âme par la crainte (*) — ainsi que les Espagnols le pratiquent — leur donne pour le reste de leur vie, une timidité qui énerve leur esprit. Ce n'est pas que nous méprisons les lettres ; mais nous n'y donnons qu'une application modérée. La sobriété par rapport aux sciences nous est recommandée, de même que par rapport aux aliments ; parce que l'intempérance de l'étude éteint la chaleur naturelle, interrompt et détourne le cours des esprits. La tête, le siège de l'âme, et pour ainsi dire le palais de la science, échauffée par la continuelle action des fibres, et par la tension habituelle des nerfs, cesse de distribuer dans tous les membres les esprits vitaux, dont elle est le principe ; ce qui produit un abattement dangereux, et une espèce d'engourdissement, qui précipite les jours et hâte le trépas.
CHAPITRE 4. — Littérature des Letalispons. — Réflexions sur les vers rimés, et sur les vers latins.
Nous écoutions avec autant de plaisir que d'attention les maximes sages et utiles, que Taïfaco nous exposait ; nous étions surpris de trouver en lui une espèce de médecin, raisonnant clairement et avec justesse sur l'économie du corps humain. Mais en même temps nous ne pouvions nous imaginer qu'il y eut des médecins dans un pays où les hommes vivaient si longtemps. Taïfaco s'étant aperçu de notre étonnement, nous dit, qu'effectivement il n'y avait personne parmi eux qui fit profession de guérir les autres, parce que chacun étain médecin de soi-même ; en quoi ils suivaient les exemples de tous les animaux, qui dans leurs infirmités ne prennent conseil que de la Nature ; que d'ailleurs ils étaient très rarement malades, et que cela n'arrivait que lorsqu'ils violaient leurs lois de santé. Qu'en ce cas ils consultaient leur propre raison et leur expérience ; et que par la connaissance de leur tempérament, que chacun étudiait avec attention, ils se guérissaient aisément.
Comme il nous avait parlé du degré d'application qu'ils donnaient à l'étude des sciences, et de l'estime qu'ils faisaient des lettres, je lui demandai quelles sciences ils cultivaient particulièrement. À quoi il me répondit, qu'en général ils les cultivaient toutes ; mais que celles qui étaient les plus estimées parmi eux, étaient les mathématiques et la physique ; que communément ils préféraient à l'étude des sciences sublimes, celle des beaux-arts ; tels que la musique, la poésie, l'éloquence et la peinture, parce que ces arts les amusant agréablement, et flattant leurs sens, contribuaient à la conservation de leur santé, et à la prolongation de leur vie.
Notre poésie, ajouta-t-il, ne se ressemble pas à la poésie des Espagnols, dont les vers, malgré la noblesse et la majesté de leur langue, ont une cadence ennuyeuse et désagréable, causée par la grandeur affectée et monotone de leurs mots. D'ailleurs la rime, qu'ils regardent comme un agrément, et qui à ce que j'ai ouï-dire, caractérise les vers de la plupart des nations d'Europe me paraît une invention méprisable, et une affectation puérile. Qu'y a-t-il de plus ridicule et même de plus fatiguant pour l'oreille, que ce retour périodique de pareilles syllabes, placées régulièrement au bout de chaque ligne, avec les mêmes mesures et les mêmes poses ? Si rien n'est plus agréable aux sens que la variété, comment a-t-on pu s'imaginer, que des sons uniformes et semblables, pussent flatter l'oreille ? La rime doit gêner infiniment le poète, et ne peut rien produire qui soit capable de sonner de la force ou de la grâce au discours et d'émouvoir l'âme. Je ne pouvais autrefois sans rire entendre les tragédies des Espagnols, où je voyais des héros mourir en rimant. Mais ce qui me paraissait le plus absurde, était de voir que dans un changement de scène, celui qui entrait nouvellement sur le théâtre, et n'avait pu entendre les vers récités immédiatement avant qu'il arrivât, ne laissait pas de rimer avec le dernier vers qu'on avait dit en son absence, comme s'il l'eut ouï. En vérité, ajouta-t-il, je ne puis comprendre votre goût européen, ni la manie de vos beaux esprits. Pour nous, continua-t-il, nous n'avons qu'une versification métrique, composée de syllabes longues et brèves, qui nous fournit une variété harmonieuse de sons, qui par les degrés divers de leur gravité, ou de leur rapidité, expriment et excitent en même temps les mouvements tranquilles ou impétueux de l'âme.
Tels étaient, lui répondis-je, le vers des Grecs et des Romains, peuples célèbres de l'antiquité, dont nous avons emprunté toutes les sciences et tous les arts, qui fleurissent aujourd'hui parmi nous. Quoique leurs langues soient éteintes, et qu'il n'y ait plus que celle des derniers qui brille encore un peu dans les ténèbres de nos collèges — parce que nous l'apprenons d'ordinaire dans nos premières années pour l'oublier, ou pour n'en faire aucun usage le reste de notre vie — il se trouve néanmoins des hommes parmi nous, qui non contents de la cultiver, et de consacrer leurs veilles à en étudier les règles et le goût, prennent encore plaisir à composer dans cette langue des vers admirables que personne ne lit. Ces vers ont beaucoup plus de force et de grâce que les nôtres ; et une preuve de leur mérite et de leur beauté, est qu'il se trouve aujourd'hui des poètes, qui, quoique certaines de n'être point entendus, ne laissent pas d'en faire.
C'est dommage, continuai-je que le goût de cette versification harmonieuse se soit perdu, et que par un triste effet de notre paresse et de notre ignorance, nous soyons réduits à lui préférer notre barbarie vulgaire. La langue des anciens Romains était encore il y a cent ans celle de tous les savants et de tous les beaux esprits d'Europe, qui par le moyen de cet idiome commun, pouvaient sans peine se communiquer mutuellement leurs lumières et leurs découvertes. Mais le désir vain d'être lu et entendu des ignorants, leur a fait abandonner un langage, qui ne leur attirait pas assez d'applaudisseurs, pour rassasier leur vanité. De-là vient qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui s'entendre, que par le secours des interprètes, où qu'ils sont obligés de perdre leur temps à acquérir l'intelligence de plusieurs langues vulgaires. Cet abus, ajoutai-je, est encore plus sensible par rapport à l'Angleterre, qu'à l'égard de tous les autres royaumes de l'Europe. Notre langue sèche et peu agréable n'est presque connue que dans nos îles ; et néanmoins c'est dans cette langue que nos savants Anglais écrivent aujourd'hui. Il semble qu'ils craignent ou dédaignent de faire part aux Étrangers de leurs richesses. Peut-être aussi veulent-ils forcer en quelque sorte la république des Lettres à adopter leur langue, c'est-à-dire, de la mettre au rang des langues savantes, et sur le pié de la française et de l'italienne, qui depuis un certain nombre d'années sont en possession de cet avantage.
CHAPITRE 5 — Description du village des Cérébellites, et des quatre clavecins. — Réception d'un nouveau Cérébellite.
En nous entretenant ainsi, nous arrivâmes insensiblement près d'un village très fameux parmi les habitants de cette contrée, et appelé dans leur langue Scaricrotariparagorgouleo, dont les environs me surprirent, par la bizarrerie des choses qu'ils offrirent à ma vue. J'y vis sur de hautes montagnes des prairies arrosées par le secours de plusieurs pompes, et des vignobles au bord des ruisseaux ; des jets d'eau sur la pointe des rochers ; des cascades à chaque pas, avec des pavillons isolés d'une architecture singulière, exposés à tous les vents, et sur lesquels on apercevait une infinité de girouettes bruyantes, et de cadrans lunaires.
Vous voyez, nous dit notre conducteur, le fameux village des Cérébellites de notre nation. Il eut beaucoup de peine à nous définir cette espèce d'hommes, qu'il nous avoua être au-delà de toute définition ; cependant nous comprîmes que ces Cérébellites se rapportaient à ce que nous appelons dans notre langue anglaise Maggot-headed, et à ce que les Françaises appellent «Calotins», gens dont le cerveau fécond, malgré le feu dont il est consumé, produit des choses étonnantes. C'est aujourd'hui, ajouta-t-il, le quatorzième jour de la lune, jour consacré parmi eux à la réjouissance ; je veux que vous soyez témoins de leurs amusements, et de leurs exercices. Ce n'est point au reste chez des fous que je vous mène, ou si l'on veut les appeler ainsi, ce sont au moins des fous pleins d'esprit, et d'un caractère aimable. En vérité sans cette espèce d'hommes, que la Providence a semé sur la surface de la Terre, pour le plaisir des sages, il me semble que le séjour en serait assez triste. Aussi je crois qu'il n'y a point de pays qui n'ait ses Cérébellites. Avançons d'abord de ce côté-ci, continua-t-il, c'est dans ce gros pavillon, que vous voyez à gauche, qu'ils ont coutume de s'assembler.
Lorsque nous fûmes arrivés à cet endroit, Taïfaco nous présenta d'abord au président de l'assemblée, petit homme, maigre, sec et agile, dont la tête chauve était couverte d'une calotte de métal plus brillante que celle de tous les autres. Tous les Cérébellites charmés de voir deux étrangers assister à leurs jeux périodiques, nous comblèrent d'honnêteté, et nous firent asseoir à la place la plus honorable ; et peu de temps après on commença une espèce de bal.
Ce qui attira le plus mon attention fut l'orchestre, composé de quatre clavecins, qui ne furent touchés que l'un après l'autre. Le premier, au son duquel on dansa, était composa de fils de laiton, lesquels aboutissaient à un grand nombre de timbres, proportionnés dans leurs volumes, dont les battants mis en mouvement par une main légère et savante, formaient des accords argentins, et rendaient une fois également perçant et harmonieux, avec une cadence digne de l'oreille des Cérébellites
Un concert succéda au bal, et fut exécuté par une seule famille. Le bisaïeul chantait le premier dessus, son fils le second dessus, son petit-fils la basse, et son arrière-petit-fils la haute contre. On ne se servit point dans ce concert du clavecin à timbres, qui aurait rendu un son trop éclatant, pour pouvoir agréablement accompagner les voix, mais d'un autre clavecin assez pareil aux nôtres, excepté que les touches au lieu de faire mouvoir des sautereaux, et d'ébranler par leur mouvement des cordes de fil de laiton, faisaient tourner par des ressorts cachés une certaine quantité de petites roues de bois enduites d'une espèce de colophane, dont chacune en tournant faisait résonner la corde de boyau qui lui était contiguë, à peu près comme dans nos vielles, où c'est une roue qui sert d'archet.
Ce clavecin me parut infiniment au-dessous des clavecins d'Europe, sur lesquels, comme le savant ceux du métier, on ne peut exécuter, ni tenues, ni diminutions, ni augmentations de son, et qui ont toujours une espèce de dureté et de sécheresse, quelque parfaitement qu'ils soient touchés. Celui-là au contraire était d'une douceur extrême, proportionné à sa force : on y pouvait aisément tenir, flatter, pincer, diminuer, et enfler les sons ; en sorte que je crus entendre un concerto de Corelli ou de Vivaldi exécuté par deux violoncelles et quatre violons d'Italie.
Je fais construire actuellement par un habile ouvrier de Londres un clavecin pareil à celui que je viens de décrire ; et je ne doute point qu'il ne réduise un jour tous les clavecins de l'Europe, qui ont été jusqu'ici en usage, au rang de la guitare, du luth, et du théorbe : instruments aussi surannés que les personnes qui se plaisent à en jouer. Cependant j'ai jugé à propos d'y faire quelque changement, suivant les avis d'un des premiers joueurs de clavecin d'Angleterre. Au lieu de cette multitude de roues, dont chacune en tournant ébranle la corde qui lui répond, il m'a dit qu'il était plus à propos de les réduire toutes à une seule d'une grandeur proportionnée à celle du clavecin, laquelle tournera toujours par le mouvement que lui donnerait le pied du jouer : qu'ainsi au lieu que dans le clavecin des Cérébellites, c'est la petite roue qui va chercher la corde, ici au contraire ce fera la corde qui cherchera la grande roue ; ce qui est plus simple, plus naturel, et plus aisé à exécuter.
Ce concert sérieux fut immédiatement suivi d'un autre petit concert burlesque qui me réjouit beaucoup, et qui fut exécuté avec le troisième clavecin, organisé d'une façon nouvelle. On avait rangé dans quinze différentes cages autant de petits cochons de différents âges ; sous chacune des touches du clavecin étaient perpendiculairement attachées de longues aiguilles, dont la pointe partait immédiatement sur le dos de ces animaux, selon que le musicien appuyait ses doigts savants sur les touches du clavecin ; les longues aiguilles ne manquaient point de piquer les cochons, qui étant proportionnés dans leur grandeur, rendaient aussi par leurs cris plaintifs des tons proportionnés, les uns à la tierce, les autres à la sixte, ceux-ci à la quinte, et ceux-là à l'octave. Ceux qui étaient destinés à faire la basse paraissaient assez gros, et semblaient articuler Hovvhn, comme les autres plus petits semblaient prononcer Hovvihn. Et afin que le son, que rendait chacun de ces animaux, finit régulièrement et avec précision, et ne causât aucune cacophonie, il y avait à cette espèce d'orgues des pédales, qui par le moyen de plusieurs courroies faisaient, quand on voulait, taire les cochons, dont le museau se trouvait bridé et serré, selon que le jouer appuyait son pied sur les touches. J'ai assisté quelquefois à des concerts, où les accords étaient moins justes, et les voix passables. L'inventeur de cet instrument nous dit, qu'il dressait actuellement des chats, et leur apprenait à chanter, conformément aux idées d'un ingénieux Cérébellite, qui avait publié un livre sur ce sujet.
Mais ce qui me causa un extrême plaisir et me donna une haute opinion des Cérébellites, fut le quatrième clavecin, instrument dont nous n'avais jamais eu d'idée en Europe. La longue vie des peuples de ce pays leur donne lieu de chercher la perfection et de la trouver ; chez nous au contraire la vie est courte et l'art est long. Cet instrument, qui dans sa construction ressemblait en effet à un clavecin, et à qui pour cela on donnait ce nom, quoiqu'il n'eut aucun rapport à la musique, s'appelle dans la langue du pays tir-à-flouc, c'est-à-dire, clavecin oculaire, ou tir-à-crac, c'est-à-dire, clavecin dramatique, et sert uniquement à la représentation de la comédie automatique. Un Cérébellite très versé dans cet art, par le mouvement rapide et les divers flexions de ses doigts agiles, qu'il appuyait sur différentes touches, faisait paraître et mouvoir sur un théâtre, qui s'élevait au bout du clavecin, plusieurs semblables à nos marionnettes, et les animait par les situations, les postures, les attitudes et les gestes divers, que ses doigts intelligents leur communiquaient, et par une espèce de voix fort jolie qu'il leur prêtait en déguisant et modifiant la sienne de cent façons différentes qui me surprirent.
Le poète auteur de la pièce, représentée par le clavecin dramatique, était présent. C'est une grande âme, me dit Taïfaco, qui ne travaille point en vue de s'acquérir une gloire chimérique, qu'il méprise. Il ne se propose dans ces sortes d'ouvrages qu'une honnête utilité. Comme on a lancé contre lui quelques petits traits satiriques, au sujet du motif qui lui fait exercer ce métier, son courage philosophique lui a fait prendre pour devise un âne mangeant des chardons, avec ces mots : Qu'ils me piquent, pourvu qu'ils me nourrissent : pour faire connaître, qu'il se met peu en peine des railleries piquantes que lui attirent ses vers sifflés du public, mais très bons au gré de son estomac, qui leur donne toujours son suffrage.
Après tous ces divertissements, on nous annonça qu'on allait recevoir un nouveau Cérébellite, qui par une infinité d'actions éclatantes, et par quelques ouvrages d'esprit, avait mérité d'être associé à cet illustre corps. On nous assura que ce digne prosélyte avait beaucoup brigué cet honneur, qui jamais ne s'accordait qu'aux plus vives et aux plus pressantes sollicitations. Enflé d'une orgueilleuse modestie, et affectant l'air d'un sage téméraire, il s'avança au milieu de l'assemblée, et s'étant mis à genoux aux pieds du président, il jura d'abord d'observer tous les statuts du corps, qui se rapportaient tous à trois chefs, comprenant toute la vie humaine, c'est-à-dire, aux pensées, aux paroles et aux actions.
Par rapport aux pensées, il promit solennellement, 1°. de suivre toujours les premières, et de n'avoir jamais égard aux secondes : parce que par rapport à un Cérébellite, il est faux que les secondes pensées soient préférables aux premières. 2°. De ne penser jamais comme le commun des hommes, mais de chercher toujours le neuf, le singulier, et le hardi. 3°. De regarder le goût, non comme une partie du jugement, mais comme un sixième sens. Par rapport aux paroles, il promit, 1°. de parler beaucoup, et d'avoir pour cela toujours dans la mémoire une abondante provision de contes bons ou mauvais. 2°. De s'accoutumer à ne penser qu'immédiatement après avait parlé. 3°. De s'exprimer toujours d'une façon neuve et particulière. Enfin par rapport aux actions, il s'engagea à mépriser ce qu'on appelle coutume, usage, bienséance, et à donner au moins une fois par an quelque scène agréable au public. Après le prestation de serment entre les mains du président, le récipiendaire reçut de lui la marque honorable de sa nouvelle dignité, qui consistait en une calotte de métal brillant. Il prononça alors un discours de remerciement, où l'on m'assura que, selon l'usage, il avait fait une satire ingénieuse contre le corps où il entrait.
Je remerciai mon conducteur de m'avoir fait passer une journée si agréable, et je lui dis que c'était dommage, que les Cérébellites de mon pays n'eussent pas de pareilles assemblées, et ne formassent pas un corps particulier, qu'à la vérité les Français, peuple voisin de notre île, en avaient fait une espèce d'Ordre ou de Régiment ; mais qu'on y enrôlait d'ordinaire les gens malgré eux, ce qui était contraire à la liberté d'une nation ; qu'ils n'avaient entre'eux aucune société ; qu'à peine même ils se connaissaient ; que la plupart n'entendaient point raillerie, surtout s'ils étaient constitués en quelque dignité ; et qu'ils regardaient les suffrages et les lettres d'association, dont on les honorait, comme des satyres personnelles ; que néanmoins rien n'était plus utile que ces lettres appelées brevets, puisqu'elles pouvaient servir à corriger quelques Français de leur sot orgueil, et à réprimer leurs failles extravagantes ; que l'appréhension d'être malignement incorporés dans ce burlesque Régiment, les empêchait souvent de se rendre ridicules avec éclat : en sorte que cette folle société était pour eux une école de sagesse, ou plutôt un préservatif contre la folie.
CHAPITRE 6. — Mœurs et gouvernement des Letalispons. — Ce qu'ils pensent au sujet de la souveraineté.
Comme j'ai toujours eu la curiosité dans les différents pays où la fortune m'a conduit, de m'informer des usages particuliers des peuples et de la forme de leur gouvernement, je crois que le lecteur attend de moi, que je lui dise quelque chose des mœurs et du gouvernement des Letalispons. On a vu jusqu'ici que cette nation rapporte tout à la conservation de la vie, que leur sagesse regarde comme le fondement de tous les biens. Par un effet du soin extrême qu'ils prennent de leur santé, ils fuient tout ce qui peut altérer la paix de leurs âmes. C'est pour cela qu'on ne les voit jamais en colère. Ils ne se haïssent point, il ne se persécutent point, ils ne se déchirent point l'un l'autre par des médisances malignes, ou par des calomnies cruelles : personne n'a d'ennemis, parce que personne n'est offensé par un autre, et que s'il échappe à la fragilité quelque chose qui puisse blesser, il est pardonné aussitôt que réparé.
Je me souviens que leur ayant dit un jour, que dans mon pays un homme offensé était toujours déshonoré, s'il ne tirait vengeance de l'injure qu'il avait reçue, ils me répondirent que parmi eux le déshonneur était toujours du côté de l'offenseur, qui par son offense avait commis une injustice, et que pour en perdre le témoin, c'était proprement à lui de souhaiter la destruction de l'offensé, s'il était permis de souhaiter la destruction de quelqu'un. Ils ne pouvaient concevoir, comment des hommes raisonnables mettaient l'épée à la main, et s'exposaient non seulement à tuer un autre homme pour une parole, et quelquefois un geste, mais encore à être tués eux-mêmes, pour laver leur propre affront. Sans cela, leur disais-je, nous nous insulterions fréquemment ; la crainte de la vengeance contribue à notre politesse, et on a remarqué qu'elle règne bien plus parmi ceux qui portent à leur côté de quoi punir ceux qui la blessent, que parmi eux à qui leur état interdit cet ornement meurtrier.
Vous vous respectez donc réciproquement par poltronnerie, me répliqua-t-il, et vous ne vous ménagez, que parce que vous vous craignez. Ne vaudrait-il pas mieux le faire par équité et par la raison ? Mais vous, à qui l'exercice de la vengeance est si familier, comment la connaissez-vous point vengeance, c'est pure cruauté. Car se venger, c'est causer du déplaisir à celui qui nous a offensé, et l'en faire repentir. Or étant tué, comment se repentira-t-il ? Il est à l'abri de tout mal, tandis que le vengeur reste dans la peine, livré à ses remords, et à la crainte des châtiments.
Qu'on ne soit point étonné de ce raisonnement singulier. Les Letalispons ont horreur de l'effusion non seulement du sang humain, mais encore de celui du moindre animal, ainsi qu'on l'a pu remarquer ci-dessus. Cependant l'amour de sa patrie et la nécessité de se défendre font qu'ils se battent très courageusement quand quelques peuples des îles voisins viennent les attaquer, parce qu'il est permis, selon eux, de verser le sang de ceux qui veulent verser le nôtre ; mais on ne les voit point dans le sein de la paix, au milieu de leur patrie et de leurs familles, porter des armes dangereuses, pour se faire respecter ou craindre. Ils ne s'arment que pour détruire les bêtes féroces, ou pour repousser les ennemis de la patrie.
Les mariages ne se font point chez eux, comme parmi nous, où les filles sont toujours à charge à leur famille, et où les plus jolies, lorsqu'elles ont peu de bien, ont beaucoup de peine à trouver des maris. Là les filles s'achètent, et une belle fille fait toujours la fortune de son père ; celles qui sont d'une beauté médiocre sont d'ordinaire épousées gratis. À l'égard de celles qui sont très laides, et qui ont le corps et l'esprit mal tournés, elles ruinent souvent leur malheureux père, qui selon la loi est toujours obligé de leur trouver un époux. Au reste l'esprit est toujours mis en compensation, soit par rapport aux belles, soit par rapport aux laides. D'un autre côté un jeune homme achète toujours à meilleur marché qu'un homme âgé. Un garçon bien fait et plein d'esprit a quelquefois pour rien une fille très jolie et très spirituelle. Tout est mis dans la balance de part et d'autre. On n'oublie pas non plus de faire attention à la fortune de celui qui épouse.
Ces peuples n'ont point, comme nous, une soif insatiable de richesses : cependant ils ne les méprisent pas ; ils blâment même ceux qui par un esprit philosophique paraissant s'en mettre peu en peine, et n'en faire aucun cas. Mépriser la richesse, disent-ils, c'est mépriser l'occasion de pratiquer plusieurs vertus. La pauvreté ne donne lieu que d'exercer le courage et la patience : l'abondance au contraire fournit les moyens de faire paraître de la tempérance, de la modestie, du désintéressement, d'être libéral et généreux.
Ils font beaucoup d'estime de la beauté, soit des hommes, soit des femmes, non par rapport au plaisir qu'elle peut causer par les charmes extérieurs, mais à cause de la relation qui est entre le corps et l'esprit. Ils sont persuadés qu'en général une personne laide et mal faite de corps a l'esprit de même, et qu'un bel homme ou une belle femme ont presque toujours l'âme belle ; à moins que l'éducation n'ait apporté quelque changement à ce cours ordinaire de la Nature. Ce qui me rappelle le mot de Socrate, qui en parlant de lui-même, disait, que la laideur de son corps était le signe de son âme : mais qu'il avait un peu diminué celle-ci par ses soins. Ce n'est pas qu'ils regardent cette règle comme certaine et invariable ; mais ils croient que ceux qui démentent leur bonne physionomie sont plus coupables que les autres, parce qu'ils trompent les yeux, en trahissant la promesse publique, que la Nature a tracée sur leur visage. À l'égard de ceux qui sont difformes et contrefaits, comme ils ne trompent personne, ils leur paraissent moins punissables.
La justice s'administre chez les Letalispons avec beaucoup de droiture et d'équité. Ce qu'il y a de singulier, et ce qui paraîtra incroyable en Europe, est que les procès ne produisent aucune haine entre les plaideurs ; ils se regardent réciproquement comme des hommes qui soutiennent deux opinions différentes sur un sujet problématique. Chacun défend son droit sans animosité, sans aigreur. Les parties sont même obligées par la loi de manger ensemble, au moins les deux derniers jours qui précédent immédiatement le jugement définitif ; et l'usage est, que celui qui perd sa cause, ne manque point de rendre visite à celui qui l'a gagnée, pour lui en faire compliment.
L'État était autrefois monarchique, et la Couronne élective. Mais depuis environ un siècle le gouvernement est devenu républicain ; non par aucune révolte des sujets contre leur prince légitime, ou par l'inconstance et la légèreté du peuple, mais par l'impossibilité de trouver dans le pays un homme raisonnable, et digne d'être roi, qui voulut l'être. Comme j'avais de la peine à me persuader que c'eût été là le véritable motif, qui eût causé cette révolution, Taïfaco me dit un jour, qu'il était surpris que j'eusse de la peine à comprendre une chose si naturelle ; et pour me la faire mieux concevoir, il me peignit ainsi les incommodités de la royauté, telles qu'il se les imaginait.
Les avantages de ce rang, me dit-il, qui semblent si flatteurs et si brillants, sont faibles et peu solides. Il est vrai que l'éclat de la souveraineté éblouit le vulgaire : ce ne sont qu'honneurs et que respects : une puissance absolue, dont dépend le bonheur et le malheur de plusieurs hommes, beaucoup de richesses et de magnificence : la jouissance aisée de toutes les choses qui flattent le plus vivement les sens : voilà ce qui peut rendre le sort d'un roi digne d'envie. Mais comparez avec ces avantages frivoles les misères réelles d'un souverain ; vous verrez qu'il est très à plaindre, et que de toutes les conditions c'est peut-être la moins heureuse.
Quel assemblage de talents rares et de qualités supérieures n'exige pas le rôle de roi, pour le bien jouer sur la scène de ce monde ? S'il est difficile de se gouverner soi-même, quelle difficulté n'y a-t-il pas à gouverner un peuple nombreux, à s'en faire craindre et aimer, à corriger les abus, sans blesser les préjugés, et à se rendre puissant, sans devenir odieux ? Un roi doit être meilleur que tous ceux à qui il commande, et faire voir en lui le modèle de toutes les vertus. Mais comment les alliera-t-il avec la politique ? Comment se rendra-t-il redoutable à ses ennemis, sans fouler ses sujets ? S'il est pacifique, on l'accusera d'indolence et de faiblesse ; s'il est guerrier, il fera murmurer ses voisins, et gémir son peuple ; les plaisirs qu'il goûte, sont-ils capables de la dédommager des fatigues que lui causent les affaires de son État ? Ces plaisirs sont bien au-dessous de ceux dont jouit un particulier : ils s'offrent à un roi, sans qu'il les cherche ; il ne les achète point, comme nous, par des soins agréables ; il n'en connaît point le plus piquant assaisonnement, qui est la difficulté et la résistance ; il n'agit point dans ses insipides plaisirs, il glisse, il sommeille.
Par rapport aux plaisirs de l'esprit, un roi ne goûte jamais purement celui de l'approbation et de la louange ; il sait qu'elle ne lui est point donnée par des personnes libres, qui puissent la lui refuser. Il n'est assuré de réussir à rien, si ce n'est à dompter un cheval ; car en tout autre exercice tout fléchit sous lui, et lui cède l'avantage ; le cheval seul n'est ni flatteur ni courtisan.
La grandeur d'un roi le gêne. Sans cesse privé de la liberté de voyager, il est en quelque sorte prisonnier dans son royaume, et captif dans sa cour, où il se trouve presque toujours environné d'une foule importune de courtisans, qui l'observent et l'étourdissent, les uns de leurs demandes, et les autres de leurs remerciements. Il est hors d'état de goûter les douceurs de l'amitié, qui n'est qu'entre les égaux. Tous les services qu'on lui rend partent ou de la coutume, ou de la contrainte, ou de l'ambition : aussi voyons-nous les méchants princes aussi bien servis que les bons : mêmes respects, mêmes cérémonies, mêmes éloges.
Mais ce qui fait le plus grand des souverains, est que la vérité les fuit ; ils ne voient d'ordinaire que par les yeux d'autrui ; et souvent les yeux dont ils se servent, empruntent encore le secours de plusieurs autres yeux, auxquels ils se fient et qui les trompent. De-là vient que souvent ils récompensent le vice et maltraitent ou négligent la vertu.
Je répondis à Taïfaco, que ce n'était pas ainsi que dans le reste du monde on regardait la royauté ; qu'un roi y passait pour l'homme le plus heureux de son royaume ; que pour avoir la gloire et le bonheur de régner sur une petite contrée, quelquefois un homme seul ébranlait une grande partie de l'univers, et faisait périr un million d'hommes, dont la moitié se battait pour ses intérêts, et l'autre pour ceux de son rival ; qu'une maxime reçue parmi les conquérants ambitieux, était que le crime cessait de l'être, quand il procurait une couronne ; que toutes nos Histoires étaient remplies de souverains trahis et détrônés, de sujets rebelles devenus usurpateurs, de tyrans qui avaient sacrifié à leur élévation tous les sentiments de la nature et de l'honneur, et qui ne s'étaient maintenus sur le trône, que par les ravages et les massacres ; que la fureur de régner avait autrefois renversé la plus puissante république de l'univers ; qu'un homme avait eu l'ambition de gouverner seul la moitié du monde, et y avait réussi ; et qu'il s'était trouvé parmi nous des potentats qui avaient aspiré à donner des lois à toute la terre.
Jugez de-là, ajoutai-je, que la condition d'un souverain ne nous paraît pas si malheureuse qu'à vous. L'éclat de la couronne éblouit tellement nos yeux, que nous n'y voyons point du tout ce que vous y voyez. Il n'y a personne parmi nous, qui ne sacrifiât volontiers ce qu'il a de plus cher, à la gloire d'être assis sur le trône, s'il pouvait se flatter raisonnablement d'y monter. Le bonheur de cet état passe même pour si indubitable, que lorsque nous voulons exprimer qu'un homme est heureux, nous disons ordinairement qu'il est heureux comme un roi. Nous comptons pour rien, les embarras de ce rang suprême. C'est à nos yeux l'objet le plus désirable, parce que nous ignorons tout le poids d'une couronne portée dignement.
CHAPITRE 7. — Histoire de Taïfaco et d'Amenosa.
Un jour que je m'entretenais avec Taïfaco à l'ombrage d'un bocage, où l'on respirait un air frais et pur, je lui demandai, pourquoi il avait autrefois quitté son pays, pour aller au Chili : si ç'avait été par le désir d'y commercer utilement, ou par une curiosité semblable à celle qui m'avait fait abandonner ma patrie, pour connaître les mœurs des peuples éloignés. Non, me répondit-il, ce ne fut aucune de ces motifs qui m'engagea à faire ce voyage, l'amour seul me le fit entreprendre.
À l'âge de dix-huit ans, je devins amoureux d'une fille nommée Amenosa, dont la jeunesse et les agréments m'avaient charmé, et dont le père passait pour un des hommes les plus riches de cette île. J'eus le bonheur de lui plaire; elle reçut mes vœux, et nous aurions été dès lors heureux l'un et l'autre, si la médiocrité de ma fortune qui n'avait point été dédaignée de la fille, n'eût été méprisée du père. Mais lorsque je la lui demandai en mariage, il me la refusa durement, en me disant que je n'avais point assez de richesse. Voyant que je n'étais malheureux, qu'à cause de mon peu de bien, je résolus de tenter toute sorte de moyens honnêtes pour l'augmenter. Dans cette résolution je fus plusieurs jours sans savoir quel parti prendre. Il est aisé de former le dessein d'être riche, mais il est difficile de bien choisir les moyens de le devenir.
J'étais dans cet embarras, accablé de tristesse et réduit au désespoir, lorsque je rencontrai un jour sur le bord de la mer, où j'étais tenté de me précipiter, un de mes amis intimes, nommé Hasco. Dès que je l'aperçus, je voulus m'éloigner ; mais aussitôt accourant vers moi, il me retint ; et m'ayant demandé affectueusement le sujet de mon chagrin et de ma triste rêverie, il m'obligea par ses tendres importunités à le lui découvrir. Si le Ciel, me dit-il alors, m'avait donné autant de richesses qu'au père de la belle Amenosa, je les partagerais volontiers avec vous pour vous la faire obtenir ; mais vous savez le peu de bien que j'ai hérité de mes pères, et je suis réduit à ne pouvoir vous offrir que mes stériles conseils. J'ai entendu dire, ajouta-t-il, que du côté de l'est, il y avait une terre fertile en or, source de celui qui est répandu dans cette île ; mais que depuis environ un siècle des hommes extraordinaires, armés de foudres et d'éclairs, l'avaient conquise, et en avaient égorgé ou foudroyé presque tous les habitants : ce qui avait interrompu le commerce que nous avions avec ces peuples, et avait rendu l'or moins commun parmi nous. Si vous m'étiez moins cher, poursuivit-il, je vous conseillerais de vous transporter dans cette riche contrée ; peut-être que le Ciel favorable à vos désirs, vous y serait trouvé les moyens d'en revenir chargé d'or. Mais les dangers où ce pénible voyage vous exposerait, ne me permettent pas de vous donner en ami un si funeste conseil.
Ah ! repris-je, les périls les plus affreux n'effrayent point mon âme. Trop heureux ! si en courant les plus grands dangers, je pouvais mériter ma chère Amenosa. Je vous rends grâces, cher ami, de l'idée que vous venez de me communiquer : le Ciel touché de mes maux vous l'a inspirée ; c'en est fait, je partirai. Hasco me voulut alors détourner du dessein que je venais de prendre, et qu'il m'avait lui-même suggéré ; mais voyant que j'étais inflexible : Eh bien, dit-il, puisque vous voulez vous exposer à périr, et que je suis la cause de votre funeste résolution, je veux vous accompagner dans votre voyage, et en partager avec vous tous les dangers. Il est juste que l'auteur du projet soit le témoin du succès. Je combattais en vain une générosité si héroïque, je fus contraint d'accepter ses offres, et nous nous disposâmes à partir ensemble.
La veille de mon départ j'allai trouver Amenosa, pour lui dire adieu, et l'informer de mon dessein. Elle fut inconsolable, et maudit cent fois cette estime des richesses, qui s'opposait à notre bonheur, et allait peut-être me coûter la vie. Elle fit ses efforts pour me détourner d'un voyage si périlleux, mais je le lui peignis moins dangereux qu'il n'était ; je la consolai par l'espérance d'un prompt et heureux retour, et la quittai, après nous être juré l'un à l'autre un amour éternel.
J'allai le lendemain dans l'endroit où Hasco m'avait promit de se rendre, et nous marchâmes l'un et l'autre vers le bord de la mer, où nous nous mîmes dans un canot que nous avions fait préparer et remplir de quelques provisions. L'espace qui nous sépare du Chili est d'environ soixante lieues. Nous avions fait assez heureusement la plus grande partie du chemin, à la faveur d'un vent d'ouest qui enflait notre voile, lorsqu'il s'éleva tout à coup un orage, qui nous mit dans un extrême péril. Nous amenâmes la voile, et nous luttâmes avec nos rames contre la fureur des vagues irritées. Notre canot fut trois fois submergé ; mais comme il était d'une écorce également légère et solide, nous sûmes, en nous jetant trois fois à la nage, l'empêcher de s'enfoncer entièrement, et le retourner avec adresse. Cependant une vague impétueuse, haute comme une montagne, vint nous envelopper, et accabla mon compagnon, que je ne vis plus depuis. Il fut enseveli dans les flots, et je perdis hélas ! un ami tendre et généreux, dans une triste circonstance où son secours m'était le plus nécessaire. Pour moi, je me tins fortement attaché au canot, que je retournai, comme j'avais déjà fait plusieurs fois. Le trouble où j'étais, m'empêcha de sentir la perte que je venais de faire aussi vivement, que je la ressentis dans la suite. Je ne songeai alors qu'à me préserver du naufrage, et qu'à défendre mes jours.
Cependant le vent cessa et les flots se calmèrent. Tout fatigué que j'étais, je me mis à ramer jusqu'au soir, qui s'éleva un petit vent assez favorable, qui me donna lieu de mettre la voile et de me reposer. J'avançais beaucoup pendant la nuit, en sorte que le lendemain vers le midi je vis terre. Au bout de trois heures, j'eus enfin le bonheur d'aborder à une pointe, appelée le cap de Quemchi, au-dessus d'Ancud. Je marchai jusqu'au soir, sans trouver aucuns habitants, ce pays étant stérile et désert. Cependant je me nourris de quelques racines assez mauvaises, et de quelques fruits sauvages, que je trouvai sur la côte, et je passai la nuit sur un arbre, où je dormis peu.
Le lendemain ayant longtemps marché de la côte du nord, je rencontrai sur le soir quelques naturels du pays, qui frappés de mon habillement étranger, s'approchent de moi, et me firent plusieurs questions sur le dessein qui m'amenait dans leurs pays. Notre langue ne diffère presqu'en rien de celle de ces peuples, parce que, si l'on en croit la tradition, notre île a été anciennement peuplée par une colonie de la contrée la plus méridionale du Chili. Ainsi j'entendis leur langage, et ils purent entendre le mien. Je leur répondis donc avec politesse, que j'étais un Letalispon, qui avait eu la curiosité de voir un peuple, dont nous tirions notre origine, et avec lequel nous avions autrefois été étroitement unis, avant qu'ils eussent été subjugués, et que leur pays eût été envahi par de cruels étrangers.
À ces mots les larmes parurent couler de leurs yeux ; ils me peignirent en général tous les maux que ces impitoyables vainqueurs leur avaient causés, et ils me firent ensuite entrer dans leur maison, où ils me traitèrent avec beaucoup d'humanité. Ils me dirent que je pourrais demeurer avec eux, autant de temps que je voudrais ; que par rapport à la liaison que leurs pères avaient autrefois eue avec les Letalispons et à notre espèce de filiation, ils me regardaient comme un de leurs compatriotes. Mais ils me conseillèrent de ne point paraître aux yeux de leurs tyrans — c'est ainsi qu'ils appelaient les Espagnols qui les avaient subjugués. Ils croiraient peut-être, me dirent-ils, que votre pays produit de l'or, comme le nôtre : ils vous contraindraient de les y conduire ; ils égorgeraient vos femmes et vos enfants, pour vous obliger de leur découvrir vos trésors, et vous immoleraient ensuite vous-mêmes, pour assouvir leur cruauté. Prévenez ces malheurs, en ne vous montrant, que lorsque vous aurez pris nos manières, et que vous pourrez paraître né dans ce pays.
Je les remerciai de leur conseil, et leur demandai, si les Espagnols étaient seuls en possession des mines d'or, et s'il n'était permis qu'à eux d'en approcher. Eux seuls, me répondirent-ils, en retirent tout le profit. Ils ont injustement envahi ce que le Ciel nous avait donné en partage ; et ils voudraient encore nous contraindre à nous ensevelir dans les entrailles de la terre, pour servir leur avarice. Mais ils n'ont pu encore nous y forcer.
Je jugeai alors que j'avais entrepris un voyage également pénible et inutile. Je résolus de m'en retourner dans ma patrie, et de faire tous mes efforts pour posséder Amenosa, et en cas que le destin continuât de m'être contraire, de mourir du moins à ses pieds. Je pris donc congé de mes hôtes, après avoir passé quelque temps chez eux et m'être reposé de mes fatigues, et je repris le chemin de Quemchi, où j'avais laissé mon canot.
Mais à peine avais-je fait six lieues, que je fus rencontré par des Espagnols qui chassaient. Voyant à mon habillement que j'étais étranger, ils m'arrêtèrent, et m'ayant demandé de quel pays j'étais, je jugeai à propos de leur répondre, que j'étais né dans une île fort éloignée. Je ne faisais pas attention que je me trahissais moi-même en leur répondant dans la même langue qu'ils me parlaient, c'est-à-dire, dans la langue chilienne. Votre pays est-il riche, me demandèrent-ils ? Non, leur répartis-je, et vous voyez en moi un exemple de sa pauvreté. Une tempête imprévue m'a jeté malheureusement sur ces côtes, et je cherche le moyen de pouvoir retourner dans mon pays. Je voulus alors continuer mon chemin, mais le chef de ces Espagnols m'ayant arrêté, me parla ainsi : Étranger, votre figure me plaît ; venez chez moi, je vous y donnerai un emploi honnête, et quand vous jugerez à propos d'aller revoir votre patrie, la récompense de vos services surpassera votre attente. Cette proposition me fit pâlir, et je craignis que cette promesse n'aboutît à me dévouer aux mines. L'Espagnol s'apercevant de mon trouble, me dit: Ne craignez rien ; oubliez ce que les naturels de ce pays vous ont pu dire à notre désavantage ; si vous vous fiez à ma parole, je n'omettrai rien pour vous rendre heureux ; si j'avais dessein d'attenter sur votre liberté, je pourrais vous contraindre à me suivre ; mais je me contente de vous y inviter.
Ce discours honnête me gagna, et malgré mes préjugés je crus devoir risquer ma liberté et ma vie, et les sacrifier à l'espérance d'acquérir de l'or. Je m'imaginai que si l'Espagnol me tenait sa parole, je serais bientôt en état de mériter Amenosa. Je fis donc une humble révérence à Don Fernandez de la Chirade — c'était le nom de l'Espagnol — pour lui faire connaître que j'acceptais ses offres. Aussitôt il ordonna à un des domestiques de sa suite de me donner son cheval.
Sur le soir nous arrivâmes à son logis. C'était une maison magnifique, située sur les bords de la mer. D'un côté on découvrait une vaste prairie couverte d'un tapis vert toujours renaissant, et environnée de collines couronnées d'arbres. De l'autre, on voyait la mer en perspective, quelquefois élevant ses flots agités jusqu'aux nues, mais le plus souvent calme et unie. La magnificence éclatait de toutes parts dans cette maison superbe. L'or y brillait dans tous les appartements : les moindres choses étaient de ce métal divin.
Mon nouveau maître — car, sans être son esclave, j'étais à lui — me traitant avec distinction, me fit asseoir à sa table. Mais ayant vu qu'on l'avait couverte de viandes de différente espèce, je m'en éloignai, et ne voulus point manger. Je demandai à Fernandez la permission de vivre dans sa maison, selon la coutume de mon pays, et de m'abstenir de manger de la chair des animaux. Il me le permit ; et j'allai aussitôt cueillir dans le jardin des légumes, des racines et des herbes, que j'assaisonnai et mangeai devant lui. Après le repas, il me prit en particulier, et me dit que comme aucun des Espagnols qui le servaient, ne savait la langue chilienne, il était bien aisé de m'avoir auprès de lui, aimant mieux se fier à moi, qu'aux naturels, qui conservaient toujours de la haine et ressentiment contre sa nation ; que ceux de ces naturels qui étaient à son service, ne cherchaient qu'à le trahir et à lui nuire ; que persuadé que je n'avais pas les mêmes motifs de le haïr, il me donnait une inspection générale sur leur conduite, et qu'il espérait que mon zèle et ma fidélité le garantiraient de tous leurs complots ; que comme je parlais leur langue, je pourrais m'insinuer dans leur esprit, découvrir leurs desseins, et les contenir dans leur devoir. Je lui promis de me comporter en homme d'honneur et de lui être fidèle, et je lui tins paroles, de manière que je gagnai entièrement son amitié et sa confiance.
Outre l'inspection que j'avais sur tous les naturels qui étaient à son service, la garde de ses trésors m'était encore confiée. J'étais heureux, si on peut l'être, éloigné d'une beauté qu'on adore et d'une patrie qu'on regrette. J'avais d'ailleurs tous les jours devant les yeux le spectacle le plus triste pour un cœur Letalispon : je veux dire, que je voyais Fernandez et les autres Espagnols tuer sans pitié les bêtes les plus aimables et les manger inhumainement. Je tâchais quelquefois par mes prières d'empêcher le meurtre de quelque animal ; mais au lieu de m'écouter on se moquait de moi. L'amour seul, auteur du désir que j'avais à acquérir de l'or, était capable de me faire rester parmi eux. Mais par un événement singulier et inattendu le Ciel me rendit à ma patrie et couronna mon amour, comme je vais vous le dire.
Quelques canoteurs de mon pays avaient trouvé sur les côtes de leur île le corps de Hasco que la mer y avait jeté. Ils l'avaient considéré, et comme il me ressemblait assez de visage, qu'il était à peu près de mon âge et de ma taille, que d'ailleurs j'étais beaucoup plus connu que lui, et que mon départ avait fait du bruit, ils avaient pris le corps défiguré de mon ami pour le mien. Le bruit de ma mort fut aussitôt répandu dans toute notre île. Ma mère qui m'aimait tendrement l'apprit avec une extrême douleur ; et étant allée chez le père d'Amenosa, elle l'accabla de reproches, et l'accusa d'être l'auteur de ma mort. Il ne répondit rien à tout ce qu'elle put lui dire ; il témoigna seulement beaucoup de regret de la perte qu'elle avait faite, et tâcha de la consoler.
Mais dès qu'Amenosa eut appris mon sort, elle s'enferma seule dans sa chambre, et voulut se donner la mort. La faiblesse attachée à son sexe arrêta heureusement son bras timide prêt à percer son sein. On enfonça la porte de sa chambre pour prévenir les funestes conseils de son désespoir, et on lui arracha son poignard ; mais on ne put lui arracher sa douleur, dont son père, qui l'aimait très tendrement, était aussi pénétré qu'elle. Tu n'es plus, cher Taïfaco, disait-elle avec transport, la dureté de mon père et la tendresse de ton cœur ont causé ta mort : elles causeront aussi la mienne, je te suivrai. Puisse mon âme, après mon trépas, se trouver sans le même séjour que la tienne, et animer un corps de la même espèce que celui qu'il anime en ce moment. Le Ciel équitable ne permettra pas que nous soyons à jamais séparés l'un de l'autre ; il nous réunira, pour récompenser ton courage et ma fidélité.
Après avoir ainsi donné un libre cours à sa douleur, elle demeura quelque temps ensevelie dans une profonde tristesse, sans prononcer aucune parole. Cependant elle trompa son père et tous ceux qui l'observaient. Affectant dans la suite un air moins affligé, elle fit entendre qu'elle pourrait avec le temps se consoler de ma mort. Son père la crut, et ne prit aucunes précautions contre son désespoir, qui éclata de cette manière. Après avoir quelque temps délibéré sur le genre de mort qu'elle devait choisir, elle préféra celui de se précipiter dans la mer, où elle croyait que j'avais fini mes jours. Elle se dérobe adroitement, et courte seule vers le rivage, pour y exécuter son funeste dessein. Mais l'image de la mort qu'elle se propose, la fait reculer. Quoi, dit-elle, mon esprit timide combat la généreuse résolution de mon cœur ! Ah ! je vais le contraindre à lui céder la victoire, en lui cachant les horreurs d'une mort qui l'effraie. Elle court aussitôt vers un canot qui était au bord de la mer ; elle y entrer sans hésiter, et coupe hardiment la corde qui l'attachait au rivage ; elle prend une rame pour s'éloigner du bord, et lève la voile. Alors, les yeux baignés de larmes, elle se couvre la tête et se couche dans le canot, qu'elle abandonne aux flots, craignant et désirant également la mort.
Le vent soufflait fort d'ouest-sud-ouest et était très favorable pour aller au Chili. Le canot après avoir vogué heureusement pendant vingt-huit heures, et avoir cinglé aussi directement, que s'il eût été conduit par un habile canoteur, fut rencontré le lendemain par une femme du Chili qui pêchait, et qui s'était avancée à trois ou quatre lieues en pleine mer. Surprise de voir un canot faire voile, sans être conduit, et sans qu'aucune personne parut être dedans, elle rama du côté de ce canot, s'en approcha, et fut bien plus étonnée encore d'y apercevait une jeune fille évanouie et à demie morte. Elle entra dans le canot, prit cette fille entre ses bras, et tâcha de la rappeler à la vie. Amenosa revenue de son évanouissement la regarda fixement, prononça mon nom, puis referma les yeux. J'ai su tout ce détail en partie d'Amenosa elle-même, et en partie de cette femme qui l'avait rencontrée, et qui ayant attaché son canot au sien, la conduisit dans sa maison située sur le rivage, et peu éloignée de la nôtre.
Elle me connaissait depuis longtemps, parce que son mari était chasseur de profession, et que j'allais souvent chez lui pour tâcher de racheter la vie aux animaux qu'il prenait avec les filets. Je me rendis par hasard dans sa maison, quelques heures après qu'Amenosa y eût été transportée. Ciel ! quelle fut ma surprise, lorsque je reconnus ma chère maîtresse. Jamais je n'éprouvai de sentiments pareils ; je sentais une joie mêlée de crainte et de douleur. J'étais charmé de la retrouver ; mais le triste était où je la voyais réduite, m'alarmait beaucoup plus que sa présence ne me ravissait. C'est donc vous, lui dis-je, adorable Amenosa. Quel destin vous a conduit sur ce rivage ? Hélas dans quel état êtes-vous !
Amenosa frappée vivement par le son de ma voix qu'elle reconnut, ouvrit ses beaux yeux éteints et me regardant avec une surprise égale à sa faiblesse : est-il bien vrai, dit-elle, cher Taïfaco, que mes yeux vous revoient ? Oui, lui répondis-je, c'est votre tendre et fidèle amant : rassurez-vous, et cessez de vous troubler. Daignez plutôt prendre quelque nourriture pour rétablir vos forces. Ma présence sembla la ranimer. Une douce joie se répandant sur son visage en diminua la pâleur. On croit, dit-elle, dans île, que vous n'êtes plus, et que vous avez été englouti par les flots. Que je suis heureuse de vous retrouver, lorsque je ne songeais qu'à mourir pour vous suivre ! C'est ce qui m'a fait exposer ma vie à la merci des flots et des vents, pour être ensevelie dans les ondes avec vous.
Quoique mon amour m'eût semblé être jusque-là au suprême degré, j'en sentis encore croître l'ardeur. Je remerciai le Ciel de m'avoir si heureusement conservé l'objet de tous mes vœux, et je priai instamment l'hôtesse d'avoir un soin extrême d'étrangère qui était chez elle ; je lui recommandai un profond secret, et lui promis une récompense digne de ses soins.
Amenosa rétablit sa santé en peu de jours, et j'aurais été au comble de mes vœux, si j'avais eu la liberté de retourner avec elle dans mon pays. Mais mon état, mon devoir, et les bienfaits dont l'Espagnol m'avait comblé, étaient des chaînes qu'il m'était difficile de rompre. J'avais au moins la consolation de voir tous les jours librement mon aimable maîtresse, et je l'aurais dès lors épousée, si, selon nos lois, le mariage contraire à la volonté des parents eût été permis.
Mais sur ces entrefaites, Don Fernandez tomba malade dangereusement. Connaissent que sa fin était proche et qu'il ne pouvait réchapper, il se disposa à la mort conformément aux principes de sa religion, et récompensa tous ses domestiques. Comme j'étais un de ceux qu'il aimait le plus, il me donna cent livres d'or pur avec trois mille livres d'argent quinté, et me fit encore quelques présents, en me priant de me souvenir de lui. Il mourut regretté de tous les Espagnols et de tous les Chiliens qui connaissent sa vertu. Heureuse contrée, si tous ceux de sa nation lui eussent ressemblé !
Alors je songeai à retourner dans mon pays et à y conduire ma chère Amenosa, persuadé que son père à la vue d'une fille unique que je lui rendrais, et des riches dont il me verrait possesseur, ne pourrait me la refuser. Je fis donc une provision de fruits, d'herbes et de racines, que je fis cuire, et après avoir remercié l'hôte et l'hôtesse d'Amenosa, et avoir payé leurs soins, nous nous embarquâmes l'un et l'autre dans un grand canot que nous avions fait construire exprès. Je prie deux habiles canoteurs pour nous conduire plus sûrement ; et je priai l'hôtesse, en lui promettant une récompense, de vouloir bien la bienséance accompagner Amenosa dans le voyage ; je l'assurai que le même canot la ramènerait chez elle dans peu de jours ; elle y consentit, et nous nous disposâmes à partir.
Lorsque nous étions sur le point de quitter le rivage, nous vîmes de loin accourir des Espagnols, qui nous firent signe de les attendre. Comme nous ignorions leurs desseins, et que nous soupçonnions qu'ils voulaient peut-être s'emparer de l'or et de l'argent que nous emportions, nous ne jugeâmes pas à propos d'obéir. Alors ils tirent quelques coups de fusil ; mais nous étions trop éloignés d'eux, pour que leurs balles pussent nous atteindre. Une lionne furieuse qui parut en même temps les obligea de prendre la fuite. Cependant nous coupâmes promptement la corde dont le canot était amarré, et nous nous hâtâmes de nous éloigner du rivage. La lionne accourut, pressée d'une faim dévorante, elle nous poursuivit dans la mer et se mit à la nage. Elle était prête de s'élancer dans notre canot, lorsque je lui déchargeai de toute ma force sur la tête un coup de rame qui la fit plonger ; mes deux canoteurs réitérèrent, et nous la frappâmes avec tant d'ardeur, de force et d'adresse, qu'elle s'enfonça entièrement dans l'eau et disparut. Amenosa armée d'une rame nous avait aidé à la repousser, et avait eu part à notre victoire.
Notre voyage fut heureux. Comme la mer était extrêmement calme, nous ne pûmes mettre à la voile, et nous fûmes obligés de ramer toujours ; ce qui fit que nous fûmes cinq jours sur la mer. Enfin nous revîmes notre chère patrie, et je conduisis d'abord Amenosa chez ma mère, qui nous reçut l'un et l'autre avec autant de joie que d'étonnement. Quoi, me dit-elle en m'embrassant, vous respirez encore mon cher fils ! Que vous m'avez coûté de larmes et de soupirs ! Votre heureux retour me rend la vie en m'assurant que vous vivez : et vous, charmante Amenosa, allez jouir des tendres embrassements d'un père qui vous pleure encore. Vous nous racontez dans la suite l'un et l'autre par quel heureux destin nous avons la consolation de vous revoir.
Ma mère conduisit le lendemain Amenosa chez son père. Mais je voulus auparavant l'aller trouver. Dès qu'il m'aperçut, il s'écria : est-ce vous Taïfaco, ou votre ombre irritée vient-elle pour me tourmenter ? J'ai expié mon crime par la perte de ma fille que j'ai refusée à vos vertus. Elle s'est elle-même précipitée dans les flots, où vous avez péri ; ce cruel souvenir me déchire assez, sans y ajouter de nouvelles peines ; coupable estime de la richesse, tu causes tous mes maux ! père infortuné ! tu n'as plus de fille, et il te reste des trésors. C'est ainsi que ma présence réveilla sa douleur et augmenta ses transports. Je tâchai de les calmer, en lui disant : je suis ce Taïfaco que l'on a cri enseveli dans les eaux, et dont vous vous reprochez la mort. Je respire, et votre fille aussi ; voyez si vous voulez qu'elle vive pour moi. À ces mots il m'embrassa d'un air transporté, et m'assura que nul autre que moi ne la possédait. Je lui rencontrai alors tout ce qui m'était arrivé sur la mer, la fortune que j'avais faite au Chili, comment sa fille y avait heureusement abordée, et comment je l'avais ramenée dans la compagnie d'une femme du pays.
Il était au comble de sa joie, et mourait d'impatience de revoir Amenosa : ma mère l'amena. D'abord elle se jeta aux genoux de son père, et lui demanda pardon de la douleur qu'elle lui avait causée. Il l'embrassa avec transport ; et après avoir versé un torrent de larmes, il lui demanda pardon à son tour des périls, où il l'avait en quelque sort lui-même exposée, en s'opposant à ses innocents désirs. Alors il prit nos mains à l'un et à l'autre, et nous fit embrasser en présence de témoins ; et ma mère en ayant fait autant, nous fûmes mariés dès ce moment, selon la coutume de cette île, où il n'y a point d'autre cérémonie pour la célébration des mariages.
Je vis avec Amenosa depuis soixante-neuf ans, ajouta-t-il, et jamais rien n'a altéré notre union. Mon bien joint à celui de son père, avec qui nous demeurons, a rendu notre maison une des plus riches et des plus florissantes de ce pays. Voilà quel fut le motif et le succès de mon voyage au Chili, où la pauvreté et le désespoir me conduisirent, et d'où je revins riche et heureux.
CHAPITRE 8. — L'Auteur s'étant mis dans un canot avec son compagnon, pour pêcher, rencontre un vaisseau français, sur lequel ils montent l'un et l'autre, pour retourner en Europe.
Depuis environ trois mois que je demeurais chez les Letalispons, sans parler de l'ennui dont il est toujours difficile de se défendre dans une terre étrangère, lorsqu'on ignore la langue des habitants, je me sentais pressé d'un désir violent de revoir ma chère patrie. D'ailleurs, Silva et moi, ne pouvions nous accoutumer aux légumes qui faisaient notre seule et continuelle nourriture ; et quoiqu'ils fussent apprêtés délicatement, nous en étions extrêmement dégoûtés.
Nous dîmes donc un jour à Taïfaco, que la vie que nous menions dans son pays, était trop austère par rapport à la nourriture ; que les moines et les ermites d'Europe, qui étaient de saints personnages, faisant profession de ne jamais manger de viande, mangeaient au moins du poisson ; que comme les poissons ne vivaient point dans le même élément que les hommes, qu'ils n'avaient aucun commerce avec eux, et qu'ils n'étaient point, à propre parler, habitants de la terre, il semblait que c'était une charité superflue, que de les épargner ; que si nous continuions de vivre à la manière des Letalispons, nous mourrions bientôt, parce que nous n'étions point accoutumés dès l'enfance à ce genre de vie.
Je serais au désespoir, nous répondit Taïfaco, que nos légumes si salutaires pour nous, vous fussent nuisibles. Vous mettez avec raison de la différence entre les animaux qui peuplent la terre, et ceux qui peuplent la terre et les fleuves. Quoique ceux-ci aient une âme, et soient, comme nous, l'ouvrage du Créateur, néanmoins ils ne sont point nos frères, comme les autres ; ils ne respirent point le même air, nous n'avons avec eux aucune société. Pour cette raison nous ne regardons pas absolument comme un grande crime de les tuer et de les manger. Cependant peu de personnes le sont parmi nous, soit par une espèce de scrupule, soit parce que cette nourriture ne nous paraît pas saine. Mais puisque vos corps sont d'une autre constitution que les nôtres, et que vous ne pouvez accoutumer à vivre comme nous, je ne trouve point mauvais que vous pêchiez du poisson, et que vous vous en nourrissiez. J'ai ici un canot dont nous nous servons quelquefois pour nous promener sur la mer dans un temps calme : vous pouvez le prendre ; et si vous avez l'industrie de faire des filets et de vous en servir, vous irez dans une petite baie peu éloignée d'ici, où vous trouverez beaucoup de poisson. Mais lorsque vous pêcherez, éloignez-vous du rivage le plus qui vous sera possible, de peur que quelqu'un ne vous voie, et ne soit scandalisé de votre action.
Nous remerciâmes Taïfaco de la bonté qu'il nous témoignait, et de la condescendance qu'il voulait bien avoir pour notre faiblesse. Dès le lendemain de grand matin, Silva et moi, nous mîmes sur nos épaules le canot, qui étant d'une seule écorce, était très léger, avec une voile et des rames ; et ayant pris le chemin de la baie, nous y arrivâmes dans être beaucoup fatigués. Nous avons fait la veille un épervier avec de la ficelle, que Taïfaco avait eu la bonté de nous donner. Suivant ce qu'il nous avait recommandé, nous nous éloignâmes beaucoup du rivage ; et comme le vent était favorable, pour nous épargner la peine de ramer, nous haussâmes la voile, qui était proportionnée à la petitesse du canot ; et avec ce secours nous nous éloignâmes du rivage, environ quatre lieues, et sortîmes même de la baie.
Lorsque nous étions prêts de lancer notre épervier, nous aperçûmes un gros vaisseau, qui était éloigné de plus de trois lieues. Ayant l'œil plus marin que Silva, je le lui fis remarquer, et lui dis en même temps, que puisque le Ciel nous fournissait peut-être une occasion favorable pour retourner en Europe, il fallait en profiter. Comme nous avions nos fusils, nous nous mîmes à tirer tous deux ensemble, pour faire un plus grand bruit, et avertir le vaisseau que nous voulions aller à bord. Cependant ayant ajusté notre gouvernail et notre voile, nous prîmes un quart de vent, et cinglâmes du côté du navire. Nous ne cessions de tirer, pour faire connaître notre intention ; aussi nous remarquâmes que le vaisseau avoir compris notre signal, car nous le vîmes tourner un peu sur la gauche, et s'approcher de nous, en sorte qu'au bout d'une heure nous en fûmes assez près, et que nous pûmes reconnaître à son pavillon qu'il était français.
J'avais quelques remords de quitter ainsi l'île des Letalispons, sans avoir dit adieu à Taïfaco. Il croira, dis-je alors, que nous serons péris, et il en sera affligé. Mais que faire ? Manquerons-nous une occasion si heureuse ? Silva s'avisa alors d'un expédient ; il me dit que lorsque nous serions prêts à entrer dans le vaisseau, il fallait tourner la voile, et ajuster le gouvernail, de manière que le canot put s'en retourner tout seul dans la baie, d'où nous étions pas fort éloignés ; que le vent avait changé, et qu'il était favorable pour le retour dans l'île, que cela étant nous ne risquerions rien d'écrire un billet à Taïfaco pour le remercier de ses bontés, et l'instruire de notre départ ; que comme il ne manquerait pas le lendemain d'envoyer nous chercher dans la baie, on y trouverait le canot avec la lettre que nous y aurions laissée. Je trouvais l'avis de Silva fort sensé, et comme j'avais sur moi une écritoire et du papier, je m'assis et écrivis cette lettre, pendant que Silva ramait vers le vaisseau.
À l'illustre et vertueux Taïfaco.
«Le désir de revoir notre patrie, cher Taïfaco, nous oblige de vous quitter, et de profiter de la rencontre heureuse d'un vaisseau européen sur lequel nous allons monter. Nous voudrions qu'il nous fût permis de retourner à terre, pour vous remercier de tant de bontés que vous nous avez témoignées. Mais nous ne savons si le vaisseau où nous nous préparons à entrer voudra nous le permettre. En tout cas, nous souhaitons que cette lettre parvienne jusqu'à vous, et que les mesures que nous avons prises pour cela réussissent. Soyez persuadé que nous conserverons toujours le précieux souvenir des bienfaits dont vous nous avez comblés. Nous publierons par toute la terre que l'île des Letalispons est l'île de la sagesse et de la vertu.»
Jean Gulliver. François Silva.
Nous mîmes cette lettre dans un endroit où elle put être aisément trouvée, sans qu'elle courut risque d'être emportée par le vent. Cependant après avoir tourné notre gouvernail et notre voile, nous quittâmes notre canot, et entrâmes dans un de ceux du vaisseau, où nous montâmes bientôt après. On peut juger que nous y fûmes bien reçus ; la nation française étant extrêmement polie et obligeante à l'égard des étrangers. Nous allâmes d'abord saluer le capitaine, à qui nous dîmes notre nom et notre pays, et à qui je racontai ensuite le malheur qui nous avait retenu plus de six mois dans l'île des Letalispons. Le capitaine nous dit qu'il retournait en droiture à Saint-Malo, d'où il était parti, depuis dix-huit mois ; et que nous trouverions aisément dans ce port des occasions de nous embarquer, l'un pour le Portugal, et l'autre pour l'Angleterre.
Nous comprîmes que le vaisseau avait fait le commerce de la mer du Sud en interlope, ce qui m'engagea à demander au capitaine, s'il n'avait point eu de nouvelles d'un vaisseau hollandais, nommé le Vulcain. Il me répondit qu'il était parti un mois avant lui du port de Coquimbo, et qu'il avait fait une assez bonne cargaison. Je lui demandai encore, s'il n'avait pas connu sur ce bord un Anglais nommé Harrington ; il m'en fit de grands éloges, et m'assura qu'il était parti en parfaite santé sur le Vulcain pour retourner en Europe. Ce qui me fit un extrême plaisir, et redoubla le désir que j'avais, de revoir l'Angleterre où j'espérais le retrouver.
Les Français n'ajoutent pas foi aisément aux choses extraordinaires et merveilleuses, non plus que nous autres Anglais ; et ce fut en quelque sorte malgré moi, que je me vis dans la nécessité de raconter aux officiers et aux principales personnes de l'équipage les aventures incroyables que j'avais eues. Silva, à qui je les avais dites assez en détail, et qui connaissait ma sincérité, ne doutant pas qu'elles ne fussent vraies, en avait parlé au capitaine, et à quelques autres officiers ; en sorte que je me vis pressé vivement de les leur raconter moi-même. Je passai d'abord pour un visionnaire, et peut-être pour un menteur. Mais lorsque l'on m'eut un peu plus connu, et qu'on eut vu clairement que je n'avais l'esprit ni faible ni égaré, et que j'étais extrêmement ami de la vérité, on commença à en juger autrement. On m'avait écouté d'abord par amusement, on m'écouta ensuite par curiosité ; une conviction mêlée d'étonnement succéda à l'incrédulité, surtout lorsque je leur eus dit, qu'Harrington, qu'ils avaient connu à Coquimbo, comme un homme très sage et très digne de foi, avait été témoin de mon aventure dans l'île de Babilary. Ils firent au sujet du gouvernement des femmes, qui leur parut ridicule, une infinité de plaisanteries, qui coûtent toujours fort peu aux Français ; et comme en parlant de ce qui m'était arrivé dans cette île, j'étais obligé de supposer qu'on m'avait trouvé beau garçon, comme je l'ai aussi supposé dans cette relation, je fus extrêmement raillé sur cet article. J'avoue qu'ils avaient raison ; cependant ce qu'on dit à son avantage ne doit choquer personne, lorsqu'un pareil aveu est ingénu, et n'est dicté ni par l'orgueil, ni par le mensonge.
Comme je n'avais eu aucunes aventures depuis mon départ d'Angleterre jusqu'à la mer de la Chine, ainsi que je l'ai dit au commencement de cet ouvrage, je n'en eus aucunes non plus dans mon retour en Europe. Pour me désennuyer sur le vaisseau, n'ayant point d'argent pour jouer, je mis à écrire une relation de mon voyage dans ma langue. Un Français avec qui je m'étais lié d'amitié, et qui entendait assez bien l'Anglais, entreprit de la traduire de mon consentement. Comme il n'avait pas plus d'argent que moi, il trouva aussi dans ce travail un remède contre l'ennui. Lorsque nous eûmes l'un et l'autre achevé notre ouvrage, il me demanda la permission de le publier dans son pays, lorsqu'il serait arrivé à Paris, et j'y consentis. Nous arrivâmes à Saint-Malo le huitième novembre 1720, et j'en partis le vingt pour me rendre à Portsmouth.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
* C'est un proverbe espagnol : La sciencia por lo sangre entra¹, c'est-à-dire, «La science entre par le sang». [¹ À proprement parler, La letra por la sangre entra ; cela signifie en réalité «Le savoir entre par le sang», et donc une allusion à l'enseignant, la règle à la main, devant l'élève...]
Fin du dernier chapitre.
[Notes]
1. Desfontaines, P.-F. Guyot, Le Nouveau Gulliver ou Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver, Paris, Clouzier et Le Breton, tome I et tome II, 1730.
2a. Lexique, partie 2 : Quang-Cheu, aujourd'hui Guangzhou (Canton) ; rondache, ancien bouclier circulaire employé par les hommes à pied ; sagamité, mets quotidien chez les Amérindiens, faite de grains de maïs séchés, broyés et cuits avec de la viande ou du poisson ; Terre de San Gabriel, peuplée au départ par les Amérindiens de la tribu des Hahamogna, une branche des Tongva (en 1542, ceux-ci dirigèrent leurs remarquables canoës en état de naviguer, dits Ti'ats, pour rencontrer Juan Rodriguez Cabrillo, explorateur portugais au service de l'Espagne, au large de l'actuel San Pedro en Californie.)
2b. Lexique, partie 3 : Royaume d'Achem, actuellement la province d'Aceh, au nord de l'île de Sumatra en Indonésie ; castine, espèce de calcaire brut qu'on mêle avec le mineral de fer pour en faciliter la fusion, en absorbant les acides du soufre ; contre-maître, celui qui exécute les ordres du capitaine et est plus particulièrement chargé de l'arrimage du vaisseau et d'en prendre soin pendant la campagne ; éclanche, gigot ou cuisse ; faussonnier, contrebandier de sel ; fentes, gerçures qui accompagnent souvent les filons métalliques ; heusse, espèce de la cheville de fer plat ; kermès, préparation d'antimoine d'un grand usage en médecine qu'on l'appelle communément «Poudre des Chartreux» ; polychreste, remède pour plusieurs maladies (cf., thériaque) ; sarbacane, pour une autre référence littéraire de cet usage précis de celle-ci, voir Michel de Montaigne (1533-1592), Essais, I, XXIII, «De la coutume et de ne changer aisément une loy receüe», 1580 ; scammonné, nom commun d'un liseron (Convolvulus scammonia) ; stramonium, espèce de la famille Solanaceae (le stramonium est un des poisons narcotiques les plus dangereux) ; tithymale, espèce de la famille Euphorbiaceae (e.g., Euphorbia cyparissias ou euphorbe petit-cyprès)
2c. Lexique, partie 4 : Ancud et le cap de Quemchi sont l'un et l'autre en l'île de Chiloé ; applaudisseur, celui qui applaudit sans discernement ; calotin, en ce contexte-ci, fanatique — ou fanatick en l'orthographe anglaise de jadis — est l'équivalent précis de Maggot-headed à cette époque (à propos, tout au long ce chapitre, Desfontaines n'emploie point le substantif masculin «Cérébellite» en le sens actuel du terme, où une cérébellite est une inflammation du cervelet) ; lionne, en ce contexte-ci, le puma femelle (Felis concolor).
3. Voici une carte du Chili :
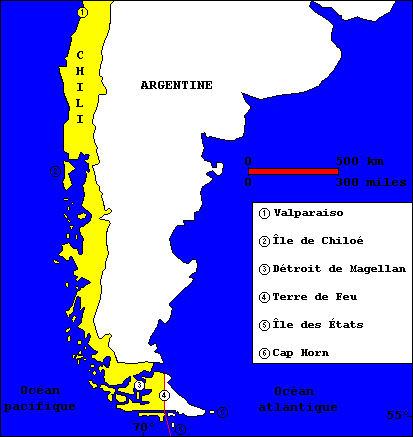
4. Transcription par Dr Roger Peters [Home Page (en anglais)].
[Juin 2006]