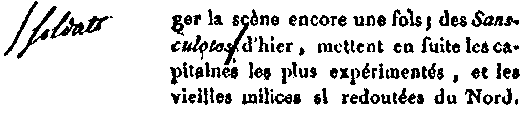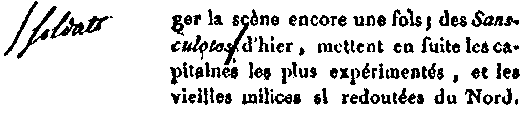DISCOURS
Destiné à être prononcé au temple de la raison, et qui l'a été
à la société populaire et républicaine de Dijon, par un de ses
membres, le 15 pluviôse, l'an second de la république.
___________________________________________________
»Peut-être qu'après tout ces croyances publiques
»Ne sont qu'inventions de sages politiques,
»Pour contenir un peuple ou bien pour l'émouvoir,
»Et dessus sa faiblesse affermir la pouvoir.
C'est ainsi que l'un de nos plus grands poètes, le grand Corneille, parlait dans une
de ses meilleures tragédies (Polyeucte, acte 4, scène 6) ; et le gouvernement,
intéressé à maintenir l'ignorance et la stupidité des peuples, le gouvernement, excité et
conduit par les prêtres, ennemis de tout génie hardi, fit supprimer ces vers
qui pouvaient être commentés, et faire dévoiler le mystère de l'oppression sociale.
Aujourd'hui la liberté triomphante parmi nous, tourne ses yeux sur la
superstition qui avait rivé les chaînes des nations ; aujourd'hui la liberté,
compagne de la raison, rapporte tout à la clarté pure de ce flambeau si longtemps obscurci.
Ne croyez pas, citoyens, qu'en détestant les cultes qui ont fait tant de mal à
la terre, le but des révolutionnaires de nos jours soit d'anéantir toute morale,
ni de donner atteinte à l'idée sublime et vrai sans doute de l'existence d'un
Dieu rémunérateur et vengeur.
Non, citoyens, ce n'est pas cela : nos faibles lumières seront toujours
confondues de la majesté de cet étonnant univers dans lequel l'astre où nous
sommes perdus, se perd lui-même au milieu de l'infini des autres astres, de
l'infini des espaces, des grandeurs et du temps.
Quoi que l'on puisse dire de quelques défectuosités physiques et morales qui se
font remarquer dans ce séjour qui nous est abandonné, il faudrait connaître
l'ensemble pour conclure ; et il ne nous est donné de voir qu'une imperceptible
partie du grand tout.
Quoi que puissent dire enfin les partisans de la force aveugle et du hasard, ce
monde parlera toujours plus haut qu'eux, et sa magnificence remuera toujours
plus puissamment les cœurs ; l'admiration suivra toujours l'examen des savants
livrés à l'étude de la nature. On dira toujours que ces corps d'inégale
grandeur, et qui est telle dans plusieurs, qu'elle effraie l'imagination, ne se
sont point faits eux-mêmes, ni n'ont point déterminé leur marche régulière et
toujours la même ; que l'harmonie, les convenances qu'on y découvre,
l'attention la plus soigneuse de la conservation des êtres et des végétaux
qu'ils renferment ; que tout cela, dis-je, indique une intelligence existante,
mais qui se cache, une volonté puissante qui a présidé à tout, dirigé tout,
combiné tout.
Ainsi donc, nous sommes bien loin de combattre l'existence d'un Être suprême ;
nous ne poursuivons cependant pas celui qui nierait cette existence, parce
qu'enfin, ni le pour ni le contre n'est démontrable mathématiquement. Les
athées, comme je l'ai dit, seront toujours très rares : qu'importe à la société
leur erreur ? Ce qu'il lui importe, c'est que tous soient bons, justes,
honnêtes, qu'ils concourent tous au bien commun.
Nous n'attaquons point la croyance d'un Dieu, mais nous disons que la morale
peut se passer de cette croyance, et se renforce par cette croyance ; que la
morale n'a point sa base dans les religions, mais dans les rapports essentiels des
hommes les uns avec les autres, puisqu'ils sont faits pour vivre ensemble, dans
le bien que l'on fait à ses semblables enfin, dans l'amour de l'ordre établi
par l'Être suprême, ou par la nature, c'est-à-dire l'arrangement
nécessaire des choses, suivant le langage des athées ; mais je laisse à part
encore fois ceux-là, et je n'entends parler ici qu'aux sectateurs du dogme de la
divinité.
Qu'est ce que ce monde ?... Pourquoi est-il fait ?... Quel est le but de
l'ouvrage ?... Nous n'en savons rien ; personne ne peut nous le dire.
Qui sommes-nous nous-mêmes ?... À quoi sommes-nous destinés ?... Y a-t-il
pour nous une autre vie après celle-ci ?... Sommes-nous un composé de
substance périssable et d'esprit immortel ?... Le même voile impénétrable
enveloppe ces questions.
Voici ce que dit la raison.
Jetés ici sans savoir comment, et de la même manière que les herbes et les
plants ; succédant à d'autres hommes comme les plantes d'aujourd'hui à d'autres
plantes, nos prédécesseurs n'en ont pas su plus que nous, et nos successeurs
n'en sauront pas davantage.
Ce dont nous sommes sûrs, c'est de cette vie.
Certains de ce que nous voyons et sentons tous, c'est-à-dire, que nous
naissons, passons de l'enfance à l'âge mûr, de l'âge viril à la vieillesse, et
de la vieillesse à la mort; incertains si ces facultés intellectuelles que nous
appelons âme, survivent à notre corps que nous voyons périr, il est clair que
notre principale destination, si ce n'est l'unique, est ce monde ; qu'ils nous
trompent, ceux qui nous disent que cette vie-ci n'est rien. Nous devons y
chercher et y trouver notre bonheur ; et comme chacun de nous y a droit
également, la réflexion nous démontrera bientôt que ne pouvant vivre isolément,
ne pouvant nous conserver seuls, attendu notre faiblesse individuelle, et appelés par
notre nature à vivre en société dans laquelle nous nous trouvons tous en
naissant, de laquelle nous ne pouvons nous séparer totalement ; c'est dans le bonheur
commun que chacun de nous doit trouver le sien ; que celui-là seul est heureux,
qui vit juste dans une société bien réglée ; que celui-là seul est vertueux,
qui préfère le bien de cette société au sien propre : tandis que l'homme qui
rapporte tout à lui, qui opprime et dépouille ses frères, est un monstre qu'il
faut détruire.
Notre simple qualité d'hommes sensibles, mortels et raisonnables, nous conduit
à cette conséquence.
Voyons si le dogme de l'existence d'un Dieu peut induire autre chose, et nous
commander d'autres devoirs.
S'il y a un Dieu, comme nous l'ayons admis, il ne s'est montré à personne ; il
n'a parlé à personne ; nul ne sait son secret. Quiconque s'annonce pour le
confident de la divinité, est un fourbe ; elle se fût communiquée à tous, si
elle eût voulu le faire, et n'eût pas pris l'intermédiaire tromper d'un homme ;
quand il s'agissait d'une vérité sur laquelle aucun ne devait jamais concevoir
de doute.
Comment a-t-il parlé aux hommes ? Non autrement que par la grandeur et
l'immensité de ses œuvres. Son soleil les éblouit tous, en même temps qu'il
vivifie, qu'il anime, qu'il réjouit toute la nature. Nul n'en peut soutenir
l'éclat inexprimable, et un aveuglement soudain punit celui qui entreprend de
le fixer un seul instant, comme pour faire entendre aux hommes que leur vue ne
doit point aller chercher le ciel, mais, qu'ils doivent se tenir à leur place,
et cultiver, peupler la terre qui est leur partage.
Telle est la leçon que nous donne le grande Être.
C'est par la nécessite qu'il nous instruit, par les affections qu'il nous
donnait. La terre n'obéit qu'aux soins assidus qu'on y prend : donc il nous a
destinés au travail. Nous somme sensibles à la pitié envers nos semblables :
donc il veut que nous soyons humains. Il veut que la terre soit peuplée, aussi
y a-t-il un puissant attrait l'acte qui renouvelle l'espèce. Il est l'auteur de
tout ordre : donc tout ce qui trouble cet ordre blesse ses lois : donc celui
qui contribue à cet ordre, au maintien de l'harmonie, de la concorde, de la
paix, de la fraternité parmi les hommes, qui punit les tyrans, sert bien Dieu.
Ainsi l'homme le plus juste envers ses semblables, est aussi le meilleur aux
yeux de l'Être suprême. Remplir ses devoirs de citoyen, d'enfant, de père,
d'époux, d'ami, est donc être bon devant Dieu, qui n'ayant rien dit à l'homme,
ne peut exiger de lui que le bon emploie de ses facultés, la conservation, la
prospérité de la race humaine.
Oui, le bonheur des hommes, et leur bonheur dès cette vie, autant qu'il est
possible, est sans contredit le vœu de leur auteur : car il implique de donner
des biens, et de ne pas vouloir qu'on en use ; d'accorder les moyens, et
d'interdire l'emploi.
Que faut-il faire pour parvenir à ce bonheur dont la condition humaine est
susceptible ? Précisément ce qui nous avons fait : rappeler tout à la liberté,
à l'égalité primitives ; rendre à chacun les droits inhérents à sa qualité
d'homme ; faire cesser les oppressions qui tenait l'homme captif, humilié,
écrasé sous l'homme ; lui apprendre à se servir de sa raison, à examiner ce
qu'on lui prescrivait de croire, à secouer ces vils amas d'erreurs dont on infecta
son enfance, et qui la prolongèrent si longtemps ; à fouler aux pieds ces
terreurs ridicules qui l'empêchèrent de jouir de la vie, et environnerent
d'affreuses images ses derniers moments.
Toutes les religions sont vraies en ce sens qu'elles annoncent Dieu.
Mais elles sont toutes fausses, en ce que ne s'en tenant pas à ce dogme pur,
elles l'étouffent sous une quantité d'autres dogmes absurdes.
Elles sont toutes fausses, en ce qu'elles supposent toutes que Dieu a parlé, ou
qu'il a appuyé la mission de ses envoyés par des miracles ; tandis que Dieu ne
parla jamais aux hommes autrement qu'en leur montrant un spectacle qui les
étonne et les obligé à s'élever jusqu'à lui ; qu'il aurait été ridicule et
injustice de se montrer, de converser avec un homme seul, et d'exiger que l'on
crût à cet homme, ou de demander la foi pour des miracles qui sont contre les
lois générales, et n'ont jamais existé que pour les ignorants et les imbéciles.
Elles sont toutes fausses, en ce qu'elles prescrivent à l'homme d'autres
devoirs que ceux que lui imposent les lois de son existence, des devoirs
opposés à ceux qui dérivent essentiellement de sa nature.
Elles pervertissent la morale, en érigeant en vertus les superstitions les plus
méprisables, les observances les plus minutieuses, et en travestissant en
crimes les actions les plus naturelles, les plus innocentes en elle-mêmes.
Elles sont absurdes, en ce qu'elles ne généralisent pas l'idée de Dieu qui n'est
qu'un et remplit l'univers ; en ce qu'elles corrompent cette conception
sublime, et condamnent les déistes qu'elle désigne sous une qualification
odieuse ; en ce qu'il ne s'agit pas, pour les religionnaires, de croire en
Dieu, le Deus optimus maximus de Cicéron et des anciens sages, mais de
croire à Dieu un tel, à Dieu de tel nom, qui presque toujours est
venu sur la terre revêtu d'un corps humain, et duquel on raconte une histoire
aussi merveilleuse qu'elle a été ignorée des contemporains de ce prétendu
homme-Dieu.
Elles sont odieuses, en ce qu'elles arment les hommes les uns contre les
autres. Ils n'y a ni ne peut y avoir qu'un Dieu ; dès lors quiconque le
reconnaît et l'adore sous quelque nom, sous quelque forme que ce soit, fait
tout ce qu'il doit. Ce n'a pas été le compte des perfides conducteurs des
nations. Pour les rendre ennemies, ils ont fait des dieux nationaux qui
se proscrivent réciproquement.
Elles sont odieuses, en ce que c'est l'instrument duquel se sont servis les
tyrans ; en ce qu'elles ont établi et cimenté la servitude, l'oppression
politique, civile et religieuse. On a vu dans plusieurs nations le gouvernement
théocratique, c'est-à-dire des prêtres sous le nom de Dieu, comme dans
les premières époques du peuple Juif.
Ce gouvernement n'a pas duré, parce que l'ambition des chefs des armées, de
ceux qui se sont faits grands, n'a pu être réfrénée par des prestiges.
Mais s'ils n'ont pas conservé le suprême pouvoir comme les confidents, les
ministres, les chéris de la divinité, ils l'ont du moins partagé partout.
De tout temps il y a eu un pacte entre le trône et l'autel. Les prêtres ont dit
aux rois : nous vous ferons régner ; mais faites-nous dominer à notre tour :
laissez nous les grands biens que nous saurons extorquer aux simples ; laissez-nous
indépendants, libres, privilégiés : taillons, chargeons de tributs les
peuples sots, à qui nous disons que vous êtes les images de Dieu sur la terre ;
que votre autorité vient de lui, qu'ils n'ont droit de l'examiner ni de s'y
soustraire.
Si ce pacte entre la tyrannie et l'astuce sacerdotale, n'a pas eu lieu en
termes exprès, les prêtres en tout temps ont bien fait sentir aux princes,
qu'ils ne pouvaient régner tranquillement et sûrement que par eux. Les
religions sont un instrument qui perce souvent la main qui l'emploie. Maîtres
des esprits de la multitude, ils ont presque toujours dominé les tyrans
eux-mêmes.
Calchas n'était-il pas plus puissant que le roi des rois Agamemnon, puisqu'il
eut l'audace de désigner et de demander pour victime sa fille Iphigénie ?
Constantin se livra aux chrétiens, c'est-à-dire à leurs prêtres, et tous ses
crimes furent déguisés par les écrivains de la secte qu'il avait fait
triompher.
Au contraire, Julien, grand homme philosophe qui les dérisionna, fut flétri
dans leurs annales.
Et pour ne tirer des exemples que de notre propre histoire :
Clovis ne dut qu'à eux, à l'amitieuse et remuante politique des évêques, son
établissement dans les Gaules.
Pépin, son fils Charles, dit Charlemagne, pour avoir été un habile brigand et
un conquérant féroce et fanatique, toutes les races usurpatrices firent consacrer
adroitement par la religion leurs titres défecteurs. Leurs talents, d'une part,
leur liaison intéressé, de l'autre, avec les pontifes de Rome, les maintint
dans un trône qui, comme on disait alors, était l'héritage d'autrui,
c'est-à-dire d'une dynastie d'usurpateurs plus anciens. Quand ces talents ne se
retrouvèrent plus dans les enfants, ou vit les rois déposés, punis, mis en pénitence
par les ministres de l'Église. On sait combien les querelles des empereurs
d'Allemagne avec les papes, ont été fatales à ceux-là. Plus d'un souverain
(pour parler le langage servile du temps passé) a payé de sa tête, ou de la perte de ses états, son manque de déférence au chef de la religion. Il fallut que François premier,
étourdi, extravagant, despote, partageât avec lui le sang de ses sujets, plutôt que de voir
renouveler les démêles de l'atroce Philippe le Bel avec l'impudent Boniface VIII : les royaumes, les États voisins furent rançonnés par la cour de Rome, et le denier de
St.-Pierre fut payé par l'Angleterre même, jusqu'à Henri VII.
Les religions sont funestes, en ce qu'elles dégénèrent dans le plus grand nombre en
fanatisme. Un religionnaire (et heureusement il en est peu qui soient tels
aujourd'hui, et dans toute la force du terme), est un être qui a abjuré la noble fonction de penser, qui a renoncé à sa raison sur l'article de la religion, pour croire aveuglement tout ce qui lui dit son prêtre ; un insensé, une brute volontaire, qui mettant des pratiques superstitieuses au rang des premiers devoirs, est toujours tout prêt à méconnaître ceux que lui imposent sa naissance, sa famille, son pays ; un homme dangereux, toujours prêt à troubler l'État où il vit, en pesant toujours à la balance de sa loi intérieure, les lois d'État, et ne se
soumettant à celles-ci qu'autant que ce qu'il appelle sa conscience, le lui permet ;
regardant comme ennemi de Dieu quiconque ne pense pas comme lui. Quelle source de discorde parmi les hommes ! quel moyen pour les ambitieux de faire des partis ! S'il n'y eût point eu de fanatisme en France, les guerres civiles ne
l'auraient point déchirée pendant quarante années sans discontinuation, et à plusieurs reprises encore ensuite. Comment sans la religion, eût-on porté nos pères à s'entre-tuer ? Si le peuple n'eût pas cru servir Dieu en immolant les
mécréants, quatre-vingt mille Français n'auraient pas été égorgés en un même jour par
d'autres Français.
Les religions sont odieuses en ce qu'elles dissuadant l'homme du bien-être qu'il pourrait trouver ici, sous prétexte de ce qu'elles lui font espérer dans une autre vie : elles
présentent ce monde comme indigne de fixer nos regards, et les biens qu'il renferme, la félicité qu'on y pourrait trouver, comme indignes de nous occuper, parce que ces biens sont périssables, et cette félicité de courte durée : elle éteignent toute émulation, toute gloire, tout motif humain, tout
désir d'être utile aux autres, tout amour de patrie, de famille ; car qu'importe tout cela à l'être qui se propose un autre objet infiniment plus relevé, qui envisage une
éternité heureuse pour récompense de l'abnégation qu'il aura faite de toutes les chose d'ici-bas ? Que
lui importe que lui, que ses semblables soient libres ou esclaves ; rien de ce qui est terrestre n'est digne de son attention. Semblables au chien de la fable, les malheureux quittent peut-être la réalité pour l'ombre, tandis que les avides et rusés prêcheurs de l'expropriation s'emparent de la proie qu'on laisse aller. N'a-t-on pas vu des moines promettre autant d'espace dans le ciel qu'on
donnerait de journaux de terre à leurs couvents, et trouver une foule de gens assez idiots pour se dépouiller de leurs possessions, sur la foi de cette promesse garantie par la
crédulité ?
Je ne ferai pas, citoyen, l'énumération des maux sans nombre que les religions ont causé aux hommes ; la catholique surtout, par son intolérance atroce, ses maximes anti-sociales, peut se vanter d'en avoir fait elle seule plus que tous les fléaux physiques ensemble ; d'abord humble, timide, dans ses commencements, quand le petit nombre de sectateurs étaient obligés de se cacher, accablés des mépris plutôt que des persécution des philosophes ; puis devenue forte, dominante, intolérante, persécutrice, voulant tout envahir, ne souffrir qu'elle, et affichant pour devise ces mots, source de tant de guerres : Forcez-les d'entrer.
Il n'est donc pas étonnant que nous, républicains nouveaux et protecteurs de toutes les libertés, nous qui sommes convaincus que nous ne pourrons achever notre révolution tant que des erreurs funestes continueront de se propager, nous à qu'il importe d'achever au plutôt notre ouvrage, en régénérant les esprits, nous mettions un peu en pratique la maxime contraire : Forcez-les de sortir.
En un mot, citoyens, examinez sans passions, sans préjugés, froidement, toutes les religions, vous verrez qu'elles ont été les causes des malheurs publics et privés ; que leur but est d'asservir, de contenir les peuples dans l'obéissance usurpée par ces mangeurs d'hommes
appelés rois, de faire vivre dans l'abondance les oisifs et impérieux ministres des autels : vous verrez que ce qui en est bon, moral, y est
plutôt moyen que fin ; que leur véritable objet est moins de réformer les mœurs et d'améliorer l'homme, que de l'abrutir en insultant à sa
raison, au point d'exiger sa croyance, sa vénération pour les platitudes les plus
absurdes et les choses les plus choquantes : vous verrez toujours l'écorce prise pour le fonds ; les actions les plus blâmables, la trahison, le
meurtre, la cruauté, louées ou ordonnées par l'Être suprême : enfin, j'ose le dire, vous les trouverez toutes impies par le
caractère malfaisant et injuste qu'elles ne craignent pas de donner à l'Être souverainement bon ; impies encore, en ce qu'elles contredisent le but de Dieu visible par l'arrangement de toutes choses, et la position où il nous a mis.
Nous croyons donc un Dieu : c'est sous ses auspices que nous avons fait et rédigé notre constitution régénératrice. Nous croyons un Dieu ; mais nous dégageons son nom de toutes les souillures dont on l'environnait ; nous le cherchons, nous l'interrogeons dans ses œuvres, et nous faisons taire les hommes menteurs qui s'interposent entre lui et nous. Le monde, l'univers, voilà notre bible ; nous rattachons la morale à sa véritable base. Il n'y en a point d'autre (morale) que ce qui se rapporte à l'utilité de la société humaine ; point de vertu sans civisme, comme il n'y a point de véritable liberté sans instruction. C'est remplir les vues de Dieu que de conserver notre dignité native, de nous servir pour notre bien commun, des facultés qu'il nous a données, de s'élever par la pensée jusqu'à lui, de ne pas nous dégrader devant nos semblables, de ne point avilir ses dons. Ainsi Dieu lui-même, en tant qu'auteur de la raison humaine, est aussi l'auteur de notre révolution et de notre nouveau système social ; comme père commun de tous les hommes, il ne peut prendre plaisir à leur oppression, ni protéger leurs oppresseurs ; pourquoi des apôtres de vérité, quand il y en a eu tant de mensonge, ne vont-ils pas prêcher cela aux automates allemands ? la guerre serait bientôt finie.
On m'objectera sans doute : mais dès que vous reconnaissez un Dieu, il faut admettre aussi un ou plusieurs cultes, un culte public.
Je le nie. L'Être éternel n'a pas besoin de vos hommages, de vos génuflexions, de vos sacrifices ; si quelque hommage lui est agréable, c'est celui d'une vie
pure et irréprochable. Si vous prétendez que Dieu veut être honoré autrement, je vous demanderai comment vous savez que Dieu veut une autre
offrande que celle des bonnes actions ; comment vous osez assurer qu'il veut précisément tel autre genre de culte ; qu'il veut être servi de telle manière, plutôt que d'une autre ! Vous serez sûrement embarrassés sur vos preuves Ce que vous proposez n'est donc qu'une vaine cérémonie qui
dégénère bien vite en superstition ; c'est l'aliment du fanatisme. Faites chacun ce que bon vous semble dans l'intérieur de vos maisons, nul ne peut le trouver mauvais ; mais des
agrégations différentes, dans des temples différents, séparent les citoyens, les divisent en autant de sectes
toujours animés les unes contre les autres par leurs ministres, puisque c'est un moyen pour ceux-ci de s'agrandir, d'étendre leurs richesses, leur crédit, que d'étendre sa secte chacun aux dépens des autres sectes.
Vous ne pouvez empêcher les ministres de pérorer chacun dans son temple. Occasion de troubles et de discordes, quelquefois de factions, malgré toute l'attention et la vigilance du
gouvernement.
Mais ce qui est inévitable, c'est l'école de fanatisme ouverte, et contredisant
toujours l'instruction publique de l'homme par la patrie ; car le prêtre, toujours secret ennemi du perfectionnement de la raison, qu'il sait bien devoir tôt ou tard le
détruire, distinguera toujours deux lois, l'une des hommes, et l'autre de Dieu, c'est-à-dire, ce qu'il imaginera de prescrire sous ce nom, et ne doutez pas que celle-ci n'ait toujours la préférence dans l'esprit de ceux qu'ils appellent avec assez de naïveté, leur troupeau.
Ainsi nulle autre croyance que celle d'un Dieu, nul rassemblement public sous prétexte de culte, aucun prêtre s'il est possible.
Qu'est-il besoin de tout cela ? l'un ni ni l'autre ajoute-t-il quelque chose à cœur juste ? que fait-il que se mettre en la présence du grand Être, de s'accoutumer à l'avoir pour témoin de toutes ses actions les plus
secrètes et de ses pensées les plus intimes, de le prendre pour juge lorsque les hommes nous calomnient ou nous condamnent injustement ? Tout culte positif a été imaginé par des hommes ; moi je vous dis de vous en tenir à celui prescrit par Dieu même, qui veut que nous perfectionnions notre être, les dons qui viennent de lui, que nous cultivions notre raison, que nous embellissions par le travail, la justice et les
vertus, ce séjour où il ne tient qu'à nous d'être heureux.
Je voudrais que les dévots m'entendissent, et que de bonne foi ils voulussent écouter et répondre. Les rendre révolutionnaires eux-mêmes, est une entreprise qu'à la raison seule il appartient de tenter ; mais la raison doit parler son langage ; elle ne déclame pas, elle n'est point injurieuse, elle examine avec équité. Je ne dirai donc comme certains criailleurs du jour : tous les prêtres ne sont que des charlatans, des imposteurs à bon escient. Rien n'est plus odieux, ni plus injuste, ni plus faux. Que d'hommes éclairés et célébrés ont cru et croient encore de bonne foi, et dans la sincérité de leur cœur, ce qu'ils ont professé ! Des génies, même du premier ordre, tels que Pascal, Racine, et les grands hommes de Port-Royal, ont été de vrais
croyants ; personne n'en a douté. Fénelon, Massillon, Fleury ne peuvent être méprises de personne ; ils ont cru, parce qu'en pareille matière plusieurs hommes s'interdisent les raisonnements, et que d'ailleurs des préceptes de sagesse se trouvent dans les livres dits sacrés, mêlés au style le plus sublime, qui tout seul ravissait, enchantait et rendait perplexe Jean-Jaques, au point de les tenir pour divins, en même temps qu'il s'élevait contre les miracles et la révélation.
Il n'y a que les chefs, les princes de la hiérarchie, qui se soient joués de ce qui fut, pendant si longtemps, l'objet de la vénération publique. Quand on examine cette longue suite de vieux politiques
appelés papes, toujours marchant à leur but, celui de joindre une grande puissance temporelle à l'autorité que leur donnait leur qualité de pontifes, mettant en feu l'Italie, faisant verser pour leurs intérêts des torrents de sang dans toute l'Europe, on est convaincu de leur hypocrisie et de leur fausseté ; mais la candeur, la bonne foi a été presque toujours le partage de la classe mitoyenne, Croyons donc à l'honnêteté de la plupart des ecclésiastiques constitutionnels ; leur sort est assez triste, sans en augmenter l'amertume.
Conservons de l'estime à ceux qui l'ont méritée par une
conduite irréprochable, et se sont montrés bons citoyens ; car il en est parmi
eux de tels : ne persécutons personne pour ce qu'il pense ou ne pense pas, sur
ces inexplicables mots : Dieu, âme, spiritualité ; sur des questions
purement spéculatives et abstraites ; sur les causes premières et finales ; et
tâchons de rallier tout au nom de la philosophie et de la raison.
Telles sont, citoyens, les premières paroles qui devaient être portées dans ce
temple dédié à la raison ; c'est-à-dire à Dieu, auteur de tout, sous l'emblème
de ce qu'il y a de plus étonnant dans ce qui existe, la raison humaine ;
dans ce temple consacré à l'instruction générale, et où la vérité seule a droit
de se faire entendre. Il faut connaître ce qu'est l'homme dans la nature,
avant de le suivre dans la société : le premier pas pour arriver au
vrai, est de se défaire des erreurs ; et la rectification de celles de la
métaphysique, tient de plus près qu'on ne pense à notre régénération.
J'ai commencé à donner quelques idées, qui seront sans doute mieux suivies,
approfondies, étendues par les bons esprits qui sont parmi nous.
Une fois détrompé, ramené à des notions saines, le peuple, du moins la partie
du peuple qui, à cause de ses préventions superstitieuses, regarde encore
peut-être notre révolution comme la destruction de ce qu'il y avait de plus
respectable, s'y livrera avec empressement.
Mais il est un point sans lequel vous n'aurez rien fait : ce sont les mœurs
républicaines qu'il s'agit surtout de former ; c'est d'apprendre à vos enfants,
de vous pénétrer vous-mêmes de la sévérité des principes du gouvernement que
vous avez adopté, qui ne peut se soutenir que par les vertus, les bonnes mœurs,
la frugalité, la tempérance, l'honnêteté, l'amour de votre pays, de vos lois.
La liberté est la source de tous les biens, de toutes les prospérités ; son
souffle bienfaisant fertilise les terriens les plus ingrats ; ce n'est que sur
le sol qu'elle habite, que l'abondance, non de quelques individus, mais de
tous, embellit, vivifie, augmente la population heureuse à qui toutes les
sources d'industrie sont ouvertes ; chez qui le commerce même, de sa nature
égoïste, devient patriote, et fait tourner ses ressources au profit de l'État,
comme dans la longue histoire de notre avilissement, le seul Jacques Cœur peut
être cité. Les richesses des patriotes ne s'y emploient pas à acquérir des
droits sur ses concitoyens, et à les humilier, mais à leur procurer des
jouissances, à leur rendre tributaires tous les climats, à multiplier des jeux,
des fêtes, dont les frais ne se prennent pas sur le nécessaire du plus grand
nombre, et où l'œil n'est pas affligé de l'aspect de la misère ; à exciter tous
les arts accourant à l'envie pour doubler, augmenter, peindre, perpétuer le
bonheur de l'immense famille.
Mais ces fruits de la liberté établie, nous ne devons pas nous le dissimuler,
ne sont peut-être pas pour nous qui travaillons à la procurer, en résistant
courageusement à tous les tyrans, à tous les esclaves, à tous les hommes
pervers et corrompus.
Nous, fondateurs de la liberté, c'est par notre constance, notre dévouement,
notre inflexibilité, les privations, que nous saurons maintenir notre volonté,
et peut-être républicaniser l'Europe ; c'est à nous à dire toujours le justum
et tenacem d'Horace. Nous n'avons à combattre que des hommes ; mais
quand l'univers entier devrait s'abîmer sur nous, ses débris, en nous écrasant,
devraient nous trouver sans crainte.
Fondateurs de la liberté, notre tâche est pénible ; mais qu'elle est belle et
glorieuse ! qui de nous regretterait sa destinée, et querellerait la nature de
nous avoir placé à une époque si intéressante ?
S'il est doux de jouir d'un bonheur que l'on doit à autrui, c'est remplir une
fonction céleste que de se sacrifier pour les générations futures. Rendons-nous
dignes de notre mission, de notre vocation sublime. Si celle de l'ancien
romain, comme le dit si magnifiquement Virgile, fut de conquérir et de
gouverner les peuples (de les conquérir, de les gouverner pour les dépouiller),
la nôtre est de les rappeler tous à leurs droits primitifs, de leur donner
l'exemple du courage qui y conduit, l'exemple de la destruction de toutes les
tyrannies. La nôtre est d'exterminer tous les ennemis de la liberté et de
l'égalité.
Vivons, enivrons-nous de la gloire qui nous attend dans les siècles et de notre
temps même ; des honneurs que la postérité reconnaissante nous décernera.
Que croyez-vous qu'elle pense de tout ce qui s'est passé de nos jours, des
prodiges opérés par l'enthousiasme de la liberté ? Qu'est-ce au prix que ce que
nous présentent les fastes de l'antiquité ? Ce n'est pas un Xerxès barbare,
vain et stupide, inondant la Grèce d'un déluge d'efféminés qui n'avaient pas
l'usage des armes ; ce sont tous les États de l'Europe guerrière, ayant porté
au plus haut degré l'art destructeur et la science non moins funeste de la
politique ; ce sont les armées de tous ces États, commandées par les plus
habiles chefs ; c'est l'Allemagne entière, pépinière d'hommes robustes
et patiences au travail ; l'Allemagne, qui détruisit l'Empire romain : c'est l'Angleterre,
dont un seul des navires de guerres eût détruisit toute la flotte des Perses et
celle des Grecs réunies ; la Hollande, plus puissante que l'ancienne Tyr
; c'est l'Espagne, longtemps la terreur de l'Europe ; la Prusse,
élevée au premier rang de la réputation militaire : ce sont tous ces États, et
plusieurs autres, envoyant tout ce qu'ils ont de forces, employant tout leur
or, toutes leurs intrigues, lâchement coalisés contre un seul peuple qui n'a
que loi, et qui de plus a contre lui encore tous les partisans de la noblesse,
de l'aristocratie, du pouvoir absolu, qu'il a abolis.
Qui l'eût dit, lorsqu'on voyait de toutes parts tant de haines éclater, tant de
ligues se former, et cet esprit de discorde, de défiance, d'opposition, que
l'on semait parmi nous ; quand nos princes, nos ci-devant grands couraient nous
chercher des ennemis ; quand tant d'ex-nobles, d'officiers, d'hommes puissants,
de riches émigraient par toutes les issues, pour revenir à la suite des
despotes, porter le fer et le feu dans leur patrie, et y rétablir l'esclavage ;
quand nos généraux, d'intelligence avec ces hordes sanguinaires et barbares, ne
songeaient qu'à leur préparer des succès, qu'à livrer au fer ennemi, à la
famine, au dénuement nos troupes confiantes, et ces innombrables soldats formés
par la liberté ; quand un roi déjà reconnu parjure et traître, remis, malgré
ses crimes, sur la tête de la nation trop crédule, conspirait de nouveau contre
sa bienfaitrice, armé des trésors et de la puissance qu'elle lui avait donnée
pour la défendre ; quand l'or et les intrigues, les émissaires répandus parmi
nous, achevaient de tout disposer à la contre-révolution ; qui l'eût dit que
les sinistres espérances de nos indignes ennemis, marchant comme à une proie
assurée, seraient trompées ; et leurs mesures, en apparence si certaines,
déconcertées ? Le génie de la liberté changea tout en un jour. Tout-à-coup le
tyran est forcé dans son palais, devenu par sa perfidie un arsenal, et rempli
de satellites nationaux et étrangers, prêts à porter le dernier coup à la
capitale, en même temps que l'ennemi entrait dans notre pays par nos places
livrées. À Paris l'impétuosité française fait échouer les projets coupables des
mal-intentionnés qu'elle frappe de mort, en emprisonnant leur maître. Près de
Châlons le Prussien repoussé, mais qui devait être anéanti, échappe par la
trahison de Dumouriez, parricide à jamais infâme, mais non encore connu :
l'attaque de Jemmapes ordonnée pour ruiner les Français, les couvre de gloire :
toute la Belgique est conquise, Mayence et tous les bords du Rhin ; la terre
allait changer de face ; nos principes fermentant, se propageant et soutenus de
nos armes, allaient renverser tous les trônes. Cette gloire qui nous attend est
retardée. Nos traîtres généraux empêchent les progrès de la valeur qui les
avait emportés eux-mêmes malgré leur mauvaise volonté ; ils s'y prennent par
les seuls moyens qui pouvaient nous arrêter : tout manque bientôt à nos
guerriers que l'on fait égorger par petits corps ; ils quittent leurs conquêtes
où ils ne peuvent plus subsister, mais où ils retourneront, n'en doutons point,
ne fût-ce que pour tirer une vengeance mémorable des assassins de Francfort.
Cependant, environnée de plus d'ennemis que jamais, cernée de tous côtés,
ayant au milieu d'elle la guerre civile, la plus atroce allumée par le
fanatisme et la rage des émigrés, et alimentée par la méchanceté du ministre
anglais, la nation française convoque ses assemblées primaires, nomme une
convention qui réforme la constitution comme dans le plus grand calme, et punit
le dernier des tyrans. Cinq cents mille homme sont aux frontières ; ils ne sont
pas suffisants, cinq mille autres sont levés sur-le-champ : en a à la fois
jusqu'à quatorze armées. Toulon livré, Lyon en pleine
contre-révolution,
Landau bloquée, la Vendée, théâtre de mille combats, hydre toujours abattue et
toujours renaissante, déchirant le cœur de la France, faisaient craindre une
fin de campagne déplorable : tout se ranime ; Lyon pulvérisé, ayant perdu
jusqu'à son nom, épouvantera l'histoire de son crime et de son châtiment ; la
Vendée éteinte dans le sang des révoltés, Toulon arraché de vive force à ceux
qui n'avaient eu qu'à le recevoir de la main des traîtres ; les ennemis chassés sur le Rhin, Landau délivré, les lignes de Vissembourg reprises, nos armes victorieuses du côté des Alpes, et bientôt les Espagnols chassés vers les Pyrénées ; enfin partout la minorité rebelle comprimée, forcée de paraître
patriote : tous ces événements rapides font changer la scène encore une fois ; des Sans-culottes d'hier (4), mettent en fuite les capitaines les plus expérimentés, et les vieilles milices si redoutées du Nord. La baïonnette républicaine l'emporte sur toute la tactique et la discipline en laquelle les despotes mettent tant de confiance.
Tels sont les faits qui s'en vont devenir. L'éternel entretien des siècles à venir.
La postérité étonnée se demandera, mais tout cela est-il bien vrai ? Comment ceux à qui nous devons tant de biens, sont-ils venus à bout de tant d'ennemis, de tant de difficultés insurmontables ? Jusqu'à ces hommes extraordinaires, dira-t-on, c'était un axiome dans les cabinets politiques, que l'argent était le nerf de la guerre, qu'on ne pouvait la faire qu'avec ce métal ; et voilà qu'ils en soutiennent une telle que le monde n'en vit jamais, n'ayant pas un écu circulant dans l'empire, avec du papier auquel, magiciens tout puissants, ils donnent une valeur que chacun reconnaît ; ils soutiennent des dépenses énormes, incalculables, sans s'épuiser, sans rien perdre de leur richesse !
Comment tant d'armées sont-elles complétées ? Partout ailleurs on arrache les hommes par force : ici on leur dit, allez, et ils courent en foule ; tout est prêt à partir s'il le faut ; la France entière veut se lever en masse : il faut la retenir.
Comment tant d'hommes sont-ils équipés, fournis, tandis que les manufactures languissent, et qu'il serait trop long d'attendre tous ces objets par la voie ordinaire des entreprises et des achats ? C'est encore ici une chose que l'amour de la patrie peut seul exécuter ceux qui ne combattent pas fournissent tout ce qu'il faut aux combattants ; les
représentants n'ont qu'a dire, et chacun donne habits, chemises, souliers, armes,
matelas.
Comment, réduits à leurs seules ressources, ont-ils fait vivre tant d'armées ?
Comment ce séjour de luxe, de mollesse, le sybarite Paris s'est-il métamorphosé en vaste atelier d'armes, dont nous avions été doucement dégarnis par les les ministres scélérats d'un roi pervers ?
Comment tant de belles actions dignes de la Grèce et de Rome, ont-elles illustré cette ville et tous les
points de la nouvelle république, depuis cinq ans ? Vivent à jamais dans la mémoire des hommes, ceux qui ont tant fait pour l'humanité !
Ainsi s'exprimeront nos neveux.
Ne trompons point leur attente. Il ne faut, pour achever de remplir nos destinées, que
continuer d'être ce que nous avons été : on peut subjuguer un peuple qui n'est défendu, comme à l'ordinaire, que par son armée, quand cette armée est battue, quand les autres attendent tranquillement l'événement, ou
avec la seule inquiétude de savoir à quel maître ils appartiendront. Mais une grande nation, dont tous les membres sont soldats, dont tout le territoire n'est qu'un vaste camp qui tire de lui-même sa substance, tous les efforts des conducteurs de mercenaires armés s'y briseront.
Ôtons leur seulement l'espérance de trahisons nouvelles par le maintien de nos lois révolutionnaires, et bientôt les olives de la paix se mêleront au laurier de la victoire. Nous ne pouvons pas plus rétrograder de la
Révolution, que retourner à notre premier âge et aux occupations futiles de notre enfance. Quelque temps encore, et nous serons récompensés de tous nos travaux. Voudrions-nous dégénérer de tant de vertus, et laisser perdre un bien qui nous coûte déjà si cher ? Non : ou nous périrons tous, ou nous le fixerons irrévocablement au milieu de nous, et le transmettrons à nos descendants !
La première alternative est impossible ; nous serons donc libres, si, inébranlables et constants, nous nous pénétrons bien de cette vérité : que nous perdons moins à mourir qu'à vivre sous la verge des
tyrans. Libres du joug de ces monstres, libres de celui des nobles, libres de celui des prêtres, dégagés de tout préjugé funeste, ne reconnaissant d'autorité que la loi et la raison, quelle grandeur et quelle
félicité ! Si Socrate revient parmi nous, il ne boira point la ciguë pour avoir méprise les religions et débité son proverbe favori : Quod supra nos, nihil ad nos. Quoi ! il n'y aurait donc point encore eu de véritable liberté sur la terre ! Il n'en existe point, quand l'esprit est
garrotté, subjugué. Ôter aux hommes un bandeau qui les aveugle ou les empêche de voir les choses comme elles sont, les guérir d'une maladie qui offusque leur jugement, les rend furieux, persécuteurs d'autrui et d'eux-mêmes, c'est se montrer leur ami, c'est leur faire le plus de bien qu'il est possible. Je ne crains pas de le dire : celui qui vient à bout de détromper un superstitieux, gagnant un citoyen à la République, fait plus pour la patrie que celui que tue de sa main un ennemi ; car quand tous nos ennemis ne seraient plus, tant que les superstitions régneraient parmi nous, il ne faudrait pas aspirer à la liberté et au bonheur, qui ne viennent que sur les pas de la raison.