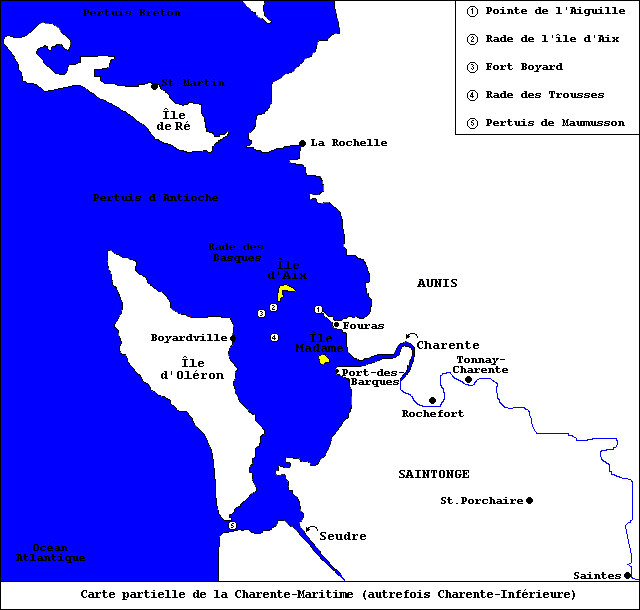
RÉCIT ABRÉGÉ
Des souffrances de près de huit cents ecclésiastiques français, condamnés à la déportation, et détenus à bord des vaisseaux le Washington et les Deux Associés, dans les environs de Rochefort, en 1794 et 1795 : de la mort du plus grand nombre d'entre eux ; de la translation des autres à Saintes pour y être reclus, et de leur bonne réception et délivrance en cette ville : Par un curé du diocèse de Paris que Dieu a daigné associer à ces ecclésiastiques |
_________________________________________________________________
Ils ont passé par bien des tribulations, et ils sont demeurés fidèles. Judith, 8.
_________________________________________________________________
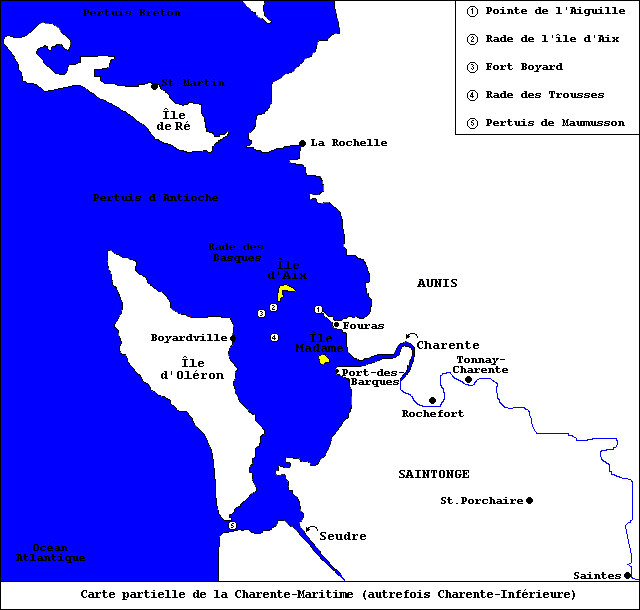
AVIS DE L'ÉDITEUR
L'ÉCRIT suivant n'a pas été composé par esprit de vengeance : un tel sentiment ne trouve point d'accès dans le cœur d'un prêtre qui a été jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. L'auteur n'a eu pour but que d'édifier quelques amis, et de leur faire bénir avec lui ; Dieu qui donne la patience et la consolation. On a cru devoir publier son écrit, pour montrer à tous les Français quelle est l'humanité et la tolérance des philosophes de nous jours, qui, dans ces dernières années, nous ont tant parlé de fraternité et de liberté des opinions et des cultes. Les incrédules modernes se vantaient d'avoir tellement éclairé notre siècle, qu'ils l'avaient rendu incapable des cruautés que l'histoire reproche aux hommes qui nous ont précédés ; et néanmoins, dans le temps désastreux où nous vivons, il s'est commis des excès de barbarie qui jusqu'alors avaient été inconnus au genre humain. Si cette affreuse vérité avait encore besoin d'être prouvée, elle le serait par le récit qu'on va lire ; et encore a-t-on bien affaibli les traits du tableau qu'il présente. Quand on aura contemplé cette scène d'horreur, qui s'offre à la suite des massacres dans les prisons, des fusillades, des noyades, des exécutions sur les échafauds, on doit être convaincu que la philosophie est, non pas un flambeau qui éclaire, mais une torche qui brûle.
En lisant le même récit, ceux qui sont restés fidèles à l'Église catholique dans cette contrée malheureuse, apprendront la perte qu'ils ont faite d'un grand nombre d'ecclésiastiques dignes de leurs regrets. Hélas ! ils en avaient déjà perdu tant d'autres que les ennemis de la religion leur ont enlevés par milles genres de persécutions ! Ils adoreront les impénétrables décrets de la divine providence, qui a permis à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Après avoir versé des larmes sur la mort de ces hommes irréprochables, ils en conserveront religieusement la mémoire, et seront affermis dans la foi par le souvenir de leur généreuse fermeté. Ils adresseront au ciel des vœux ardents pour les habitants de Saintes, qui ont accueilli avec une sensibilité si affectueuse ceux des ecclésiastiques déportés que la mort avait épargnés jusque-là, et qui, par tant de bons traitements, ont sauvé la vie à ce reste précieux ; ils porteront dans leurs cœurs ces chrétiens charitables ; et si, comme le dit Saint Paul, le corps entier doit se réjouir de ce qui arrive d'heureux à un de ses membres, ils regarderont fait à toute l'Église le bien fait à plusieurs des ses ministres. (I. Cor. 12).
Ceux qui se sont laissés entraîner hors du bercail et qui ont abandonné leur pasteur pour suivre un étranger, pourront voir, s'ils veulent jeter les yeux sur l'écrit suivant, que tant de prêtres qui ont tous sacrifié, les biens, la tranquillité, la considération, les amis, les parents, la patrie, la liberté, la vie même, plutôt que d'adopter des innovations contraires à la doctrine et à la pratique de la véritable Église, n'étaient pas des entêtés ni des fanatiques : la conscience peut seule exiger et obtenir un tel sacrifice ; ils ont mieux de mourir que d'enfreindre la sainte loi de Dieu, et ils ont péri. (I. Machab.)
Quoique l'auteur de cet écrit représente particulièrement l'état des déportés qui furent détenus à bord du Washington, parmi lesquels il était ; cependant la description, qu'il en fait, convient aussi à la situation de ses compagnons d'infortune qui furent mis à bord des Deux Associés : il faut seulement supposer quelques légères différences relatives principalement à la grandeur du dernier de ces vaisseaux, et au nombre de ses prisonniers qui étaient plus considérables.
_________________________________________________________________
RÉCIT
I. Arrivée des déportés à Rochefort, leur embarquement
et détention sur deux vaisseaux.
Au mois de mars 1794, nous nous trouvâmes rassemblés à Rochefort au nombre de près de huit cent ecclésiastiques, presque tous prêtres, et tous condamnés à la déportation en haine de Jésus-Christ et de Son Église. Dans ce clergé nombreux, envoyé de toutes les parties de la France, on comptait des vicaires-généraux de divers diocèses, des abbés commendataires, des doyens de chapitres, des chanoines, des curés, des vicaires, des supérieurs ou directeurs de séminaires, des professeurs de collèges, des religieux de tous les ordres. On nous avait associé un laïque condamné à la même peine, nommé M. Girard, ci-devant garde du corps de M. le comte d'Artois ; et ce respectable militaire nous édifia beaucoup par ses vertus.
Nous avions été amenés à Rochefort par détachement, dans des charrettes découvertes où nous étions entassés, et quelquefois
enchaînés comme des criminels : une escorte de soldats conduisait les voitures. Les lieux où l'on nous faisait séjourner pour passer la nuit, étaient les cachots des prisons. Notre entrée dans les villes qui se rencontraient sur notre passage, était, ainsi que notre sorties, accompagnée des haies injurieuses du peuple soulevé contre nous, et marquée par des avanies plus ou moins humiliantes. Voici une de ces avanies ; elle est plus remarquable que les autres. Les ecclésiastiques du département de l'Allier, au nombre de quatre-vingt, à la tête desquels était M. Imbert, ex-jésuite et vicaire apostolique du diocèse de Moulins, arrivèrent à Limoges. En y arrivant, ils trouvèrent aux portes de la ville une multitude immense, que la curiosité avait rassemblée pour considérer un spectacle d'un genre nouveau. C'était une grande quantité d'ânes et de bœufs couverts d'habits sacerdotaux, qui s'avançaient en formant une longue file ; et un énorme cochon revêtu d'ornements pontificaux, qui fermait la marche. Une mitre fixée sur la tête de ce dernier animal portait cette inscription, le pape. Celui qui présidait à cette fête irréligieuse, dont il était l'inventeur, fit arrêter les charrettes qui voituraient les ecclésiastiques, ordonna à ces hommes vénérables de descendre, et les mit, deux à deux, en rang avec les animaux. La procession sacrilège entra ainsi dans la ville. Quand elle fut parvenue à la place principale, on la rangea en cercle autour de l'échafaud sur le quel était établi l'instrument de mort appelé guillotine. Alors le cercle s'ouvrit pour donner passage à la gendarmerie, qui amenait un prêtre non-assermenté que le tribunal révolutionnaire de la ville venait de condamner à périr par ce genre de supplice. L'exécution se fit aussitôt. Le bourreau montra ensuite au peuple la tête qu'il venait d'abattre, et dit : Les scélérats que vous voyez ici, méritent d'être traités comme celui que je viens d'exécuter. Par lequel voulez-vous je commence ? Le peuple s'écria : Par celui que tu voudras. Cependant, après que la multitude eut savouré le plaisir de les effrayer par l'apparence d'une mort prochaine, on les conduisit en prison pour y passer la nuit. Ainsi se termina cette journée qui leur semblait devoir être la dernière de leur voyage et de leur vie : le jeu cruel qu'on se permit à leur égard, se borna à la dérision et à la terreur.
Lors donc que nous fûmes rassemblés à Rochefort, on nous mit à bord de deux vaisseaux, pour exécuter jugement qui nous
condamnait à la déportation. Trois cents d'entre nous furent embarqués sur le Washington ; et les autres, au nombre de près de cinq cents, sur les Deux Associés. L'équipage de chaque vaisseau était composé du capitaine, de plusieurs officiers, et d'un certain nombre de soldats et de matelots.
Pour s'embarquer, il fallait grimper sur le vaisseau par une échelle haute d'une douzaine de pieds. Cette échelle mal assurée vacillait sans cesse ; et, parce que ses échelons étaient fort éloignés les uns des autres, on ne pouvait les atteindre sans faire de pénibles efforts. Les soldats et les matelots, irrités de ce qu'on ne montait pas assez vite, criaient: Avance donc, scélérat. On arrivait enfin sur le bord du vaisseau. Là on trouvait une second échelle, haute d'environ six pieds, par laquelle il était aussi difficile de descendre, qu'il l'avait été de monter par la première. Les
vieillards surtout étaient exposés à faire une chute dangereuse. Après être descendu, on était conduit par deux matelots devant le capitaine.
Le capitaine était assis devant une table, en habit d'ordonnance, le sabre nu à la main. À ses côtés, étaient deux officiers vêtus et armés comme lui ; à la droit et à la gauche des officiers, étaient des soldats portant baïonnettes au bout du fusil ; à la suite des soldats, étaient des matelots sans armes. Ce cortège ainsi rangé formait un grand cercle, qui s'ouvrait pour introduire le déporté qu'on amenait, et se refermait ensuite. Quand le déporté était parvenu au milieu du cercle, on le faisait arrêter quatre soldats venaient se placer auprès de lui, et tenaient la pointe de leurs sabres dirigée contre son corps. Alors le capitaine lui ordonnait de livrer son porte-feuille. Dès qu'il avait obéi, plusieurs matelots se jetaient sur lui : ils arrachaient la cocarde de son chapeau, en lui disant, Scélérat, tu es indigne de porter cet ornement de nos têtes ; ils lui ôtaient tous ses vêtements, ne lui laissant que sa chemise (plusieurs même furent complètement mis à nu). Après l'avoir réduit à cet état d'humiliation, ils visitaient les vêtements qu'ils lui avaient ôtés, et le modique bagage qu'il avait pu apporter avec lui en entrant dans le vaisseau, pour trouver l'or qu'ils supposaient y être caché ; et dans la crainte que ce métal n'échappât à leurs recherches, ils coupaient les semelles et les talons des souliers. La visite finie, ils choisissaient parmi les effets pris au déporté, une culotte, une paire de bas, un habit, un bonnet et un mouchoir, le tout de la moindre qualité : ils en faisaient ensuite un paquet, le lui jetaient à la tête, et le faisaient sortir du cercle. Le déporté allait joindre ceux de ses confrères qui avaient déjà subi cette ignominieuse épreuve : là, il n'osait, aussi bien qu'eux, ni se plaindre, ni lever les yeux.
M. le Clerc, curé dans le diocèse de St. Brieux, avait sauvé du pillage un mouchoir des indes, dont un coin était noué, et renfermait 25 louis. Au moment où il allait se rhabiller, un matelot aperçut le mouchoir, et l'arrache, en disant : Ah ! scélérat, tu oses faire tort à la nation de ce mouchoir ! L'ayant dénoué, il trouve l'or caché dans le nœud, et porte le tout au capitaine. Celui-ci fait sur-le-champ mettre aux fers le respectable ecclésiastique, comme coupable d'avoir voulu voler la nation. M. le Clerc, encore nu, passa 24 heures enchaîné sur le pont du vaisseau.
Quand nous eûmes tous été embarqués et dépouillés, le 25 mars, les deux vaisseaux mirent à la voile, et allèrent jusqu'à la rade de l'île d'Aix, à quelques lieues de Rochefort. Ils y restèrent jusqu'au premier novembre suivant. À cette époque, ils se rapprochèrent un peu de Rochefort, et vinrent hiverner dans le Port-des-Barques. Le premier février 1795, ils quittèrent ce port ; et revinrent à Rochefort le 5 du même mois.
Pendant ce long espace de temps, détenus à bord de ces vaisseaux, nous pûmes dire avec le psalmiste : «Nous sommes tous les jours mis à mort pour le nom du Seigneur ; on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie». (Ps. 43.)
II. Souffrances des déportés.
Leur situation pendant le jour.
Pour séparer les déportés des gens de l'équipage, on avait fait avec des planches une cloison sur le pont.
Aux deux extrémités de cette cloison, on avait ménagé deux portes basses et étroites. À chacune de ces portes, en dedans de la partie du pont destinée aux ecclésiastiques, on tenait toujours en faction un soldat, armé d'un fusil garni de sa
baïonnette, d'un sabre, et d'une double paire de pistolets. Dans la longueur de la cloison, on avait pratiqué six ouvertures, par où passait autant de bouches de canon ; et ces canons étaient chargés à mitraille, et pointés sur l'emplacement réservé aux prêtres.
La partie du pont destinée aux déportés était celle où est placé le mât de beaupré. Cette partie était toujours malpropre, toujours remplie de boue, toujours embarrassée par des cordages et des barriques ; et aux côtés du mât se trouvaient deux petites loges, dans chacune desquelles on nourrissait un cochon.
Voilà le local où 300 ecclésiastiques étaient obligés de passer toute la journée. Dans cet emplacement étroit, et que divers objets embarrassaient encore, les déportés étaient serrés les uns contre les autres, comme le sont des personnes que la curiosité a rassemblées en foule dans un même lieu. Il fallait qu'ils se tinssent toujours debout ; et la gêne d'une telle attitude se faisait surtout sentir à l'heure des repas. Dans cette fatigante position, qui ne devint plus supportable que quand nous eûmes gagné de la place en perdant plusieurs de nos confrères, nous étions encore exposés à toutes les injures de l'air, à toutes les intempéries des saisons. Pendant l'été, le soleil dardait ses rayons sur nos têtes, et nous brûlait le visage. Pendant l'hiver, des brouillards épais nous enveloppaient sans cesse, et la pluie ou la neige nous tombaient souvent sur le corps : nous éprouvâmes toute la rigueur du froid qui se fit sentir en France dans le mois de décembre et janvier. En tout temps, le roulis du vaisseau incommodait beaucoup la plupart d'entre nous ; et quand la mer était agitée, ce roulis, devenant alors plus fort, leur causait de violence maux de cœur et des vomissements qui allaient jusqu'au sang.
Leur nourriture.
La nourriture des déportés consistait en pain, en biscuit, en viande salée, en morue, en gourganes (espèces de fèves), et en vin. Ces aliments étaient de très mauvaise qualité : le pain, noir et moisi ; le biscuit, gâté et plein de vers ; la viande salée, sèche et dépourvue de suc ; la morue, jaune et pourrie ; les gourganes, noyées dans une grande quantité d'eau, sur laquelle on voyait surnager un peu d'huile rance ou de vieux oint : le vin seul était bon.
La distribution de ces vivres aurait été interminable, si on l'eût faite individuellement. Pour l'abréger, le capitaine l'avait simplifiée. Il avait partagé les déportés par tables, composées de dix convives ; et avait donné à chacune un chef, qui, à l'heure des repas, était tenu d'aller chercher les vivres destinés pour sa table. Ce mot table, employé par le capitaine pour désigner chaque dizaine de convives, était bien impropre : car nos repas ne se faisaient pas sur des tables ; et il eût été impossible d'en placer une seule parmi nous, puisque nous manquons d'espace même pour nous asseoir. Il y avait pour le service de chaque table, une gamelle, un bidon, une tasse, un couteau, et des cuillères de bois, quand on donnait des gourganes. La gamelle était une jatte de bois, qui contenait la viande salée, la morue ou les gourganes ; le bidon était un vase de bois, où l'on mettait le vin ; la tasse, qui était de fer blanc, servait à chaque convive pour boire à son tour la quantité de vin qui lui revenait ; le couteau servait au chef pour faire la répartition des vivres. Pendant que le chef faisait les parts, la gamelle était soutenue par un des convives. Les parts faites et distribuées, chaque convive tenait la sienne dans ses mains, et la déchirait avec ses dents. Dans cette opération, il était à chaque instance
contrarié ou même arrêté par le mouvement de ses voisins, qui éprouvait de leur côté un inconvénient semblable ; tant on était gêné dans la presse où l'on se trouvait. L'action de manger était donc toujours difficile et pénible ; mais elle devenait presque impraticable quand on donnait des gourganes. Alors chaque convive tenait la gamelle à son tour ; et les autres tâchaient de prendre avec leur cuillère un peu de ces gourganes, et de la sauce claire dans laquelle elles nageaient. Quand on avait pris quelque chose, on ne parvenait pas à porter le tout à sa bouche : une partie, avant d'y arriver, tombait sur les habits.
Si encore chaque table avait eu la ration qui était fixée et payée par le gouvernement, on aurait pu ne pas souffrir le faim. Mais il n'en était ainsi : car, en vertu d'un arrangement concerté entre le capitaine et le commis des vivres, chaque chef de table ne recevait que trois livres de pain, au lieu de cinq ; quarante onces de biscuit, au lieu de soixante ; cinq mesures de vin, au lieu de dix. Le reste des aliments qui passait par les mains des gens de l'équipage, supportait une diminution aussi considérable. Il arrivait de-là que la part de chaque convive était trop modique pour pouvoir le nourrir. Aussi avons-nous vu, plus d'une fois, quelques-uns d'entre nous que la faim tourmentait plus que les autres, enlever aux cochons, dont les loges étaient au milieu de nous, les gourganes de rebut et les morceaux de pain pourri qui se trouvaient dans les auges de ces animaux.
Leur situation pendant la nuit.
Le lieu où les déportés passaient la nuit, n'avait guère plus d'étendue que celui où ils se tendaient pendant le jour. On y
descendait par une échelle si droite et si roide, que tous les jours, en descendant, plusieurs d'entre nous se faisaient aux jambes des blessures dangereuses. L'air et le jour n'y pénétraient que par l'écoutille, c'est-à-dire, par l'ouverture qui servait à descendre. Ainsi l'entrée seule du réduit se trouvait éclairée d'une lueur faible ; le reste de son espace était constamment dans les ténèbres les plus épaisses.
Tel était le gîte qu'on avait assigné à 300 ecclésiastiques. Ils s'y étendaient les uns à côté des autres, sans quitter leurs habits et sans avait le moindre appui sous la tête.
Il y avait, de distance en distance, des baquets placés pour l'usage de ceux qui éprouvaient des besoins pressants, et qui ne pouvaient aller les satisfaire hors de leur gîte, parce que des verrous en fermaient l'issue. Le dortoir des déportés était donc un vrai cachot.
Quand on nous avait renfermés dans notre affreux dortoir, nous avions bien de la peine à y prendre le repos que la fatigue de la journée nous avait rendu si nécessaire. Plusieurs causes concouraient à chasser le sommeil bien loin de nos paupières. Dans l'été nous éprouvions une chaleur étouffante et dans l'hiver et surtout dans les mois de décembre et de janvier, nous sentions un froid pénétrant, sans pouvoir obtenir la moindre couverture pour nous en garantir. L'air que nous respirions était corrompu par l'haleine d'un si grand nombre de personnes entassés dans un si petit espace, et par l'odeur
fétide qui s'exhalait des baquets. Sous prétexte de le purifier, on venait tous les jours, à quatre heures du matin, brûler du brai (espèce de raisin) à l'entrée de notre réduit : mais cette fumigation singulière n'avait pour nous d'autre effet que d'encrasser nos poumons. Une vermine abondante, engendrée par notre malpropreté involontaire, sillonnait notre peau, dévorait le peu de chair qui nous restait, et suçait jusqu'à la mœlle de nos os.
Après que nous avions passé dix heures dans notre cachot nocturne, on nous en tirait pour nous faire remonter sur le pont ; et ce déplacement nous procurait du moins l'avantage de respirer à volonté.
Les mauvais traitements qu'on leur faisait.
En entrant dans les vaisseaux, nous ne nous étions pas attendus à être bien accueillis et bien traités par les soldats et les matelots. La grossièreté qu'on trouve en ceux qui n'ont pas eu d'éducation ; la licence qu'on sait être familière aux militaires et au marins, plus encore le désordre que la révolution a mis en France dans le corps social, et le bouleversement qu'elle a produit dans les conditions qui le composaient ; tout cela devait nous empêcher de croire que ces hommes, à la merci desquels on nous mettait, auraient pour nous des égards. Aussi se plaisaient-ils journellement à profaner nos yeux par leurs impudicités monstrueuses ; à souiller nos oreilles par leurs discours sales, leurs chansons
infâmes, leurs invectives atroces, leurs blasphèmes abominables : et nous, nous avions pitié de l'abrutissement de ces malheureux qui n'avaient plus de l'homme que la figure.
Mais nous avions espéré que les capitaines et leurs officiers auraient pour nous des procédés honnêtes, ou du moins raisonnables et justes. Pour cette fois, nous nous étions trompés. Hélas ! on les avait si étrangement prévenus contre nous ! On nous avait représentés comme de mauvais citoyens, comme les ennemis du bien public, comme le fléau de la société. Ainsi les chefs de qui l'on nous faisait dépendre, nous ont regardés comme les balayures de la France, comme les ordures qu'elle jetait hors de ses limites. Ils ont donc cru devoir se dépouiller à notre égard de tout sentiment d'humanité, et
ne pas nous traiter comme des hommes. Au lieu de faire de toutes les victimes mises en leur puissance, un grand et unique holocauste, ils ont mieux aimé immoler en détail. On leur avait apparemment recommandé de nous faire mourir par degrés, et de nous faire avaler goutte-à-goutte le calice d'amertume. Quoi qu'il en soit, à Dieu ne plaise que nous voulions leur rendre le mal pour le mal, et que nous appelions la vengeance sur leurs têtes : à l'exemple de notre divin Maître qui a prié pour Ses bourreaux, nous pardonnons à nos persécuteurs leurs outrages, leurs injustices, leurs violences ; et nous demandons au Seigneur, que les mauvais traitements que nous avons éprouvés, servent d'expiation à ceux qui nous les ont faits.
Dans les temps de notre embarquement, les capitaines nous ôtèrent tous nos livres et même notre bréviaire. Ils craignaient, sans doute, que les malheureux déportés ne cherchassent et ne trouvassent dans la prière un adoucissement à leurs maux. Ils nous interdisaient jusqu'au mouvement des lèvres. Le capitaine du Washington aperçut une fois des ecclésiastiques que priaient tous bas, et leur dit avec fureur : Quoi ! fanatiques, je crois que vous invoquez votre Jésus! C'est en vain que vous priez ce coquin-là ; il ne saurait vous retirer d'ici. S'ils avaient pu étendre leur empire sur notre esprit et sur notre cœur, ils nous auraient empêché de penser à Dieu, et défendu de l'aimer.
Les railleries amères et les sarcasmes impies ne nous étaient pas épargnés. Le capitaine des Deux Associés, au sortir d'une orgie qui s'était faite à bord du Washington, entra dans la partie du pont qu'occupaient les déportés
; et après avoir rassasié ses yeux du plaisir de contempler leur misère, il leur dit d'un ton moqueur : Quoi ! scélérats, vous ne riez pas ici ! Je connais les principes de votre religion. Votre Jésus ne dit-il pas qu'on doit s'estimer heureux lorsqu'on souffre ? Coûtez donc, et savourez votre bonheur.
Sans cesse notre patience était exercée par des vexations de toute espèce. On nous laissait laver le mauvais mouchoir et la mauvaise chemise qui nous étaient restés, sans daigner nous donner ni la place, ni les ustensiles, ni le savon dont nous aurions eu besoin pour faire proprement cette indispensable lessive. On nous refusait une aiguille et du fil pour recoudre les pauvres hardes qu'on nous avait laissées, et qui s'en allaient en lambeaux. Des déportés qui avaient enterré quelques-uns de leur confrères, et qui revenaient au vaisseau trempés des eaux de la pluie ou de celles de la mer, demandaient en vain pour avoir la facilité de faire sécher leurs habits, qu'on leur rendit pour quelques heures les autres vêtements qu'on leur avait enlevés : ils n'obtenaient pas ce soulagement si juste. Un jour le capitaine du Washington fit mettre aux fers un sergent, pour avoir donné quelques rafraîchissements à six ecclésiastiques, qui, dans la même journée, avaient successivement mis en terre huit de leurs confrères, et reçu la pluie pendant toute la durée de cette pénible opération. Jamais il ne voulut accorder un second mouchoir et une seconde chemise à M. Cordier, ex-jésuite, âgé de 85 ans. Il enleva même à ce vieillard la bâton dont il se servait pour soutenir sa caducité ; et en le privant de cet appui, il lui dit d'un ton railleur : Vieux scélérat, si je te laissais cela, tu serais capable de faire la contre-révolution à mon bord... Si un couteau ou une gamelle se perdaient par la négligence des gens d'équipage, la perte était mise sur le compte des déportés, et on leur faisait un grand crime. Pour les punir, on les privait tous du vin qu'ils devaient avoir ; ou bien à l'heure des repas, on refusait à chaque chef de table le couteau dont il avait besoin pour faire le répartition des aliments.
Quand nous osions nous plaindre de quelques mauvais traitement, ou réclamer contre quelque injustice, on répondait à nos plaintes ou à nos réclamations par des actes de violences. Dans le mois de janvier 1795, lorsque le temps était si
rigoureux, quatre ecclésiastiques représentèrent au capitaine du Washington qu'eux et tous leurs confrères souffraient beaucoup de la faim, parce que le commis des vivres avait considérablement diminué leur ration. Pour toute réponse, ils furent mis aux fers pendant huit jours. Le capitaine des Deux Associés n'était pas plus équitable. Au mois d'août 1794, il parut avoir pitié du sort des déportés, et leur dit : Faites un mémoire qui expose votre situation déplorable, et je le présenterai à ceux qui peuvent adoucir vos maux. M. de La Romagère, vicaire-général de Châlons-sur-Marne, rédigea le mémoire dont il s'agissait, le signa avec quatorze autres ecclésiastiques, et le remit au capitaine. Celui-ci, après l'avoir reçu, vint dans la partie du pont où se tenaient les déportés, fit l'appel nominal de tous ceux qui avaient signé l'exposition de leur misère commune, et les condamna à être mis aux fers.
Les dénonciations calomnieuses que les gens de l'équipage se plaisaient à faire contre nous, étaient favorablement
accueillies ; et d'après ces dénonciations, on nous nous condamnait sans nous avoir entendus. M. de Roailhac, chanoine de Limoges, fut accusé par un matelot d'avoir dit : Si parmi mes confrères il se trouvait cent hommes comme moi, nous viendrions bien à bout de l'équipage. Sur le témoignage de l'accusateur seul, et sans avoir été admis à se justifier, il fut condamné par le capitaine des Deux Associés à être fusillé sur le pont. On lui signifia sur-le-champ son arrêt de condamnation, et on lui donna une demi-heure pour se préparer à la mort. Ce temps écoulé, il fut attaché au mât de beaupré. Avant qu'on l'exécutât, il dit aux autres déportés qui assistaient à son supplice : «Mes chers confrères, comme je suis sur le point de comparaître devant le tribunal de Dieu, vous devez croire que je vous dis la vérité. Je n'ai jamais tenu le discours que l'on m'impute, et je meurs innocent. Je vous demande le suffrage de vos prières».
Leurs maladies.
Tant de souffrances n'avaient pas encore suffisamment épuré les ministres de Jésus-Christ et de Son Église : Dieu acheva de les purifier par la maladie ; et cet état fut pour eux, ce que le creuset est pour l'or.
Les hôpitaux des malades étaient établis sur de petites barques à pont, qui avaient environ 50 pieds de long sur 14 de large dans leur plus grande largeur. À l'extrémité de chaque barque, se trouvait une chambre destinée à loger son patron avec deux matelots, et un sergent avec quatre soldats. Le reste de la capacité, qui avait à peu près 40 pieds de longueur, était réservé pour les malades. Cet espace avait cinq pieds de haut dans le milieu de la barque. C'était là qu'on
mettait jusqu'à cinquante malades, serrés les uns contre les autres, étendus sur les planches, enveloppés de leurs habits ordinaire, et n'ayant ni couverture sur les pieds ni appui sous la tête. Sur ces petits bâtiments, le roulis était bien plus fort, bien plus incommode, bien plus dangereux que sur les vaisseaux : pour peu que la mer devînt grosse, elle agitait violemment les barques, et les malades se trouvaient ballottés sans relâche. Souvent l'eau qui tombait sur le pont, s'insinuait par dessous, et inondait tout l'hôpital. Ce qui ajoutait encore à l'horreur de la situation des malades, c'est qu'éprouvant des besoins extraordinaires que la maladie occasionnait, et manquant de linge de rechange, ils demeuraient continuellement plongés dans l'ordure, en sorte que leurs vêtements pourrissaient sur les eux. La vermine qui les tourmentait habituellement, s'augmentait avec la malpropreté : quelquefois même les vers les rongeaient tout vivants. À force d'être frottés contre les planches, tout leur dos s'écorchait ; et les lambeaux de leurs habits se collaient sur leurs plaies sanglantes : une odeur infecte, une odeur de mort de répandait dans l'étroit et sombre réduit qui les renfermait ; et jamais l'air ne pouvait être renouvelé dans un tel hôpital.
La boisson des malades était une mauvaise tisane ou un bouillon plus mauvais encore : souvent même ils en manquaient entièrement, et souffraient les ardeurs brûlants de la fièvre, sans pouvoir étancher leur soif. Deux prétendus chirurgiens, dont le plus âgé avait 24 ans, paraissaient quelquefois dans les hôpitaux ; mais ces jeunes gens, par leur inexpérience, nuisaient plus aux malades qu'ils ne leur servaient. S'ils leur administraient quelques purgations, ils ne savaient pas en régler la dose ; et les médicaments qui auraient pu être utiles par un emploi modéré, devenaient funestes par un
usage excessif ; voir aussi la note 1.
Au mois d'août 1794, on supprima les hôpitaux établis sur les barques, pour les établir dans la petite île Madame, voisine de l'île d'Aix ; et au mois de novembre suivant, on les transféra sur le rivage du Port-des-Barques, quand les vaisseaux vinrent hiverner dans ce port. On dressa donc à terre huit tentes, et on mit trente lits dans chacune. Ainsi les malades commencèrent à avoir un lit tel quel, et ce fut un grand adoucissement pour eux : mais ils étaient très incommodés quand il pleuvait, car la pluie mouillait le grabat dans lequel ils étaient couchés ; d'ailleurs le régime qui avait eu lieu sur les barques, continua d'avoir lieu sous les tentes. La peine des infirmiers se trouva considérablement augmentée par le déplacement des hôpitaux. Il fallait qu'ils fissent un bon quart de lieue, marchant dans une eau bourbeuse qui leur venait jusqu'à la ceinture, et portant sur leurs épaules, non seulement les malades, mais encore le bois et les autres provisions
qu'on envoyait des vaisseaux tous les jours.
Les infirmiers des malades étaient leurs propres confrères. Chacun de nous ambitionnait l'avantage de servir ses collègues, lorsque la maladie venait les frapper : nous nous disputions le mérite de cette bonne œuvre, et l'esprit de charité excitait parmi nous une rivalité sainte. Le frère Élie, religieux de l'abbaye de Sept-Fons, disait, après avoir obtenu de son supérieur la permission de se consacrer au service des malades : «Je me dévoue à cet honorable ministère. Je sais que ma santé ne résistera pas aux peines et aux fatigues qu'il va me causer : mais je sacrifie volontiers mes jours pour sauver ceux de mes frères ; et je mourrai content, si je puis racheter leur vie par ma mort». M. Arnaudot, jeune diacre du diocèse de Poitiers, remplit pendant longtemps avec un zèle admirable les fonctions d'infirmier. La conservation d'un seul ecclésiastique lui paraissait un dédommagement plus que suffisant des peines qu'il prenait, des fatigues qu'il endurait, des dangers qu'il courait ; et plusieurs d'entre nous durent à ses soins généreux le rétablissement de leur santé. Un jour qu'il était occupé à hisser les corps de huit prêtres qui venaient de mourir, pour les faire passer de la barque dans le canot, les matelots, trouvant qu'il n'allait pas assez vite dans ce pénible travail, l'invectivèrent avec dureté. Un mouvement de sensibilité dont il ne fut pas le maître, lui arracha ces paroles : «Vous êtes bien plus empressés de venir chercher les morts pour avoir leurs dépouilles, que vous ne l'êtes d'apporter des remèdes pour soulager les malades». Cette réponse fut rapportée au capitaine, qui le fit mettre aux fers pendant cinq jours : mais une punition si rigoureuse ne l'empêcha pas de reprendre avec une nouvelle ardeur ses fonctions d'infirmier. Ce diacre, en servant les prêtres à l'autel où ils se sacrifiaient, espérait être associé à leur sacrifice : mais Dieu qui l'avait animé d'une charité si vive, ne permit pas qu'il en fût la victime.
Les malades, au milieu de leur détresse et de leurs douleurs, faisaient paraître une patience inaltérable et une résignation parfaite : ils se montraient de dignes ministres de Dieu dans les nécessités, dans les angoisses, dans les tourments. M. Tabouillot, curé d'une paroisse de Lorraine, demandait à boire à M. de Brigeat, doyen du chapitre d'Avranches, qui le servait. Celui-ci répond qu'il n'a ni tisane ni bouillon à lui donner. Le malade reprend avec une sainte vivacité : «Ah ! il est bien juste que j'endure cette privation, puisque mon adorable Sauveur a été abreuvé de fiel et de vinaigre».
Ils se complaisaient dans leurs afflictions, ils s'en glorifiaient, persuadés que les afflictions présentes n'ont aucune proportion avec la gloire qui sera une jour découverte en nous. On les maudissait, et ils bénissaient ; on les maltraitait, et ils priaient pour leurs ennemis. Aucune plainte, aucune murmure ne sortait de leur bouche : dans leur misérable hôpital, ils demandaient, comme Jésus au jardin des oliviers, que la volonté de leur Père s'accomplit en eux.
Dans leur état douloureux, ils étaient donnés en spectacle aux anges et aux hommes. Ce spectacle fit impression sur plusieurs prêtres constitutionnels qui se trouvaient parmi nous. Ces confrères, aveugles ou faibles, avaient adopté toutes les innovations qu'on leur avaient proposées, et fait toutes les démarches qu'on avait exigées d'eux ; et pour récompense de leur soumission sincère ou simulée, ils envoyaient condamnés comme nous à la déportation, et détenus avec nous.
Ce n'était pas là le prix dont on devait payer leur docilité ou leur complaisance, et leurs espérances étaient bien cruellement trompées. Aussi, dans les premiers temps de notre captivité commune, ils secouaient le joug mis sur eux par la main divine, et regimbaient contre l'aiguillon. Par leur mauvaise humeur, leurs mouvements d'impatience, leurs murmures contre Dieu, ils aggravaient les maux que nous partagions avec eux, et appesantissaient la croix que nous portions ensemble. Mais à force d'avoir sous les yeux la tranquillité et la patience de leurs compagnons d'infortune, ils rentrèrent en eux-mêmes, et comprirent que notre attachement à l'Église catholique était le principe de cette paix et de cette résignation, qui paraissaient en nous dans l'état de santé et plus encore dans l'état de la maladie : aussitôt ils abjurèrent le schisme qui les séparait du centre de l'unité ecclésiastique, et ne firent plus avec nous
qu'un cœur et qu'une âme.
III. Mort du plus grande nombre des déportés.
Nous étions tous les victimes du Seigneur ; Il nous avait tout placés sur l'autel : mais Il ne voulut pas nous immoler tous, et Son glaive se contenta de frapper la plus grande partie d'entre-nous. Dans les dix mois qui s'écoulèrent depuis la fin de mars 1794 jusqu'au commencement de février 1795, les maladies nous enlevèrent à peu près cinq cent soixante confrères, détenus et souffrants avec nous ; voir aussi la note 2.
Sur leur lit de mort, c'est-à-dire, sur les planches des barques, ou sur le pauvre grabat qui leur avait été substitué, les déportés soupiraient après l'heureux moment où leur âme serait dégagée des liens du corps, pour être réunie au Dieu créateur, au Dieu rédempteur, au Dieu sacrificateur. M. Pétiniaud, vicaire-général de Limoges, ramassant le reste de ses forces, rappelait à des confrères mourants à ses côtés, plusieurs passages de la sainte Écriture analogues à leur situation commune, et leur disait avec effusion de cœur : «La mort est un gain pour nous. Qu'avons-nous besoin de vivre encore ? La cité sainte de la terre est livrée au pouvoir de ses ennemis. Ses vieillards ont été égorgés dans les places publiques, ses jeunes sont tombés sous le glaive homicide. Ses temples sont réduits à une profonde solitude, les instruments de sa gloire ont été enlevés. Ses jours de fête ont été changés en des jours de deuil ; ses solennités sont vouées à l'opprobre, sa magnificence profanée, son éclat souillé, ses honneurs anéantis. Mourons donc avec l'espérance que nous allons être introduits dans la sainte cité du ciel, et réunis à nos frères aînés qui déjà y ont été admis ; mourons avec l'espérance que nos tribulations, qui n'auront duré qu'un moment, opéreront bientôt en nous une gloire éternelle ; mourons avec l'espérance que Jésus-Christ transformera un jour notre corps vil et abject, pour le rendre conforme à Son corps glorieux». (Philip. 1. I. Machab. 1 et 2. Hebr. 2. II. Cor. 4. Philip. 3.)
Ils prenaient avec empressement la croix informe qu'un infirmier leur avait faite à la hâte, et comme il avait l'or ; et,
embrassant avec amour ce signe de notre salut, ils expiraient dans le baiser du Seigneur.
Dès qu'ils avaient expiré, les gens de l'équipage qui étaient présents, criaient avec une joie barbare : Vive la nation ! À bas les calotins : quand viendra la mort du dernier de ces scélérats ? Ce cri de triomphe se répétait ensuite sur les vaisseaux, et se prolongeait pendant un certain temps. On bâtait de faire enlever le corps des morts, et de le faire enfouir dans la terre, comme un objet d'horreur et d'exécration. L'île d'Aix, l'île Madame, et le rivage du Port-des-Barques, furent successivement le lieu destiné à la sépulture des déportés. C'était-là que les ecclésiastiques survivants étaient obligés de traîner sur une brouette, ou de porter sur une civière, et souvent sur le dos, chacun de leurs confrères décédés. Le transport fait, ils creusaient la fosse ; et, avant d'y déposer le corps qu'ils avaient apporté, ils étaient tenus, sous peine d'être fusillés, de le dépouiller entièrement, et de le réduire à une nudité absolue. Quatre soldats et autant de matelots, qui assistaient à l'inhumation, se jetaient sur les dépouilles du mort, et partageaient entre eux ce modique butin. Tandis qu'ils faisaient leur partage, ils disaient à ces ecclésiastiques affligés qui mettaient leur confrère dans la fosse, et recouvraient de terre son corps dépouillé : Scélérats, est-ce que vous avez la vie plus dure que celui-ci ? quand viendra donc votre tour ?
Frères bien-aimés, c'était ainsi que nous étions forcés de vous rendre les derniers devoirs ; c'était-là toute la pompe funèbre qu'il nous était permis de faire en votre honneur. Nous ne pouvions qu'arroser de larmes le coin de terre où nous déposions les restes de votre mortalité, et prier dans le secret du cœur pour le repos de vos âmes immortelles. Chers collègues, Dieu sait combien il nous en coûtait de vous perdre, et combien la séparation nous paraissait cruelle. Il nous semblait qu'on nous arrachait une partie de nous-mêmes, et nos cœurs faisaient de violents efforts pour vous suivre. Sans cesse de nouvelles pertes nous causaient de nouveaux regrets, et à peine pouvions-nous suffire à les pleurer toutes.
Cependant, parmi ces angoisses, Dieu répandait une douce consolation dans nos âmes. Nous ne pouvions nous empêcher de regarder votre mort comme précieuse aux yeux du Seigneur, et nous aimions à penser que vous jouissiez déjà du bonheur
promis à ceux qui souffrent persécution pour la vérité. Dans cette confiance, tous nos cœurs vous disait : «Athlètes de Jésus-Christ, vous avez bien combattu, et vous êtes parvenus au terme de la carrière, sans que votre foi ait été ébranlée ; nous espérons qu'en paraissant devant le juste Juge, vous aurez reçu de Ses mains la couronne de justice. Le fondement de notre espoir est dans la ressemblance que vous avez eue avec Jésus, qui est le souverain prêtre, le prince des pasteurs, le chef de toute l'Église. Serviteurs de ce Dieu qui s'est rendu pauvre, vous avez été revêtus de Ses livrées. Disciples de ce Dieu qui s'est fait l'homme de douleurs, vous avez porté Sa mortification dans vos corps, et la marque de Sa croix sur vos membres. Ministres de ce Dieu abandonné par Ses apôtres et par Son père à la fin de Sa vie mortelle, vous avez été, dans vos derniers jours, rejetés par vos concitoyens, et bannis du sol qui vous avait vus naître. Associés au sacerdoce de ce Dieu qui est tout à la fois sacrificateur et victime, vous avez pendant longtemps immolé l'hostie sainte, et vous avez fini par vous immoler vous-même comme une hostie d'agréable odeur. Le Père céleste vous a rendus semblables à Son divin Fils ; il doit donc vous glorifier avec Lui. Nos persécuteurs, en vous voyant mourir, ont cru que vous mourriez pour toujours, et votre sortie de ce monde leur a paru être un véritable anéantissement : mais vous vivez en présence du Seigneur, et la mort n'a plus d'empire sur vous. Maintenant donc que vous êtes entrés en possession du royaume auquel nous sommes tous appelés, souvenez-vous de vos compagnons de captivité, qui sont encore dans les fers. Maintenant que vous êtes parvenus à notre commune patrie, souvenez-vous de vos frères, qui demeurent encore dans ce lieu d'exil, dans cette vallée de larmes, sur cette terre qui dévore ses habitants. Demandez à Dieu pour nous, qu'il abrège notre pèlerinage, ou qu'il nous donne la force d'en supporter la prolongation. Demandez-Lui que ceux qui ont été associés à vos souffrances, le soient aussi à votre
félicité ; et, puisque notre Père a voulu que Ses enfants fussent, pour un temps, séparés les uns des autres, demandez-Lui qu'il les réunisse bientôt dans Son sein paternel.»
IV. Débarquement du reste des déportés, leur translation à Saintes
pour y être
reclus, leur bonne réception et délivrance en cette ville.
À la fin de novembre 1794, la Convention nationale, informée de notre malheureux état, avait ordonné qu'on nous mit à terre, et avait renvoyé l'exécution de son décret aux autorités constituées de Rochefort. Mais ces autorités étaient encore, en grande partie, composées des hommes sanguinaires qui avaient été mis en place pendant la tyrannie de Robespierre. Voulant donc prolonger nos souffrances, elles retardèrent l'exécution du décret qui nous était favorable ; et, pour avait droit de nous retenir sur les vaisseaux, elles dirent qu'elles n'avaient pas de local prêt à nous recevoir, et qu'il fallait prendre le temps d'en préparer un. Ce délai nous fut bien funeste : car il nous fit passer sur les vaisseaux le rigoureux hiver qui vint affliger la France ; et l'excès du froid, comblant la mesure de nos maux, causa la mort de beaucoup d'entre nous.
On résolut enfin de nous envoyer à Saintes. En conséquence, le premier février 1795, les deux vaisseaux quittèrent le Port-des-Barques ; et, le 5, ils arrivèrent à Rochefort, où ils ne ramenaient que 228 déportés, petit reste échappé aux ravages de la mort. Le lendemain on nous fit sortir des vaisseaux ; et on nous fit entrer dans plusieurs petites barques à pont, qui nous conduisirent le même jour à Tonnay-Charente. Nous y passâmes la nuit, entassés dans nos barques ; et, dans la matinée suivante, nous fûmes mis à terre.
Quinze charrettes attelées de bœufs, que le gouvernement avait fait tenir prêtes, se chargèrent de nos malades et nos infirmes ; et ceux d'entre nous qui pouvaient encore marcher se mirent à la suite ; trente gendarmes furent commandés pour nous escorter. Nous nous mîmes en route, et nous allâmes coucher à Saint-Porchaire. Nous reçûmes tout le jour une très forte pluie ; et, pour passer la nuit, nous fûmes déposés sur le pavé d'une église. On eut cependant quelque égard à notre situation ; et plusieurs grands feux furent allumés autour de nous, pour faire sécher nos habits et réchauffer nos membres. Mais une épaisse fumée remplit bientôt notre misérable gîte, et il nous impossible de nous délivrer de l'humidité et du froid qui avaient pénétré jusqu'à la moelle de nos os.
Le jour parut enfin, et nous poursuivîmes notre voyage. La pluie, qui n'avait pas cessé pendant la nuit, continuait encore quand nous nous mîmes en chemin ; et elle nous accompagna jusqu'à Saintes, où nous arrivâmes à onze heures du matin.
Malgré le mauvais temps, la curiosité avait rassemblé sur notre passage une foule nombreuse de spectateurs. Ils virent défiler, sous leurs yeux, les quinze charrettes remplies de nos malades et nos infirmes, lesquelles étaient suivies de ceux d'entre nous qui allaient à pied, et des gendarmes qui nous escortaient. Nos haillons dont la pluie avait détrempé tous les lambeaux, notre teint livide, nos joues creuses, notre corps décharnés, tout en nous témoignait l'affreuse misère à laquelle nous avions été réduits. Ce triste spectacle émut vivement tout ceux qui étaient témoins : ils ne purent retenir leurs larmes, en voyant parmi eux des hommes à demi-morts, des squelettes qui ne conservaient plus qu'une peau sèche et collée sur les os, des cadavres qu'animait à peine un faible souffle de vie.
Nous fûmes déposés dans la vaste maison qu'habitaient ci-devant les religieuses bénédictines de Notre-Dame, pour y demeurer
reclus tant qu'il plairait au Seigneur de le permettre. Là, un lit de paille était préparé pour chacun de nous. Mais la divine providence qui voulait faire cesser nos maux, nous avait conduite dans une terre bénite, où la charité, cette aimable fille du ciel, a établi son séjour de prédilection. Les habitants de Saintes vinrent à notre secours avec un empressement si vif, avec un concert si unanime, qu'en peu temps nous fûmes tous pourvus de couchettes, de matelas, de draps, de couvertures, de tables, de chaises, et d'autres meubles nécessaires. Nous manquions de vêtements et de linge, on se hâta de nous en fournir. Après que ces précieux services nous eurent été rendus avec le désintéressement le plus parfait, on établit en notre faveur un distribution journalière et copieuse d'aliments de la meilleure qualité, on y joignit les médicaments dont malades avaient besoin.
Une émulation générale animait tous les citoyens à nous faire du bien, et les plus pauvres même étaient jaloux de concourir à la sainte prodigalité qui nous concernait. Un journalier de la ville vint à notre maison de réclusion, s'adressa
à M. du Pavillon, vicaire-général du diocèse, et lui dit : Monsieur, mon travail me met en état d'acheter tous les jours deux bouteilles de vin pour mon usage, et celui de ma femme et de mes enfants ; permettez que je dispose d'une
en faveur d'un déporté. L'offre de cet excellent homme fut accueillie comme elle méritait de l'être.
Pour sentir tout le prix du dévouement universel dont nous étions l'objet, il faut savoir que les vivres étaient alors très rares et très chers à Saintes. Mais les généreux habitants faisaient tous les sacrifices nécessaires pour nous en procurer abondamment : ils se privaient d'une partie de leur subsistance, pour que la nôtre fût entière.
Le zèle infatigable du bon peuple qui prenait soin de nous, sa constante sollicitude, ses largesses continuelles, nous firent recouvrer nos forces avec une promptitude presque miraculeuse : le sang commença à remplir nos veines que la disette avait épuisées ; et les traces profondes que de longues souffrances avaient imprimées sur nos corps, s'effacèrent
presque entièrement. Nos malades furent bientôt rappelés des portes de la mort, et rendu à la vie.
Nos bienfaiteurs nous avaient meublés, vêtus, nourris, soulagés en toute manière, et presque ressuscités : ils couronnèrent tous leurs bienfaits, en obtenant du Comité de Sûreté Générale que la liberté nous fût rendue. Cet événement si heureux pour nous, fut un vrai triomphe pour eux : ils éprouvèrent encore plus de joie en nous annonçant la nouvelle de notre délivrance, que nous-mêmes en l'apprenant. Quand le moment de nous séparer d'eux fut arrivé, ils ne voulurent pas nous laisser aller, sans nous avoir donné l'argent qui nous était nécessaire pour les dépenses de la route.
Vertueux habitants de Saintes, peuple compatissant et généreux, telles sont les œuvres de miséricorde que vous avez pratiquées à notre égard. Vous avez vu les prêtres de votre religion éprouvant des besoins de tout genre, et vous les avez soulagés. Vous les avez vus réduits à une nudité presque entière, et vous les avez revêtus. Vous les avez vus tourmentes de la faim, et vous les avez nourris. Vous les avez vus travaillés de maladies, et vous les avez soignés. Vous les avez vus détenus dans une prison ; et non content de les visiter et de les assister, vous leur avez procuré la liberté. Après tant de bienfaits répandus sur les oints du Seigneur, il vous a semblé que aviez encore trop peu fait pour eux ; vos inépuisables libéralités, qui avaient satisfait à leurs nécessités présentes, se sont étendues jusqu'à leurs besoins futurs. Vous n'avez pas voulu recevoir les adieux, sans leur fournir des ressources pour la route qui leur restait à faire ; et vos dons les ont conduits jusqu'au lieu de leur destination. Rien n'a pu vous empêcher de suivre jusqu'à la fin les
mouvements de la charité de Jésus-Christ, qui vous pressait de secourir Ses ministres : les railleries, les injures, les menaces des ennemis de l'Église, n'ont pas été capable de refroidir votre zèle, ni de ralentir le cours de vos bonnes œuvres. Ces hommes sans pitié marquaient vos noms sur la liste de mort, mais le Dieu de toute bonté les inscrivait sur le livre de vie.
Oui, nos très chers frères, vous avez dilaté les entrailles des saints, que de longues angoisses avaient resserrées : vous leur avez procuré un repos qu'ils n'espéraient plus goûter. Leur âme s'est épanouie : elle s'est livrée à un sentiment qu'elle ne connaissait plus, à la satisfaction de trouver encore sur le sol de la France des cœurs sensible aux malheurs d'autrui. Depuis longtemps ils buvaient dans le calice des tribulations : dès qu'ils ont été arrivés dans l'enceinte de vos murs, ils ont été inondés d'un torrent de délices.
Vous tous qui avez été nos consolateurs, nos bienfaiteurs, nos libérateurs, que vous rendrons-nous pour la tendre commisération que vous nous avez témoignée, pour les charitables soins que vous nous avez prodigués, pour les abondantes largesses dont vous nous avez comblés ? Comment nous acquitterons-nous du tribut de reconnaissance que nous vous devons à tant de titres ? Ah ! nous ne pouvons pas répondre à votre générosité par des bienfaits réciproques, puisque Dieu nous a ôté toutes nos possessions en ce monde. Mais, dans notre dépouillement, il nous reste le cœur pour vous aimer d'un amour
éternel : il nous reste la bouche pour vous bénir à la face du ciel et de la terre ; pour vous souhaiter toutes sortes de prospérités, les biens de la nature et les dons de la grâce, la félicité de la vie présente et bonheur de la vie future. Puisse toute l'Église catholique être informée des aumônes que vous avez versées avec tant de profusion dans le sein de ses prêtres souffrants, et les célébrer avec nous à jamais !
___________________________________________________
[Notes de bas de page.]
1. M. Bourdon [frère Protais], gardien des Capucins de Rouen, est attaqué d'une fièvre violente, qui oblige ses compagnons de le lier avec leurs mouchoirs, pour se garantir des funestes effets de son transport. Le chirurgien appelé déclare que le malade est sans fièvre, et que les discours extraordinaires qu'il tient, sont la preuve d'une conspiration tramée par les déportés. Le capitaine des Deux Associés convoque le jury militaire. Déjà on propose de fusiller tous les ecclésiastiques qui sont à bord du vaisseau. Un seul officier arrête cette affreuse précipitation, en disant qu'il faut constater l'existence du complot ; et préalablement mettre aux fers le prétendu malade : cette avis prévaut. M. Bourdon est chargé de chaînes ; et après avoir passé le reste du jour à se meurtrir avec ses fers, il expire au milieu de la nuit dans des tourments affreux [le 23 août 1794].
L'officier de santé administra quatre à cinq grains d'émétiques à quatre ecclésiastiques
dangereusement malades. Un peu d'eau tiède, qui eut été si nécessaire pour donner de l'activité remède violent, leur fut refusée, et ils périrent dans des douleurs insensées.»
2. Voici les noms de ceux qui étaient les plus connus :
M. de Bonnay, vicaire-général de Mâcon ;
M. de Brie, vicaire-général d'Arles ;
M. de Brigeat, doyen du chapitre d'Avranches ;
M. de Cardaillac, vicaire-général de Cahors ;
M. Cordier, ex-jésuite ;
M. Foucault, archidiacre de Limoges ;
M. Gilbert, vicaire-général d'Angoulême ;
M. Imbert, ex-jésuite et vicaire apostolique de Moulins ;
P. Urbain Jacquemart, procureur-général des Augustins réformés de France ;
M. de Longueil, vicaire-général de Metz ;
M. de Luchet, chanoine de Saintes ;
M. de la Momagère, vicaire-général de Bourges ;
M. d'Omonville, chanoine de Rouen ;
M. de Peret, doyen de la Sainte Chapelle de Bar-le-Duc ;
M. Pétiniaud, vicaire-général de Limoges ;
P. Prieur de l'abbaye de La Trappe ;
M. de Richemont, vicaire-général d'Angoulême ;
M. Rolland, vicaire-général de Mâcon ;
M. Souzy, vicaire-général de La Rochelle ;
M. de Vassimont, vicaire-général de Saint-Dieu.
___________________________________________________
DE L'IMPRIMERIE DE CRAPART,
rue Thionville, n°. 44.
[Fin de la monographie de M.-B.-P. Bottin]
[Notes]
1. Marie-Bon-Philippe Bottin, Des souffrances de près de huit cents ecclésiastiques français,..., Paris, Crapart, 1796.
2. M. le curé Bottin (1750-18..), domicilié à Lagny-sur-Marne dans le canton de Meaux, fut condamné à mort comme réfractaire, le 16 octobre 1793, par le tribunal criminel du département de Seine et Oise ; malheureusement, en ce moment, d'autres détails de sa vie ne sont pas disponibles.
3. Le 2 juillet 1994, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a béatifié 64 prêtres qui sont morts sur les pontons mouillés en rade de l'île d'Aix ou sur l'île Madame, y compris Florent Dumontet de Cardaillac (mort le 5 septembre 1794), Jean-Nicolas Cordier (mort le 30 septembre 1794), Joseph Imbert (mort le 9 juin 1794), Raymond Pétiniaud de Jourgnac (mort le 26 juin 1794), Scipion-Jérôme Brigeat Lambert (mort le 4 septembre 1794), Jean-Baptiste Etienne Souzy (mort le 27 août 1794), Nicolas Tabouillot (mort le 23 février 1795) et, probablement, Gervais-Protais Brunel (moine cistercien de Mortagne, c'est-à-dire «P. Prieur de l'abbaye de La Trappe», mort le 20 août 1794) et Pierre-Joseph Le Groing de La Romagère (mort le 26 juillet 1794).
4. Pour un compte-rendu plus détaillé des prêtres pendant la Terreur, voir Jacques Hérissay, Les Pontons de Rochefort, Paris, 1925 (réimprimé chez Librairie de la Voûte, Paris, en 2000 ; 480 pages).
5. Pour un récit de la deuxième vague des déportations des prêtres, à la suite du coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), voir celui de Jean-Jacques Aymé (1752-1818), Déportation et naufrage de J. J. Aymé, ex-législateur ;..., Paris, Maradan, 1800 ; transcription.
6. Transcription en orthographe actuelle, ainsi que la carte, par Dr Roger Peters [Home Page (en anglais)].
[Décembre 2002]