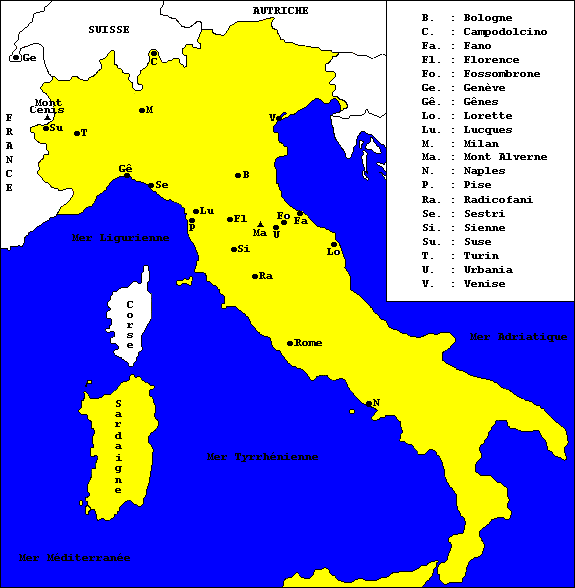
HISTOIRE DES TROMPERIES
DES PRESTRES ET DES MOINES
DE L'EGLISE ROMAINE,
Où l'on découvre les artifices dont ils se servent pour tenir les
Peuples dans l'erreur. Et l'abus qu'ils font des choses de la Religion.
Contenuës en huit Lettres ; Ecrites par un VOYAGEUR pour le bien du Public.
__________________________________________________________________
A ROTTERDAM,
Chez ABRAHAM ACHER
M. DC. XCIII
__________________________________________________________________
A Monseigneur de Bentin, Comte de Portland,
Conseiller du Roy en tous ses Conseils, &
premier Gentilhomme de sa Chambre, &c.
|
AU LECTEUR.
Ayant été prêtre séculier dans l'Église romaine, et ayant fait dans mes voyages, particulièrement dans celui d'Italie, plusieurs remarques assez curieuses sur la manière de vivre et sur les intrigues détestables des prêtres et des moines de cette même Communion, qui ne pouvaient pas si facilement venir à la connaissance des autres, j'ai cru les devoir donner au public. J'ai déclaré au commencement de ma première Lettre, la raison qui m'a porté à faire ces sortes de recherches. J'ajouterai seulement ici, que ceux qui connaissent l'esprit de Rome, n'auront pas de difficulté à ajouter foi aux matières de fait que je rapporte. Et je ne crois pas qu'aucun voulut hasarder son crédit à les critiquer, puisqu'elles sont encore aujourd'hui exposées aux yeux de tout le monde, et que tous les voyageurs, qui ont fait quelque séjour dans ces pays-là, en peuvent être tout autant de témoins.
Si je me sers quelquefois d'expressions, qui pourraient sembler un peu gaies, je prie mon lecteur de l'attribuer à la matière, et de considérer, que de même qu'on ne peut pas bien rapporter les choses sérieuses avec des termes enjoués, aussi n'est-il pas possible d'exprimer les ridicules avec un air de gravité.
Au reste je ne crois pas, que les Papistes aient sujet de se plaindre de moi, comme ils font ordinairement de ceux qui les abandonnent, qui est, que ces gens-là, disent-ils, ne cherchent qu'à les déchirer impitoyablement sans bornes et sans mesures. Car la vérité est, que j'ai encore assez de matière pour remplir un autre volume aussi grossi que ceux-ci, et qui pourrait leur servir comme de troisième tome. Mais j'ai bien voulu me retrancher afin qu'ils aient plus sujet de louer ma modération, que de se plaindre de la rigueur de ma censure.
Enfin, comme toutes ces observations, que j'ai faites dans mes voyages, ont beaucoup servi à mon changement de religion, j'espère que Dieu bénira la publication que j'en fais par une suite de bons effets, en défilant les yeux aux Papistes, décourageant ceux qui les trompent, et faisant que les Protestants rendront grâces à Dieu d'avoir été si heureusement délivrés d'un si misérable esclavage. C'est là Lecteur le principal dessein que je me suis proposé dans mon livre.
Adieu,
G. D'E. E. A. P.
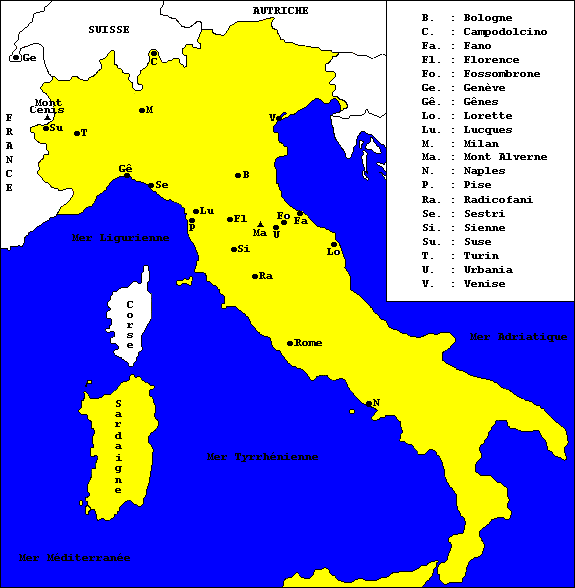
| 1° L. |
Des reliques, etc. Paris → Flavigney → Dijon → Cîteaux → Saint-Laurent → Mont Cenis → Suse. |
| 2° L. | De l'esprit de vengeance du clergé de Rome, etc. Suse → Turin → Gênes. |
| 3° L. | Des hôpitaux et des pèlerins d'Italie, etc. Gênes → Sestri → Lucques → Pise → Florence → Mont Alverne. |
| 4° L. | D'un voyage à Lorette, etc. Mont Alverne → Urbania → Fossombrone → Fano → Lorette. |
| 5° L. | Des fêtes et des confréries d'Italie, etc. Lorette → Rome. |
| 6° L. | Du déplorable abus qui se fait de la prédication en Italie, etc. Rome. |
| 7° L. | Des processions d'Italie, etc. Rome → Radicofani → Sienne → Florence → Bologne. |
| 8° L. | De la corruption des prêtres et moines italiens dans leurs dévotions et dans leur morale, etc. Bologne → Naples → Venise → Milan → Campodolcino → Genève [→ Allemagne]. |
PREMIÈRE LETTRE.
Des reliques, etc.
Vous n'avez pas oublié, Monsieur, que dans le dernier entretien que nous eûmes en France sur les matières de la religion, je vous engageai à m'avouer que la religion protestante était plus conforme à la raison que la Romaine que vous professez. Il est vrai que par un détour plus fin que solide, vous appeliez cette raison une raison humaine, appuyée sur les sens, qui sont, disiez-vous, comme l'écueil où la pureté de la Foi vient à faire naufrage. Vous vouliez que la Foi fût le fondement de votre religion à l'exclusion de tout autre, et comme vous admettiez librement avec vos théologiens plus de cent différents miracles dans la Transsubstantiation, vous disiez que c'était un mystère de la Foi qui doit être plutôt humblement adoré que témérairement approfondi. Lorsque je pris la liberté de vous dire que ma raison m'étant donné de Dieu, pour m'en servir dans la recherche de la vérité, il m'était difficile d'en rejeter les lumières, et que sans cela j'étais comme une personne qui tombe dans un eau profonde, et qui faute de trouver pied, se perd et se noye, vous me répondîtes que si je voulais suivre la raison vous me donneriez des guides capables de satisfaire un esprit bien fait, que je n'avais qu'à jeter les yeux sur de gens savants, de moines, et de prêtres qui sont les lumières du monde, les arcs-boutants et les colonnes de l'Église, qui par l'intégrité de leur vie, et par la pureté de leur doctrine supportent ici-bas le temple de Dieu : qu'il était moralement impossible que tant de gens savants fussent dans l'erreur, et que le consentement de tant de beaux esprits, vous semblait un fondement assez solide pour mettre un esprit raisonnable en repos. Vous me parlâtes en suite fortement de la modestie qui convient à ceux qui n'ont qu'une médiocre capacité. Vous savez bien que je reconnais mieux qu'aucune personne du monde la médiocrité, et que je vous remerciai de cet avis, en vous témoignant pourtant que quelque utile qu'il me paraisse, je ne croyais pas qu'il me dût arrêter dans la recherche de la vérité. Comme quelque temps après, en partie par dévotion et en partie par curiosité, j'entrepris le voyage d'Italie, je me suis ressouvenu du renvoi que vous m'aviez fait à vos prêtres et à vos moines, et je me suis appliqué plus que je n'aurais fait à examiner leur conduite, pour tâcher de reconnaître si c'était en effet un fondement suffisant et raisonnable, comme vous le prétendez, pour raffermir une personne qui commençait à douter de la vérité de vos principes que Dieu prît dès lors un soin tout particulier de disposer toutes choses pour m'en donner l'éclaircissement dans mon voyage. Il permit qu'en sortant de Paris, je m'associai avec un moine bénédictin d'une congrégation reformée, homme assez savant, et dont l'esprit et quelques bonnes qualités avaient attiré l'approbation des religieux de son Ordre pour l'envoyer pour la seconde fois leur procureur général en Cour de Rome. Il avait un extérieur fort avantageux et l'esprit fin, propre pour ménager l'esprit des cardinaux et s'insinuer dans celui du pape, et il s'était mis en voyage pour ce dessein. Nous prîmes notre chemin par la Brie et en suite par la Bourgogne, et passâmes sur la route par plusieurs monastères de son Ordre, où nous fûmes reçus et traités fort civilement, et où j'eus lieu de faire quelques observations, qui m'ont paru assez importantes pour vous les communiquer. Elles feront le sujet de cette Lettre, après laquelle je me réserve de vous faire part à la première occasion, si je reconnais que vous l'ayez pour agréable, des autres choses que j'ai eu lieu d'observer depuis mon entrée en Italie.
Nous arrivâmes le 13 juillet à une petite ville, sur les confins de l'Auxerrois, appelée Flavigny. C'est un lieu peu considérable pour le présent, quoique fameux pour un pèlerinage qui y a été entretenu depuis longtemps en l'honneur d'une sainte Reine, et très infâme pour les contestations et les impostures, qui étaient encore en chaleur sur ce sujet lorsque nous y passâmes. Une sainte appelée Reine souffrit le martyre aux environs d'Alisé, petit village à une lieue de Flavigny. Le terroir étant abondant en eaux salutaires et minérales, un temps fort considérable après, les moines de Flavigny firent la recherche du corps de cette sainte, et donnèrent à entendre au peuple que lorsqu'elle fut décapitée, dans l'endroit précisément où tomba la tête, une fontaine reconnue par expérience fort salutaire pour les malades, sourdit à l'instant comme un perpétuel miracle, en témoignage combien Dieu avoir approuvé la confession de foi de sa servante. Cette erreur s'étant ensuite continuée l'espace de plusieurs siècles dans l'esprit des peuples, et devenue d'autant plus incurable qu'elle étaient ancienne, il est arrivé depuis quelques années que les pères cordeliers, qui sont des religieux de l'Ordre de S. François, gens fins et rusés, ont obtenu de l'évêque du lieu de bâtir une petite chapelle autour de ladite fontaine, dont ils ont pris possession au grand regret des moines de l'Ordre de S. Benoît, anciens et paisibles possesseurs de toutes les reliques de sainte Reine ; qui virent par là combien il était dangereux d'avoir de si rusés voisins, et la faute qu'ils avaient faite d'avoir negligé de se rendre maîtres d'une source d'eau prétendue si féconde en bénédictions, et qui n'était éloignée que d'une lieue de leur monastère.
En effet les Cordeliers s'en surent bien mieux servir qu'eux. La dévotion augmenta en fort peu de temps au profit de ces bons pères, lesquels n'étant pas contents d'avoir la fontaine miraculeuse et voulant attirer à eux toute la dévotion du pèlerinage prétendirent un beau matin d'avoir une partie considérable du corps de la sainte. Ils commencèrent d'en exposer publiquement un bras tout entier ; de sorte que l'on vit paraître dans la distance de moins d'une lieue, une sainte à trois bras, au grande étonnement et scandale des peuples d'alentour, et d'une infinité de voyageurs et de pèlerins qui s'y rendent de toutes parts. Plût à Dieu qu'une telle avanture, et une infinité d'autres aussi étranges, eussent ouvert les yeux à ces pauvres peuples pour découvrir une bonne fois comme ces misérables moines les jouent ! Ils auraient pu reconnaître que non seulement les os qu'ils adorent sont très incertains, n'étant pris que sur la foi de gens qui n'en ont point ; mais encore que cette fontaine ne fut jamais miraculeuse, mais une excellente eau minérale, ainsi qu'on peut le colliger de la nature du terroir, et comme l'ont reconnu plusieurs fameux naturalistes et médecins qui ont écrit savamment sur ce sujet.
J'aurais souhaité, Monsieur, que vous eussiez été présent lorsque le père gardien de ce couvent — qui prit la peine lui-même de nous faire voir les beaux bâtiments et jardins qu'il avait bâtis de l'argent de la dévotion — se mit à discourir de sa prétendue relique, qu'il eût l'effronterie de nous montrer ; je suis sûr que vous seriez bien revenu de l'opinion avantageuse que vous avez de ces sortes de gens. Il protesta avec un blasphème horrible que pour lui, il ne croyait pas plus fermement le mystère de la Trinité qu'il était convaincu de la vérité de sa relique, nonobstant que l'évêque du lieu lui eût défendu de l'exposer d'avantage en public. Ce serait une chose trop ridicule de vous rapporter la voie et manière par lesquelles il assurait que ce bras leur était venu, jusqu'à y mêler les révélations de ses frères les Cordeliers, et le ministère des Anges, qui est voie ordinaire de l'introduction du culte superstitieux dans l'Église romaine. La réflexion que je vous prie de faire seulement sur ceci, est que véritablement c'est une chose pitoyable et lamentable de voir que les Catholiques romains, entre lesquels il ne manque pas d'y avoir plusieurs gens d'esprit, sont si obstinés que de ne vouloir pas être désabusés, quoiqu'ils voient tous les jours à leurs yeux plusieurs choses qui pourraient les tirer de l'erreur ; et il est à croire que par un juste jugement de Dieu, comme ils rendent un culte à leurs saints et saintes qui n'est dû qu'à Dieu seul, ils sont réduits à rendre le même culte à des choses qui dans leur approbation même ne le méritent pas. La plupart de leurs théologiens soutiennent que lors qu'une dévotion est une fois établie, quoique le sujet auquel elle se termine soit reconnnu en suite supposé, et même indigne de ce culte, on ne peut néanmoins en conscience en arrêter le cours ; parce que, disent-ils, le scandale que cela causerait, serait un beaucoup plus grand mal que celui que l'on voudrait ôter, et la simplicité d'un peuple abusé, et dont l'intention est toujours droite et pure, est beaucoup plus agréable à Dieu qu'une trop grande reserve, et défiance d'être trompé, qui pourrait les porter à revoquer en doute toutes sortes de reliques et de miracles ; ce qu'ils considèrent comme un très grand mal. Mais la vérité est que cela diminuerait trop leurs profits temporels, ni ayant point de pèlerinage qui ne leur en produise de très considérables par le nombre infini de neuvaines, de prières, et de messes que l'on y fait dire, qui sont toutes taxées à un très haut prix. Je puis vous rapporter sur ce sujet le résultat d'une conférence, où je me trouvai moi-même, il y a quelque temps, à Blois en France au sujet de plusieurs reliques conservées dans la paroisse de Saint-Victor, distante de deux lieues de ladite ville. Elles étaient fort mal en ordre dans de vieilles châsses de bois, presque pourries par la longueur du temps, ce qui empêchait de les porter en procession et de les exposer en public. Il s'agissait donc de les mettre plus à la mode, les transportant dans de nouvelles châsses. Pour cet effet, Monseigneur de Chartres, évêque du diocèse, fût supplié d'en faire la translation, lequel en envoya aussitôt les ordres à M. l'archidiacre de Blois, qui assembla plusieurs du clergé pour consulter avec le curé et les prêtres de Saint-Victor des précautions qu'il fallait prendre dans cette translation. La résolution fut que pour éviter le scandale qui pourrait arriver si l'on ne trouvait rien dans ces vieilles châsses, et pour ne point diminuer la bonne opinion et la dévotion du peuple si l'on ni trouvait que peu d'ossements, le transport dans les nouvelles ne se ferait point en public, mais le plus secrètement qu'il serait possible, en la présence seulement de quelques personnes prudentes, qui sauraient remédier à toutes sortes d'accidents en cas de besoin. Je fus prié par quelques amis de l'archidiacre de m'y trouver, et je puis vous assurer que la résolution fut prise que si l'on n'eût rien trouvé du tout dans les châsses, de soutenir ni plus, ni moins que les corps des saints y étaient tout entiers. Pour appaiser un peu les scrupules qui auraient pu naître sur ce procédé, un chanoine de Saint-Sauver de Blois, homme résolu, et de peu de conscience, soutint devant l'assemblée qu'on ne devait point faire de difficulté d'assurer une telle chose, toute fausse qu'elle fût ; que où il s'agissait de l'intérêt de l'Église il fallait sacrifier toutes sortes de respects et de sentiments ; qu'on ne devait point exposer les mystères des Catholiques aux railleries des hérétiques — c'est ainsi qu'ils appellent les Protestants — qui ne manqueraient pas de se moquer, sitôt qu'ils sauraient que l'on n'aurait rien trouvé dans les châsses de Saint-Victor, qui avaient été si longtemps le sujet de l'adoration des peuples ; que de plus la dévotion des séculiers pour les ecclésiastiques, était déjà si refroidie, que l'on n'en pouvait presque rien tirer que par un saint artifice. L'archidiacre écouta tout son discours sans le contredire en la moindre chose, et le curé de la paroisse comme y ayant le plus d'intérêt, l'en remercia hautement. Après quoi on procéda à l'ouverture des châsses, et la vérité est, soit de saints ou non saints, que l'on y trouva des os : mais un moine de l'abbaye de Saint-Omer de Blois qui était présent, s'écria sur l'heure, qu'il sentait une odeur très suave qui en sortait, et qui l'embaumait de telle manière qu'à peine pouvait-il se soutenir. Un jeune religieux son compagnon suivit immédiatement ; et quelques paysans de la paroisse protestèrent la même chose. L'archidiacre et tous les autres déclarèrent franchement qu'ils ne sentaient rien ; que toutes fois comme il se pouvait faire que ces personnes-là eussent quelque mérite particuler devant Dieu qui les rendit plus dignes de recevoir de semblables faveurs, leurs attestations seraient reçues et mises à la marge du procès-verbal que l'on faisait de cette translation, et dont l'original serait enfermé avec les reliques dans les nouvelles châsses.
J'avais la curiosité quelques semaines après, au temps des vendanges, d'interroger en particulier quelques-uns de ces paysans sur l'odeur qu'ils avaient sentie. Les uns dirent de rose, d'autres de jasmin, et d'autres de violette. Mais comme je m'aperçus qu'ils chancelaient et souriaient en même temps, je les pressai un peu davantage, et enfin ils m'avouèrent que la bonne opinion qu'ils avaient des deux moines qui avaient commencé à parler, les avait entraînés et comme forcé leur imagination, à leur faire croire qu'ils sentaient ce qu'ils n'avaient jamais senti en effet. Cette confession faite avec ingénuité, me fit rechercher l'occasion de parler à ces deux religieux. J'allai voir le plus jeune, auquel je fis premièrement deux ou trois visites de civilité, pour me le rendre plus familier. En suite j'obtins de son supérieur, de lui permettre de venir se promener avec moi à une maison de campagne ; où après quelques rafraîchissements, je le mis sur l'article des reliques de Saint-Victor. Vaincu par les civilités que je lui faisais, il me témoigna qu'il m'ouvrirait son cœur comme à son propre frère, et que la vérité était qu'il n'avait point senti cette odeur miraculeuse, dont il avait été le témoin : mais que pour ne point contredire son confrère, et par une soudaine honte qui l'avait surpris de ne pas paraître si privilégié que lui des faveurs célestes, il avait déposé contre sa conscience, et en avait eu ensuite quelque scrupule. Mais mon père, lui dis-je, comment pouvez-vous être en repos, si vous n'allez premièrement vous dédire de ce que vous avez avancé pour faire honneur à la vérité ? Le Diable est le père du mensonge, et vous ne pouvez pas prétendre à la qualité des enfants de Dieu, si vous ne détruisez l'œuvre du demon, dont vous avez été vous-même l'instrument. Il repartit qu'il avait consulté là-dessus ses supérieurs, et que le règle générale qu'on lui avait donné pour surmonter les scrupules de cette nature, était de considérer si la chose entreprise contre la gloire de Dieu, ou contre l'avantage de son Ordre ; que ce n'était point contre la gloire de Dieu d'avancer l'honneur d'un de Ses saints, lorsque de certaines circonstances glorieuses et utiles à l'Ordre engagaient de le faire, et que tout le mal en cela se réduisait à dire, que Dieu a fait ce qu'il pouvait faire, et ce qu'il a fait en plusieurs autres occasions ; ce qui n'était au plus qu'un petit péché véniel ; comme ils disent que sont tous les mensonges qui ne sont point contre la justice, c'est-à-dire qui ne sont tort à personne.
Ayant donc tiré de lui cette vérité, il ne restait plus que le vieux moine à convaincre ; ce qui ne me fut pas possible de faire ; car il persista toujours à soutenir ce qu'il avait avancé, et beaucoup plus, car il ajoutait que cette odeur l'avait suivi partout, tant qu'il était resté un peu de poussière de ces sacrées reliques sur ses habits. Cependant cela ne m'empêcha pas de considérer que toute la crédibilité de ce miracle, était réduite sur la conscience d'une seule personne, sur laquelle les autres déposants s'étaient reposés ; et qu'un jour lorsqu'on ouvrirait de nouveau les châsses où ce procès-verbal était renfermé, comme la superstition prend toujours de nouvelles forces du temps et de l'âge, ce miracle serait cru avec autant de fermeté que le sont dans l'Église de Rome une infinité de très faux et très ridicules. J'ai bien voulu, Monsieur, représenter à votre considération une chose qui s'est passée presque en vos quartiers, et dont vous pouvez vous informer vous-même quand il vous plaira ; afin que par la fidélité que vous reconnaîtrez dans le rapport que je vous en fais, vous soyez mieux disposé à ajouter foi à ce que je vous écrirai des pays étrangers. Je retourne présentement à notre voyage.
De Flavigny nous passâmes à Dijon, ville capitale du duché de Bourgogne, où je fus témoin oculaire d'une friponnerie qui s'y fit. Je ne vous rapporterai pas tant l'action pour elle-même, que pour vous y faire faire une réflexion fort importante à notre sujet. Nous allâmes à la Sainte-Chapelle, où l'on nous montra plusieurs reliques fort ridicules, et entre autres ce qu'ils appellent la Sainte-Hostie (1), dont ils racontent qu'il sortit très abondamment du sang par les endroits où ils disent qu'un Protestant la perça d'un couteau ; que d'hostie elle devint un petit enfant, et d'enfant retourna en hostie. Le discours nous porta insensiblement à demander pourquoi l'on ne voyait pas tant de miracles présentement, qu'il s'en faisait au temps passé. Le chanoine qui nous montrait les reliques nous fit là-dessus, que dans l'abbaye de Saint-Bénigne de la même ville, il s'en faisait encore presque tous les jours à un autel de la Vierge, où les enfants mort-nés étaient portés, et recevaient pour quelques moments la vie jusqu'à ce qu'ils eussent reçu le baptême. Ceci était estimé un très grand bonheur pour eux, puisque dans l'opinion de l'Église romaine les enfants qui meurent de la sorte ne peuvent point êtres sauvés par la foi des parents, mais descendent dans un lieu ténébreux qu'ils appellent les Limbes, qui est fait exprès pour eux, et où ils resteront éternellement sans souffrir la peine du sens, puis qu'ils n'ont point péché par les sens ; mais où ils souffriront la peine du dam qui consiste dans la privation de la vision béatifique de Dieu, qui est une peine due au péché originel. Il n'y a point sans doute de pères et de mères si dénaturés qui voulussent épargner leur argent à faire dire des messes et des prières, pour retirer leurs enfants d'un état si déplorable : et c'est le métier qui faisaient les bons religieux de cette abbaye. Nous allâmes sur les dix heures du matin à cette église, où était la miraculeuse image de la Vierge appelée communément la petite Notre-Dame de Saint-Bénigne, et nous y vîmes deux enfants mort-nés qui étaient depuis deux jours tout livides et noirs, et presque tous corrompus. Les parents qui étaient des meilleures familles de Dijon avaient pendant ces deux jours-là fait célébrer dans cette église plus de deux cents messes à un écu pièce, pour obtenir de Dieu par l'intercession de cette statue, et par les prières de ces religieux, autant de vie qu'il serait nécessaire à ces pauvres enfants pour recevoir le saint baptême. Les moines de cette abbaye auraient volontiers retardé encore un jour pour leur redonner la vie ; mais l'infection commençait à devenir si grande qu'il était presque impossible de demeurer dans l'église. Ainsi nous nous trouvâmes à temps pour en voir l'exécution. Vers midi qui était le temps de la dernière messe, un jeune religieux qui la servait, allant pour porter le livre du côté de l'Évangile, heurta de son bras, soit qu'il le fit exprès ou par inadvertance, la table de l'autel, sur lequel étaient les deux enfants mort-nés ; ce qui les fit remuer. Le prêtre qui disait la messe, et qui apparemment savait l'heure et le moment, s'en aperçut, et interrompant sur l'heure les sacrés mystères — ainsi que parlent les Papistes — il prononça à haute voix les paroles baptismales sur les enfants, «Je vous baptise, etc.» Leur jetant en même temps sur le corps l'eau dont il s'était lavé les mains. Au même instant un grand bruit s'éleva dans l'église, le peuple se mettant à crier miracle. Mes propres yeux ne pouvaient pas démentir de ce que j'avais vu, et j'aurais entrepris de tout mon cœur de désabuser ce peuple, si je n'eusse su combien il est dangereux de s'opposer à une populace aveuglée, conduite et entretenue dans l'erreur par des prêtres ou des moins, qui n'ayant point d'autre dieu que l'intérêt, l'auraient excitée sous prétexte d'hérésie ou d'incrédulité, à me mettre en pièces. Je ne laissai pas néanmoins d'en dire un mot en particulier à quelques personnes qui avaient été présentes à cette action, et qui m'avouèrent qu'ils avaient vu la même chose que moi. La Bourgogne a été de tous temps un pays abondant en superstition, et l'on en voit de tous côtés des marques. Aussi y a-t-il peu de pays où les prêtres et les moines fassent mieux leurs affaires, et soient plus riches. Je vous prie, Monsieur, de faire présentement réflexion que les pères de cette abbaye sont des religieux réformés de l'Ordre de S. Benoît, d'une congrégation que vous avez le plus en vénération en France, tant pour le savoir, que pour la piété que vous m'avez dit qui les rendaient également recommandables ; que si, dis-je, ces gens si saints et si vertueux dans votre estime, sont néanmoins si habiles et si attentifs à vous tromper, étant si amateurs de leur profit temporel, que ne devez-vous pas attendre de tant de religieux non réformés, qui menent une vie si licencieuse et si libertine à vos yeux, et qui sont profession ouverte de faire tomber les séculiers dans leur pièges par mille sorte d'artifices, pour avoir de quoi entretenir leur vie débordée et scandaleuse ?
Nous restâmes quelques jours à Dijon, où je serais trop long de vous raconter toutes les dévotions ridicules qui y sont en vogue, comme celle de Notre-Dame d'Ephèse de l'église Saint-Bernard, et de l'image de la Vierge conservée à Talent et prétendue avoir été peinte par S. Luc, et miraculeuse. Cependant comme la dévotion à ces sortes d'images croît or décroît selon que les prêtres ou les moines les savent faire valoir, cette dernière a beaucoup souffert, et est tombée presque dans mépris ; de sorte que le curé de cette paroisse désespérait presque de la remettre en crédit. Il nous dit qu'il n'avait plus pour cela qu'une ressource entre les mains, qui était de faire publier un miracle qui s'était fait depuis peu à cette image, qui était plus sensible que toutes les guérisons qui s'y faisaient tous les jours. C'est, dit-il, que m'étant aperçu il y a environ dix ans, que la dévotion diminuait notablement, je m'appliquai à en rechercher la cause : et trouvant que l'image était dans un fort pitoyable état, à cause de l'humidité du lieu qui avait presque pourri la toile, et que les rats en avaient mangé une partie et l'avaient extrêmement défigurée au visage, je m'imaginai que ce pouvait être là, la raison de ce que le peuple y était moins dévot. Pour y apporter le remède, je fis appliquer la vieille toile sur une neuve, et fis venir un des meilleurs peintres de Dijon pour la retoucher dans les endroits défectueux : ce qui fut fait avec beaucoup de soin et d'exactitude ; et un premier dimanche du mois l'image repeinte et rembellie de nouveau, fut remise avec beaucoup de solennité et grand concours de peuple dans sa première place. Depuis ce temps-là, poursuivit-il, j'ai toujours été travaillé de la goutte, et de plus la Sainte Vierge, pour témoigner qu'elle n'avait pas agrée qu'un autre peintre eut été si téméraire que de mettre les mains à l'ouvrage — que son serviteur S. Luc avait laissé à la postérité — pour le rétablir dans son premier lustre, elle a permis depuis quelques jours que les couleurs qui y avaient été ajoutées, se soient écaillées et tombées par terre ; ce qui fait que l'image est tombée dans le pitoyable état où elle était auparavant ; état qui est néanmoins beaucoup plus agréable à la Vierge, que de la voir mêlée avec des couleurs étrangères. Il ajouta qu'il avait fait imprimer le récit de ce miracle, et qu'il en envoyait des copies dans toutes les provinces circonvoisines et même dans les pays étrangers, et qu'il croyait que cela rappellerait la dévotion à son église. Ceci, Monsieur, m'est revenu depuis en mémoire dans mon voyage d'Italie, car étant à Bologne l'on me montra une fort belle peinture d'Annibale Carracci [1560-1609], en frais sur la muraille du cloître de l'abbaye de San Michele in Bosco, mais qui ayant beaucoup souffert par l'injure des temps, avait attiré la compassion de Guido Reni [1575-1642], un autre fameux peintre d'Italie, qui l'avait retouchée et remise presque dans son premier état. Cependant l'on voit présentement que la nouvelle peinture qui a été ajoutée sur la vieille tombe de même par écaille, et cela sans miracle, n'y ayant rien de plus naturel de voir, que de nouvelles couleurs couchées sur de vieilles ne peuvent pas s'incorporer si bien ensemble que lorsque les unes et les autres sont fraîches. Cependant quand la superstition est une fois introduite dans les esprits, elle les préoccupe tellement, que tout ce qu'il y a de plus commun et ordinaire leur semble un miracle. J'ai vu plusieurs autres images de la Vierge en Italie, que l'on dit avoir été peintes par le même S. Luc, et qui par cette raison sont toutes prétendues être miraculeuses, particulièrement celle de Santa Maria à Rome. Mais en vérité elles sont si différentes les unes des autres, qu'il est impossible qu'elle aient été peintes par une même personne, ni qu'elles soient toutes le portrait de la Vierge ; les traits, les linéaments, la figure, et les proportions du visage et du corps étant tout autres dans l'une que dans l'autre. Je vous en parlerai plus particulièrement dans mes observations d'Italie. Pour le présent, puisque nous nous trouvons encore à Dijon, je vous rapporterai ce dont j'ai été moi-même témoin oculaire dans la même abbaye de Saint-Bénigne des pères bénédictins réformés, où est conservée la statue miraculeuse de la Vierge pour les enfants mort-nés dont nous avons parlé ci-dessus. J'étais allé voir un de mes frères qui était religieux de cette abbaye. Comme je me promenais après dîner dans le jardin avec lui, un autre religieux accourut en hâte et lui dit à l'oreille qu'il se rendit incessamment à l'église pour y avoir voir quelque chose de fort curieux ; étant de compagnie, et connu de ces pères, je le suivis. L'affaire était que le prieur accompagné de sept ou huit de ses moines, étaient après à découvrir un ancien crucifix que l'on conservait dans une fort belle chapelle, que l'on appelle du même nom, la chapelle du Crucifix miraculeux. Il y avait quarante ans que ce crucifix avait été caché avec une voile de velours noir. L'histoire porte qu'un religieux de cette abbaye faisant un soir sa prière devant ce crucifix, la statue de Jésus-Christ qui y était attachée lui parla et lui dit : «Mon bien-aimé frère, couvre-moi, afin que je ne voie pas les iniquités de mon peuple, et que personne ensuite ne soit assez hardi de me découvrir pour voir ma face.» Ce moine exécuta sur l'heure l'ordre qu'il avait reçu et en donna avis à son abbé et autres religieux qui en portèrent incontinent la nouvelle par toute la ville ; ce qui donna lieu à cette grande dévotion qui continue encore aujourd'hui. Il y a un très grand concours de peuple, particulièrement tous les vendredis, et plus spécialement encore le Vendredi saint, toute la ville y vient en procession pour l'adorer et lui rendre le même culte qu'à Jésus-Christ même. Or le prieur de ce monastère qui un vieux routier et savant dans toutes les ruses monastiques, n'était pas beaucoup étonné de cette menace du crucifix, et était résolu à quelque prix que ce fut de satisfaire sa curiosité : ce qu'il fit. Il mit lui-même la main à l'œuvre, au refus qu'en firent quelques-uns de ses religieux qui témoignaient être plus épouvantés, et craignaient, disaient-ils, que le feu du Ciel ne descendit pour les consumer s'ils étaient assez hardis d'y toucher. Il découvrit lui-même avec un courage merveilleux la machine mystérieuse. Je riais en moi-même de voir la posture de ces moines qui étaient là présents. Les uns s'enfuirent, donnant à connaître qu'ils ne voulaient pas se rendre participants par leur présence d'un si grand attentat et sacrilège. Les autres se fermèrent les yeux pour ne pas être éblouis de la majesté de ce crucifix — Ne opprimerentur a gloria scrutatores majestatis. Et enfin les autres se prosternèrent la face contre terre, afin d'être regardés de leur divin Maître, ainsi qu'ils disaient, dans l'acte de l'adoration la plus profonde. Il n'y eut presque que mon frère et moi qui restâmes debout proche le prieur du monastère, qui était occupé à découvrir le crucifix, et lequel commençant lui-même, où faisaient semblant d'être effrayé, se mit à réciter le psaume, Miserere mei Deus etc. Mais ni les uns, ni les autres n'avaient pas sujet de craindre que rien leur sauta aux yeux, car on n'y trouva qu'un sac de toile où étaient enfermés quelques morceaux de bois tout pourris, qui étaient les pièces de cet ancien crucifix. Parmi tout ce débris, à peine pûmes-nous reconnaître la tête où était cette bouche miraculeuse qui avait parlé. Le tout était dans un misérable état, tout vermoulu et percé de vers sans forme ni figure, pleine de mouches mortes et d'araignées. De sorte que tous ces bons religieux qui étaient là présents, étant un peu revenus de leur frayer, et n'ayant pas vu tant de gloire qu'ils en attendaient, commencèrent à discourir entre eux pour accorder l'histoire de fait, c'est-à-dire l'état dans lequel ils trouvaient le crucifix, et leur tradition touchant la révélation et le discours du crucifix avec le religieux. Car s'il eût été vrai qu'il n'eût jamais été découvert depuis le temps qu'il avait parlé, étant attaché à la croix qui le supportait, comment se pouvait-il faire qu'on le trouvât présentement en mille pièces dans un sac ? Le supérieur conclut assez sagememt qu'il fallait qu'anciennement l'on eût eu en grande vénération ce crucifix-là, et que cela eût apporté quelque grand avantage au monastère, et qu'apparemment ce religieux par inadvertance ou autrement l'avait fait tomber et rompu en pièces, et que craignant d'être châtié sévèrement par son abbé, il en avait ramassé les morceaux dans un sac et les ayant attachés à la croix et couvert de cette pièce de velours noir, avait ensuite forgé et débité sa prétendue révélation ; que cependant comme il ne savait pas ce qui en était pour certain, il aimait mieux suspendre son jugement que d'en faire un téméraire ; et que d'ailleurs, selon leur principe général, la dévotion étant déjà établie, il ne voulait pas empêcher tant de bonnes œuvres qui étaient à ce sujet, ni interrompre le cours de tant de messes et de prières que l'on faisait dire à la chapelle du Crucifix miraculeux. Ainsi il rempaqueta tout lui-même, et remit tout dans l'ordre qu'il l'avait trouvé — et que l'on peut voir encore si l'on pouvait avoir assez de pouvoir de le faire — dans ladite chapelle, où la dévotion est continuée comme auparavant. Si les évêques catholiques romains avaient un peu plus de véritable zèle pour la gloire de Dieu et même pour l'honneur de leur parti, ils s'appliqueraient sans doute davantage à examiner les différentes dévotions qui sont pratiquées dans leurs diocèses ; je m'assure qu'ils trouveraient beaucoup d'impiété cachée sous le voile de la dévotion. Mais bien loin de cela, ils sont les premiers à les encourager par les indulgences qu'ils donnent sur ce sujet, aux chapelles et églises où elles sont entretenues, et grande quantité ont été accordées par les évêques de Langres à ceux qui réciteront cinq Pater et cinq Ave Maria à cette chapelle du Crucifix prétendu miraculeux de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Puisque nous voilà à Dijon, je n'oublierai pas, Monsieur, de vous entretenir d'un fameux nid de moines qui en est à quatre lieues. C'est la grande et célèbre abbaye de Cîteaux, dont l'abbé, comme vous savez, est chef et général de tout l'Ordre, qui est sans doute un des plus vastes corps religieux qui sont dans l'Église romaine. L'Empire, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et le Portugal sont pleins d'abbayes de cet Ordre, qui reconnaissent toutes celle de Cîteaux pour leur mère. Je connais très particulièrement le prieur du monastère, qui était un jeune homme d'Orléans, lequel m'invita de l'aller voir. L'abbé envoya deux de ses carrosses à six chevaux pour prendre quelques-uns de ses parents auxquels il voulait donner à dîner, et avec lesquels j'eus l'honneur de me joindre. Sur le chemin depuis Dijon on ne parla que de la fin tragique de M. Bourré, issu d'une des plus nobles familles de Dijon, et religieux du même Ordre ; lequel avait été exécuté depuis peu publiquement à Dijon, pour avoir empoisonné son abbé, qui avait voulu prendre connaissance de ses dérèglements ; le fait étant évident qu'il avait corrompu une partie des religieuses d'un monastère où l'abbé l'avait envoyé directeur et confesseur. Étant proche de Cîteaux j'admirai les avenues de cette superbe abbaye. Ce lieu qui n'était qu'une affreuse solitude lorsque S. Robert premier abbé de cet Ordre l'institua, est devenu présentement par la luxure et délicatesse des moines un paradis terrestre abondant en toutes sortes de délices. L'histoire porte que cet abbé, amateur du silence, se retira avec quelques-uns de ses disciples dans cet endroit, qui n'était alors qu'un bois fort épais et écarte de presque tout commerce avec les hommes. Ils commencèrent à se bâtir eux-mêmes des cellules avec des branches d'arbres, et quelques-uns d'entre eux se creusèrent des cavernes sous terre, sans artifice et sans forme, et très semblables aux tanières des bêtes sauvages. L'herbe et les racines qui croissaient dans les bois leur servaient indifféremment de nourriture, et toute la précaution qu'ils prenaient, c'était qu'après les avoir cuites ils en donnaient premièrement à manger à quelque chien ou autre animal domestique ; que s'il ne mourait ou ne devenait pas malade sur l'heure, ils se tenaient comme assurés qu'il n'y avait dans ce ramas aucune herbe venimeuse dont ils pussent craindre les dangereux effets. Mais ô Dieu ! quel changement ne se fit-il point quelque peu de temps après ? Les peuples d'alentour ayant eu connaissance de la vie surprenante qu'avaient entreprise ces solitaires, accoururent de toutes parts pour en être les admirateurs, et s'en retournaient publiant partout que dans les bois de Cîteaux ils avaient vu en leurs jours plus qu'Elie et plus que Jean-Baptiste. Et comme en ces temps-là le monde était plus susceptible de tendresse et de compassion pour des gens qui pour l'amour de Dieu, ainsi qu'ils le divulguaient, avaient laissé toutes choses, on leur porta de tous les endroits une grande abondance de vivres et de commodités pour la vie. Ces bons religieux se contentèrent pendant quelque temps d'accepter quelques-uns des plus grossiers, et ensuite peu à peu les plus délicats, les recevant comme un ordre exprès de Dieu, en s'attribuant la promesse de Jésus-Christ faite à Ses apôtres, qu'ayant tout abandonné pour l'amour de Lui, ils recevraient dans ce monde le centuple et en l'autre la vie éternelle. C'est ainsi qu'en fort peu de temps ces moines, d'une vie très extraordinaire et d'une piété très apparente, passèrent à une vie très scandaleuse, donc S. Bernard lui-même commença à se plaindre hautement de son temps ; mais qui présentement est crue à un bien autre degré d'excès. Au lieu d'une solitude, ils en ont fait, comme une ville qui renferme toutes sortes d'ouvriers dans son enceinte, qui y vivent avec leurs femmes et toutes leurs familles. Au lieu de cette diète si réformée à laquelle ils s'étaient attachés par vœu solennel au pied des autels, et particulièrement de ne point manger de viande toute la vie, ils en ont présentement, contre les vœux, introduit l'usage avec d'autant plus de délicatesse qu'ils l'accompagnent toujours avec l'agréable diversité des herbes et du poisson. Et pour moi véritablement je puis témoigner, que les deux jours que j'y restai, leur table outre les viandes communes, fut couverte de plusieurs plats de venaison, suivis d'un service de poisson où tous les bords étaient garnis de langue et de laitances de carpes ; et de queues d'écrevisses. L'abbé avait même fait venir de Dieppe qui en est distant de plus cent vingt lieues, avec un très grand coût et par une poste exprès qui courut jour et nuit, des soles qui se trouvèrent encore assez fraîches ; ce que les intendants et présidents au mortier de la ville de Dijon n'avaient pas encore osé entreprendre dans la somptuosité de leurs festins. Les moines de cette abbaye tout glorieux d'un excès qui aurait dû les confondre, se vantaient avec une impudence horrible qu'il n'y avait dans cette province qu'un abbé de Cîteaux qui pût faire et continuer tous les jours une telle dépense. Après le repas l'abbé suivi de plusieurs de ses officiers et d'un grand nombre de laquais en livrée, nous conduisit lui-même pour nous montrer des nouveaux bâtiments qu'il faisait faire dans son abbaye, et qui consistent en quatre grands corps de logis d'une magnifique structure, en des pierres de taille taillées en point de diamant, destinés pour loger séparément les quatre principaux abbés de l'Ordre avec tout leur train au temps des chapitres généraux. En un cinquième bâtiment qu'il faisait faire pour sa personne, était un superbe pavillon, qui élevait sa tête orgueilleuse au-dessus des quatre autres, comme pour les commander, et qui présentait en cela l'autorité que cet abbé a sur les autres en qualité de général. On nous conduisit ensuite dans les anciens bâtiments. Et c'est ici que m'aperçus de l'artifice de ces moines pour continuer encore, s'il est possible, le respect et la haute estime des séculiers pour leur monastère et pour leurs personnes. C'est de montrer à ceux qui les vont voir, une grande quantité de reliques, et de lieux qu'ils appellent de dévotion ; dans lesquels ils font plusieurs inclinations de corps et génuflexions, récitant quelques oraisons avec d'autres simagrées qu'ils vous obligent de faire aussi avec eux. Ensuite ils se mettent à vous raconter de vieilles histoires et miracles du temps passé, faits en faveur de leur Ordre ; entre lesquels ils ne manquent pas de faire venir toujours quelque usurpateur des biens de leur monastère, ou quelqu'un qui en a parlé, puni de Dieu de mort subite, frappé par la foudre, ou étranglé par les diables. J'ai observé la même ruse depuis dans presque tous les monastères et les couvents d'Italie, et dans tous les lieux où il y a quelque dévotion établie. Ils nous montrèrent un grand réfectoire des premiers religieux de leur Ordre, qui est un grand bâtiment voûté et fort long, sans ornement ni au-dedans, ni au-dehors, et plus semblable à une grande cave affreuse, qu'à un lieu propre pour manger. Cependant, commença à dire un de ces religieux, c'est ici la sainte grotte où nous anciens pères les bienheureux fondateurs de notre Ordre s'assemblaient tous les jours après soleil couché, fatigués du travail manuel et d'avoir chanté les louanges de Dieu, pour manger ensemble un pauvre morceau de pain noir, avec quelque peu de légumes ou de racines, sans sel, ni sans beurre ou aucun autre apprêt, et dans une quantité plutôt pour les empêcher de mourir que pour les faire vivre ; pratiquant des mortifications que l'on peut plutôt admirer qu'imiter. Ces grands saints sont présentement dans le Ciel, et ont échangé leur austérités avec les noces de l'époux ; et c'est de là haut qu'ils regardent continuellement d'un œil favorable ceux qui vivent ou ont vécu quelque temps dans ce monastère, ou qui y ont fait quelque bien considérable, et nous savons par révélation que quand bien même ils auraient mené une vie abominable, ils ne mourront jamais en péché mortel. Un conseiller de Dijon qui était là présent, lui dit en souriant, que peu s'en fallait que cela ne lui fit venir l'envie de léguer tout son bien au monastère ; et me poussant doucement par le bras, me demanda si je ne prenais pas grand plaisir d'entendre ce moine si gros et si gras, après avoir si bien dîné, parler de la pénitence de ses anciens pères et des bénédictions de Dieu sur son abbaye avec tant d'énergie. Cependant la vérité est que c'est là un artifice dont ils se servent pour jeter dans les esprits quelque sorte de vénération pour leurs Ordres et pour leurs personnes. De ce lieu on nous fit passer dans un autre qu'ils appellent l'ancien chapitre, qui est un bâtiment à la gothique avec plusieurs rangs de piliers, comme une église ; néanmoins assez magnifiques. Les carreaux du pavé sont coupés en autant de lettres qui forment tous les Psaumes de David ; et vers le milieu on nous montra une grande pierre sur laquelle on portait anciennement les religieux quelques heures auparavant que de mourir, et on les y exposait tout nus sur la cendre et sur un cilice pour les y faire expirer. Cette coutume, nous dit le père, a été abolie depuis, parce que l'on reconnut par expérience que quelques-uns avaient plus de force que l'on ne pensait, et restaient quelques fois inhumainement exposés à la violence du froid pendant vingt-quatre heures ou plus, avant que de mourir ; de sorte que l'on avait quelque scrupule d'en avoir été les homicides : et présentement, poursuivit-il en souriant, nous mourrons doucement sur la plume, après avoir expérimenté auparavant tout ce que l'art de la médecine peut fournir pour notre soulagement ; ce qui nous est autant méritoire que cette impitoyable rigueur, puisque nous soumettons en cela notre volonté à ceux qui nous commandent, et auxquels nous sommes obligés d'obéir : l'obéissance, même dans les choses douces, étant plus acceptable à Dieu que tous les sacrifices. C'est ainsi que ce père excusait la décadence de leur observance, et voulait faire paraître vertu ce qui n'était en effet qu'une production de leur mollesse, ou plutôt disons mieux, que par un juste jugement de Dieu ces sortes de gens ayant témérairement voue ce qui n'était pas en leur pouvoir d'accomplir, sont tombés d'autant plus bas qu'ils avaient prétendu de voler plus haut. C'est pour cette raison que nous voyons tant de réformes de ces Ordres religieux, et un peu de temps après d'autres réformes de ces mêmes réformes, qui auront encore besoin d'être réformés dans peu. Mais ce qui est d'étonnant en cela, c'est qu'ils tombent dans des corruptions étranges et dans des habitudes de péché qui font horreur aux gens les plus engagés dans le monde ; comme nous voyons dans ce peu que j'ai touché de M. Bourré, moine de cet Ordre, et dans une infinité d'autres exemples qui éclatent tous les jours.
Il n'y a qu'un seul Ordre religieux dans l'Église romaine qui puisse se vanter d'être ancien et sans réforme, qui est celui des Chartreux. Étant resté deux jours à Cîteaux nous prîmes notre chemin par le Lyonnais et par le Dauphiné, et comme nous nous trouvâmes assez près de la grande Chartreuse, la curiosité nous porta d'y aller. Cette Chartreuse est le chef de tout l'Ordre, et c'est là que se tiennent leurs chapitres généraux. Saint Bruno qui en fut le fondateur s'y retira avec ses compagnons, l'an de Notre-Seigneur 1084. Ce que l'on dit communément du motif de sa retraite est plutôt une fable qu'une histoire, et est néanmoins soutenu avec beaucoup de chaleur, comme une vérité, parce que ces pères, qui en ont fait faire une ample peinture dans leurs cloîtres : et est d'un autre côté dénié par les docteurs de la célèbre université de Paris. Cette fable porte que Bruno qui avait longtemps fréquenté l'université, se trouva à l'enterrement d'un docteur qui en était membre, homme d'une vie extérieurement irréprochable, et décédé en odeur de sainteté. Lorsque l'on récitait dans l'église l'Office des morts pour lui, et que l'on fut venu à ces mots des leçons, Responde mihi quantas habeo iniquitates, le corps du mort se leva de la bière sur son séant, et prononça d'une voix terrible ces mots : Accusatus sum — Je suis accusé. Ce qui ayant extrêmement surpris le peuple qui était là présent, on différa les obsèques jusqu'au lendemain, auquel on recommença de nouveau l'Office des morts. Et lorsque l'on fut arrivé aux mêmes mots, Responde mihi etc., le mort répondit avec un ton de voix plus effroyable que la première fois ces deux autres mots : Judicatis sum — Je suis jugé. Ce qui augmenta à l'étonnement de tous ceux qui s'y étaient rencontrés, et fit prendre la résolution de différer encore un jour à l'enterrer ; auquel une foule de peuple s'étant pareillement assemblée, l'Office fut recommencé, et aux mêmes mots le mort se leva pour la troisième et la dernière fois, disant avec un accent pitoyable : Condemnatus sum, qu'il était condamné aux Enfers sans ressource. Un spectacle si nouveau et si affreux, dit la fable (2), fit tant d'effet sur l'esprit de Bruno, que dès l'instant il résolut de quitter le monde, et de se retirer dans quelque solitude pour y vivre à Dieu seul, éloigné de la vue de monde ; et persuada la même à sept écoliers de l'université de Paris ses compagnons ; lesquels se joignirent à lui et allèrent ensemble se jeter aux pieds de l'évêque de Grenoble, pour lui demander le désert nommé Chartreux qui lui appartenait : ce qu'ayant obtenu ils s'y retirèrent et y bâtirent des cellules. La vérité de ceci est que ce saint se retira avec ses compagnons dans cet endroit : mais toute l'histoire du docteur est évidemment fausse, comme l'ont manifestement prouvé les docteurs de l'université de Paris, n'y ayant aucun écrivain contemporain, ni pendant l'espace de deux cents ans après qui en ait fait la moindre mention. Et ce n'est qu'une invention du cerveau des Papistes, propre d'être jointe à tous les contes qu'ils font des apparitions des âmes du Purgatoire. La curiosité vous portera peut-être, Monsieur, à souhaiter que je vous fasse la description de cette Chartreuse et de sa situation, qui est assurément le lieu le plus désert que la Nature pût former, et qui est néanmoins devenu aujourd'hui un séjour fort plaisant par les dépenses immenses que ces pères, qui sont extrêmement riches, ont faites pour le rendre agréable aux sens. Je tâcherai donc, Monsieur, pour vous satisfaire, de mettre sur le papier les idées qui m'en restent. Ce désert appelé Chartreuse a donné le nom à cet Ordre. C'est un lieu situé dans le sein d'une très haute montagne, dont le sommet se sépare en quatre autres, et forme au milieu, un espace d'environ un mile en longueur et plus d'un quart de mile en largeur, qui est l'endroit où sont bâties les cellules de ces pères. Les eaux qui se ramassent dans cette montagne forment un très impétueux torrent, qui port le nom de Saint-Laurent. C'était un lieu fort escarpé et presqu'inaccessible lorsque S. Bruno s'y retira : mais présentement, avec des sommes immenses, les religieux en ont rendu le chemin fort facile et fort plaisant, ayant taillé de très larges degrés dans le roc et fait comme plusieurs escaliers pour y monter. Ni carrosses, ni charrettes, ni mêmes les chevaux n'y peuvent aller, et ils se servent de mulets accoutumés de jeunesse à monter et à descendre ces degrés, pour y convoyer toutes leurs provisions. Nous y montâmes par la voie de ces même commodités ; la neige y était encore en plusieurs endroits sur la pointe des rochers, quoique ce fut sur le milieu du mois d'août, et qu'il fit au bas de la montagne un chaud presque insupportable. La Chartreuse n'était pas encore achevée de bâtir, n'y ayant que fort peu de temps qu'elle avait été toute réduite en cendre. On soupçonna ces religieux d'y avoir eux-mêmes mis le feu tout exprès, parce que leurs cellules leur semblaient trop à l'antique et trop étroites, et qu'ils ne pouvaient pas y avoir toutes les aises qu'ils auraient souhaitées. Ce fut dans un temps que le vent était si favorable pour cet effet, et le feu prit dans un endroit où les matières étaient si combustibles, et si fort éloigné de toutes les officines à feu, qu'il était aisé de juger que ce n'était pas tant par accident, que par propos délibéré que l'embrasement avait été causé. De plus la lenteur à y remédier témoigna quelque empressement dans ces religieux pour la voir plutôt consumée, et quelques-uns ont assuré qu'on en savait déjà la nouvelle plusieurs jours auparavant dans les pays étrangers. Un de ces pères nous en fit le récit comme d'un miracle, disant qu'il fallait que l'Ange titulaire de ce lieu prévoyant ce qui devait arriver, en eût donné la connaissance dans ces provinces éloignées. Quoiqu'il en soit, la Chartreuse fut toute réduite en cendres, et en moins de six mois presque toute rebâtie. La plupart des matériaux ayant été préparé par avant et comme par une Providence divine, ainsi que ce père disait, dans des endroits proches de la montagne. Il est à remarquer que leur chapitre général ayant quelque vénération pour ces anciens bâtiments de leurs premiers pères, et pour empêcher aussi les séculiers de les taxer de délicatesse leur avait refusé la permission de bâtir. Mais qui peut retenir la convoitise des moines, lorsque par voies directes ou obliques, per fas et nefas [par tous les moyens possibles], ils ont en main les moyens de l'accomplir ? Les nouveaux bâtiments furent réduits à perfection avec une magnificence beaucoup au-dessus de la modestie convenable à la profession de ces solitaires, et plus propres pour loger des rois que des ermites. Il ne restait plus qu'un bâtiment au pied de la Chartreuse à achever, et qui était déjà avancé. Pour ce qui est la manière de vivre de ces religieux, je puis dire qu'ils ont encore retenu quelque chose de leur première institution, particulièrement l'abstinence de la viande : mais la diversité et quantité des poissons, des herbes, des œufs et autres choses semblables qui leur est servie est beaucoup plus agréable aux sens que l'usage des viandes, et d'un plus grand coût. Le père procureur de cette maison nous assura que la dépense de chaque religieux montait au moins à cinq cents écus l'année. Ils ont le moyen de tirer la substance et comme la quintessence de plusieurs gros poissons dont ils font des consumés extrêmement nourrissants. Le pain d'une blancheur extraordinaire et le meilleur vin qui se puisse avoir leur est donné sans mesure. Outre cela chaque Chartreux dans son appartement a un grenier plein de fruits, de sorte qu'ils peuvent boire et manger en tout temps, et traiter les amis qui les vont voir pour charmer leur solitude. Quelques-uns d'entre eux qui sont d'un tempérament mélancolique sont tellement enfoncés dans leur solitude qu'ils ont en horreur la conversation, et ne veulent pas même parler à leurs supérieurs : ce n'est pas vertu mais une humeur sauvage qui les domine, et les rend presque insupportables à eux-mêmes, et comme Timon l'Athénien, ils haïssent tout le genre humain ; la plupart de ceux-là deviennent entièrement fous, perdant l'usage de l'esprit et de la raison. C'est pourquoi l'on a bâti dans ce lieu-là un assez appartement pour eux. Chaque Chartreux a son appartement séparé qui consiste en cinq ou six belles chambres bien proprement ornées et un beau jardin qui fait la séparation d'un appartement d'avec l'autre, lesquels ont tous leur issue dans le cloître qui est d'une longueur prodigieuse, et d'une très riche et magnifique structure. De sorte qu'il paraît n'être pas tant bâti pour la commodité des cellules que pour l'embellissement et ornement de ce lieu. L'abord des étrangers qui y viennent de toutes parts, par curiosité et par dévotion, quelques-uns pour affaires, et d'autres pour y voir quelques Chartreux de leurs parents ou de leurs amis, a rendu cette solitude fort fréquentée, et par conséquent moins affreuse à la Nature, et en été particulièrement plusieurs personnes de qualité s'y retirent pour y jouir des délices et des fraîcheurs de la montagne. Ces pères, pour être visités plus souvent, et y attirer leurs parents et amis, ont établi l'hospitalité, et reçoivent un chacun selon sa qualité, homme et équipage, sans qu'il en coûte rien. L'on y peut rester plusieurs jours selon que votre compagnie leur est agréable ou utile. Au commencement ils avaient aussi quelque égard pour les pauvres, mais présentement, si les gens qui y vont ne sont pas de façon et en bon ordre, ils les négligent et les méprisent. L'endroit où l'on reçoit les étrangers est un bâtiment très superbe et somptueux, où il y a des appartements destinés pour des personnes de qualité de toutes sortes de rangs. L'officier établi sur la cuisine sait quelle sorte de traitement est convenable pour chaque chambre, ce qui est observé très exactement. Par là on peut juger des richesses immenses de ces pères. Vous vous étonnez, Monsieur, de voir que ces solitaires dont l'instituteur S. Bruno témoigna être si grand amateur de la pauvreté, de la retraite, et du silence, soient parvenus par succession de temps à un si haut degré de puissance et de grandeur, et si ardents à changer leur désert, d'ailleurs si écarté, en un pays si habité, et à le rendre plus plaisant que ne le sont les grands chemins qui conduisent aux grandes villes. Ils se vantent de n'avoir jamais été réformés depuis leur première institution : mais en bonne foi, Monsieur, ne croyez vous pas qu'ils auraient besoin d'une bonne réforme ? Ce qu'il faut conclure de là, c'est que tous ces grands efforts que l'on fait au-dessus de la Nature, qui ne peuvent subsister que par une grâce et assistance très particulière de Dieu qu'il donne à qu'il Lui plaît, lorsque l'on se les veut approprier et en faire témérairement profession, et comme un état fixe, s'y attachant par des vœux, se terminent toujours dans des faiblesses honteuses qui découvrent qu'ils étaient plutôt des artifices du Demon pour élever le cœur de l'homme et le précipiter en suite, que des mouvements de la grâce pour l'humilier premièrement, et par là faire triompher du Diable, de la chair, et du monde. Pour nous jeter en suite de la poussière aux yeux, et divertir notre esprit de faire réflexion sur un si grand désordre, on nous conduisit à la chapelle de Saint-Bruno qui n'en est éloignée que d'un quart de mille, sur un rocher entouré de très hauts sapins. Ils nous dirent que c'était là autrefois sa cellule, et qu'une source d'eau très pure qui en sortait avait été obtenue miraculeusement par ses prières, et rendait la santé à plusieurs malades, et que quoique l'on en bût avec excès l'on n'en pouvait jamais être incommodé. Le père bénédictin avec qui j'étais associé dans le voyage en bût par dévotion une assez grande quantité, ce qui l'incommoda fort en descendant de la montagne, quoique pour ne rien déroger au miracle, il l'attribuât à l'air froid et coulé de ces rochers. Ce père me répéta plusieurs fois qu'il ressentait dans ce lieu son âme pénétrée d'une dévotion extraordinaire, et d'un grand sentiment de la présence de Dieu, et me demanda si je ne ressentais pas la même chose ? Je lui répondis que oui, mais qu'en cela je ne croyais pas qu'il y eût rien que de très commun et de très ordinaire, étant chose très naturelle dans les grottes, les lieux obscurs, les forêts épaissies et sombres, dans les cavernes, à la source des fontaines et des rivières, et même lorsque l'on se trouvait seul ou peu accompagné de nuit dans de grands bâtiments, dans des chapelles, ou dans des églises, de ressentir son âme émue d'une certaine horreur qui rappelle Dieu à notre souvenir. Ce que j'ai moi-même expérimenté dans mes voyages ; et comme quelques jours après je passai les Alpes, qui sont de très hautes montagnes, avec ce père, lorsque nous fûmes arrivés à un endroit fort solitaire, je lui en fis faire la remarque et avouer que véritablement il se trouvait autant ému qu'il l'avait été à la grande Chartreuse. Néanmoins ces bons pères font observer cela à tous les étrangers qui y vont, comme une bénédiction particulière de Dieu donnée à ce lieu par l'intercession et les mérites de S. Bruno. Il est étonnant de voir que les chose que Dieu comme auteur de la Nature opère en nous, sont la plupart du temps par les gens de la Communion de Rome attribués à Dieu comme auteur de la grâce et des prodiges à leur égard : tant il est vrai que c'est une chose douce et qui flatte extrêmement l'orgueil de l'Homme de croire que Dieu nous juge dignes de nous tirer de la voie ordinaire, pour nous favoriser particulièrement, renversant à tout moment pour notre sujet l'ordre naturel qui'il a établi ici-bas, par des opérations miraculeuses. Nous descendîmes de cette Chartreuse par un chemin fort étroit entre les rochers l'espace de près de deux lieues ayant à notre gauche le torrent de Saint-Laurent qui se précipite avec un bruit effroyable du haut de la montagne jusqu'au pied de la petite ville de Saint-Laurent qui lui donne le nom. Tout le pays circonvoisin plusieurs lieues à la ronde appartient aux Chartreux, et l'on y avait de tous côtés les superbes bâtiments et maisons de plaisance que ces pères y ont fait bâtir, avec des étangs et de réservoirs pleins de toutes sortes de poissons rares pour l'entretien de leur bouche. Nous nous acheminâmes ensuite verse la Savoie, et passâmes les Alpes par le mont Cenis d'où nous descendîmes dans le Piémont à une petite ville que l'on appelle Suse. C'est ici, Monsieur, que je m'arrêterai, et conclurai cette Lettre par cette dernière réflexion que je vous prie de faire, qui est que l'Église romaine bien loin d'avoir sujet de se faire un honneur particulier de ses Ordres religieux dont elle se vante tant, au-dessus de l'Église protestante qui les a exclus, devrait s'en humilier, et même en rougir, puisqu'il est évident que ces gens-là ne travaillent sous des prétextes spécieux de dévotion, de silence, et de retraite qu'à s'acquérir une grande estime dans l'esprit des peuples ; ce qui fait qu'ils les tournent ensuite où il leur plaît, et l'expérience fait voir que c'est toujours à leur avantage temporel. Ils commencent par l'esprit en apparence, et finissent évidemment par la chair. J'ai fait d'autres découvertes plus curieuses en Italie, que je serai bien aisé de vous communiquer, si je reconnais que vous ne soyez point offensé de cette première Lettre, mais que vous l'ayez reçue avec le même esprit de charité et de zèle, que je conserverai toute ma vie pour le bien spirituel de votre chère personne, comme étant, Monsieur, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Le 10 février 1794, cette irremplaçable Sainte-Hostie fut brûlée par Charles Montéléon, curé constitutionnel de l'église Saint-Michel de Dijon.
2. Il s'agit de la soi-disant «triple-résurrection» de Raymond Diocrès en l'année 1082 ; et voici l'échange plus complet. Responde mihi quantas habes iniquitates et peccata — Réponds-moi, combien as-tu commis d'iniquités et de péchés ? (1e jour) Justo judicio Dei accusatus sum — Je suis accusé par un juste jugement de Dieu ; (2e jour) Justo judicio Dei judicatus sum — Je suis jugé par un juste jugement de Dieu ; (3e jour) Justo judicio Dei condemnatus sum — Je suis condamné par un juste jugement de Dieu.
SECONDE LETTRE.
De l'esprit de vengeance du clergé de Rome, etc.
Monsieur.
Comme il n'y a rien qui vous soit plus sévèrement défendu dans l'Église romaine, après la lecture de l'Écriture sainte, que celle des écrits qui entrent en discussion de la vie et de la doctrine de vos pasteurs, parce qu'ils veulent qu'on les suive aveuglement sans examiner ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font, j'appréhendais un peu pour ma première Lettre qui vous a fait quelques découvertes de leur conduite. Mais voyant le bon accueil que vous lui avez fait, j'espère que ce peu de réflexion que vous y aurez fait, et la bonne disposition que vous me témoignez de vouloir bien être instruit d'avantage sur ce sujet, pourront enfin vous faire ouvrir les yeux pour reconnaître l'état dangereux où vous êtes. Comme je ne désire rien plus que servir d'instrument pour produire un si bon effet, je continuerai, Monsieur, à vous communiquer les observations que j'ai faites dans mon voyage sur les matières de la religion.
Étant arrivés à Suse, petite ville du Piémont en Italie, et sujette au duc de Savoie, l'on nous dit que le corps de S. Maur, abbé et premier disciple de S. Benoît, reposait dans une des églises de ce lieu-là. Comme le père qui s'était rendu le compagnon de mon voyage, était un Bénédictin réformé de la Congrégation de S. Maur en France, je lui demandai s'il ne voulait pas aller rendre ses devoirs à cette relique de son bienheureux fondateur ? Il me répondit fort librement, qu'il s'en donnerait bien de garde ; que les Italiens étaient des fourbes qui prétendaient avoir tous les saints de Paradis dans leur pays, et que cependant il n'y avait rien de plus faux, parce que le corps de S. Maur était conservé tout entier dans une de leurs abbayes en France. Il assurait de même que les corps de saint Benoît et de sainte Scholastique y étaient pareillement, le premier dans la petite ville de Saint-Benoît-sur-Loire à huit lieues d'Orléans, le second au Mans, quoique toutes ces reliques, et une infinité d'autre d'une vérité authentique leur fussent contestées par les Italiens, sans autre fondement que quelques bulles des papes qu'ils ont obtenues, disait-il, par artifice, et qui les déclarent être véritables et légitimes possesseurs de ces reliques, contre toute sorte d'évidence tirée de l'histoire et de la tradition. Mais mon père, lui dis-je, vous souvenez-vous du discours que vous teniez il y a deux jours, lorsque nous passions les Alpes, pour prouver l'infaillibilité des papes : vous l'étendiez avec chaleur non seulement aux matières de droit, mais encore à celles de fait ? La question était comment il se pouvait faire que les papes eussent donné des bulles si fulminantes, pleines d'excommunications et d'anathèmes contre ceux qui ne croiraient pas que la maison de Lorette eût été transportée de la Terre sainte par les anges, dans l'endroit d'Italie où l'on suppose qu'elle est à présent ; et de même contre ceux qui dénieraient qu'une grande montagne qui est proche de la ville de Chieti, dans le royaume de Naples, et qui est toute entr'ouverte, ait été une de celles qui s'entr'ouvrirent à la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Vous assuriez que le pape dans ces sortes d'occasions recevait une direction infaillible du Saint-Esprit, suivant laquelle il lui était impossible d'errer lui-même, ni de tromper les autres, non plus que dans les matières de la Foi, et plus particulièrement encore lorsqu'il s'agissait de rendre un culte religieux à quelque objet de dévotion, tel qu'était celui que l'on rendait à la maison de Lorette et à cette sainte montagne : Comment pouvez-vous donc dire présentement, mon père, au sujet de votre S. Maur et de votre S. Benoît, ou de quelque autre que ce soit, que ces papes qui ont prononcé contre vous en faveur des Italiens, ont été abusés ? N'est-ce pas une matière de culte, aussi bien que celle de Lorette ? La parité était trop visible, et ce bon père se serait engagé dans une trop fâcheuse contradiction en soutenant le contraire. Pour éviter donc la confusion qui lui en aurait pu arriver, il aima mieux tourner sa réponse en plaisanterie, en disant que dans les Alpes il avait pensé comme un Italien, mais que présentement il parlait comme Français ; parce qu'il est vrai que les peuples d'Italie, et particulièrement ceux des territoires du pape, reconnaissent l'infaillibilité du Saint-Père dans les choses de fait ; ce que la plupart des Catholiques romains dénient en France. Cette distinction de parler comme un Italien, ou comme un Français, était dans le fond bien frivole ; et en vérité s'il était permis produire ses sentiments, tantôt selon l'inclination d'un pays, et tantôt à la façon d'un autre, si ce père eut parlé comme un Allemand, ou comme un Hongrois, il aurait réduit l'autorité du pape sur un fort petit pied ; car j'ai observé dans mes voyages que ces peuples, quoiqu'ils professent la plupart la religion romaine, ont l'avantage de n'y croire guère. Il aurait sans doute bien mieux valu, Monsieur, qu'il eût parlé comme un bon Chrétien doit faire, en homme d'honneur et de bien, avec un esprit sincère et désintéressé, fortifié par la grâce, appuyé par la raison, et fonde sur l'Écriture sainte, et il n'aurait pas attribué à un homme mortel sur la Terre le titre d'infaillible qui n'appartient qu'à Dieu seul. J'étais sur le point de lui en dire mon avis, mais je me ressouvins que j'étais en Italie, où une seule parole aurait pu me faire traîner devant le cruel et impitoyable tribunal de l'Inquisition : ainsi j'aimai mieux me taire. Je fis seulement réflexion en moi-même le procédé de ce religieux, que là où les prêtres et les moines trouvent leur avantage, ou dans les choses qui leur sont indifférentes, ils ne manquent pas de publier que le pape est infaillible : Mais si cette infaillibilité leur porte le moindre préjudice, il n'est plus qu'un homme ignorant et errant qu'on peut tromper comme les autres.
De Suse nous nous transportâmes à Turin, qui est une fort belle ville sur les bords du Pô et le lieu de la résidence des ducs de Savoie. C'est là qu'un commencement de la beauté des églises d'Italie se présenta à nos yeux. La plupart des paroisses, des monastères et des couvents y sont très richement bâtis, et ornés au-dedans très somptueusement. On n'y voit que marbres, porphyres, jaspes, dorures et peintures de tous côtés. Les croix, les chandeliers, les lampes, les bustes et les châsses pour les reliques y sont toutes d'or et d'argent, d'un nombre et d'un prix presque infini. Quelques bons prêtres français qui s'étaient joints avec nous pour aller voir les églises, étaient dans un prodigieux étonnement, et se sentant tout attendris devoir partout les temples du Seigneur si bien ornés, en pleuraient de joie. Et comme en sortant de France ils avaient pris leur chemin par Genève, et par les cantons suisses, où ils avaient vu les temps des Protestants dénués presque de toutes les beautés matérielles, ils concluaient de là fort faussement qu'il n'y avait point d'autre véritable religion que la Romaine, et que son zèle pour la maison de Dieu rendait témoignage de la vérité de sa croyance. Je leur dis que cette conclusion me paraissait aussi faible que l'étaient les principes qui l'appuyaient, et que pour preuve de la vérité d'une religion, les grandeurs et les richesses du monde étaient de très pauvres prémices ; et que pour moi si j'avais à former un argument présomptif en matière de religion, j'aimerais mieux le tirer de la bonne vie et des mœurs de ceux qui la professent, que du somptueux ornement de leurs églises. On nous montra le trésor d'église où est conservé le Saint-Suaire ; et un peu après les chanoines et les prêtres entrèrent au chœur pour chanter vêpres et complies, qui sont les prières du soir de l'Église romaine. Ils entrèrent sans ordre, indécemment, en causant et en riant, et en se poussant les uns les autres par les bras. Les premiers venus, sans attendre que les autres fussent rangés à leurs places, commencèrent à chanter l'Office. Ce qui aurait pu durer une heure et demie de temps à réciter, avec les pauses requises, dévotement et modestement, ainsi qu'il est pratiqué dans les prières journalières que l'on fait dans l'Église anglicane, fut dépêché en moins d'un quart d'heure avec une étrange précipitation, sans qu'on pût presque distinguer un mot d'avec l'autre, ni la fin des versets d'avec le commencement. En vérité, Monsieur, s'il était permis de juger des consciences par l'extérieur, j'aurais pu inférer du leur, que leurs cœurs étaient bien éloignés des paroles de leurs lèvres, et leurs lèvres et leurs cœurs encore plus de Dieu. Ils ne fatiguèrent pas beaucoup notre patience à les entendre ; et le service étant promptement achevé, ils s'enfuirent plutôt qu'ils ne sortirent de l'église, chacun de leur côté. Le père qui était avec moi, s'apercevant que j'en étais scandalisé, me dit, comme il avait quelque expérience de l'Italie, en ayant déjà fait le voyage une autrefois, qu'il n'était pas encore temps de l'être, et que plus j'avancerais du côté de Rome, plus j'en trouverais de sujet. L'on m'avait déjà dit que plus j'irais en avant, et plus je trouverais de belles églises et plus richement parées. Ainsi joignant ces deux choses ensemble, j'en concluais que toutes ces belles parures extérieures ne procédaient pas assurément de la piété et du zèle des ecclésiastiques d'Italie pour la maison de Dieu, puisqu'ils en négligeaient le principal ornement qui était l'intérieur, et qu'il fallait que quelque'autre chose en fût le motif, comme je l'ai découvert dans la suite, et comme je vous l'écrirai plus exprès dans une autre occasion. Après avoir visité les églises, nous allâmes sur le soir dans la grande place de Turin, devant le palais de Son Altesse royale. Nous y vîmes plusieurs théâtres de bateleurs, de danseurs de corde, et de joueurs de farces, dont les places des villes d'Italie ne manquent jamais d'être remplies en tout temps pour la satisfaction du public. Mais ce qui me surprit, ce fut de voir que la plupart des gens qui les écoutaient autour des théâtres, étaient des prêtres ou des moines qui frappaient des mains pour approuver ce qu'ils disaient de plus ridicule et riaient à gorge déployée. Il y en avait là de toutes sortes d'Ordres. Quelques pères jésuites qui y étaient des plus échauffés, firent civilité au père bénédictin qui était avec nous, et ayant connu qu'il était un procureur général d'Ordre, ils lui offrirent une place éminente proche d'eux, ce qu'il accepta. Pour moi je ne voulus point prendre d'engagement, et me retirai avec les deux ecclésiastiques français à notre hôtellerie. Nous eûmes occasion de discourir ensemble ce même soir avec le comte Zamberti, officier de Son Altesse, que j'avais vu autrefois en France, et nous ne pûmes pas nous empêcher de lui témoigner l'étonnement où nous étions d'avoir vu tant de religieux aux spectacles publics, et si attentifs à entendre des bouffons ; que nous trouvions cela extrêmement vilain et scandaleux, et qu'assurément on ne voyait pas cela en France. Il nous dit que ce n'était point ce qui nous devait surprendre le plus, et qu'en Italie ceux d'entre les ecclésiastiques que l'on voyait le plus souvent à la place le soir, étaient les plus estimés, comme étant ordinairement les plus gens de bien. Parce que les autres en ce temps-là, étaient communément ou au bordel, ou dans des tavernes avec des vilaines. Je me retournai ici vers nous prêtres français, et leur dis : Hé bien, Messieurs, que devez-vous présentement conclure de la magnificence des églises de ce pays ? Sera-ce, comme vous faisiez tantôt, qu'où il y a de plus beaux temples, c'est là qu'il y a aussi le plus de piété et de religion ; tandis que vous voyez que ceux qui devraient être plus particulièrement les temples vivant du Saint-Esprit sont dans une si exécrable profanation ? Sur ce que nous avions dit qu'en France, l'on ne voyait pas dans les gens d'Église de si mauvais déportements, le comte nous repartit fort sagement que l'on en devait remercier les Protestants, et que c'était leur présence seule qui maintenait la doctrine, la modestie et la retenue dans le clergé de l'Église gallicane, et que si une fois on les contraignait d'en sortir — car on connaissait déjà le dessein du roi — on en verrait sortir en même temps toutes les sciences et toutes les vertus avec eux. Cela s'accorde parfaitement bien avec ce que quelques personnes de la Communion de Rome m'ont avoué depuis peu, que l'on commence déjà à s'apercevoir en France que depuis que les Protestants en ont été bannis, et qu'on les a cru bien loin, la ferveur dans les ecclésiastiques a commencé à s'attiédir, leur dévotion à se refroidir, et leur application à l'étude est devenue languissante. On les voit présentement fort peu sur leurs livres, mais la plupart du temps roder de maison en maison, sous prétexte d'encourager leurs nouveaux pervertis, et faire les docteurs de ce qu'ils ont appris du temps qu'ils étaient pressés par les doctes écrits et savantes controverses des ministres protestants.
Je retourne à mon voyage, mais auparavant que de sortir de Turin, puisque j'ai déjà touché un mot de l'église où est conservé le Saint-Suaire, je crois que vous ne trouverez pas mauvais que je vous dise en bref ce que j'en pense. Ceux de votre communion tiennent que c'est le même suaire ou linceul dans lequel Nicodème ensevelit le précieux corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ après qu'il fut descendu de la Croix, et que la figure de ce corps adorable y est restée miraculeusement empreinte pour la consolation des fidèles. Je n'entrerai point en discussion de cette histoire que je n'ai pas examinée, mais je vous dirai seulement, Monsieur, que l'on en montre un autre dans la cathédrale de Besançon dans la Franche-Comté qu'ils soutiennent être le même dont se servit Nicodème (1). Différents papes suivant leur propre caprice, ont accordé plusieurs bulles et indulgences, les uns à celui de Turin et les autres à celui de Besançon, jusqu'à ce que les contestations sur ce sujet étant continuées avec trop de chaleur entre les deux archevêques de ces deux villes, et même avec plusieurs libelles diffamatoires de part et d'autre, on trouva enfin à Rome le moyen de les accorder, en déterminant contre l'expression de leur vulgate, au chapitre 27 de S. Matthieu — Et involvit illud sindone munda — où le mot sindone est au singulier, qu'il y en avait deux, et qu'ainsi l'un et l'autre sont véritables. On ne peut pas à la vérité dénier qu'il n'y ait eu un suaire, et même il se peut faire qu'on l'ait conservé avec beaucoup de soin jusqu'à présent : mais de voir cette facilité, pour accorder deux évêques, à déterminer hardiment qu'il y en avait deux, c'est ce qui choque les esprits tant soit peu bien faits : et ensuite ordonner qu'on leur rendra à tous deux le jour de Pâques, le même culte d'adoration qu'on rend le Vendredi saint à la Croix, qui n'est point différent de celui qu'on rend à Jésus-Christ même ; c'est ce qui est impie.
Après être resté quelques jours à Turin, je me trouvais à deux journées de Gênes. La curiosité de voir cette superbe ville me fit prendre la résolution d'y aller. J'étais néanmoins combattu par la satisfaction que j'avais eue en la compagnie du père bénédictin qui était assez plaisant et agréable dans la conversation. Je croyais qu'il serait nécessaire pour cet effet de nous séparer ; car la lettre d'obédience qu'il m'avait montrée de son général, portait qu'il devait se rendre incessamment à Rome, recta via, sans prendre aucun détour. Je lui communiquai le dessein que j'avais pris d'aller à Gênes, et il me témoigna tout aussitôt qu'il était dans la résolution d'y venir avec moi ; qu'il ferait en sorte que ses supérieurs n'en sauraient rien ; et dans la lettre qu'il écrivait de Turin, il leur marquait que n'étant pas encore bien remis de quelques accès de fièvre, cela l'obligerait d'y rester encore quelques jours, qui était justement le temps qu'il prenait pour faire le voyage avec moi. Je reconnus par là que les moines les plus réformés ne sont pas grand scrupule de rompre l'obéissance dont ils font vœux, et de transgresser les règles qu'ils professent, à la moindre petite occasion qui se présente de quelque satisfaction particulière. L'usage de la viande lui était de même défendu par sa Règle, cependant il ne se trouvait pas plutôt éloigné des monastères de son Ordre qu'il se mettait à en manger ; et lorsqu'il en rencontrait un autre, il reprenait incontinent son observance, me priant de ne pas donner à connaître qu'il s'en fût écarté. Je puis dire néanmoins avec vérité que je n'ai jamais vu un si rigoureux censeur des actions d'autrui qu'il l'était. Lorsqu'il se trouvait parmi des moines qui n'étaient pas réformés ou qui étaient plus relâchés que ceux de sa Congrégation, il les entreprenait hautement et même avec insolence ; il leur disait qu'il ne les considérait que comme des âmes damnées, et pire que des démons. Il n'avait pas un sentiment plus charitable pour les gens que les moines par distinction appellent les gens du monde ou les mondains, qui sont en général tous les séculiers. Il lui semblait qu'il n'était pas possible de se sauver dans ce monde, à moins que de s'aller enfermer dans un couvent, et même il fallait que ce fût un cloître de son Ordre. S'il voyait dans les rues une dame un peu bien parée, sans examiner si sa condition, ou quelque autre raison l'y obligeait, il prononçait aussitôt une sentence de condamnation éternelle contre elle, disant que c'était une victime destinée aux flammes de l'enfer : et s'il entendait parler de quelques personnes nouvellement mariées, ou qui eussent fait quelque bonne fortune — Hélas, disait-il, ces gens-là font leur paradis en ce monde, mais ils brûleront éternellement en l'autre. Ainsi sans excepter qui que ce soit et interprétant les actions les plus innocentes en mal, il jugeait avec une malignité de cœur ce qui n'appartient qu'à Dieu seul de juger. Ce que je dis ici, ce n'est pas seulement de ce religieux-là seul, mais généralement presque de toutes sortes de religieux réformés, ou qui professent une vie plus étroite, et même des prêtres séculiers qui prétendent par leur bigoterie se distinguer du commun ; j'ai observé qu'ils jugent le reste des hommes sans miséricorde. Quelques-uns m'ont avoué qu'on les élevait là-dedans de jeunesse, en leur représentant souvent le monde comme une mer orageuse, d'où il est très rare que quelqu'un s'échappe sans faire naufrage, et que leurs monastères sont des ports de salut et des havres de grâce où il est impossible de périr. Il vaudrait bien mieux les élever dans un esprit d'humilité, et leur inspirer de charitables sentiments pour leurs prochains, soit qu'ils soient unis dans une même profession de vie avec eux, ou dans une autre voie, où l'on doit chrétiennement croire que Dieu les a appelés. Mais il faut avouer que c'est comme un malheureux sort de tous les gens qui font à part, de ne considérer que ceux de leur parti, et d'avoir un mépris général pour le reste. Ce fut sans doute cette considération qui porta nos pères, les premiers réformateurs de la religion, à désapprouver, et ensuite à rejeter toutes ces sortes d'inégalités, qui en divisant les hommes en plusieurs états différents, partagent ordinairement leurs cœurs les uns des autres, et les séparent ainsi de la charité de Jésus-Christ. Autant que le religieux dont je vous parle était rigoureux envers les autres, autant était-il indulgent pour lui-même. Il était même d'un naturel comique et bouffon, et n'affectait que dans certaines occasions la gravité monastique.
Nous arrivâmes à Gênes le premier du mois de septembre. Ayant appris qu'il y avait là une fort belle abbaye de son Ordre, appelée Santa Caterina, il voulut y aller loger, espérant y être aussi bien reçu qu'il l'avait été jusqu'ici dans les autres monastères. Il alla présenter sa lettre d'obédience à l'abbé ; lequel l'ayant lue, regarda ce moine depuis les pieds jusqu'à la tête, et lui demanda de quel Ordre il était ? Il lui répondit que sa lettre en rendait témoignage, et qu'il était un Bénédictin réformé. L'autre lui repartit qu'il n'en croyait rien, et qu'il ne portait pas l'habit de S. Benoît qui en était la principale marque. Il est à remarquer que ces moines en France portent des robes de drap assez grossières, et un capuchon taillé fort étroit : au lieu que les Italiens ont extrêmement amplifié les leurs et portent des étoffes extrêmement fines et lustrées. Ils sont chaussés fort mignonnement, ont de beaux bas de soie, de beaux chapeaux fins, et ne cèdent en rien au luxe des séculiers. Mais un peu de différence dans les habits en Italie, fait aussi une différence d'Ordre. Il y a de plus de dix sortes de religieux de l'Ordre de S. François, qui ne sont distingués les uns des autres, que parce que les uns ont leur capuchon ou leurs manches plus larges de deux ou trois doigts que les autres. Cependant cela met une si grande division entre eux qu'ils ne se peuvent pas voir, et se haïssent mortellement. Le moine dont je parle n'était pas assez bien vêtu à leur mode pour plaire à l'abbé, et la conclusion fut qu'il lui refusa fort vilainement l'entrée de son monastère. Ce pauvre Bénédictin entra dans une telle colère de l'affront qu'on lui faisait, qu'il dit plusieurs injures à l'abbé dans son propre monastère : qu'il était un abbé maudit de Dieu ; qu'il serait damné, et que tous ceux qui vivaient sous sa conduite iraient en enfer avec lui ; que c'était eux-mêmes qui avaient changé le vénérable habit de l'Ordre, et tellement alteré qu'il semblait présentement être fait plutôt pour plaire aux demoiselles que pour les distinguer des gens du monde, et qu'ils verraient bien au jour, mais hélas trop tard, quel accueil leur glorieux patriarche S. Benoît ferait dans le Ciel à ce pauvre habit qu'il avait sur le corps et qu'ils méprisaient ici si fort en Terre. Ce prélat se sentit si fort piqué de cette invective, qu'il menaça ce moine réformé que s'il ne sortait ce même soir-là de Gênes, il le ferait tuer. Le père tout épouvanté et tremblant me vint trouver à l'hôtellerie où j'étais, et me raconta son désastre. Cela fut cause que je ne séjournai que trois jours à Gênes ; parce que ce religieux pour ne pas être sacrifié à la vengeance italienne, n'osait sortir dans les rues, et fut obligé de se tenir renfermé dans une chambre, pendant tout le temps que j'y restai à voir la ville.
La vengeance est un abominable vice, et qui est présentement avec beaucoup de raison attribué très particulièrement aux Italiens. Mais ceux d'entre eux qui l'exercent avec le plus de fureur et de rage, sont assurément les gens de l'Église. Comme ils n'ont point de familles à avoir soin, leur attention est moins partagée, et par conséquent plus unie à se ressentir des injures qui leur sont faites, et ont plus de temps pour y penser : outre qu'en cas d'accident, ils n'ont que leurs personnes à sauver. Ils ne craignent pas même si fort la confiscation de leurs biens, parce qu'ils sont assurés que dans tous les pays où l'on adhère à la Communion de Rome, ils y pourront vivre avec leurs messes, et qu'on ne les laissera manquer de rien. C'est un patrimoine qui les suit partout, et qu'on peut leur ôter qu'avec la vie.
Ce qui facilite extrêmement l'exécution des vengeances en Italie, c'est le grand nombre de petites principautés qui la partagent, et dont les princes sont tous indépendants les uns des autres, et extrêmement jaloux de conserver leurs droits, particulièrement de protection et de refuge pour ceux qui ayant fait quelque mauvais coup, se retirent dans leurs états. Le roi de France obtiendrait plus aisément de l'Empereur un réfugié, que du duc de la Mirande qui n'a pas l'espace de trois mille Italiques de pays ; parce que plus la puissance est petite, et plus fait-elle d'efforts pour faire paraître qu'elle est grande. La République de Saint-Marin n'est qu'un petit hameau d'environ cinquante maisons de pauvres paysans qui se gouvernent d'eux-mêmes. Quoiqu'ils soient renfermés de tous côtés dans les territoires du pape, que l'on appelle le domaine de S. Pierre, ils donnent une si résolue protection aux prêtres meurtriers et homicides, qu'il n'est pas possible au pape de les persuader d'en rendre un seul. Ce n'est pas seulement les princes souverains en Italie qui sont jaloux des franchises de leurs États, mais encore toutes les personnes de qualité, qui ne veulent pas permettre qu'on prenne un malfaiteur dans leurs maisons. Je vous dirai en passant, Monsieur, que c'est c'est cette liberté prétendue qui donna commencement à la franchise des quartiers des ambassadeurs des couronnes à Rome, et qui a tant fait de bruit entre le pape Innocent XI et le roi Louis XIV de France. Car comme les ambassadeurs pour se distinguer, voulaient avoir quelque privilège au-dessus de la Noblesse ordinaire, ils prétendirent non seulement l'immunité dans leurs palais, mais encore une franchise entière dans tous les quartiers où ils étaient situés. Innocent XI trouva que c'était une entreprise digne de sa gloire et de son courage, de travailler efficacement à détruire à Rome ces retraites assurées de vauriens et d'assassins ; obligeant les ambassadeurs de renoncer pour toujours aux franchises des quartiers, et de se contenter pour le respect qu'on porte à leurs maîtres, de celles de leurs maisons. Mais que servait-il à Innocent d'être si zélé à abolir ces lieux de refuge ? Ne savait-il pas que toutes les églises, les monastères, les couvents et les collèges de Rome sont tout autant de lieux ouverts, que l'on trouve à tous bouts de champ, où l'injustice, l'inceste, le vol et le meurtre sont protégés ? Je veux que les temples du Seigneur soient estimés quelque chose de si saint et de si sacré, que ce soit comme une sorte de profanation d'y entrer les mains armées pour s'y saisir d'un criminel : mais pourquoi donner ce même privilège à tous les cloîtres et maisons de ces misérables moines qui sont eux-mêmes les plus scélérats, et qui ont de si grandes enceintes de murailles, que si on les pouvait joindre tous ensemble, ils feraient sans doute plus de la troisième partie de la ville de Rome ? Qu'y a-t-il donc de si saint et de si sacré parmi les profanes ? Pour moi je ne saurais en concevoir autre chose, si ce n'est que les papes et les princes ecclésiastiques de la Communion romaine, ne s'efforçant pas moins d'établir leur pouvoir temporel que leur tyrannie sur les âmes, se donneront bien de garde de diminuer aucun des privilèges des moineries qui sont chez eux, crainte que les princes étrangers à leur exemple, n'entreprennent de faire de même dans leur pays ; et comme les moines se tiennent toujours du côté du pape, ce serait en quelque façon affaiblir leur parti. De plus ces gens-là ont l'esprit si lâche et si intéressé, que si Sa Sainteté, ou quelque cardinal, leur envoie ordre de délivrer quelqu'un qui se serait réfugié chez eux, ils le rendent incontinent, étant bien aisés d'avoir par là occasion de faire leur cour à peu de frais. Mais si quelque autre seigneur séculier leur en fait l'instance, c'est alors qu'ils veulent maintenir les privilèges de leurs monastères, et à moins d'une bonne pièce d'argent entre leurs mains, ils n'accorderont jamais la demande ; particulièrement si le criminel est un moine ou un ecclésiastique. Et c'est, comme j'ai dit ci-dessus, ce qui les rend plus hardis à se venger. De plus ils sont assurés qu'ils seront toujours secondés de quelqu'un de leurs confrères. Ils se supportent les uns les autres extrêmement dans ces sortes d'occasions ; ce qui fait que l'on ne peut pas en offenser un, que l'on n'ait affaire à plusieurs. Comme ils font tous quelque corps, car où ils sont moines, ou frères, et ils font corps avec tous ceux de leur Ordre, couvent ou monastère ; ou ils sont prêtres séculiers, et ils font corps avec les autres prêtres de leurs diocèses, cathédrale ou paroisse, n'y ayant de si petite église qui n'ait quinze ou vingt prêtres pour la servir. Quand on en offense quelqu'un, tous les autres du même corps se déclarent offensés, et s'appliquant à en prendre la vengeance comme si on les avait injuriés eux-mêmes. Ce n'est pas l'esprit de charité qui les y porte, car la charité ne se venge point ; mais c'est un certain plaisir comme naturel, qu'ils ont de faire ressentir les effets de leur rage à ceux qui les offensent, ou ceux qui ont quelque sort de liaison avec eux, et qui leur fait dire avec un de leurs poètes : Dolcissima, mortali, è la vendetta — Il n'y a rien de plus doux au monde que la vengeance. Je comptai étant à Bologne en Italie, en une semaine de temps dix-sept morts, qui étaient restés les victimes froides de cette furie infernale, et dont la plupart avaient été tués par des moines ou des prêtres. Le grand prévôt que l'on appelle le Bargello, pour avoir fait par ordre du cardinal archevêque, la recherche d'un moine qui entretenait scandaleusement un bordel public, était du nombre de ces pauvres infortunés, et avait été misérablement massacré le jour de Pâques en sortant d'une église.
Un des moyens les plus terribles que les ecclésiastiques aient entre les mains pour assouvir leur vengeance, c'est cette malheureuse Inquisition qu'ils ont introduite sous prétexte de religion, qui est la plus diabolique invention qui soit jamais sortie de la boutique de Satan, et dont ils se servent si adroitement pour les fins particulières. Ils ont fait une matière d'Inquisition de frapper, injurier, ou mépriser une personne du clergé tant séculier que régulier. Voici de la manière qu'on procéda à Bologne contre un honnête homme que je connaissais, qui dans la chaleur de sa passion avait appelé un frère dominicain, vieux fou de moine. Ce frère porta sa plainte à l'Inquisiteur, lequel fit tout aussitôt arrêter ce jeune homme qui fut mis dans les prisons de l'Inquisition, où il resta dix mois auparavant qu'on lui demandât pourquoi il y était. Ensuite on le fit comparaître devant le sacré tribunal, et comme il ne pût pas dénier qu'il eût appelé ce frère, vieux fou de moine, on réduisit son procès en cette forme. Celui qui ne porte point d'honneur aux ecclésiastiques, ne croit pas l'état ecclésiastique digne d'honneur, et est par conséquent un hérétique : Or est-il que vous n'avez point porté d'honneur à Frère Nicolas qui est un ecclésiastique ; donc vous ne croyez pas l'état ecclésiastique digne d'honneur, et vous êtes un hérétique. L'accusé répondit, qu'il était vrai qu'il l'avait appelé vieux fou, mais qu'il l'entendait quand à sa personne, sans aucun rapport à sa profession. Ici l'accusant insista qu'il l'avait aussi appelé fou quand à sa profession, y ayant joint le mot de moine qui la signifiait, et sans y ajouter ces mots, sauf son caractère. Car il est vrai que si en Italie l'on dit des injures à un prêtre ou à un moine et qu'on l'appelle fripon, coquin, et autre chose semblable, et qu'on y ajoute incontinent sauf votre caractère, ou sauf l'habit que vous portez, ce n'est pas une matière d'Inquisition : mais si malheureusement on s'en oublie, on est perdu. Ainsi ce pauvre monsieur fut jugé coupable. Pour ce qui est de frapper un qui est dans la cléricature, de quelque manière que cela se fasse grièvement ou légèrement, c'est toujours une matière d'Inquisition. C'est ce qui rend les ecclésiastiques si hardis et si insolents dans toute l'Italie. Je vis à Rome un prêtre qui était venu aux injures avec un officier dans la Piazza Navona. Cet officier lui donnait du plat de la langue fort adroitement, et ne s'oubliait jamais de mettre au bout, sauf son caractère ; de sorte que le prêtre demeura confus, et tout écumant de rage il commença à dire aux gens qui étaient là présents : Messieurs, il faut que je fasse mettre cet homme-là à l'Inquisition, il me semble qu'il m'a frappé ; n'avez-vous pas vu qu'il m'ait donné quelque petit coup ? Il l'aurait souhaité de tout son cœur pour avoir lieu de satisfaire sa vengeance ; mais comme on n'avait rien vu de cela, on ne lui en pouvait rendre témoignage. Il y a un proverbe qui dit que pour vivre paisiblement à Rome, il n'y faut offenser ni femmes, ni prêtres ; parce que les dames s'y font venger par leurs amants, et les gens d'Église par l'Inquisition. Il est vrai que les personnes de rang, comme les abbés, les évêques, et les cardinaux ne se servent pas ordinairement de cette voie, qui leur semble un peu trop embarrassante. Ils ont des serviteurs et des gens affidés lesquels par argent, ou pour obtenir quelque faveur, s'offrent à eux volontairement pour être exécuteurs de leurs vengeances. Et s'il arrive qu'ils soient saisis dans l'action, ils s'en mettent fort peu en peine, se reposant confidemment sur le pouvoir et l'autorité de leurs maîtres, qui ne manqueront pas de procurer par toutes sortes de moyens leur décharge et leur délivrance. Pour ce qui est des papes, comme ils ne sont pas exempts de ces faiblesses, ils n'oublient pas de se servir dans l'occasion de la puissance qu'ils ont en main, et comme les autres monarques de la Terre, lorsqu'ils sont offensés, ils ont les mains longues. Il ne faut plus parler à ces saints pères, d'humilité et de patience à souffrir les injures, à l'exemple de Jésus-Christ dont ils veulent représenter la personne en Terre. Ils en ont la plupart rejeté les vertus, et ne sont occupés qu'à représenter ici-bas ce qu'il y a de plus glorieux dans le Ciel, qui est son pouvoir et sa judicature. Ce titre de sainteté qu'on leur donne, n'est plus qu'un terme fastueux dont ils se servent pour exprimer leur superbe. Nous avons un signalé exemple de vengeance dans la vie du pape Sixte Quinte [élu le premier mai 1585], qui mérite bien que je vous en fasse ressouvenir. Sixte était de fort basse extraction, né d'un pauvre vigneron et d'une servante, et avait été réduit dans sa jeunesse à garder les cochons. Cependant par la subtilité de son esprit et assisté d'une fortune extraordinaire, il était parvenu au trône pontifical. Mais bien loin que la bassesse de son extraction lui inspirât quelques sentiments humbles au milieu de cette grandeur, il ne pouvait souffrir la moindre chose qui y réfléchit, et par un esprit de vengeance qui lui était naturel, il faisait éclater sa cruauté sur tous ceux qui par mégarde, ou de propos délibéré, lâchaient quelque parole de mépris sur ce sujet. On vit un matin la statue de Pasquin revêtue d'une chemise fort sale, et Marphorio qui lui en demandait le sujet. Pasquin répondit : Parce que ma blanchisseuse est devenue princesse. Cette réponse réfléchissait sur Donna Camilla, sœur du pape, qui de pauvre blanchisseuse qu'elle était auparavant, avait été élevée par son frère à la principauté. Le pape fit faire toutes les perquisitions imaginables pour découvrir l'auteur de cette pasquinade, et n'ayant pu réussir dans sa recherche, il eut recours à la ruse, mais à une ruse si basse et si indigne, que le seul récit que l'on en fait est capable d'en donner de l'horreur. Il fit publier par tout que cette pointe d'esprit lui plaisait si fort, que si celui qui en était l'auteur venait se découvrir à lui, non seulement il ne le ferait pas mourir, mais qu'il lui donnerait une récompense de deux mille écus. Le pauvre malheureux gagné par une promesse si avantageuse se donna à connaître. Le pape sur l'aveu qu'il en fit, lui fit compter les deux mille écus, et l'assura qu'il ne serait point pendu. Sur quoi le misérable fit ses très humbles remerciements à Sa Sainteté pour une si grande grâce. Oui, reprit le pape, je te teindrai en cela ma parole ; mais je ne t'ai pas promis de ne te pas faire couper les mains et la langue, et il commanda sur l'heure qu'on les lui coupât en sa présence, pour faire un agréable sacrifice à sa vengeance. Cette action fut fort observée, et comme les vices de même que les vertus éclatent au souverain degré dans les têtes couronnées, et plus encore dans celui qui se dit Dieu en Terre, ce fut un grand obstacle au projet qui fut fait après sa mort de sa canonisation.
Je me suis quelquefois appliqué à rechercher quelle pouvait être la raison de cet esprit de vengeance qui paraît aujourd'hui si naturel aux Italiens, si cela procède du climat et de la nature du pays, ou de quelque autre cause nécessaire qui ne se puisse pas éviter. Mais ayant rappelé à ma mémoire, la grandeur d'âme, le courage et la magnanimité des anciens Romains, qui habitaient le même terrain, et qui se rendirent autant aimables par leur clémence, que redoutables par leur valeur ; j'ai vu qu'il en fallait plutôt rechercher une cause morale que naturelle. Et autant que je la puis concevoir, c'est que dans la suite des temps, la meilleure partie de l'Italie étant tombée sous la domination des évêques de Rome, ils envoyèrent dans les provinces en être gouverneurs, des prêtres ; gens qui n'entendaient ni le commerce, ni la guerre, qui sont comme les deux nerfs d'un État, sans lesquels il demeure comme un corps paralytique sans action et sans mouvement. Cette oisiveté jointe aux grandes chaleurs du pays, et aux mauvais exemples de ces mêmes gouverneurs, qui étaient des gens qui aimaient leurs plaisirs, y introduisit en fort peu de temps la mollesse. Dans l'ancienne Rome l'épée cédait quelquefois à la robe, les armes faisaient place aux lettres : Cedant arma toga. Mais présentement tout y a cédé à l'amour des femmes. Cet amour étant excessif et déréglé est inséparable de la jalousie, et la jalousie produit la vengeance, qui sont justement les deux grands vices que l'on attribue aux Italiens. De cette grande facilité à se venger dans leurs amours, ils sont passés présentement à ne pas laisser tomber la moindre petite parole, ou la plus légère injure en quelque matière que ce soit, sans en prendre s'ils peuvent une très impitoyable vengeance. Ce vice ayant commencé dans les États pontificaux, s'est communiqué insensiblement à ceux des princes circonvoisins, et infecte enfin aujourd'hui misérablement toute l'Italie. On a remarqué que Bologne et Ferrare qui ont ployé le col des derniers sous le joug de Rome, ont redoublé de beaucoup depuis ce temps-là leur esprit vindicatif. Mais ce qu'il y a des plus à condamner dans leurs vengeances, c'est qu'ils les exécutent ordinairement d'une manière vile et basse, par le poison et par le poignard, en derrière et traîtreusement. Ils se moquent des duels, et disent que c'est la plus grande folie du monde de mettre l'épée en main à son ennemi, et de se mettre par là autant en état de le satisfaire que d'en être satisfait. Si nous avons un ennemi, disent-ils, nous ne sommes pas si fous que de crier de loin, Garde-toi : mais nous voulons le tuer à la première occasion, sans nous mettre en danger de l'être de lui.
Au reste, Monsieur, si les Italiens ont leurs défauts, ils ont aussi de fort bonnes qualités. Ils sont fort prudents dans la conduite de leurs affaires, fort discrets dans leurs discours, civils et honnêtes entre eux et envers les étrangers ; d'un bon conseil, fort prompts à rendre service ; constants dans leur amitié, et d'une humeur fort obligeante pourvu qu'il ne leur en coûte rien. Ils ont beaucoup d'esprit, et je puis dire que si leurs prêtres et leurs moines ne les avaient point corrompus dans leur morale, et n'avaient point si fort altéré le culte de la religion, de même qu'ils ont le meilleur pays, aussi seraient-ils les meilleurs gens qui soient au monde. Cependant le papisme est cru à un si prodigieux excès d'idolâtrie, de superstition et de folie, que je m'étonne comme ils retardent si fort à en rejeter le joug. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à ouvrir les yeux pour en voir les erreurs, mais ils n'osent pas déclarer leurs sentiments à qui que ce soit, pour ne pas tomber sous la barbare et inexorable cruauté de l'Inquisition. Ce tribunal fut érigé comme une bride inhumaine pour retenir particulièrement les Italiens, dont l'on voyait déjà plusieurs qui commençaient à remuer et à examiner la doctrine de Rome. Pour le rendre plus fier et plus terrible, les papes ne crurent pas pouvoir faire mieux que de le mettre entre les mains des Dominicains, gens cruels et impitoyables, et attachés alors plus qu'aucun autre Ordre à maintenir les intérêts du pape. Pour les y encourager d'autant plus, on trouva à propos de conférer de temps en temps aux plus zélés inquisiteurs la dignité épiscopale, et d'en élever plusieurs au cardinalat. Dans tous les États du grand-duc de Toscane, elle a été donnée aux Franciscains, dont plusieurs ont été pareillement nommés évêques et cardinaux. Le motif en la partageant ainsi entre deux ordres différents, ne fut que pour la mieux soutenir par l'émulation. Le principal dessein que l'on prétendit d'abord dans l'érection de l'Inquisition, fut d'arrêter par sa violence les progrès de l'hérésie, et pour se servir de leurs termes : Contra haereticam pravitatem. Mais les ecclésiastiques ayant depuis considéré le grand avantage que cela que donnerait par-dessus les séculiers s'en sont su si bien prévaloir, qu'il n'y a présentement presque rien qu'ils n'y réduisent, pour venir à bout de leurs fins particulières. Si vous manquez à payer les dîmes, sans examiner si vous le pouvez faire ou non, on argumente contre vous que vous ne les payez pas, parce que vous ne croyez pas qu'il les faille payer : Donc vous êtes un hérétique. S'il vous échappe quelque mot contre la vie licencieuse des évêques et du clergé tant régulier que séculier, votre dessein a été de rabaisser la dignité épiscopale et l'Église dans l'esprit des peuples ; vous avez travaillé pour les hérétiques : Donc vous êtes dans leurs intérêts, et vous en êtes un vous-même. Si l'on a du bien, et que l'on se montre indifférent de contribuer aux collectes qui se font pour dire des messes et autres prières pour le repos des âmes des défunts, quoiqu'il n'y ait pas un prêtre ni un moine qui en voulût dire sans argent, l'on est accusé de ne pas croire le Purgatoire, et l'on est un hérétique. Si même l'on refuse trop souvent de mettre dans les boîtes qui courent continuellement dans les rues pour aider à faire la fête d'un tel saint ou d'une telle sainte, pour une telle procession dans une telle église, pour la Chapelle du Rosaire, pour le Scapulaire de la Vierge, ou pour le Cordon de S. François, ces gens-là ont l'impudence de vous dire qu'ils voient bien que vous n'avez guère de dévotion pour les choses saintes, et que vous n'y croyez guère ; et c'est un avertissement que si vous y manquez une autre fois, on pourrait bien prendre connaissance de vous à l'Inquisition. Il n'est pas permis d'excuser ou d'intercéder par foi, ou par amis, directement, ou indirectement pour ceux qui ont eu le malheur de tomber dans les prisons de l'Inquisition, sans se rendre en même temps coupable des mêmes crimes dont ils sont atteints. On ne peut pas même leur parler sans une permission expresse et par écrit de l'Inquisiteur, qu'il n'accorde qu'avec beaucoup de difficulté et fort rarement. Un abbé calabrais de mes amis, fut mis à Venise à l'Inquisition, pour avoir souri lorsqu'un certain moine faisait le récit d'une apparition d'une âme de Purgatoire. Un an après son emprisonnement ayant appris qu'on n'avait point encore prononcé de sentence de mort contre lui, quoiqu'il eut été mis plusieurs fois à la torture, et étant allé demander une approbation à l'Inquisiteur pour l'impression d'un livre, je pris occasion de lui demander la permission d'aller visiter une fois ce pauvre prisonnier. À la prière que je lui en fis, il me regarda fort fièrement, et me demanda ce que j'avais à démêler avec lui. Je lui dis que rien ne me portait à cela qu'un esprit de charité chrétienne, pour donner à ce pauvre infortuné quelques paroles de consolation. Ce moine me repartit avec une manière extrêmement rude et désobligeante, que le prisonnier était en de très bonnes mains, et n'avait besoin d'être consolé ; ainsi il ne me fut pas possible de lui parler. J'eus pourtant la satisfaction de l'en voir délivré six mois après, par les charitables soins et les puissantes intercessions de Cornaro Piscopia (2), noble Vénitienne, fille d'un savoir et d'un mérite extraordinaire, à laquelle il dédia les savantes poésies qu'il avait composées dans sa prison. J'ai dit ci-dessus qu'il n'était pas permis d'intercéder pour qui que ce soit ; mais vous saurez, Monsieur, que l'Inquisition est beaucoup plus douce à Venise que dans les autres endroits d'Italie. Ce sage sénat ayant horreur de l'inhumanité des frères qui l'exercent, a établi une chambre particulière, où les nobles vénitiens président et prennent connaissance de toutes les affaires qui la concernent ; de sorte que les Dominicains n'en sont pas tout à fait les maîtres. Cet ami ayant eu le bonheur de sortir d'un si mauvais pas, fut si fort touché des cruautés qu'on lui avait fait souffrir durant sa prison, qu'il conclut de là que l'Église romaine étant animée d'un esprit si barbare, et qui est sans exemple parmi les infidèles mêmes, ne pouvait pas être la véritable pousse de Jésus-Christ. Elle peut bien à la vérité avoir la prudence des serpents pour sa conservation, pourvu qu'elle retienne toujours la douceur de la Colombe, pour ne pas se rendre indigne de celui qui veut qu'on apprenne de lui qu'il est doux et humble de cœur. Cet ami m'avoua qu'auparavant qu'il fût mis à l'Inquisition, à la vérité il doutait du Purgatoire et de la Transsubstantiation, mais que depuis qu'on les lui avait voulu faire croire par force, il n'y croyait point du tout, et qu'il allait se retirer en Suisse ou à Genève pour y vivre en liberté selon sa croyance. Il ajoutait que toutes les nuits il était troublé dans son sommeil par les affreuses images des tourments qu'on lui avait fait souffrir dans les cachots, où on lui avait démis tous les membres l'un après l'autre, écrasé tous les doigts, appliqué sur ses pieds des lames de fer ardentes. Pour le rendre plus sensible aux douleurs on le remettait dans son cachot pendant quelques jours, où on ne lui donnait qu'un pauvre morceau de pain noir, et une petite mesure d'eau, après quoi on le remettait de nouveau entre les mains des bourreaux de l'Inquisition, pour lui faire éprouver de nouveaux genres de supplices. On le liait par un bras, et par le moyen d'une poulie on l'élevait en l'air, où on le laissait pendant plusieurs heures. On le descendait en suite plus mort que vif, et pour lui faire revenir le sentiment, on le fouettait de chaînettes de fer pleines de pointes et d'aiguillons, jusqu'à ce qu'on l'eût mis tout en sang. Et tout cela, ô cruauté plus que barbare ! pour tâcher de découvrir les secrets d'une pauvre conscience et les replis d'un pauvre cœur. Le père inquisiteur qui était là présent pour encourager les bourreaux et voir s'ils faisaient bien leur devoir, s'approchait quelquefois du patient, et lui demandait d'un ton de voix fort sévère, s'il était donc vrai qu'il ne crût point au Purgatoire ; qu'il le priait d'y penser bien sérieusement ; que tout ce qu'on lui faisait souffrir n'en était qu'une très légère image, et qu'il était bien plus horrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Ce pauvre monsieur ne répondait rien à tout cela que par ses soupirs et par ses larmes : mais il me confessa depuis qu'il y avait fait en effet un très sérieuse réflexion, par laquelle il concevait qu'il était inconsistent avec la bonté infinie de Dieu, de traiter avec tant de rigueur des âmes qu'il avait déstinées pour la gloire et pour jouir éternellement de Lui ; que les ouvrages de Dieu étant parfaits, il faisait miséricorde à qu'il voulait (3) ; et qu'il Lui était infiniment plus glorieux de pardonner la coulpe et la peine, que de se reserver une misérable vengeance par les feux et les flammes du prétendu Purgatoire ; et que par cette raison il n'y croyait point du tout.
Le supplice ordinaire à Venise pour ceux qui sont convaincus d'hérésie à l'Inquisition, c'est ou de les étrangler dans la prison, ou de leur attacher une pierre au col et de les envoyer noyer dans la mer. Et en cela cette Inquisition est beaucoup plus douce que celle des autres endroits d'Italie où on les brûle tout vifs à petit feu ; ou bien on leur coupe tous les membres les uns après les autres que l'on jette en leur présence dans le feu, après leur avoir arraché premièrement la langue de la bouche, et fait souffrir de très horribles tourments. Croyez-vous en bonne foi, Monsieur, que ce soit là l'esprit de l'Évangile ? A-ce été la manière dont Jésus-Christ s'est servi pour convertir les pécheurs ? A-t-il jamais parlé d'emprisonnements, de gênes et de tortures ? En avons-nous quelque exemple de Lui, ou quelque précepte ? Non assurément. Ce ne doit donc pas non plus être l'esprit du christianisme. Ainsi les moyens que les papes ont pris pour maintenir leur tyrannie sur les consciences, pourraient servir de justes motifs pour la détruire, si les peuples voulaient sérieusement ouvrir les yeux, et s'opposer vigoureusement aux effets de leur violence. Il n'y a que la vertu qui se soutienne par elle-même. L'iniquité a toujours besoin d'un secours étranger. Ce qu'elle ne peut emporter en lion par la force, elle tâche d'en venir à bout en renard par la ruse. Ce que les papes et leurs adhérents ne peuvent pas avoir par l'Inquisition, ils s'efforcent de le surmonter par l'artifice et par le mensonge. Un des principaux artifices dont ils se servent pour maintenir les peuples dans leur obéissance, c'est de les tenir dans une profonde ignorance, premièrement des vérités de l'Evangile, leur défendant très expressément de lire l'Écriture sainte comme un livre très dangereux et pernicieux pour leurs âmes ; ensuite c'est d'empêcher qu'il ne vienne entre leurs mains aucun livre de controverse composé par les Protestants. C'est une matière d'Inquisition d'en retenir ou d'en lire quelqu'un, ou sachant que quelque autre personne en ait de ne le pas déclarer. Ils ont de plus très grand soin de charger les prédicateurs dans leurs sermons, qu'en parlant des Protestants, qui étant extrêmement bien fondés dans leur doctrine sont par conséquent les plus puissants ennemis de l'Église romaine, ils les doivent représenter au peuple comme des gens qui ont absolument renoncé la Foi de Jésus-Christ, et qui ne croient non plus en Lui que les infidèles. C'est pourquoi ils les appellent indifféremment hérétiques et infidèles, et pour me servir du mot italien : Questi Noncristiani. De sorte qu'effectivement tout le menu peuple, et même la plupart des gens qui ont étudié sont dans la pensée que les Protestants ne croient point du tout en Jésus-Christ non plus que les Turcs. Un chanoine me demanda un jour par curiosité à Rome, ce que faisaient les infidèles en France, et pourquoi on les y souffrait. Je me fis expliquer ce mot que je n'entendais pas, et sachant qu'il voulait parler des Protestants, je lui dis qu'ils n'étaient pas infidèles, mais qu'ils croyaient en Jésus-Christ aussu bien que les Catholiques romains ; que seulement ils rejetaient la Transsubstantiation, la Messe, le Purgatoire, etc. et particulièrement le pouvoir et l'infaillibilité du pape. M'ayant entendu discourir un assez longtemps : Véritablement, Monsieur, me dit-il, si la chose est comme vous dites, je vois bien que ces gens-là ne sont pas si grands diables qu'on nous les fait ici ; j'ai souvent entendu prêcher qu'ils étaient aussi mécréants que des Juifs, et vous êtes le premier à qui j'aie jamais ouï-dire que les Protestants croient en Jésus-Christ. Mais, Monsieur, lui dis-je, il n'est pas possible que vous qui avez étudié en théologie, n'ayez entendu parler des sentiments de Luther, de Calvin et de Zuingle dans le traité que l'on y donne des sacrements en général, et en particulier dans ceux de l'Eucharistie, de la Pénitence, du Sacrifice de la Messe, etc. Ces gens-là ne croyaient-ils pas en Jésus-Christ ? Oui, repartit le chanoine, je sais que ces hérétiques-là prétendirent non pas de détruire, mais seulement de reformer l'Église, et dans plusieurs matières ils ont des arguments extrêmement forts, et auxquels on a encore aujourd'hui beaucoup de peine à répondre : mais néanmoins Dieu qui a un soin tout particulier de Son Église, pour manifester aux fidèles que ces gens-là étaient dans le mauvais chemin, a permis ensuite que leur parti se soit anéanti. Comme une erreur en attire un autre, ils sont roulés de précipice en précipice jusque dans l'abîme de l'infidélité. Ils se séparèrent au commencement de l'Église romaine sous prétexte de reforme ; mais quelque temps après leurs sectateurs réduisirent tout à l'esprit particulier, qui est de croire tout ce qu'ils veulent, et que pourvu qu'ils adorent un dieu tel qui soit, et mènent une vie moralement bonne, c'est assez pour eux pour être sauvé.
Je vis par là, Monsieur, que ce chanoine avait été fort mal informé — comme la plupart des Italiens le sont — de l'état présent des Protestants et de leur doctrine, et qu'on met à Rome toutes sortes de ruses en pratique contre ceux qui ne veulent pas fléchir les genoux devant Bahal. Le mensonge y est vertu quand il peut servir, comme ils le pensent, pour une bonne fin. Je me souviens qu'un Jésuite qui revenait nouvellement d'Angleterre, prêcha hardiment que tout y était réduit à l'esprit particulier ; et ayant fait une ample description des assemblies des Anabaptistes et des Quakers sous le nom de l'Église anglicane, lorsqu'il en vint à l'article des soupirs et des gémissements, et des femmes en chaire, il fit éclater de rire tout son auditoire ; et fit concevoir sans doute, avec une très grande injustice, un grand mépris pour cet auguste et vénérable corps de Protestants, l'Église anglicane si zélée pour la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, Son fils unique, si exacte dans le culte et l'obéissance qu'elle Lui rend, et si raisonnable dans Ses ordres et dans Ses cérémonies. Tant que ces vigilants pasteurs, messieurs les évêques de l'Église anglicane, et les savants ministres qui leur sont soumis auront les yeux ouverts sur les brebis du troupeau, il n'est pas à appréhender que le loup de Rome en moissonne une seule de leurs mains ; et ses émissaires tout subtils larrons qu'ils soient, ne pourront jamais entrer de nuit dans la bergerie pour les dévorer ou les massacrer comme ils ont déjà tant de fois tâché de faire. J'ai fait depuis peu une remarque sur le sermon de ce Jésuite que j'entendis tout entier, et que je souhaiterais qui put entrer une bonne fois dans le cœur de tous les Protestants, qui est que pour battre en ruine l'Église de Rome, le grand secret n'est pas de rejeter, comme quelques-uns font, absolument tout ce qu'elle pratique. Le meilleur moyen d'en venir à bout, ce serait de retenir ce qu'elle a de bon, et de ne rejeter précisément que ce qu'elle a de mauvais. Si l'on rejette absolument toutes sortes de jeûnes parce que ceux de la Communion de Rome en observent quelques-uns, comme ils ne cherchent qu'à noircir les Protestants en représentant leurs actions dans le plus mauvais sens qu'ils peuvent, et cachant toujours ce qu'il y a en eux de bon, ils disent que ce sont des gens qui n'aiment que leur ventre, et qui ont en horreur tout ce qui peur humilier et mortifier la chair. Si on rejette l'épiscopat : ils haïssent, disent-ils, la sujétion, et n'aiment que l'indépendance. Si on refuse de prier en commun, on n'est point uni en charité. Si l'on ne consulte pas de temps en temps les ministres sur les affaires de la conscience, tout est réduit à l'esprit particulier. Enfin si l'on célèbre le mariage et qu'on fasse les obsèques sans aucunes prières ni cérémonies, ils disent que les Protestants s'accouplent comme des bêtes, et sont enterrés comme des chiens. C'est ainsi que ce calomniateur de Jésuite avec une malice envenimée, depuis le commencement de son sermon jusqu'à la fin, s'efforçait de les rendre odieux et exécrables. Et en effet il ne lui était pas bien difficile de réussir dans un pays où on les connaît présentement si peu, et où l'on n'en parle presque jamais que sous le nom de diables d'hérétiques, de non-chrétiens et d'infidèles. Mais il n'en serait pas de même assurément, si en conservant ce qu'il y a de louable et d'honnête, et même ce qu'il y a d'indifférent autant qu'il se peut faire, on ne s'attachait uniquement qu'à combattre les points de doctrine ou de pratique qui ont occasionné la Réforme ; car alors ils ne pourraient pas condamner les Protestants en aucune chose, qu'en produisant ces mêmes points de doctrine et de pratique avec les oppositions qu'on y fait. Et c'est ce qu'ils ne veulent point faire, pour ne pas mettre au jour leur faiblesse. Une preuve évident de ce que je dis, c'est le grand soin qu'ils prennent d'empêcher qu'aucun livre de controverse n'entre en Italie, non pas même ceux que les plus fameux de leur parti écrivent. J'eus bien de la peine de trouver à Rome les œuvres de M. Henri Arnaud qu'il avait dédiées au pape, et que je ne crois pas qui aient été traduites en italien. Le seul dessein en cela, est d'empêcher par toutes sortes de moyens qu'on ne connaisse au vrai l'état de la question ; car leurs objections sont si faibles, et les réponses qu'ils font à celles des Protestants sont si pitoyables qu'un esprit tant soit peu désintéressé, même dans leurs propres livres, pourrait voir de quel côté est la vérité. S'il y a jamais eu un auteur qui se soit efforcé de calomnier et de noircir les Protestants, ç'a été sans doute le Jésuite P. Louis Maimbourg, dans ses livres du luthéranisme et du calvinisme. J'entrepris à Venise de traduire en Italien tous ses ouvrages (4). J'en avais déjà traduit plusieurs volumes lorsque je pris en main le luthéranisme et le calvinisme : mais je fus fort surpris que l'Inquisiteur de Venise ne me voulut pas permettre d'en poursuivre la traduction ; et quelque temps après je reçus un ordre de Sa Sainteté qui me défendait de faire imprimer ces deux livres, avec un autre du même auteur qui traitait de la puissance des évêques de Rome. Le seul nom d'évêque qui lui était donner dans le dernier, au lieu des magnifiques titres de Pape et de Souverain Pontife, joint à quelques recherches assez curieuses sur l'origine et le progrès de cette grandeur prodigieuse à laquelle sont arrivés aujourd'hui ces évêques romains, étaient un motif assez pressant au pape pour le condamner : mais il ne me fut pas possible de pénétrer quel pouvait être celui qui le portait à prononcer la même sentence envers les deux autres. Si ce n'est, comme j'ai déjà touché ci-dessus, pour ne pas renouveler, même s'il était possible, dans l'esprit des Italiens l'état de la question qui est entre ceux qui se disent Catholiques et les Protestants. Car quoique ces deux livres soient pleins de railleries, d'injures et de calomnies faites à plaisir pour rendre méprisable un parti que l'on s'efforce par toutes sortes de moyens d'abaisser dans l'esprit des peuples, cependant Innocent XI ne croyait pas que ce rabais dût être aussi profitable à l'Église romaine, que la publication de quelques points de doctrine qui y sont nécessairement insérés, lui aurait pu être nuisible.
Vous ne sauriez vous imaginer, Monsieur, les précautions que les papes prennent pour empêcher l'entrée des livres protestants en Italie. Comme on n'y peut entrer par terre que par les Alpes, ils tiennent des gens exprès à tous les passages pour examiner les passants, et voir s'ils ne portent point de livres défendus avec eux ; auquel nombre sont réduits généralement tous ceux qui traitent de controverses. Dans un voyage que je fis de Venise à Lyon, je pris mon chemin en m'en retournant en Italie par le Valais. À l'entrée de ce pays, dans un détroit de la montagne, il y a une fameuse abbaye de chanoines réguliers de S. Augustin appelée Saint-Maurice. Le Rhône qui est extrêmement impétueux dans cet endroit et qui se dégorge un peu plus bas dans le lac de Genève, ne laisse qu'un chemin fort étroit où il fait nécessairement passer pour y entrer. L'abbé de Saint-Maurice y a fait faire une porte, et comme il en est le maître, les papes qui savent que c'est une clef des Alpes pour entrer en Italie, l'ont chargé d'avoir l'œil sur les passants, particulièrement pour empêcher le transport des livres défendus, parce que Genève dont ils craignent extrêmement, n'en est éloigné que de la longueur de son lac. La promesse que le pape avait faite à l'abbé de le faire évêque s'il s'acquittait bien de sa commission, l'avait rendu extrêmement exact lorsque j'y passai. Il faisait arrêter sans exception tous les passants, cependant avec quelque distinction ; car les gens de pied étaient fouillés à la porte par les gardes, et ceux qui étaient montés et avaient quelque apparence, étaient conduits dans l'abbaye, où l'abbé les traitait fort civilement, et les faisait manger avec lui tandis que l'on fouillait honnêtement dans leurs valises. L'abbé avec qui je discourus après le repas un assez longtemps, me dit que le pape lui envoyait de l'argent pour la dépense des passagers, parce que tout le revenu de son abbaye n'y pourrait pas suffire. Et que Sa Sainteté lui avait écrit des lettres si pressantes pour lui recommander d'avoir soin de ce poste, qu'il concevait par là combien l'on craignait les livres des Protestants à Rome. Comme il avait lui-même quelque connaissance de l'Italie, il dit que si les Italiens, particulièrement ceux qui sont sujets au pape, avaient la moindre communication avec Genève, il serait à craindre qu'ils ne se retirassent entièrement de l'obéissance de Rome. En effet il n'y en a point qui puisse mieux connaître le faible de ce dieu en Terre, du sacré Collège des Cardinaux, et des autres gens d'Église que ces peuples qui en sont eux-mêmes les témoins ; et il n'y en a point aussi qui soient plus intéressés qu'eux à rejeter un joug qui leur est d'ailleurs si insupportable. On ne peut pas presque se ressouvenir sans verser des larmes du florissant état où étaient autrefois ces belles provinces qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine de S. Pierre, et de voir comme elles gémissent misérablement sous la domination des prêtres, toutes désolées et sans ornement. Ces fameuses et anciennes villes Ravenne, Bénévent, Spolète, Peruse, Orviette, et tant d'autres qui étaient autrefois la gloire de l'Italie, ne sont presque plus présentement que des amas de ruines causés par l'insatiable avarice des papes. Il est vrai que ce pays est naturellement le plus beau et le plus abondant qui soit au monde, mais cependant il n'y en a point qui soit plus dénué d'argent. Les grands impôts que le pape y met en ont épuise une partie, et les légats qu'ils y envoyant pour y commander de trois ans en trois en ans, s'efforcent par toutes sortes d'extorsions, pendant leur triennal, de sucer le reste. Ils s'en retournent ensuite à Rome chargés des dépouilles de ces pauvres peuples, où ils ne sont pas plutôt arrivés, qu'ils les consument avec autant de prodigalité qu'ils les avaient amassés avec avarice.
Je ne vous entretiendrai pas ici, Monsieur, des grandeurs et du luxe de la Cour romaine, je pourrai vous en écrire plus à loisir dans une autre occasion. Je vous prie seulement de me dire ici, si véritablement vous ne croyez pas que les Italiens auraient grande raison de se délivrer d'une si grande tyrannie, en retirant en même temps leurs consciences d'un si dur esclavage, et leurs biens d'entre les mains de tant de si cruels usurpateurs ? Pour moi, Monsieur, je ne doute point que si les doctes écrits des ministres protestants de l'Église anglicaine pouvaient un jour pénétrer dans ce pays, et qu'on leur fit seulement autant d'honneur que de les regarder une fois pour les lire, je ne doute point, dis-je, que le papisme dont ils détruisent si évidemment les fondements, ne prit fin entièrement. Ou plutôt, disons mieux, que ce sera lorsqu'il plaira à Dieu le Père des lumières, d'éclairer leurs esprits pour reconnaître leur aveuglement, et d'échauffer leurs cœurs par Sa sainte grâce pour embrasser la vérité, que nous verrons toute l'Italie devenir protestante contre ses propres erreurs, et ne faire avec ceux qui y ont protesté si généreusement depuis tant d'années, qu'une même bergerie sous un seul pasteur de nos âmes qui est Jésus-Christ.
Je ne vous écrirai pas, Monsieur, les autres particularités et curiosités que j'ai vues à Gênes, mon dessein n'étant pas, comme je vous ai déjà écrit, de vous faire une entière relation de mon voyage, mais de n'en toucher qu'autant que j'y trouve quelque rapport avec les matières de la religion. C'est ce que je prendrai la liberté de faire de temps en temps dans mes Lettres, si je vois que vous continuez à les recevoir avec la même bonté que vous avez fait la première. C'est là mon plus grand souhait, afin de vous témoigner avec quel zèle je suis, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Le 16 mai 1794, le Saint-Suaire de Besançon fut envoyé à Paris et, par la suite, jeté au feu ; le procès-verbal de la Convention du 24 mai 1794, inséré au Moniteur de 1794, page 557, dit : «On nous envoie non seulement ce linge ouvré et d'un travail moderne, mais encore le poncis ou le moule découpé qui servait à y renouveler chaque année l'empreinte dont on admirait la conservation miraculeuse». [Voir aussi peut-être, l'abbé Louis Éberlé, La confrérie du saint-suaire et de la croix pour la sépulture des pauvres à l'hôpital Saint-Jacques de Besançon, Besançon, Jacquin, 1886.]
2. L'esprit universel Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, naquit à Venise le 5 juin 1646, reçut le doctorat en philosophie le 25 juin 1678 dans la cathédrale de Padoue, et mourut dans cette ville le 26 juillet 1684.
3. Cf., Romains 9:18, «Ainsi donc, Dieu miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.»
4. Au moins une traduction d'Émilliane parue, à savoir : Istoria delle crociate per la liberazione di Terra Santa dal r.p. Luigi Maimburgo della Compagnia di Giesu. Tomo primo. Trasportata dal francese all'italiano da d. Gabriele d'Emilliane, sacerdote parigino, dottore teologo, Venezia, Piazzola, 1684 — «Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre-Sainte [2 vol., Paris, Mabre-Cramoisy, 1675-76] du R. P. Louis Maimbourg [1610-1686] de la Compagnie de Jésus. Tome I. Transporté du français au italien du père Gabriel d'Émilliane, prêtre parisien, docteur en théologie.»
TROISIÈME LETTRE.
Des hôpitaux et des pèlerins d'Italie, etc.
Pour continuer à vous faire le récit des observations que j'ai faites en mon voyage d'Italie sur ce qui regarde la religion, je vous dirai, Monsieur, que de Gênes nous prîmes notre chemin le long de la côte, et en trois jours nous arrivâmes à Sestri, ville épiscopale située sur le bord de la mer Ligurienne. L'évêque du lieu nous reçut avec beaucoup de civilité. Nous n'avions point voulu nous embarquer pour Livourne, parce que le père avec qui j'étais ne pouvait pas souffrir la mer, et appréhendait extrêmement d'être pris par les corsaires. Il n'y a point de gens plus stoïques à discourir de la mort que les moines ; mais il n'y a rien de plus lâche et de plus timide qu'eux lorsqu'ils sont en danger de la rencontrer. C'est donc ce qui nous fit résoudre de passer l'Apennin pour aller à Lucques, pour prendre ensuite par la Toscane. L'évêque nous avertit de prendre des guides pour passer la montagne, parce que sans cela il nous assurait que nous courrions grand risque d'être volés. Il y a plus de trois journées de chemin par des lieux fort déserts et fort écartés, où l'on ne trouve ni villages ni maisons, excepté deux ou trois pauvres hôtelleries toutes seules de douze lieues en douze lieues. Il y a toujours dans Sestri grande nombre de ces guides qui se tiennent prêts pour accompagner les passants. Ils sont armés de mousquetons, de pistolets et de baïonnettes. On en prend deux, ou trois, ou autant que l'on veut pour passer toute la montagne, et on leur donne deux écus par tête. Deux marchands génois se joignirent à nous dans le même dessein, ce qui fit que nous ne prîmes que deux hommes auxquels il fallait donner quatre écus. Le père bénédictin qu'un autre voyage qu'il avait fait en Italie aurait dû rendre plus circonspect, voulut faire la fin et épargner l'écu qu'il aurait dû payer pour sa part, disant que cela lui servirait à se faire mieux traiter dans la prochaine hôtellerie ; qu'il n'y avait point de danger dans la montagne, et que tous ces guides-là étaient des coquins qui s'efforçaient d'épouvanter les passants pour gagner avec eux quelque pièce d'argent, et qu'ils n'en auraient point du sien. Ainsi s'étant fait donner le chemin par écrit, il prit le devant de deux heures. Pour moi je me ressouvins du conseil de l'évêque, qui était un vénérable vieillard, et que quand ce ne serait que pour le respect qu'on doit porter à la vieillesse, il ne faut jamais, si l'on peut, rejeter les avis des vieux gens. Je me joignis donc aux marchands génois, et nous devions partir avec notre escorte. Le Bénédictin était parti à six heures, dans le dessein néanmoins de se faire rattraper bientôt, et de se joindre à nous comme par occasion, sans être obligé ensuite de rien payer. Mais le malheur pour lui voulut que mous fûmes retardés de trois heures, car nous ne partîmes qu'à onze. Nous fûmes extrêmement surpris à sept lieues de là, dans la montagne, de trouver ce pauvre moine assis sur une pierre avec ses bottes, tout affligé et en larmes du malheur qui lui était arrivé. Il avait été attaqué dans le même lieu par cinq voleurs, qui l'ayant démonté, lui avaient pris son argent et tout ce qu'il avait dans sa valise, excepté son bréviaire qu'ils lui avaient rendu, ce qui lui déplaisait plus que tout le reste ; car encore, disait-il, s'ils avaient pris, j'aurais été exempt de dire mon bréviaire jusqu'à Rome. Cependant nous trouvâmes le moyen de le remonter, faisant descendre un des guides, auquel le père promit de donner ses bottes, nous le défrayâmes du reste sur la dépense commune jusqu'à Lucques. Il nous assura que les gens qui l'avaient volé, étaient armés et vêtus de même que les guides, et que s'il ne se trompait extrêmement, il les avait vus dans le marché de Sestri. On nous dit depuis que ce sont ces mêmes guides qui partent en même temps que les voyageurs, et par des chemins raccourcis dans la montagne se vont mettre en embuscade sur le chemin par où ils savent que l'on doit nécessairement passer, et ne manquent pas d'attaquer ceux qui ne se sont point voulu servir d'eux ou de quelques-uns de leurs compagnons. Par malheur pour ce père, il avait reçu l'argent d'une lettre de change à Turin, et n'en devait recevoir d'autre qu'à Rome. C'est ce qui nous obligea de nous séparer, ne me trouvant pas en état de fournir à sa dépense et à la mienne. Il se résolut donc d'aller du mieux qu'il pourrait à Rome par les monastères de toutes sortes d'Ordres, et même par les hôpitaux, puisque la nécessité l'y obligeait. Je le revis ensuite à Rome, où il n'était pas encore bien remis des misères qu'il avait souffertes depuis notre séparation. Il me fit un récit fort particulier des hôpitaux où il avait passé, ce que c'en était, et comme il y avait été traité. J'ai souvent entendu reprocher aux Protestants qu'ils n'ont point d'hôpitaux pour les étrangers, et confondant cette sorte d'hospitalité publique avec la charité, dire hardiment qu'ils ne sont point charitables, ni par conséquent véritables enfants de l'Église. C'est le propre d'une faible cause de mettre tout en œuvres pour se soutenir, et c'est néanmoins ordinairement ce qui sert de plus à la ruiner. Pour détruire cette prétendue charité des Catholiques, il suffira, Monsieur, de vous rapporter ce que m'en a dit ce père, et ce que j'en ai appris de quelques autres voyageurs : et c'est ce qui fera une partie du sujet de cette présente Lettre.
Vous saurez premièrement en général, que tous les anciens hôpitaux d'Italie sont redevables de leur fondation aux saints lieux de Rome et de Lorette. Les pèlerinages il y a quelques siècles, par une plus grande superstition, y étaient plus en vogue qu'ils ne sont à présent, quoiqu'il serait à souhaiter qu'ils le fussent encore moins : une personne n'était pas estimée être bon Chrétien qui n'avait pas fait le voyage de Rome. Les papes voyant combien ce grand concours augmentait leurs revenus, et rendait leur ville capitale riche et opulente, trouvèrent le moyen d'obliger les confesseurs d'enjoindre pour l'expiation des plus gros péchés, comme le rapt, l'inceste et le meurtre d'en faire le voyage. De sorte qu'il n'avait point de rémission pour ces sortes de péchés sans aller à Rome. Ils se firent ensuite des cas réservés de la plupart des ces sortes des péchés, dont on en trouve encore présentement un grand nombre dans la bulle In Cœna Domini (1), se réservant à eux seuls le pouvoir d'en absoudre ; de sorte qu'en ces cas, il faut aller à Rome, ou se résoudre de ne jamais aller en Paradis. Il est vrai que l'on a trouvé présentement le moyen de vous en épargner la peine, qui est d'envoyer en votre place une bonne somme d'argent. On se contente de cela, car je suis sûr que ce n'est pas la personne qu'on y demande. Comme dans le grand nombre de pèlerins qui s'y transportaient par dévotion, ou par nécessité pour l'expiation de leurs péchés, il s'en trouvait beaucoup qui étaient très pauvres et n'avaient pas les moyens de dépenser dans les hôtelleries, plusieurs personnes riches portées de compassion pour ces misérables, fondèrent des hospices ou hôpitaux pour les retirer. Ils y recevaient le logement et la nourriture, ou à quelque heure du jour que ce fût quelque aumône que l'on appelle la passade. Suivant que la fondation était forte, on y recevait une plus grande ou une plus petite aumône.
On trouve en Italie plusieurs hôpitaux fondés sur la fin du dixième ou au commencement du onzième siècle. La cause de ceci fut la fausse opinion où l'on était alors que le jour du Jugement universel s'approchait, sur une fausse tradition qui se conserve aujourd'hui dans l'Église romaine, que Jésus-Christ étant interrogé par Ses apôtres combien de temps ce monde visible durerait, Il leur répondit : Mille ans et plus. De sorte que la plupart des princes chrétiens et des grands seigneurs entreprirent en ce temps-là le voyage de Rome, fondèrent des hôpitaux pour les pauvres et pour les pèlerins, et des abbayes où plusieurs d'entre eux se retirèrent en attendant ce jour effroyable du Jugement. Pour ce qui est des hôpitaux le soin en fut commis aux prêtres, comme gens qui se mêlent de toutes sortes de legs pieux, et qui prennent volontiers le soin de tous les endroits où l'argent de la dévotion a cours. Ils étaient trop intéressés pour ne pas encourager de si beaux commencements, et ne manquèrent pas comme ils sont encore aujourd'hui, d'être continuellement dans les maisons des veuves et des personnes riches pour les porter à augmenter par leurs testaments les revenus des hôpitaux dont on les avait fait les économes. De sorte que qu'en peu de temps ces hôpitaux devinrent extrêmement riches. Il ne s'agit plus que de voir l'usage qui s'en fait présentement, pour juger si l'on en doit tirer un argument en faveur de ceux de la Communion romaine pour prouver que leur charité est supérieure à celle des Protestants, ou si l'on n'en peut pas plutôt inférer le contraire. Ce père bénédictin m'en fut dire des nouvelles. Il me dit qu'après que nous nous fûmes séparés à Lucques, qui est une petite république, il prit son chemin par Altopascio, qui est un ancien et fameux hôpital fondé par une reine de France, à huit miles de Lucques. Il ne sut pas bien me dire à combien monte le revenu de cette fondation, mais seulement que tous les étrangers de quelque rang qu'ils soient, pauvres et riches, y doivent être reçus et traités pendant trois jours selon leur qualité. Présentement ils n'y reçoivent plus les prêtres et les moines qui y passent, et ne donnent qu'un pain d'une demi-livre et une pinte de vin aux autres passants à la porte. Encore faut-il produire beaucoup de passeports et de lettres pour prouver que l'on est pèlerin, faut de quoi ce père fut en grand danger de n'y point être reçu. Mais au lieu de cela, il produisit hardiment sa lettre d'obédience. Le bon prêtre qui les examinait ayant vu qu'elle était en latin, et n'en sachant peut-être pas beaucoup, à la manière des prêtres d'Italie, la laissa passer, disant qu'il voyait bien que c'était une lettre de voyage du nonce apostolique de Turin ; de manière qu'il fut admis. Il me dit qu'il y fut passablement bien traité, et que s'étant informé de quelle manière cet hôpital était gouverné, un vieux serviteur de cette maison lui dit, qu'il y avait vingt-cinq officiers qui en étaient les intendants, les uns sous le nom de gardiens, d'administrateurs, et de receveurs ; et les autres sous celui de premier, second et troisième panetière et sommelier, qui étaient tous de riches ecclésiastiques qui partageaient entre eux presque tout le revenu de l'hôpital, n'y ayant plus qu'une fort petite portion de réserve pour ce peu de charité que l'on y faisait.
De là il passa à Pescia, qui est une fort jolie ville à une petite journée de là, où il y a un très grande nombre de couvents et de monastères. Il s'alla présenter à plusieurs pour y être logé ; mais partout on lui ferma les portes ; car les moines ou frati en Italie dont impitoyables et ne font aucune aumône aux étrangers. Ils ont un certain artifice dont ils se servent pour refuser les pauvres passants, qui est que tous les moines ont ordre de répondre que leur abbé, gardien ou prieur n'est pas au monastère. Et quand par hasard on les trouve et qu'on s'adresse à eux-mêmes, ils répondent que leur cellerier, procureur, ou quelque autre officier qui a la bourse est sorti. Ce père ayant été refusé partout, fut donc obligé d'aller chercher l'hôpital, qu'il trouva bien différent de celui d'Altopascio, pour le mauvais traitement, quoiqu'il eût beaucoup plus de peine à y entrer, sur ce que sa lettre portait qu'on l'envoyait à Rome pour affaires, et non pas pour dévotion ; car quoiqu'ils n'entendent pas beaucoup de latin, ils demandent néanmoins toujours qu'on leur montre ces deux mots-là : ex devotione. Deux ermites de ces coureurs d'Italie qui passent leur vie à aller d'hôpital en hôpital, ayant vu que ce père avait rudoyé pour sa lettre, s'approchèrent de lui après soupé, et s'offrirent de remédier à ce qu'il lui manquait, pour ne pas s'exposer à recevoir un affront une autre fois. C'était de lui faire eux-mêmes des lettres de pèlerinage, et d'y mettre dessus le sceau de l'archevêque de Lyon qu'ils avaient contrefait. Il ne s'agissait plus que de quelque pièce d'argent qu'ils demandaient du Bénédictin, lequel n'en ayant point, leur offrit son bréviaire. L'un d'entre eux le refusa, disant que c'était un mauvais meuble pour traîner dans les hôpitaux ; qu'il y avait longtemps qu'on leur avait heureusement dérobé les leurs, et que cela les exemptait de le dire, suivant ce décret de la sacrée Congrégation de Rome : Amisso vel ablato breviario non tenetur præbiter officio. Il ajoutait qu'ils avaient vu depuis peu chasser un prêtre de l'hôpital, parce qu'ayant un bréviaire, il avait manqué de dire l'Office devant soupé ; et qu'il craignait qu'on ne leur fît autant ; qu'ainsi il le priait de retenir son bréviaire. Mais son compagnon mit la main dessus, et dit qu'à la première boutique de libraire il saurait bien s'en défaire. Ainsi le Bénédictin reçut en même temps deux grâces, l'une d'être déchargé du fardeau de ses prières ; et l'autre d'avoir acquis une clef sûre pour entrer dans tous les hôpitaux, qui était une fausse lettre de pèlerinage. Ces deux ermites en donnaient pour de l'argent à tous ceux qui leur en demandaient. Le père poursuivit hardiment sa route par toutes les villes d'Italie, jusqu'à Rome, ayant été reçu dans les hôpitaux sans difficulté. Mais il m'avoua que s'il pouvait faire châtier sévèrement tous ceux qui en sont les gardiens et les administrateurs, il croirait rendre un grand service à Dieu et aux pauvres pèlerins : parce que, disait-il, c'est une chose pitoyable de voir comme ils les traitent, et ce qu'ils leur donnent à manger, qui ne monte pas à deux sols de dépense pour chacun, et si mal proprement que cela fait mal au cœur ; tandis que ces misérables prêtres-là prennent tout l'argent pour eux, pour maintenir leurs carrosses avec les magnifiques titres qu'ils prennent de Grands-Aumôniers, Grands-Administrateurs, ou Grands-Prieurs de l'Hôpital. C'est une chose infâme de voir comme on les fait coucher. Il y a environ vingt ou trente lits dans une grande chambre, et on les met deux à deux, ou trois à trois, selon le nombre qu'ils sont, dans un même lit. On les fait dépouiller tout nus dans une autre chambre, avant que d'entrer dans celle-ci. On ne leur permet pas même de retenir leurs chemises ; après on les enferme tous sous la clef jusqu'au lendemain matin. Les lits sont tous pourris, pleins de vermine, et sans draps dans plusieurs endroits. Les hôpitaux sont fort bien rentés ; mais c'est une invention maligne des gens qui sont établis pour en avoir le soin, de traiter le plus mal qu'ils peuvent les pèlerins, afin de les dégoûter entièrement d'y venir, et il faut être réduit dans une grande nécessité pour s'y résoudre.
Ce père me fit particulièrement mention d'un hôpital qui est entre les mains des Dominicains à Viterbe. Ces pères firent tous leurs efforts auprès des messieurs de la ville pour en obtenir la direction, promettant qu'ils prendraient un soin tout particulier des pèlerins, y employant fidèlement les revenus à leur usage ; ce qui leur fut accordé. Mais depuis, comme ce n'avait jamais été leur intention de le faire, mais plutôt de s'en servir eux-mêmes, ils ont pris pour eux tous les bâtiments, et ils mettent les pèlerins dans une des caves du logis. Le père y alla, et y trouva compagnie de sept ou huit autres pèlerins. Il dit qu'on les y ferma sans leur donner quoique ce soit à boire et à manger, ni lits pour se coucher. On les y fit rester toute la nuit jusqu'au lendemain dix heures, auquel temps on leur ouvrit la porte. Les pères dominicains les voyant sortir se moquaient d'eux ; leur demandant s'ils avaient le ventre plein, et s'ils avaient bien dormi à leur aise ; qu'ils les priaient à leur retour de Rome de repasser par là, et qu'on tiendrait toutes choses prêtes pour les bien recevoir. Tout le monde fait qu'il n'y a rien de plus dangereux en Italie que d'offenser un frère dominicain, parce que l'Inquisition est entre leurs mains, et qu'ils s'en servent ordinairement pour se venger. C'est pourquoi ces pauvres gens furent obligés de se retirer en silence, sans répliquer un mot aux vilaines railleries qu'on faisait d'eux, après les avoir si mal traités.
Le fameux et riche hôpital de Lorette à qui l'on a fait des donations immenses en faveur de pèlerins n'est guère mieux servi que celui-ci. Je vous rapporterai à ce sujet une chose dont j'ai été moi-même témoin étant à Lorette. Je me promenais dans la place qui est entre l'église et cet hôpital, avec deux prêtres français qui y avaient logé la nuit précédente. Les gardiens sont obligés de sonner une cloche pour assembler les pèlerins devant le souper, afin qu'ils s'y puissent trouver tous ensemble. Mais ces misérables qui n'ont non plus de religion que des chiens, et qui ne cherchent qu'à frauder les pèlerins, manquèrent ce soir-là tout exprès, comme ils font bien souvent, de la sonner. Les prêtres français se retirèrent sur les six heures à l'hôpital, où on leur demanda pourquoi ils n'étaient pas venus plutôt, et que le soupé était fini. Ils s'excusèrent sur ce qu'on n'avait point sonné la cloche. On leur soutint faussement qu'on l'avait sonnée, et il ne leur fut possible d'obtenir un morceau de pain ce soir-là. Le lendemain ces deux pauvres prêtres craignaient si fort que la même chose ne leur arrivât — car dans cet hôpital l'on y donner à souper et à coucher trois nuits de suite — qu'ils se tinrent depuis trois heures après midi, jusqu'au soir, sous la cloche. Les gardiens voyant qu'il n'était possible de les frustrer, les appelèrent tout doucement vers les six heurs, et leur dirent d'entrer dans la salle pour souper. Ce qu'ils refusèrent de faire, disant qu'ils n'entraient point qu'on n'eût sonné la cloche pour appeler les autres pèlerins. Les gardiens tout en colère ne purent pas s'exempter de le faire ; mais pour se venger ils leur servirent de fort méchant vin. Dans d'autres endroits d'Italie ils se servent d'autres ruses dans les hôpitaux, pour obliger les pèlerins à n'y pas venir si facilement. À Parme et à Turin, ils les obligent, tout fatigués qu'ils sont, d'aller en procession par toute la ville, à la vue de tout le monde, et à chanter de grandes litanies. Cela fait que les gens qui ont un peu de cœur, ou ceux qui sont naturellement plus honteux que les autres, aimeraient mieux coucher dans les rues et s'exposer à mourir de faim, que d'aller dans ces sortes d'hôpitaux, et s'exposer à des lois si odieuses. Quelques autres prennent à tâche de gâter tous les passeports des étrangers avec de grandes vilaines marques noires qu'ils font dessus, afin de donner à connaître qu'ils ont été reçus dans ces hôpitaux. Des gens qui sont un peu soigneux de conserver leur honneur dans leur pays, et de tenir leurs passeports bien propres, se donnent bien de garde de s'aller présenter dans ces lieux-là, où la charité est si ignominieusement administrée. Cependant c'est une subtilité dont ces gens-là se servent pour diminuer le plus qu'ils peuvent le nombre de leurs hôtes ; car moins ils en ont pendant l'année, et plus il leur reste d'argent entre les mains. D'autres ont l'effronterie de les faire travailler, pour leur faire gagner ce qui leur a été destiné par charité. Et enfin généralement partout, s'ils ne se trouvent à l'heure précise pour entrer, qui est ordinairement une heure devant la nuit, ils en sont exclus, et il n'est pas possible ni par prières, ni par larmes d'y être admis. D'autres les traitent très rudement de paroles, et avec un grand mépris. Enfin la charité s'y administre partout d'une manière si peu charitable, que si les bienfaiteurs de ces hôpitaux pouvaient retourner en vie, et en possession des biens qu'ils y ont légués, je crois qu'ils se donneraient bien de garde, voyant l'abus que l'on en fait, de recommencer de semblables fondations.
Le père me dit qu'il ne fut jamais mieux reçu que dans un nouvel hôpital que l'on érigeait à Montefiascone, à trois journées de Rome. Il y avait environ cinq ou six ans que les prêtres du lieu étaient après à persuader la noblesse et la bourgeoisie de cette petite ville, à contribuer à cette fondation. Ils avaient déjà un revenu fort considérable par les legs que quelques dames de qualité y avaient fait dans leurs testaments, et par quelques rentes annuelles que la ville y avait annexées. Le père voyant le bon accueil qu'on lui avait fait, dit en riant aux prêtres qui en étaient les directeurs, qu'il était fort satisfait du bon traitement qu'il avait reçu, qu'il priait Dieu de leur conserver cet esprit de charité pour les pauvres, et qu'il souhaitait pour le bien de leurs âmes qu'ils ne fissent point un jour comme les autres ; c'est-à-dire, qu'ils ne partageassent entre eux les revenus de l'hôpital, et ne négligeassent les membres de Jésus-Christ, comme ils font. Plusieurs pèlerins m'ont dit que c'était la plus grande misère du monde d'aller dans les vieux hôpitaux, quoique ce fussent les mieux fondés, et que dans les nouveaux on les traitait assez bien, parce que les prêtres n'en avaient pas encore partagé le revenu. Ils font comme les jardiniers qui laissent pendre le fruit à l'arbre jusqu'à ce qu'il soit venu à une parfaite maturité, après quoi ils le cueillent et en font leur profit : ou comme des marchands qui trafiquent ensemble, ils ne partagent point la bourse qu'elle ne soit pleine. Toutes ces belles pratiques extérieures de piété et de dévotion se terminant visiblement au propre intérêt, font bien voir qu'ils n'avaient point d'autre principe que l'avarice et l'hypocrisie.
Vous pourriez m'objecter ici, Monsieur, qu'il faut donc que les Italiens que j'ai dit ailleurs avoir beaucoup d'esprit, soient bien simples de se laisser persuader de donner leurs biens pour de semblables fondations voyant le grand abus qu'il s'en fait. À cela je vous puis répondre, que les prêtres en toutes sortes de pays ont toujours un très grand ascendant sur l'esprit des peuples, et que ceci joint à la doctrine de Rome, qui est que les prières des pèlerins ont une particulière efficace auprès de Dieu pour retirer les âmes du Purgatoire, et à la pratique qui est observée dans ces mêmes hôpitaux, de faire faire le soir de longues prières aux pèlerins pour les âmes des bienfaiteurs défunts, et de faire dire des messes pour eux dans les chapelles qui en dépendent, est un motif assez puissant dans la fausse croyance où ils sont pour les y porter. De plus ces mêmes prêtres sont fort adroits à divulguer partout, qu'ils sont très fidèles dans l'administration des aumônes ; qu'ils traitent bien les pèlerins, et que même ils y contribuent du leur pour aider aux grandes dépenses de bouche qu'il faut faire. Mais par une restriction mentale, ils l'entendent assurément de la leur ; car devant Dieu ils ne pourraient pas s'excuser de mensonge.
Il y avait autrefois en Italie beaucoup plus d'hôpitaux qu'il n'y en a présentement. Chaque monastère avait son hôpital. Saint Odon, abbé de Cluny [dès 910], voyant que les hôpitaux étaient passés en vogue, et que c'était une dévotion qui faisait grand bruit dans le monde, ne voulut ceder de rien en cela aux séculiers. Il partagea les grands biens de son abbaye en trois parts. La première fut pour l'abbé et pour la réception des étrangers de marque qui venaient au monastère. La seconde pour l'entretien des moines, qui fut appelée «manse conventuelle». Et la troisième pour le soulagement des pauvres, et pour recevoir les pèlerins, auxquels l'abbé par humilité lavait les pieds. Presque tous les abbés de France, d'Allemagne et d'Italie suivirent cet exemple, et partagèrent de même les revenus de leurs abbayes en trois. Mais cette charité si abondante n'eut pas un long cours. Peu de temps après, ce qui avait été donné d'une main fut repris de l'autre. La portion des pauvres se perdit ou plutôt se confondit avec celle de l'abbé et des moines. On ne voit plus présentement en Italie aucun de ces hôpitaux, excepté un seul qui se trouve au Mont-Cassin, et un autre à la grande Camaldule où l'on reçut les pèlerins. Les Chartreux en ont aussi dans le Milanais à leur Chartreuse de Pavie. Mais ce n'est pas à leur charité que l'on en est redevable, c'est à celle de Gian Galeazzo Visconti, duc de Milan et leur fondateur [en 1396], qui voulut que cette Chartreuse qu'il avait dotée d'un revenu presque immense, fut un hospice public tant pour les riches que pour les pauvres. Les pères chartreux ont fait depuis tout ce qu'ils ont pu pour anéantir l'hospitalité, sous le spécieux prétexte que cela les troublait dans leur solitude. Mais les seigneurs milanais qui en vertu de la même charte de fondation y doivent être reçus eux-mêmes et traités splendidement, avec leurs trains et équipages, toutes les fois qu'ils y passent, y étaient trop intéressés, et s'y sont opposés vigoureusement ; de sorte qu'ils sont obligés encore présentement, malgré qu'ils en aient, de la continuer.
C'est une chose connue en Italie et avouée de tout le monde, que les gens de l'Église y manquent extrêmement de charité. J'ai remarqué moi-même que les pauvres, qui n'en sont que trop persuadés par leur propre expérience, ne leur demandent que fort rarement l'aumône. Pour ce qui est des réguliers, ce père bénédictin me dit que depuis que nous fûmes séparés, dans toutes les villes où il y avait des monastères de son Ordre, il s'y était allé présenter pour avoir le couvert, mais qu'on n'avait presque jamais voulu l'y recevoir. On lui donnait pour réponse qu'il y avait un hôpital dans la ville, et qu'il pouvait s'y retirer. Il allait donc à l'hôpital, et là on lui en refusait l'entrée, disant qu'il y avait dans la ville un monastère de son Ordre, et qu'il y devait aller. Ainsi ce pauvre moine se voyant rejeté de tous côtés, déplorait sa condition. Il disait ensuite que s'il était en son pouvoir, il voudrait abolir tous les hôpitaux, et aussi tous les pèlerinages. Car de même, ajoutait-il, que ces hôpitaux sont scandaleusement administrés, aussi n'y a-t-il rien de plus abominable que gens qui s'y retirent. Entre vingt, à peine en trouvera-t-on un qui soit parti de son pays avec intention de visiter les saints lieux. Ce sont la plupart des vagabonds qui font le tour de l'Italie tous les ans. Ils passent ordinairement l'été dans les Alpes. Ils voyagent pendant l'automne ; passent l'hiver à Rome, à Naples ou dans la Calabre. Ensuite ils voyagent de nouveau dans le printemps pour aller prendre leur quartier d'été dans les montagnes. Leur manière de vivre c'est de gésir pendant le jour, d'aller de métairie en métairie, de sauter les haies pour dérober les fruits et prendre les volailles sur les grands chemins ou dans les basses-cours, et de voler ce qu'ils peuvent. Après quoi ils se retirent vers le soir dans quelque village prochain où ils savent qu'il y a un hôpital. Plusieurs d'entre eux voyagent avec toute leur famille ; ils ont leurs femmes et leurs enfants avec eux. Ceux-ci disent presque tous qu'ils sont de nouveaux convertis ; qu'ils étaient Protestants ou Juifs auparavant ; qu'ils ont abjuré leurs erreurs, et sont maintenant réduits pour l'amour de Jésus-Christ dans une si misérable condition. Ils présentent même de fort belles lettres de crédence avec de beaux grands sceaux. J'ai pris quelquefois plaisir d'interroger ces gens-là sur le judaïsme, ou sur la croyance des Protestants ; mais ils ne pouvaient pas me satisfaire par leurs réponses. C'est pourquoi je les interrogeais plus particulièrement comment ils pouvaient avoir obtenu de si belles lettres. Quelques-uns d'entre eux m'ont avoué qu'ils les avaient achetées pour de l'argent d'un abbé qui demeurait à Turin, et qui vivait de ce métier-là. Il avait toutes sortes de cachets, et contrefaisait toutes sortes d'écritures. Pour eux ils confessaient qu'ils n'avaient jamais été ni Juifs, ni Protestants ; mais qu'ils se servaient de cet artifice pour porter le monde à leur faire plus de charité.
On voit encore plusieurs sortes de coureurs d'hôpitaux qui ne valent pas mieux. Il y en a qui traînent avec eux de grosses chaînes et des menottes de fer, disant qu'ils ont été esclaves en Turquie, et qu'ils ont été délivrés miraculeusement des mains des infidèles par les vœux qu'ils ont faits à Rome ou à Notre-Dame de Lorette : cependant si on les examine un peu de près sur ces contrées éloignées, ils ne savent pas en répondre pertinemment. Et il est d'ailleurs évident qu'ils achètent leurs chaînes chez les serruriers ; ce que plusieurs Italiens m'ont dit eux-mêmes avoir vu. De plus se sont des gens si dissolus dans leurs mœurs et si débauchés, que s'il était vrai que la Vierge eût fait quelque miracle pour les tirer d'esclavage, elle en devrait faire un autre pour les y faire retourner. Un autre sorte de pèlerins dans les hôpitaux, ce sont de certains ermites de la qualité de ces deux dont je vous ai écrit ci-dessus, qui ne sont que rouler d'un lieu de dévotion à l'autre, de Rome à Lorette, et de Lorette à Rome, menant partout une vie scandaleuse. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu la permission des évêques pour mener la vie hermétique, mais qui en ont pris l'habit d'eux-mêmes. Je me souviens qu'à Lyon M. le grand vicaire fit arrêter un de ces ermites, qui avoua dans les prisons qu'il avait donné lui-même l'habit à dix-sept méchants garnements, moyennant trois écus par tête ; sur quoi il leur avait fourni le drap, coupé et cousu les robes et les capuchons lui-même, et donné de fausses lettres pour courir l'Allemagne et l'Italie. Les gardiens des hôpitaux reçoivent tous ces gens-là mieux que les passants et pèlerins qui sont un peu honnêtes, parce que par leur présence ils dégoûtent les autres d'y venir.
Ce sont là les sortes de gens qui courent par les hôpitaux, lesquels étant d'ailleurs administrés de la manière que je vous ai écrite ci-dessus, jugez je vous prie, Monsieur, si l'Église de Rome a grand sujet d'exalter si fort ses pèlerins et ses hôpitaux, et de reprocher aux Protestants qu'ils n'en ont point. Pour moi je crois que leur méthode et conduite en ce point est incomparablement meilleure. Ils ont retranché fort sagement ces sortes de pèlerinages, étant convaincus qu'il est bien meilleur de se renfermer dans son cabinet pour prier en secret le Père céleste, que de courir d'un côté et d'autre pour prier Dieu et les saints dans les places publiques, comme sont les Catholiques romains. Ils savent que Dieu n'a point attaché la sainteté ni aux temps ni aux lieux, et que c'est une folie de fonder des lieux de retraite pour des vagabonds qui sont la plupart des gens oisifs ou de mauvaise vie, qu'on devrait plutôt enfermer pour les faire travailler, et gagner leur vie honnêtement que de leur laisser une liberté dont ils font un si mauvais usage. Pour ce qui est des étrangers et des voyageurs, s'il arrive qu'ils tombent dans quelque nécessité, on ne manque pas dans les pays protestants de les secourir honnêtement dans le besoin, particulièrement si l'on reconnaît que ce soit des gens de bien. Et si ce sont des personnes établies dans les villes, les paroisses d'où ils prennent connaissance de toutes leurs nécessités et y remédient fort charitablement. Voilà, ce me semble, Monsieur, une charité bien mieux réglée, et par conséquent beaucoup plus agréable à Dieu, et telle qu'elle était pratiquée dans la primitive Église.
Vous me direz ici, Monsieur, que les pèlerins de l'Église de Rome ne sont pas seulement ces pauvres misérables dont j'ai fait mention, mais qu'il y a des personnes fort qualifiées, de toutes sortes de rangs et de conditions qui font le voyage de Rome et de Lorette par dévotion, à l'imitation de sainte Pélagie, de sainte Paule et de sainte Eustochie, nobles dames romaines qui entreprirent le voyage de Jérusalem pour y visiter les saints lieux, selon le témoignage de S. Jérôme ; et que ce sont ceux-là dont votre Église exalte le zèle. Je ne vous dénierai pas à la vérité, que je n'aie vu plusieurs gens de qualité aller en pèlerinage à Rome et aux autres lieux de dévotion qui sont en vogue en Italie ; et je ne voudrais pas désapprouver si fort leur entreprise, si les objets auxquels ils vont rendre leurs adorations en étaient dignes, et que la manière avec laquelle ils le font fût édifiante. Mais pour vous dire sincèrement mon sentiment, je ne vois rien dans toute l'Italie qui mérite que l'on se mette en de si grands frais ; si ce n'est pour y voir les belles villes, et les beaux ouvrages que la nature et l'art ont produits. Mais en ce cas c'est la curiosité, et non la dévotion qui porte les gens à en entreprendre le voyage. De plus, Monsieur, la manière avec laquelle les personnes riches vont en pèlerinage est si extravagante, si libertine et si licencieuse, qu'en vérité il vaudrait bien mieux qu'ils se tinssent dans leurs maisons à rendre honneur à Dieu dans leurs familles, que d'en sortir comme ils font pour satisfaire leurs plaisirs sous le manteau de la dévotion, au grand scandale de tout ce qu'il y a de gens de bien. J'espère que vous en tomberez vous-même d'accord lorsque je vous en aurai appris quelques particularités dans la première lettre que j'ai dessein de vous écrire, qui traitera de mon voyage de Lorette.
Pour le présent, comme je me trouve encore à Lucques, où le Bénédictin se sépara de moi, et à l'occasion duquel je vous ai parlé des hôpitaux, je vous dirai seulement avant que d'en sortir, sans vous faire la description de cette ville qui n'entre point dans mon dessein, qu'en sortant de mon hôtellerie, je fus fort surpris d'entendre des gens dans la rue qui juraient et blasphémaient le saint nom de Jésus-Christ. Il y avait là beaucoup de peuple qui s'était amassé, et qui les regardait, sans témoigner la moindre horreur d'entendre des blasphèmes si exécrables. Je demandai avec quelque indignation pourquoi on les souffrait parler de la sorte. On me répondit fort doucement que je me trompais, et qu'ils ne juraient ni ne blasphémaient point le saint nom de Jésus-Christ. Il y avait là beaucoup de peuple qui s'était amassé, et qui les regardait, sans témoigner la moindre horreur d'entendre des blasphèmes si exécrables. Je demandai avec quelque indignation pourquoi on les souffrait parler de la sorte. On me répondit fort doucement que je me trompais, et qu'ils ne juraient ni ne blasphémaient point ; mais que c'était une querelle particulière touchant une pièce de monnaie de la valeur d'environ douze sols que l'on appelle à Lucques un «Jésus-Christ». Les Lucquais firent battre cette monnaie en l'honneur d'un crucifix miraculeux qu'ils conservent dans leur cathédrale, et qu'ils disent avait ou pleuré, ou parlé, ou versé du sang : car ce sont là les miracles ordinaires de ces crucifix. Jésus-Christ en Croix est imprimé sur cette monnaie que l'on appelle un cristo. Ce qui fait qu'au jeu ou dans les différents qui naissent touchant les paiements, le vénérable nom de Jésus-Christ est bien souvent non seulement pris en vain, mais aussi injurié et blasphémé, comme ces misérables faisaient pour une de ces pièces de monnaie, que l'un rendit à l'autre avec ces mots effroyables : «Tien voilà ton B..... de Christ». J'ai vu une autre sorte de monnaie que l'on appelle une madonnina [cinq baiocchi] ; c'est-à-dire une «Notre-Dame» ou une «Vierge Marie», qui est une pièce de six sols de Bologne. Le même inconvénient par proportion arrive dans les disputes qui naissent sur ce sujet. C'est ainsi qu'une dévotion imprudente se termine ordinairement à une grande impiété. La reine Christine de Suède ayant vu une de ces monnaies, dit en riant au cardinal de Lucques, que les Italiens auraient mieux fait d'en faire une avec le nom de Dieu ; voulant dire l'or et l'argent était le dieu d'Italie, n'y ayant point de peuples au monde qui en soient plus idolâtres, et néanmoins plus négligents et paresseux pour en gagner.
De Lucques je passai à Pise, ancienne ville de Toscane, située sur la rivière d'Arne. Entre les choses remarquables on y voit un fort beau cimetière, en italien camposanto. Il est extrêmement grand, de figure carée. Les murailles et les tombeaux sont tout de marbre, de jaspe et de porphyre artistement bien travaillés. Les Pisans le remplirent de terre qu'ils avaient apportée dans plusieurs vaisseaux, de Jérusalem. Les corps morts y sont consumés en vingt-quatre heures. Ils disent que c'est un continuel miracle de cette terre sainte : mais pour moi je n'y en trouve pas plus que dans le cimetière de Saint-Innocent à Paris, où la même consomption s'y fait en aussi peu de temps, sans aucun miracle.
On montre dans toutes les églises une infinité de reliques de saints et de saintes, comme dans tout le reste de l'Italie, dont la plupart sont extrêmement ridicules. Je ne m'arrêterai pas présentement à vous en faire le dénombrement, et je passerai à Florence, où je vous entretiendrai de cette grande dévotion qui est si fort en crédit à une église que l'on appelle la Santissima Annunziata (l'Annonciade ou Annonciation). L'origine de cette dévotion est telle. Un peintre ayant été employé à faire l'image de la Vierge, dans la posture où la tradition de Rome dit qu'elle était, lorsque l'Ange Gabriel lui fut envoyé pour lui annoncer l'Incarnation du Verbe ; c'est-à-dire dans sa chambre, à genoux, lisant la prophétie d'Isaïe. Le peintre réduit à perfection toutes les parties du tableau, excepté une qui était le visage de la Vierge, qu'il avait réservé pour le dernier. Mais ne sachant quelle idée prendre pour représenter au vif une si excellente créature, et désespérant de trouver rien d'assez parfait dans son art pour en venir à bout. Dans le chagrin où il était, il s'endormit dans l'église où il travaillait. Trois ou quatre heures après il s'éveilla : Et prodige étrange ! digne de l'admiration de tous les peuples ! il vit que le visage de la Vierge, dont le dessein l'avait si fort embarrassé, était heureusement achevé, et beaucoup mieux qu'il n'aurait pu faire. Là-dessus il cria miracle, et publia hautement qu'un ange envoyé du Ciel y avait mis la main pendant son sommeil. Les frères du couvent où il travaillait s'y trouvant intéressés, se rangèrent de son côté ; de sorte qu'en un moment la dévotion prit feu, et le concours fut si grand à leur église, et y a continué depuis avec un si heureux succès, qu'elle est aujourd'hui une des plus riches d'Italie, et le couvent des frères un des mieux rentés. Les réflexions que j'ai faites sur cette peinture, sont qu'il pourrait y avoir eu de la tromperie en plusieurs manières. Premièrement, il pouvait y avoir eu quelque tour de subtilité de la part de quelque inconnu, ou même de quelqu'un des frères habile dans le métier, lequel étant entré par hasard dans la chapelle où ce peintre travaillait, et l'ayant vu endormi, ce serait servi de l'occasion ; et ayant parachevé l'œuvre, ce serait retiré secrètement avant que l'autre se fût éveillé. Secondement, il se peut faire que le peintre pour faire parler de lui, et se mettre en crédit d'un homme de bien, ait débité une telle menterie. Enfin, il pourrait bien être que les frères de ce couvent ayant suborné le peintre pour quelque pièce d'argent, l'aient porté à publier une telle menterie pour en tirer avantage. Ce que je dis ici de ce qui peut avoir été, n'est pas que je veuille m'efforcer par toutes sortes de moyens de donner quelque mauvais tour à ce prétendu miracle. Je sais que c'est le caractère d'un esprit mal fait et malin d'interpréteur en mal ce qui peur recevoir un sens favorable, et je ne voudrais pas pour tout un monde m'exposer à un tel reproche. Mais ce que j'en dis, c'est que je suis d'ailleurs convaincu par de bonnes raisons, que le fait de question est une fausseté manifeste et palpable. Premièrement, si c'était un ange, comme on le prétend qui eût peint le visage de la Vierge ; comme l'opération d'un ange est beaucoup plus parfaite que celle d'un homme, il s'ensuit que cette peinture, au moins quand au mélange et à l'application des couleurs, devrait être extrêmement au-dessus des ouvrages de Carracci, de Guido Reni, ou des autres plus fameux peintres d'Italie. Cependant on voit tout le contraire, et qu'elle n'est pas meilleure que ce que ce peintre avait déjà commencé ; ce qui a fait dire à un voyageur qui l'avait bien considérée, qu'il fallait que cet ange qui l'avait peint fût un gros lourdaud, d'avoir tiré des traits si grossiers. De plus un argument très fort pour prouver aux Catholiques romains que cette supposition est fausse ; c'est que ce visage ne ressemble point du tout à ces autres images de la Vierge qu'ils prétendent avoir été dépeint par l'Évangéliste S. Luc. Ce visage est rond, blanc et vermeil, avec des yeux assez vifs et animés, et un front étroit et uni : Et celui de la main de S. Luc a un visage long et basané à l'égyptienne, un regard humble et modeste, avec un front large et avancé, et qui n'a rien de cette beauté si charmante de la Vierge, dont leurs discours sont remplis lorsqu'ils en parlent, et plus propre à exciter un appétit sensuel que des sentiments de dévotion. Il faut donc nécessairement où que cet ange se soit trompé, ou que S. Luc ait été fort ignorant dans le métier de peintre, qu'ils lui attribuent néanmoins en perfection. Car l'un ou l'autre s'est assurément mépris. De dire que ce soit l'ange, c'est déroger extrêmement et contre toute raison à l'excellence de ces esprits bienheureux ; et d'en accuser S. Luc, c'est aller contre leur tradition qu'ils ne devraient pas si fort abaisser, que de la faire cèder au témoignage particulier d'un pauvre peintre qui peut-être un homme menteur comme tant d'autres — je parle ici de celui qui peignit ce tableau de l'Annonciation. Enfin l'on pourrait tout aussi bien dire, que le Diable pour donner plus de cours à la superstition s'en serait mêlé, comme d'assurer que c'est un ange de lumière : Mais même l'on n'aurait pas trop raison de le dire, car le Diable est plus fin, et il aurait assurément pris son idée sur le tableau de Santa Maria Maggiore à Rome. Quoiqu'il en soit les papes on dit cela était vrai, et ont approuvé ce fait ; ils ont donné des bulles pour l'autoriser, et des excommunications contre ceux qui en douteraient, de même que tant d'autres ont fait en faveur des images de S. Luc. Cette dévotion a attiré des trésors immenses à ces pères que l'on appelle Servites (2). Le grand-duc de Toscane y allait faire ses prières tous les soirs, lorsque j'étais à Florence, et c'est là ordinairement que les étrangers se rendent pour y voir la Cour. Il faisait toujours de grandes aumônes aux pauvres qui étaient à la porte, et qui, à ce que l'on m'a dit, sont tous des gens fort à leur aise, quoique pour y porter davantage le monde à compassion, ils se tiennent couverts de haillons. Ils ont tellement pris possession de ce poste, qu'ils ne permettent pas qu'aucun gueux étranger se mêle parmi eux.
À l'occasion de ces pauvres, et afin que vous reconnaissiez aussi mieux la puissante vertu de cette sainte image, et des miracles que la Vierge fait continuellement en faveur de ceux qui y vont rendre leurs dévotions, je vous rapporterai ici un miracle que l'on criait par les rues de Florence, qui était arrivé depuis peu. J'en achetai par curiosité l'imprimé. La pièce me parut assez galante, et quoiqu'elle soit un peu longue, j'espère que le récit ne vous en sera pas ennuyeux. Un gentilhomme d'une des meilleures familles de Florence était tombé d'un état florissant, par divers revers de fortune, dans une extrême pauvreté. Ce qui l'affligeait davantage, c'est qu'il avait deux grandes filles qui n'étaient point encore pourvues. Tout son recours dans une si misérable condition, fut à la mère de Dieu. Pour entrer plus avant dans ses bonnes grâces, il fit vœu d'être toute sa vie fort dévot à son image miraculeuse de l'Annonciade. Pour cet effet il se levait tous les jours de fort grand matin, et allait faire sa prière sous le portail de l'église avant que les portes fussent ouvertes. Après avoir continué sa dévotion un assez longtemps, la Vierge voulut exaucer sa prière, et lui donner quelque soulagement. Elle inspira deux aveugles, de ceux qui se tenaient ordinairement à la porte de l'église, de se lever plutôt qu'à l'ordinaire pour aller prendre leurs places sous le portail. Y étant arrivés, l'un commença à raconter à son compagnon les grandes obligations qu'il avait à la Vierge miraculeuse, et que de très pauvre il était devenu riche en très peu de temps par les aumônes ; qu'outre l'argent monnaie qu'il avait laissé au logis, il avait deux cents pistoles d'or cousues dans le fond de son chapeau. L'autre aveugle l'ayant entendu discourir fort au long, dit qu'il n'enviait point son bonheur, puisqu'il était redevable à l'image miraculeuse de beaucoup davantage, et qu'il avait dans son chapeau cinq cents pistoles d'or. Le gentilhomme qui était tout proche en prière, sans avoir fait le moindre bruit qui le put découvrir, les ayant entendu parler de la sorte, voyant une si belle occasion de s'enrichir, s'approcha tout doucement des deux aveugles, et des deux mains leur enleva d'un même coup à tous deux leurs chapeaux de dessus la tête, et se retira quelques pas en arrière. Les deux aveugles extrêmement surpris, un chacun d'eux croyant que son compagnon eût fait le coup, s'entre-demandèrent l'un à l'autre leurs chapeaux, et entrèrent dans une telle colère, qu'ils prirent leurs béquilles, et s'en étant déchargés à tous deux plusieurs grands coups sur la tête, ils se seraient entre-tués l'un l'autre, si l'on n'était accouru promptement pour les séparer. Le gentilhomme s'était déjà retiré, et ayant quelque scrupule de ce qu'il avait fait, alla trouver le même jour le cardinal-archevêque de Florence (3), auquel il raconta ce qui s'était passé. L'archevêque approuva fort son action, et lui dit qu'il n'était point obligé à la restitution, puisqu'il était visible que la Vierge l'avait assisté en considération de la dévotion qu'il portait à son image miraculeuse ; et ordonna pour la consolation des fidèles que ce fait fut imprimé et publié par la ville de Florence. La même histoire a été depuis imprimée de nouveau dans un livre qui a beaucoup de cours en Italie, et qui est intitulé l'Utile c'ol dolci. Vous voyez ici, Monsieur, un plaisant miracle, où la Vierge pour favoriser un de ses serviteurs en fait un voleur, que l'on aurait dû punir selon les lois. Car enfin de quelque manière que ces pauvres aveugles eussent amassé cet argent, il était à eux, et leur avait été donné par aumône. Que si d'ailleurs cette histoire a été faite à plaisir, je m'étonne qu'un cardinal-archevêque l'ait voulu faire imprimer, et ensuite que l'Inquisition qui sur toute autre matière paraît si exacte, ait voulu en permettre l'impression dans le livre susmentionné.
On est si rebattu de miracles en Italie, qu'à moins qu'ils ne renferment quelque chose de romanesque et de fabuleux, l'on n'y fait presque pas de réflexion. C'est ce qui fait que les Italiens, qui sont accusés avec beaucoup de fondement d'en imposer tous les jours de nouveaux, prennent si grand soin aujourd'hui d'en rendre les circonstances si rares, si surprenantes, ou si agréables, qu'il y a du plaisir à les lire ou à en entendre le récit. J'en pourrai traiter plus particulièrement dans quelqu'une de mes Lettres. C'est ce qui me fera passer présentement sous silence ceux de cette fameuse église de l'Annonciade, pour vous parler de quelques lieux de dévotion qui ne sont pas beaucoup éloignés de la ville de Florence, que j'eus la curiosité d'aller voir. C'est dans les hautes montagnes de l'Apennin. Là on y voit à une journée l'une de l'autre, trois fameux déserts, où ont pris commencement autant de chefs de différents Ordres. Le premier est Camaldule, le second Vallombreuse, et le troisième le mont Alverne. La Camaldule a été appelée par prééminence le sacré désert ; et c'est assurément un des lieux les plus déserts qu'ait pu former la nature. Saint Romuald obtint ce lieu d'un comte appelé Maldule. Il s'y retira pour y mener une vie pénitente, et ayant attiré par son exemple quelques disciples, il y bâtit un monastère dans l'entre-deux de deux cimes, sur une très haute montagne ; et ensuite désireux d'une plus grande solitude, il se retira au plus haut sommet d'une des cimes qui était un lieu presque inaccessible. Là il institua comme un double Ordre, l'un de moines, et l'autre de solitaires sous un même habit et une même règle, excepté quelques constitutions particulières aux uns pour la vie hermétique, et aux autres pour la vie monastique. Les moines habitèrent le monastère qu'il avait bâti plus bas, et les solitaires restèrent avec lui à la cime que l'on appelle aujourd'hui le sacré désert. J'arrivai à ce monastère au commencement d'octobre. On va presque toujours en montant depuis Florence, et de là on peut découvrir cette superbe ville avec tout le pays d'alentour ; ce qui y cause une très agréable perspective. Ces pères ont conservé l'hospitalité, et reçoivent encore aujourd'hui les étrangers qui y vont, et les traitent selon leur qualité pendant trois jours. Comme il n'y a là aucune hôtellerie, ni maisons proches où l'on puisse se retirer, je m'allai présenter à l'abbaye où je fus reçu fort honnêtement. J'y trouvai trois messieurs florentins auxquels je me joignis de compagnie, et l'on nous servit le soir à table des œufs et du poisson, sans superfluité, mais avec une médiocrité bienséante à l'état religieux de ces pères, dont je restai plus édifié que je n'avais été à Cîteaux en France, où l'abbé nous y traita avec tant de profusion et d'excès. Nous témoignâmes le soir que notre dessein était d'aller le lendemain au sacré désert. C'est pourquoi l'on nous éveilla à cinq heures de matin, et l'on nous fit manger à six. Je fus tout surpris que l'on nous eut préparé à dîner de si bonne heure, et pas un de nous n'avait l'appétit encore ouvert ; mais l'on nous dit qu'il fallait nous forcer à manger, parce que l'air était si subtil et si froid en allant vers la cime, que nous ne pourrions pas le supporter si nous avions l'estomac vide. De plus qu'il fallait nous disposer à grimper à pied près de six miles dans les rochers, et marcher sur la neige avant que d'arriver au sacré désert, et que là on n'y donnait à manger à personne pour ne point troubler le repos des solitaires. De sorte que nous serions obligés de redescendre par le même chemin au monastère, pour y prendre une seconde réfection. Nous nous laissâmes donc persuader, et après avoir mangé nous partîmes de l'abbaye sur les sept heures, et nous nous acheminâmes vers la cime, toujours en tournant dans la montagne, dans une continuelle forêt de grands sapins. Tous ces rochers sont pleins de petites sources d'eau très claire, qui ruissellent de toutes parts dans le chemin par où l'on monte, de manière que l'on ne peut pas monter bien haut sans marcher dans l'eau, ce qui est fort incommode. Ces eaux étant ramassées, forment un assez gros torrent qu'il faut passer et repasser sur de grands arbres de sapins posés en travers en forme de pont. Nous arrivâmes vers le midi à la cime, après avoir marché environ deux miles sur la neige. C'était au mois d'octobre, mais le haut de la montagne est si froid, que lorsqu'il pleut en bas, il neige presque toujours en haut. La neige y était extrêmement haute depuis huit jours, et nous n'aperçûmes de loin que la partie supérieure de l'église, et les toits des cellules. Nous en comptâmes jusqu'à soixante, qui sont séparées les unes des autres de l'espace d'environ vingt pas, et forment comme une petite ville. Chaque cellule a plusieurs appartements et un jardin. On nous montra celle de S. Romuald qu'un des ermites habitait. Nous demandâmes pourquoi ils ne portaient pas un plus grand respect à la cellule de leur bienheureux fondateur, qu'ils la laissaient à un de leurs religieux pour y demeurer ? Ils nous dirent que c'était là le seul moyen de la conserver contre l'humidité, et que sans cela le bois en pourrirait et qu'elle serait en danger de tomber en ruine. On nous montra la cellule d'un vénérable ermite qu'ils disaient y avoir quarante ans qu'il n'en était sorti, y vivant encore dans un perpétuel silence sans parler à personne. On lui passait son manger par une petite fenêtre, qu'il prenait fort sobrement. Ces solitaires le prenaient pour un saint ; car ils estiment le silence par-dessus toutes les autres vertus. Cela me donna occasion de demander à ceux qui avaient la charge de nous accompagner, ce que c'était donc que cette grande vertu du silence, et comment ils la définissaient ? Ils nous répondirent que c'était se taire avec les hommes pour parler avec Dieu. Sur quoi je leur dis, qu'il me semblait qu'elle serait mieux définie, se taire et parler quand il faut ; et que je ne pouvais pas approuver l'usage qu'ils ont introduit parmi eux de ne parler que par signes. Nous venions d'en éprouver nous-mêmes les incommodités en entrant dans ce sacré désert ; car ayant trouvé la porte de l'enceinte des murailles ouverte, nous étions entrés tout droit ; et comme nous ne savions de quel côté tourner, nous nous approchâmes de quelques-uns de ces solitaires qui travaillaient à remuer la neige pour faire des passages. Nous les priâmes d'avoir la bonté de nous dire à qui il fallait nous adresser pour voir les particularités de ce lieu, mais pas un d'eux n'ouvrit la bouche pour nous répondre un mot. Les uns nous firent des signes de mains et de pieds, et d'autres avec leurs ballets et avec leurs pelés. Nous croyons d'abord qu'ils étaient fous, ou qu'ils nous voulaient chasser : mais à la fin nous comprîmes qu'ils nous faisaient signe de retourner à la porte pour parler aux portiers, que nous trouvâmes heureusement. Je dis donc à ces deux portiers, que je trouvais fort étrange que Dieu ayant donné aux hommes une langue et une bouche pour exprimer leurs pensées, quelques-uns au lieu de reconnaître par un bon et direct usage, cet avantage qu'il leur a donné par-dessus les bêtes brutes, entreprissent de vouloir parler avec les mains et avec les pieds, comme font les muets de naissance ou à qui l'on a coupé la lange ; Que pour le moins cela me semblait une chose fort impropre, bien loin de me paraître une vertu propre à sanctifier les hommes. Ils me répondirent que c'était là des mystères qui n'étaient point connus des séculiers, mais seulement révélés de Dieu aux solitaires, et aux âmes parfaites qui en connaissent l'excellence. Les péchés des gens du monde, poursuivit-il, sont des péchés grossiers comme l'avarice, l'envie, la luxure, la blasphème, etc. Mais pour nous, nos plus grands péchés c'est de rompre quelquefois par fragilité le silence, de marcher avec un peu trop de précipitation, de faire quelques regards curieux quoiqu'innocents, d'être malpropres dans nos habits, d'avoir préféré quelquefois l'oraison vocale à la mentale, d'avoir été trop attaché aux goûts célestes, et trop rétif aux souffrances. Il me semblait apercevoir dans ces sortes de réponses, je ne sais quoi de superbe et hautain qui ressentait le non sum sicut cæteri hominum du Pharisien, et qui me fit appréhender que la superbe ayant été le péché des anges dans le Ciel, ne fût aussi celui de ces solitaires dans les cimes. Ainsi bien loin que toutes ces belles apparences de piété me fissent concevoir quelque penchant pour ces solitudes matérielles qui semblaient en faciliter la pratique, que je conçus plus d'amour pour une vie ordinaire et humble dans le monde, accompagnée de toutes les pratiques de piété qu'on a lieu d'y exercer. Il me semblait que ces solitaires-là ne faisaient leur capital que de certaines bagatelles, qui néanmoins les éloignait si fort de la charité de ceux qui vivent engagés dans le commerce du monde, qu'ils ne les considèrent que comme des gens qui sont dans le chemin de perdition, et pour lesquels il n'y a point de salut. Ces sentiments ne sont pas assurément charitables ; car plusieurs séculiers dans le monde sont aussi agréables aux yeux de Dieu que ces ermites dans les montagnes. Les portiers nous dirent qu'on portait trois fois la semaine du grand monastère qui est au bas de la montagne, les vivres et autres provisions nécessaires pour l'entretien de ceux qui vivaient au sacré désert. Ils nous conduisirent ensuite à l'église qui est fort petite et étroite, toute boisée de tous côtés contre l'humidité et le grand froid. Ils nous assurèrent que dans de certains hivers toutes les cellules et l'église étaient ensevelies dans la neige, et qu'ils creusaient des chemins par-dessous pour la communication des cellules, auxquels ils donnaient des jours par en haut, en sorte que cela paraissait comme de grandes voûtes blanches. Pendant tout le temps qui'ils vivent sous la neige, ils ne sentent pas beaucoup de froid : mais pour garantir de l'humidité, ils entretiennent un très bon feu qui brûle jour et nuit, ayant là auprès de très grandes forêts de pins, de châtaigniers et de sapins qui leur fournissent abondamment du bois. Après avoir visité l'église, nous nous en retournâmes par le même chemin que nous étions venus, et nous nous rendîmes à l'abbaye vers les cinq heures du soir, où l'on nous reçut fort bien comme auparavant. Il n'y a que cette abbaye qui se maintienne dans une assez bonne observance. Tous les autres moines du même Ordre, qui ont beaucoup de monastères dans l'Italie, mènent une vie fort scandaleuse. Nous en partîmes le lendemain après avoir remercié ces pères ; et sachant que l'abbaye de Vallombreuse, qui est chef d'un autre Ordre de moines fort fameux en Italie, n'en était éloignée que d'une journée, nous nous y acheminâmes tous ensemble. Nous descendîmes l'espace de quelques miles, et ensuite nous côtoyâmes l'Apennin par un chemin très agréable. Nous marchâmes fort longtemps dans des forêts d'oliviers tout chargés d'olives, et de temps en temps nous trouvions des collines pleines d'orangers et de citronniers tout chargés d'oranges et de citrons. Quelques-uns sont d'une hauteur qu'un homme à cheval peut passer par dessous sans toucher les branches. Après qu'on les a une fois plantés, ils y croissent sans art et sans être cultivés. Tous les côtés de ces montagnes sont extrêmement riches, étant remplies de toutes sortes d'arbres fruitiers, et au pied de chaque arbre il y a un cep de vigne qui l'embrasse, et entrelaçant ses branches avec celles de l'arbre, mêle fort agréablement dans la saison ses raisins avec les fruits. Après une demi-journée de chemin, il nous fallut monter dans l'Apennin l'espace de quatre miles, par des endroits assez escarpés et scabreux, jusqu'à Vallombreuse — en latin Vallus Umbrosa. C'est une vallée par rapport aux cimes de montagnes qui l'environnent ; mais à l'égard du pays plat qui est au bas, c'est une très haute montagne et même fort froide ; car il n'y croit point d'arbres fruitiers, excepté des châtaigniers et quelques pommiers. Les grandes forêts de pins et sapins qui l'environnent de tous côtés, la rendaient autrefois fort obscure, ce qui lui fit donner le nom de Vallombreuse. Saint Jean Gualbert en fit le choix pour le lieu de sa retraite. Il aimait naturellement ces sortes de lieux, et dans tous les voyages qu'il entreprit, lorsqu'il voyait quelque bois obscur ou quelque lieu solitaire, il projetait d'y venir un jour établir sa demeure, et d'y fonder un monastère.
Je suis la plupart du temps obligé dans mes Lettres, selon que la matière m'y engage, de faire le récit de plusieurs actions vicieuses et mauvaises des Italiens. C'est toujours contre l'inclination naturelle que j'ai de taire le mal, et de ne rapporter que le bien. C'est pourquoi pour délasser ma plume, et pour donner quelque chose au grand désir que j'ai de faire honneur à la mémoire des grands hommes, vous permettrez s'il vous plaît, Monsieur, que je me donne la satisfaction de vous faire le récit d'une action véritablement vertueuse et mémorable de S. Jean Gualbert. Ce jeune seigneur avait un frère qu'il aimait tendrement, lequel s'étant engagé dans un duel, fut malheureusement tué par son rival. Gualbert crut ce serait une entreprise digne de son honneur et de son grand courage que de chercher à venger la mort de son frère. Pour cet effet il se mit à la poursuite de cet homicide, et comme il avait pris la suite, il en fit la recherche par toutes les provinces d'Italie. Il arriva enfin qu'il le rencontra désarmé dans un chemin où il ne pouvait pas lui échapper. Ce malheureux le voyant venir à lui, l'épée nue à la main, se jeta par terre, et lui cria miséricorde. Mais voyant bien à sa voix fulminante et à ses regards enflammés qu'il n'y avait point de quartier pour lui, il croisa ses mains son estomac pour recevoir le coup de mort. Gualbert le voyant en cette posture, se ressouvint de Notre-Seigneur Jésus-Christ en Croix, lequel bien loin de se venger avait prié pour ses persécuteurs, et était mort pour eux. Alors descendant de son cheval, au lieu de percer ce misérable, il lui pardonna, le baisa, l'embrassa et le considéra ensuite toute sa vie comme son propre frère. Si les Italiens, au lieu de s'amuser comme ils font à rendre un culte superstitieux à leurs saints, s'appliquaient à imiter ces beaux exemples de vertu, ils se rendaient assurément plus agréables à Dieu, et l'on ne verrait pas parmi eux tant de si viles et si abominables vengeances.
Je retourne présentement à la solitude de Vallombreuse. Nous arrivâmes à cette célèbre abbaye, où il y a des bâtiments les plus magnifiques et les plus somptueux que l'on puisse voir. L'un de ces messieurs florentins avec qui j'étais, y avait un frère, qui était la première personne après l'abbé, et à sa considération nous y fûmes reçus fort civilement. Ces moines y mènent une vie fort commode et fort plaisante. Lorsqu'ils sont las de vivre dans ce désert, on en fait l'échange avec les moines de Florence ; et c'est pour eux une très agréable variété de demeurer une partie de l'année à la compagne, et l'autre à la ville. Ils ont coupé à un quart de lieue tout autour du monastère les grands sapins qui y étaient, pour y donner plus d'air et le rendre plus sain. L'on nous mena le lendemain matin à l'ermitage de S. Jean Gualbert, qui est à demie lieue de là sur la pointe d'un petit rocher qui s'élève au milieu de la vallée, et escarpé de tous côtés. On y monte en tournant comme par un escalier à vis, l'espace d'un quart d'heure ; après quoi l'on arrive à la cime qui est l'ermitage. Il consiste en une chapelle bien propre, dorée et peinte de tous côtés, et un fort joli corps de logis bien boisé et peint par dedans, avec un jardin d'une médiocre grandeur. De sorte que le tout est un petit bijou. On n'y voit aucun monument de l'ancienne cellule de ce saint. Tous les bâtiments qui y sont, sont neufs et à la mode. Il y a toujours un père ermite qui y demeure, avec un frère convers pour le servir. Quand un ermite meurt, les abbés de la Congrégation de Vallombreuse font choix dans leur chapitre général, d'un moine d'une vie exemplaire et amateur de la solitude, qu'ils y envoient. La grande abbaye qui en est proche, lui fournit toutes les choses nécessaires à la vie. Il a une fort belle bibliothèque pleine de beaux livres pour son entretien, et l'ermite qui y était pour lors, était assez savant, et me parut un fort honnête homme. Il nous fit un beau discours sur le mépris du monde, et sur les avantages de la retraite. Mais sans cela, nous étions déjà si ravis de la beauté de cet ermitage, que s'il y en eût eu là plusieurs de la sorte, et avec les mêmes commodités, la nature plutôt que la grâce aurait pu nous persuader, pour mener une vie sans peine et sans souci, de nous y faire ermites. Les moines de Vallombreuse se sont extrêmement relâchés de leur premier institut. Ils sont vêtus de noir et professent la Règle de S. Benoît, quoiqu'ils ne l'observent guère.
Le jour suivant nous nous mîmes en chemin de fort grand matin pour aller au mont Alverne. C'est le lieu où le séraphique père S. François, fondateur de tous ces Ordres religieux qui vivent sous sa Règle, se retira pour y vivre en contemplation, et où ils disent qu'il reçut l'impression des sacrés stigmates. La journée que nous fîmes fut extrêmement pénible. Nous montâmes de Vallombreuse, avec la direction d'un guide que nous prîmes, sur la cime de l'Apennin, et nous cheminâmes toujours sur les hauteurs jusqu'au pied de l'Alverne. On découvre cette montagne de fort loin, et quelques-uns soutiennent qu'elle est la plus haute de tout l'Apennin. Elle n'a rien du tout d'agréable, n'ayant rien que des roches toujours nues, sans arbres, ni verdure. Elle est si haute qu'il n'y pleut presque jamais ; c'est pourquoi il n'y avait point de neige. Nous y montâmes avec beaucoup de peine, par un chemin fort étroit, entre de très hauts précipices, et nous arrivâmes à sa cime qu'il était nuit presque toute noire. Il y a là un fort grand couvent de religieux de l'Ordre de S. François, appelés par les Italiens Zoccolanti (4), à cause des socques de bois qu'ils portent au lieu de souliers. La première chose que nous fîmes ce fut d'y aller pour nous informer où nous pourrions avoir une retraite pendant la nuit. Ces pères nous dirent qu'il y avait une hôtellerie tout proche pour les étrangers. Autrefois ces religieux exerçaient l'hospitalité envers toutes sortes de personnes qui venaient par dévotion à l'Alverne, comme les pères camaldules la pratiquent encore aujourd'hui envers ceux qui vont au sacré désert dont je vous ai entretenu ci-dessus. Mais ils se sont présentement lassés, et ont tourné les fonds destinés pour ce sujet à leur plus grand profit. Par malheur pour nous, il n'y avait personne à l'hôtellerie. L'hôte était allé, avec toute sa famille, à une noce à une journée de là. Nous fûmes donc obligés de retourner au couvent, pour prier ces pères de nous vouloir donner le couvert, puisque nous ne pouvions pas faire autrement. Ils le firent avec tant de répugnance et si malhonnêtement, qu'en vérité nous ne pouvions assez admirer comment des gens qui vivent pour la plupart sur les aumônes que leur font si abondamment les séculiers, pussent refuser de les assister à l'occasion. Ils nous donnèrent une chambre pour coucher, mais ils s'excusèrent de nous donner à manger, disant qu'ils n'en avaient point pour eux-mêmes ; et nous voulaient laisser sans feu, quoique les nuits y soient extrêmement froides, sous prétexte qu'ils avaient trop de peine d'aller quérir le bois au bas de la montagne. Nous les priâmes d'avoir au moins la bonté de nous laisser entrer dans leur cuisine pour nous chauffer à leur feu commun : mais ne voulant pas que nous y vissions les bonnes provisions qu'ils y avaient, ils nous dirent que cela ne se pouvait, parce qu'ils y avaient de leurs pères malades auprès du feu qui disaient leur Office. Un de ces messieurs florentins qui était en notre compagnie sachant que les provisions ne manquaient jamais au couvent, se fâcha extrêmement contre le gardien, et lui reprochant sa malhonnêteté, lui dit qu'il donnait régulièrement trois fois la semaine à leur grand couvent de Florence une bonne quantité de pain et de vin, et qu'il n'y serait pas plutôt de retour qu'il les voulait casser aux gages, que de plus il leur en dirait lui-même la raison. Ce fut pour lors que ce gardien commença de changer de note, et nous faisant ses excuses en considération du bienfaiteur de l'Ordre, il nous conduisit lui-même dans la cuisine, ou au lieu de ces malades et de ces diseurs d'Officio, nous y trouvâmes quatre ou cinq gros frères qui jouaient aux dés, une grosse marmite qui bouillait sur le feu, et de bonnes pièces de viande à la broche qui rôtissaient. Un de ces frères nous voyant entrer, rafla le plus vite qu'il put les dés et les jetons dans sa robe, mais un peu après n'y songeant plus, il se leva et laisser tout tomber par terre. Le père gardien les excusa, disant que c'étaient des pères qui avaient été prêcher bien loin ce jour-là, et pour se délasser prenaient un peu de récréation. Ils nous firent souper avec eux, et nous fûmes fort bien traités. Après quoi on nous mena à notre chambre, où nous trouvâmes grand feu. Le lendemain un de ces pères nous accompagna pour nous montrer les saints lieux de l'Alverne. Nous fûmes fort étonnés de voir la surface de cette montagne, que nous n'avions pas eu le temps de considérer le soir précédent, parce qu'il était fort tard. Ce ne sont que des roches amoncelées les unes sur les autres et entre-ouvertes, qui forment tout autant de précipices effroyables qu'on ne peut regarder qu'avec horreur. Quelques-uns croient que ces rochers s'entre-ouvrirent à la mort de Notre-Seigneur. Saint François était dans cette pensée lorsqu'il s'y retira pour y méditer les sacrés mystères de la Passion. On nous montra l'endroit où l'histoire de sa vie dit que Jésus-Christ lui apparut en forme de séraphin en croix, et imprima dans ses mains, dans ses pieds, et dans son côté les cinq plaies qu'on lui fit à la Croix, afin qu'il fût dit que François avait souffert autant de Lui : mais selon ceci il aurait bien souffert davantage, car la même légende ajoute qu'il en souffrit jusqu'à sa mort, les douleurs aussi vives que Jésus-Christ les ressentit lorsqu'il fut percé en Croix, et qu'il ne vécut depuis que par un perpétuel miracle, qui dans une continuelle mort lui conservait la vie. Je trouve cette prétendue apparition de Jésus-Christ en séraphin avec des ailes, extrêmement impropre, pour ne pas dire ridicule. Car pourquoi ne lui pas apparaître dans Sa forme humaine ? Celui qui n'a pas voulu prendre la nature angélique, en a-t-il jamais pris la figure ? Et ne serait-ce pas favoriser extrêmement l'opinion de ces anciens hérétiques qui assuraient que le Fils de Dieu n'avait pris qu'un corps d'air et fantastique ? Pour moi je crois que cette impression des stigmates s'est passée seulement dans l'imagination forte de S. François, de même que quelques-uns se sont imaginé avoir des pieds de cire et la tête de verre. L'endroit où il est dit que cette opération miraculeuse se passa, est sous une grande lastre, qui n'est enclavée que par un bout dans les roches, mais suffisamment à mon avis pour être soutenue. Cependant ces pères publient partout que c'est un grand miracle, et qu'il ne se peut pas faire naturellement que cette pierre ne tombe. Proche de là on nous montra un petit chemin fort étroit sur le bord d'un grand précipice. C'était par où S. François allait pour prier sous cette roche. Le Diable envieux de le voir si dévot, entreprit un jour de le précipiter : mais lui voyant l'ennemi du genre humain venir à lui, s'appuya sur le prochain rocher qui reçut son corps, s'amollissant comme de la cire. On montre encore cet enfoncement dans la pierre qui y reste ; mais qui peut avoir aussi bien été fait avec un ciseau qu'avec toute autre chose. Pour ce qui est du Diable, les Catholiques romains en font bien de petites histoires qui ne sont pas toujours véritables. Je me souviens d'avoir vu en France dans l'église de Sainte-Colombe-lez-Sens une assez plaisante histoire, représentée en relief sur un bénitier de marbre qui est proche de la porte. C'est d'un saint ermite nommé Beat. Le Diable étant venu un jour pour lui donner des distractions pendant qu'il disait son Office, le saint l'enleva par les oreilles et le mit dans le bénitier, et ayant mis son bréviaire dessus, il l'y fit rester pendant quinze jours. Il n'y a rien de plus plaisant que de voir la représentation de ce Diable, qui lève le plus qu'il peut ses grandes oreilles d'âne hors de l'eau bénite, et qui enrage ; car ils disent qu'il craint plus l'eau bénite que le feu d'enfer. Les moines de cette abbaye ont fait faire ce relief : Ad perpetuam rei memoriam.
Je reviens à l'Alverne. On nous fit voir ensuite plusieurs autres endroits dans les roches où S. François faisait ses exercices de dévotion, et entre autres celui où il écrivit les Constitutions de son Ordre. J'en ai vu l'original écrit de sa main, dans la petite chapelle de la Portioncule chez l'église de Santa Maria degli Angeli, à environ cinq miles d'Assise dans l'Ombrie. Ce fut là que l'on dit qu'il eût plusieurs révélations et apparitions. On fait mention entre autres d'une apparition de Notre-Seigneur Jésus Christ, dans laquelle en considération du grand zèle de ce saint pour le salut des pécheurs, Jésus-Christ lui accorda une indulgence autant plénière qu'il la pouvait donner ; c'est-à-dire une rémission entière de la coulpe et de la peine pour tous ceux qui le premier jour d'août visiteraient cette petite chapelle. De sorte que le grand jubilé de l'année sainte, n'est pas plus salutaire aux pécheurs que l'est celui-ci. Une personne qui va visiter ce jour-là cette chapelle avec intention de gagner ce jubilé, en disant cinq Pater et cinq Ave Maria, fusse le plus abominable pécheur qui soit au monde, il est rendu aussi pur et innocent qu'il l'était après son baptême ; et s'il mourait dans cet état, il n'y aurait ni Enfer, ni Purgatoire pour lui, mais il irait tout droit en Paradis. Dans cette croyance où sont les Catholiques romains et particulièrement les Italiens, il y un si prodigieux concours de peuple ce jour-là de toutes parts, que cela met la famine dans tous les pays d'alentour, et plusieurs sont étouffés par la presse aux portes de l'église, qui vont ainsi jouir du privilège de leur indulgence dans l'autre monde. Ne faut-il pas avouer en vérité que les Catholiques romains sont bien aveugles, ou au moins bien négligents de leur salut, de se confier dans l'affaire la plus importante de leurs âmes qui est la rémission des péchés, à ce que leur en a dit un homme mortel. Leur S. François leur a dit qu'en allant dans un tel endroit, à un tel jour, et récitant une telle prière, leurs péchés avec tous les châtiments qui leur sont dûs, leur seront entièrement remis, et qu'il en a une assurance de la bouche de Jésus-Christ même, qu'il dit lui être apparu en particulier. Sans rien examiner davantage, les voilà qu'ils le croient ; ils se reposent sur sa parole ; et laissent en arrière, à aveuglement étrange ! les sacrés oracles de l'Évangile qui les avertissent sérieusement, que la seule voie pour remettre les péchés, c'est la repentance. Les pères soccolans de l'Ordre de S. François que cette dévotion a rendus extrêmement riches, ont bâti en cet endroit un fort beau couvent ; et comme cette chapelle était trop petite pour leur usage, ils ont fait construire une fort grande et magnifique église tout autour ; en sorte que la petite église se trouve renfermée dans la grande. Je n'ai jamais vu aucun lieu de dévotion en Italie, que je n'aie toujours trouvé tout proche un beau palais et une bonne cuisine au profit de ceux qui la font valoir : c'est ce qui me les rend d'autant plus suspects. À cinq miles de là on trouve Assise, qui est jolie ville assise sur un coteau. C'est là où naquit S. François, et où l'on dit que son corps repose au grand couvent des Franciscains, dans une chapelle souterraine, sous le grand autel. On tient que son corps, et celui de S. Dominique y sont non corrompus, se soutiennent d'eux-mêmes tous droits sur pied, se donnant la main l'un à l'autre. Et que Dieu a ainsi permis que ces deux saints qui avaient été si grands amis pendant leur vie, n'aient point été séparés après leur mort. C'est un mystère qui ne se voit plus présentement : Le pape même avec tout son pouvoir n'en a pas le privilège, depuis qu'un de ses prédécesseurs y a été échaudé ; lequel pour avoir résolu d'aller voir cette rare merveille, mourut de mort subite. Ces deux saints apparurent ensuite à un bon frère franciscain, et lui dirent qu'il en arriverait de même à tous ceux qui serait assez téméraires que d'entreprendre la même chose. Nonobstant cette tradition, les pères soccolans qui sont un corps différent de celui des Franciscains, disent qu'ils ont le corps de S. François à Portioncule, qui n'en est éloigné, comme j'ai déjà dit, que de cinq miles : Et les Dominicains soutiennent qu'ils ont celui de leur patriarche S. Dominique, à leur grand couvent de Bologne. Si les papes n'en font pas la visite, ce n'est pas dans le fond parce qu'ils appréhendent de mourir, mais c'est qu'ils craignent de désobliger un de ces puissants partis, je veux dire les Franciscains ou les Dominicains, et ils ne le pourraient pas faire sans ruiner une dévotion d'un côté ou d'autre : ce qui porterait à ces Ordres religieux un grand préjudice. C'est pourquoi ils aiment bien mieux laisser les peuples dans la superstition et dans l'erreur. Le pape doit ménager l'intérêt des moines, parce que les moines soutiennent l'intérêt du pape.
Le troisième chose dont je voulais vous entretenir, avant que de fermer cette Lettre, touchant S. François ; c'est que j'ai vu un petit couvent qu'il bâtit lui-même, avec ses frères dans l'Apennin, en descendant à une ville d'Italie que l'on appelle le Borgo di San Sepolcro (5). Il y vécut plusieurs années, et il voulut qu'il servît de modèle à tous ceux que l'on bâtirait dans la suite. À la vérité je n'ai jamais vu en ma vie une si pauvre demeure. Ce sont plusieurs petites grottes jointes ensemble, qui semblent plus propres à renfermer des ours que pour retirer des hommes. Je souhaiterais présentement que l'on comparât un peu avec cette pauvre hutte, ces superbes couvents que ses enfants, c'est-à-dire ceux qui professent de vivre sous sa Règle, ont bâti par toute l'Italie ; ces grands couvents de Rome, de Naples, de Venise, en un mot de toutes les autres villes. Les plus fameux architectes n'y ont-ils pas épuisé tout leur art pour en former les desseins, les plus renommés peintres leurs couleurs pour en historier toutes les murailles, et les plus subtils doreurs leur plus fin or, pour en rendre les voûtes éclatantes et lumineuses ? Enfin n'a-t-on pas été chercher dans les entrailles de l'Apennin les plus fins marbres, les jaspes et les porphyres les plus rares pour en former les colonnes qui les soutiennent, pour en paver leurs cloîtres, leurs réfectoires et leurs dortoirs, et en composer toutes les portes, les fenêtres et les cheminées de leurs cellules ? Les pères capucins ont été les seuls qui ont témoigné quelque horreur d'une si grande pompe, si contraire aux lois d'humilité et de pauvreté de leur législateur S. François. Ils s'obligèrent au commencement de leur réforme à une certaine forme de bâtir leurs couvents fort modeste et fort régulière : Si ce n'est qu'ils ont toujours eu grand soin d'avoir de beaux jardins, de beaux parterres, de belles fontaines, et de grandes allées d'arbres qui servent ordinairement de promenade aux messieurs des villes qui en sont proches. Les Capucins sont aujourd'hui les meilleurs jardiniers de l'Europe. En Italie ils fournissent toutes les demoiselles de fleurs, et les femmes grosses de fruits. On voit néanmoins qu'ils se sont aussi beaucoup relâchés depuis peu, de leur modestie à bâtir. Les nouveaux bâtiments qu'ils font présentement sont plus exaucés et plus larges, leurs cellules plus grandes, leurs églises plus ornées, et les autres lieux réguliers plus à la mode. Ils ont de très beaux couvents à Venise, à Florence, à Pise et à Milan. Lorsque je passai par le duché de Bourgogne en France, je vis à Dijon le beau corps de logis que ces pères faisaient bâtir pour leurs infirmes, qui ne cédait en rien aux plus beaux palais des présidents et conseillers de la ville. Et lorsque je traversai l'Allemagne pour venir en Angleterre, je vis sur le Rhin, à demi-journée au-dessus de Coblents, un superbe bâtiment que je prenais pour un des palais de l'Électeur de Trêves. C'est un couvent de Capucins que Son Altesse Électorale leur a fait bâtir. Avant que d'en jeter les fondements, il leur demande un modèle de leurs couvents : Mais ces pères lui répondirent que si S. François en donnait le plan, il serait fort simple et fort étroit ; mais que puisque Son Altesse Électorale avait la bonté de s'en mêler, on ne trouverait pas à redire que le bâtiment se ressentit un peu de Sa Grandeur. La conclusion de tout ceci, Monsieur, est que ces gens-là ont beau faire ; tant qu'ils feront consister la perfection chrétienne dans ces manières de vivre bizarres, stoïques et extraordinaires ; l'expérience d'un peu de temps fera toujours reconnaître qu'ils se sont trompés. Tous leurs beaux desseins périront toujours à leurs yeux. Et comme les principes sur lesquels ils s'appuient sont faux, ils se trouveront toujours réduits à l'impossible de pratiquer ce qu'ils ont voué, et seront obligés enfin de reconnaître que les grands axiomes de la morale chrétienne qui sont d'une vérité infaillible, et auxquels on doit uniquement s'attacher, c'est de fuir le mal et de faire le bien ; d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Je finis avec ces belles paroles, et suis de tout mon cœur, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. La bulle In Cœna Domini, rendue par le pape Paul III en 1536, prononcée une excommunication générale contre tous les hérétiques, les contumaces et les ennemis du Saint-Siège ; elle fut ainsi nommée parce qu'on la lisait publiquement à Rome tous les ans le jour de la Cène (jeudi saint).
2. L'Ordre des Servites de Marie fut fondé vers 1267 par un groupe de sept nobles florentins, y compris le futur bienheureux Philippe Benizi, d'abord à Cafaggio et puis à mont Sénario (à 18 kilomètres de Florence).
3. Francesco Nerli, naquit à Rome le 12 juin 1608, fut élu archevêque de Florence le 22 décembre 1670, créé cardinal dans le consistoire du 12 juin 1673, et mourut à Rome le 8 avril 1708.
4. L'Ordre franciscain des Frères mineurs observants dits Zoccolanti, ou Soccalans en français, fut fondé en 1368 par Paoluccio de' Trinci de Fuligno (à 100 kilomètres nord-nord-est de Rome).
5. Saint François et ses confrères bâtirent des huttes à Portioncule, près de l'église de Santa Maria degli Angeli : mais non pas à Borgo di San Sepolcro. Cette dernière ville, actuellement Sansepolcro, est le berceau du célèbre peintre et mathématicien Piero della Francesca (1416-1492).
QUATRIÈME LETTRE.
D'un voyage à Lorette, etc.
Vous ayant promis dans ma dernière Lettre de vous parler de mon voyage de Lorette, je ne doute point que la curiosité d'apprendre quelques particularités touchant ce lieu de dévotion qui fait tant de bruit dans le monde, ne vous porte à souhaiter que je m'acquitte de ma promesse. Pour tâcher de vous satisfaire sur ce point, je vous dirai, Monsieur, que du mont Alverne m'étant séparé de ma compagnie qui n'allait pas plus loin, je descendis tout seul de l'autre côté de l'Apennin, et prenant mon chemin par les villes d'Urbania et de Fossombrone, j'arrivai à Fano qui est une jolie ville sur le bord de la mer Adriatique. Étant sorti le matin pour chercher quelque commodité pour aller à Lorette, je vis arriver une grande compagnie de personnes assez plaisamment montées et habillées. C'était des pèlerins qui venaient de Bologne. Ils étaient au nombre de soixante, et tous montés sur des ânes, qui est une commodité assez douce, dont on se sert sur la marche d'Ancône, plutôt que de chevaux. On commence à trouver ces sortes de montures à Imola, à demi-journée de Bologne. On les prenait autrefois à Bologne, mais comme cela donnait occasion de faire une allusion qui ne plaisait pas aux écoliers ni aux docteurs de l'université de cette ville-là — car on disait communément : Nous irons à Lorette et nous prendrons un âne à Bologne — les magistrats défendirent en leur faveur de s'en servir. On les prend donc à Imola, et pour la valeur d'environ douze sols on peut aller six miles, qui est ce que ces sortes de bêtes sont accoutumées de faire. Ils ont de petites selles et des étriers comme des chevaux. On n'a que faire de fouet et d'éperon ; car sitôt qu'on les a montés, ils courent continuellement de toute leur force jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à leur terme. Alors il est impossible avec tous les coups qu'on leur peut donner, de les faire avancer un pas plus loin, et l'on est obligé de les laisser là et d'en prendre d'autres. On en change ainsi successivement de six miles en six miles, jusqu'à la montagne d'Ancône, qui n'est pas beaucoup éloignée de Lorette. C'était donc là les montures de nos pèlerins. Ils étaient tous revêtus de leurs habits de pèlerinage. Ces habits consistent en une grande veste de toile, de couleur de cendre, qui descend jusqu'à demi-jambe, avec de grandes manches qui viennent jusqu'au poignet. Au haut du collet, par derrière, il y a une espèce de grand capuchon qu'ils font venir par dessus leurs têtes, et l'enfonçant bien profondément, ils le font descendre jusqu'à l'estomac ; de sorte qu'ils ont le visage tout couvert. Pour avoir la vue et la respiration libres, ces capuchons ont des trous aux endroits qui correspondent aux yeux et à la bouche, comme des masques. Ils ne mettent ces capuchons sur leurs têtes que quand ils entrent dans des endroits où ils ne veulent pas être connus ; autrement ils les laissent pendre par derrière sur leurs épaules. Ils serrent cette veste sur les reins avec une ceinture. Un peu au-dessus de la ceinture sur la poitrine, ils ont un écusson où sont représentées les armes de leur société, confrérie, ou compagnie, qu'ils appellent en italien sacola. Il n'y a presque point d'Italiens qui ne soit de quelqu'une. Ces pèlerins ont un grand chapelet à leur ceinture, et un bourdon à la main, qui est la principale marque de leur pèlerinage. Ce sont des bâtons de la hauteur d'une demie pique avec des nœuds faits autour, au haut et au milieu. Ils les portent à l'église pour les faire bénir par leurs curés avant que de partir ; ce qui se fait avec de grandes prières et avec l'eau bénite. Quand ils les ont reçus, il ne leur est pas permis de rester plus de trois jours dans les lieux de leur résidence, et ils ne peuvent point être reçus à la communion qu'ils n'aient accompli leur pèlerinage ; si ce n'est qu'ils fassent changer le vœu qu'ils en ont fait en quelque peine pécuniaire. Alors ils en sont volontiers déchargés par les prêtres. Les pèlerins que je vis arriver à Fano étaient tous revêtus d'une même couleur, et avaient déjà couru une poste ce matin-là sur leurs ânes. Leurs vestes étaient neuves et d'un lin extrêmement fin. Comme ce n'était pas apparemment un esprit de pénitence qui les leur avait fait prendre, ils n'avaient pas manqué de les retrousser en plusieurs endroits assez haut pour faire entrevoir les beaux habits de brocard, d'or et de soie qu'ils avaient par-dessous. C'est ce qui me fit croire aussi que ce pouvait être des personnes de qualité. De plus leurs ceintures étaient d'une soie de la couleur de leurs vestes, parfaitement bien travaillées. M'étant informé qui ils étaient, on me dit que c'était la Compagnie de Notre-Dame de la Vie de Bologne. C'est un très riche hôpital pour les pauvres malades, où les prêtres ont érigé une congrégation ou société de personnes nobles qui y ont leurs messes et prières journalières. Ils s'obligent d'assister de leurs biens et de leurs soins les malades de ce lieu. La plus grande partie des maladies de Bologne est de cette compagnie. Ils vont processionnellement tous les ans à Lorette, vers la fin de l'automne, après la récolte des fruits, comme font aussi la plupart des autres compagnies. Étant arrivés proche de la grande église, les prêtres vinrent au-devant d'eux avec la croix et la bannière pour les recevoir. On leur fit une petite harangue, à laquelle le prieur de cette compagnie, qui était un comte de Bologne, répondit en peu de mots. Après quoi ils entrèrent dans l'église où ils firent une courte prière, et se dispersèrent ensuite dans les meilleures hôtelleries de la ville, où l'on avait envoyé dès le soir précédent les ordres nécessaires pour un bon dîner. Il était environ dix heures du matin lorsque ces pèlerins arrivèrent, et une demie-heure après ils furent suivis d'environ une vingtaine de calèches pleines de dames. C'était des pèlerines qui étaient parties de Bologne dans le même dessein, et qui étaient toutes ou parentes ou amies de ces messieurs. Elles étaient superbement habillées, et même avec une lasciveté indigne de personnes qui vont par dévotion en pèlerinage. Elles avaient de petits bourdons attachés à leurs corps de jupes d'environ de la longueur de la main. Les uns étaient d'or, et les autres d'ivoire enrichis de perles fines et de diamants. Quelques-unes en avaient composées de fleurs d'orange, ou de ces fleurs artificielles dont on fait tant d'estime à Bologne, et qui font la plus grande partie du trafic des religieuses de cette ville-là. D'autres en portaient de travailler à l'aiguille qui pouvaient être l'ouvrage de plusieurs années. Enfin d'autres en avaient de quelque autre matière précieuse.
Les pèlerins n'eurent pas plutôt été reconnaître les hôtelleries et donné ordre de tenir tout prêt, qu'ils allèrent au-devant de leurs dames pour les recevoir, et les conduisirent avec beaucoup d'honneur dans les appartements qui leur avaient été préparés. La curiosité me porta de retourner à mon hôtellerie où j'avais vu les grands préparatifs qu'on y faisait. Comme ces messieurs manquaient d'une chambre, je leur fis offre de la mienne, et eux fort civilement me prièrent à dîner. La table fut couverte de plusieurs services, et pendant le repas presque tout l'entretien fut de railler les dames sur leurs bourdons. Ce n'était pas une raillerie piquante, mais de certaines rencontres heureuses, pleines d'esprit, et de certains mots à double entendre que ces Italiens savaient être du goût de leurs Italiennes. Après le dîner, un chacun se mit en ordre pour continuer le voyage. Les pèlerins montèrent sur des ânes, et les dames dans leurs calèches. Pour moi je me joignis à un fort honnête homme natif de Parme, qui n'allait pas en pèlerinage, mais qui voyageait par curiosité. Nous suivîmes cette troupe de fort près, sur de semblables montures, ne pouvant pas nous mêler avec eux dans la marche, parce que nous n'avions pas d'habits de pèlerins. Je demandai à cet Italien pourquoi ces messieurs qui étaient tous des gens de qualité, et qui apparemment avaient tous leurs carrosses et de bons chevaux à Bologne, se servaient de ces ânes. Il me dit que quelques-uns s'en servaient par gaillardise pour se divertir mieux par le chemin ; et d'autres par humilité, et pour avoir plus de mérite ; et que ces ânes qui avaient porté tant de dévots pèlerins à Lorette, avaient même quelque sorte de bénédiction particulière, qui était, qu'il n'arrivait jamais d'accidents fâcheux à ceux qui les montaient, et que si par hasard on tombait de dessus, on ne se faisait point de mal ; ou s'il arrivait qu'ils jetassent dans quelque bourbier, on s'en retirait toujours heureusement. De sorte que je commençai à m'apercevoir que ce pauvre monsieur était persuadé que ces ânes étaient aussi miraculeux. Il me dit que quelques corsaires d'Alger ayant fait depuis peu une descente sur la marche d'Ancône, n'avaient jamais pu attraper une troupe de voyageurs qui étaient montés sur ces saintes bourriques, quoique'ils les poursuivissent de fort près ; et qu'ayant fait un grand feu sur eux, ils n'en avaient ni tué, ni blessé aucun.
Nous jetions de temps en temps les yeux sur nos pèlerins qui allaient devant nous. Et nous voyons que leur plus grande application sur le chemin, était de divertir les dames qui étaient dans les calèches. Les uns s'étudiaient en passant et repassant, de faire des postures plaisantes et ridicules devant elles pour les faire rire ; les autres se laissaient tomber tout exprès de leurs ânes pour le même sujet. Enfin tout le long du chemin, comme les Italiens ont l'esprit extrêmement agréable et inventif, ce n'était que plaisanteries et comédies. Ces dames ne manquaient pas assurément dans leurs âmes, de donner mille bénédictions au jour et au moment qu'elles avaient été assez heureuses de former le vœu d'aller à Lorette, puis qu'apparemment elles n'avaient jamais été si bien diverties. Un chacun fait que les Italiens n'ont pas plutôt une femme qu'ils en font une esclave. Cependant leur jalousie n'a pas encore eu le pouvoir de les empêcher d'aller les fêtes et les dimanches aux églises et aux lieux de pèlerinage, lorsqu'elles en ont fait le vœu. L'Église de Rome ayant fait un péché mortel, de ne pas aller à la messe en ces sortes de jours, et de ne pas accomplir les pèlerinages dont on a fait vœu, elle a ôté en même temps la liberté aux maris d'empêcher leurs femmes de satisfaire à ces pressants devoirs. Si quelqu'un entreprenait de les contredire là-dessous, l'Inquisition en prendrait connaissance, et procéderait contre lui comme contre une personne qui n'approuve pas la messe ni les pèlerinages, et qui par conséquent est un hérétique. Les dames ne manquent pas de se prévaloir bien de ce privilège, et d'avoir recours lorsqu'elles le jugent nécessaire, à cette dernière table de leur liberté qui leur reste : Ultima naufragio libertatis tabula. À peine voit-on une dame aller à ces sortes de dévotions, qu'elle n'ait toujours quelque amant fort dévot qui la suive. Il était aisé de juger à l'air des pèlerins et des pèlerines dont je vous parle, du principal motif qui les avait portés à entreprendre ce voyage. On s'arrêta vers les quatre heures du soir, à un village pour s'y rafraîchir ; après quoi les gentilshommes prirent le devant pour aller au bourg prochain faire les cérémonies de l'église avant que les dames arrivassent, comme ils avaient fait le matin à Fano. Après quoi ils se retirèrent avec leurs dames dans les meilleures hôtelleries de la ville, où ils ne manquèrent pas de se faire bien traiter et de se divertir bien ; et continuèrent ainsi toute le reste de leur marche jusqu'à Lorette. Ne voilà-t-il pas en vérité un pèlerinage bien dévot, capable de confondre les Protestants, qui n'en ont point, et qui se contentent d'invoquer leur Père céleste qui est au Ciel, sans se mettre en peine de l'aller chercher à Lorette ou à Rome ?
Nous trouvâmes outre ceux-ci que nous suivions de près, plusieurs autres bandes de pèlerins, tant marchands qu'artisans. Les uns revenaient de Lorette, et les autres y allaient. Ils faisaient les fous avec leurs bourdons et leurs habits extravagants partout le chemin, et grande chère dans toutes les hôtelleries qu'ils rencontraient. J'ai reconnus depuis que tous les gens de métier en Italie, ont chacun une petite boîte de réserve, dans laquelle ils ramassent le plus d'argent qu'ils peuvent pendant l'année, pour faire ensuite quelque pèlerinage ou à Lorette, ou à S. Antoine de Padoue, où quelque autre endroit plus loin ou plus près, selon qu'ils voient que leur argent peut suffire pour aller et revenir en faisant bonne chère. Il n'y a rien assurément de plus agréable que ces sortes de voyages en Italie, vers le commencement du printemps où à la fin de l'automne lorsque les grandes chaleurs sont passées, particulièrement quand on est en bonne compagnie, où il se trouve toujours quelqu'un qui a le talent de faire rire les autres. Les Italiennes surtout se servent de mille intrigues et inventions pour obliger leurs pères et mère, ou leurs maris, de les faire aller en pèlerinage. Il n'y a point de vœu qu'elles fassent plus volontiers. Elles emploient surtout l'autorité de leurs confesseurs, pour leur donner à entendre que c'est la volonté de Dieu qu'elles y aillent. Tout le voyage se passe en bouffonneries, comme je viens de vous marquer, et toutes les plaisantes aventures qu'elles y ont eues, leur servent ensuite l'hiver auprès du feu, d'un agréable divertissement pour entretenir la compagnie. Voilà quels sont les pèlerins et les pèlerines dont j'avais promis de vous parler ; Lesquels joints avec ceux qui vont dans les hôpitaux, comme vous avez vu dans ma dernière Lettre, comprenant tout ce qu'il y a de pèlerins riches et pauvres. Les Papistes ont beau dire que se sont là des faits particuliers qui ne peuvent point être allégués contre le fond de leur doctrine, car cette sainteté des pèlerinages en général ne se trouve non plus que l'universel à parie rei. On a beau se figurer une nature humaine universelle, on ne trouvera jamais d'humanité que dans les individus. Si les pèlerinages avaient la vertu de sanctifier les hommes on verrait aussi des pèlerins devenus saints par les pèlerinages ; et le vieux proverbe ne serait pas vrai, comme il est, qui dit que jamais bon cheval, ni méchant homme n'en devint meilleur pour aller à Rome. Si saint Jérôme, sainte Paule ont été visiter les saints lieux de la Palestine, ce n'est pas ce qui a fait leur sainteté ; et ils auraient sans doute aussi bienfait de se tenir chez eux. Ce n'est pas que je les veuille blâmer là-dedans, non plus que je ne voudrais pas entreprendre un honnête homme qui par curiosité, sans pourtant négliger ses affaires, et sans faire tort à personne irait à Constantinople où à Rome. Il est même naturel d'avoir quelque sorte de respect et vénération pour des gens qui ont beaucoup voyagé. C'est une belle curiosité d'aller voir en Jérusalem tous les saints lieux où Jésus-Christ a opéré notre rédemption : mais par rapport au salut, je trouve que c'est une chose fort inutile, et je croirai jamais pour cela que personne en soit plus grand saint. Jésus-Christ n'a point attaché notre salut à de certains endroits du monde plutôt qu'à d'autres, et ne permettra jamais que ces nouvelles additions que les hommes ont fait à l'Évangile pour arriver à leurs fins, servent de moyens efficaces pour leur sanctification. J'ai conversé avec une infinité de gens qui ont été en pèlerinage, mais je n'ai jamais reconnu pour cela le moindre amendement en leur vie. Au contraire plusieurs m'ont semblé beaucoup pires. On me conseillait en Italie de faire comme faisait un certain Génois. Il demandait fort souvent à son boucher quand il irait à Lorette. Le boucher le pria un jour de lui dire pourquoi il lui faisait la même demande si souvent. Le Génois lui repartit, qu'il avait remarqué que toutes les fois qu'il retournait de ce pèlerinage, il ne lui donnait jamais le juste poids, et que pour celle-ci il était résolu à son retour de le laisser reposer cinq ou six mois sans se servir de lui. En effet tous ces gens-là font des dépenses étranges dans le voyage, après quoi la plupart ne font point de scrupule pour se refaire de voler sur le commune. De plus, comme je vous ai déjà fait remarquer dans ma troisième Lettre, il y en a fort peu qui entreprennent ces sortes de voyages avec un véritable esprit de dévotion. C'est plutôt par récréation ou par curiosité, ou par quelque autre motif qui leur est connu. Mais enfin comme je ne prétends pas juger en dernier ressort de l'intérieur de qui que ce soit par l'extérieur, je veux bien supposer en leur faveur qu'ils y aillent tous avec de très hauts sentiments de dévotion, je dis qu'en cela même ils ne sont excusable devant Dieu que dans leur bonne volonté, et sont dignes de compassion de se méprendre si fort dans le culte qu'ils rendent à leur Créateur des devoirs qui ne sont dûs qu'à Lui seul. Oh quam bona voluntate miseri sunt ! C'est là toute la grâce qu'on leur peut faire. Car on ne peut en aucune manière justifier ces adorations qu'ils rendent à la Vierge et aux saints, aux maisons où ils ont vécu, et aux instruments de leur martyre. Comme ce point regarde particulièrement la théologie, et que mon dessein n'est pas de vous écrire en théologien, mais en voyageur, je le mettrai à part pour le présent, et continuerai à vous parler de mon voyage de Lorette. J'y arrivai sur la fin du mois d'octobre. Cette ville est située au milieu d'une très fertile et très agréable campagne, environ deux ou trois miles loin du bord de la mer Adriatique. Il n'y avait autrefois que la chapelle toute seule dans cet endroit, mais par succession de temps on y a fait bâtir des maisons, et les papes à qui tout ce pays appartient les ont fait entourer de murailles et de bastions. De sorte que c'est aujourd'hui une considérable forteresse, qui défend l'État ecclésiastique de ce côté-là, et particulièrement contre les descentes des Turcs et autres corsaires qui venaient fort souvent ravager cette côte-là. Cette chapelle est appelée par les Italiens Santa Casa, c'est-à-dire la Sainte Maison. Les Catholiques romains croient que c'est la même maison où Jésus-Christ demeura en Nazareth avec la Sainte Vierge Sa mère, et Son père putatif S. Joseph, l'espace de trente ans, jusqu'au temps qu'il commença à prêcher Sa sainte doctrine, et à la confirmer par Sa vertu divine et par Ses miracles. Ils prétendent qu'elle fût transportée par les anges de Nazareth où elle était, dans l'endroit où elle est présentement. L'histoire qu'ils en font est telle. Les Sarrasins s'étant rendus maîtres de la Palestine et des saints lieux ; la Vierge ne voulant pas laisser entre les mains de ces infidèles, un si grand trésor comme était la maison qu'elle avait habitée avec son fils Jésus-Christ sur la Terre, commanda aux anges de la transporter dans les terres des Chrétiens ; les anges l'enlevèrent toute entière avec tous les fondements et la portèrent de nuit en Dalmatie. Mais s'étant aperçus depuis de la faute qu'ils avaient faite, et que ces peuples-là n'étaient pas si bons que les Italiens, ils la reprirent de nouveau, et la portèrent une autre nuit proche de la ville de Recanati en Italie, dans un champ qui appartenait à deux frères. Elle y resta plusieurs années, jusqu'à ce que ces deux frères entrés en dispute touchant le partage des aumônes que l'on y faisait, la Vierge pour les punir, commanda aux anges de l'enlever pour la troisième fois et de la porter dans le champ d'une pauvre veuve appelée Lorette, qui lui était fort dévote. La bonne femme s'étant levée le matin, et trouvant une petite maison où il n'y en avait point le soir précédent, ne fut pas moins surprise que les deux frères l'étaient de ne la plus voir dans leur champ. Elle en écrivit au pape, qui savait déjà par révélation tout ce qui s'était passé, et qui donna aussitôt de grandes indulgences à ceux qui iraient rendre leurs devoirs à cette sainte maison. Les autres papes ont confirmé tout cela depuis, et y ont accordé une infinité d'autres pardons. Ce lieu ensuite par un très grand bonheur pour eux, est devenu une source inépuisable de richesses, qui leur produit encore aujourd'hui des sommes immenses d'argent tous les ans. Ne voilà-t-il pas une plaisante histoire, et le seul récit qu'on en fait n'est-il pas capable d'en donner du mépris ? Ces bons anges qui portèrenet la première fois la Santa Casa en Dalmatie étaient bien étourdis, et ne regardaient guère à ce qu'ils faisaient. De plus si la Sainte Vierge l'ôta aux deux frères de Recanati parce qu'ils étaient en querelle l'un contre l'autre, je m'étonne comme elle la laisse présentement au milieu d'un amas de vauriens et de filous qui s'y sont établis, et qui sont presque tous des vendeurs de chapelets et de médailles. Car tous ceux qui ont été à Lorette savent, et on les avertit auparavant qu'ils y entrent, que pour y faire ses dévotions et n'être point volé, il faut tenir son chapelet d'une main, et sa bourse de l'autre.
Je passe maintenant à la description de cette chapelle ou Santa Casa. Elle est toute de brique d'environ vingt-cinq pieds de longueur. Sa largeur n'est pas proportionnée à sa longueur. Le bois dont elle était lambrissée étant tombé de pourriture, on l'a voûtée de briques. Elle a deux fenêtres et deux portes aux deux côtés, et une autre fenêtre dans le bas ; par laquelle on dit qu'entra l'ange Gabriel pour annoncer à la Vierge le mystère de l'Incarnation. On a dressé un autel dans le fond, dans l'endroit où ils disent que la Vierge était à genoux lorsque l'ange entra. Et sur l'autel il y a une sainte vierge de bois d'environ quatre pieds et demi de hauteur, qui est la statue miraculeuse à laquelle on rend les adorations. Elle a des habits pour tous les jours ouvriers, pour les fêtes et pour les dimanches ; elle en a de toutes sortes de couleurs, et même sept habits de deuil pour la semaine sainte. On la change d'habits avec beaucoup de cérémonies. Je m'y trouvai un samedi au soir lorsque les prêtres l'habillèrent pour le dimanche. Ils lui ôtèrent un habit de pourpre qu'elle avait, pour lui en mettre un vert. Ils commencèrent par lui ôter son voile, ensuite son grand manteau royal, puis sa robe et ses jupes de dessus et de dessous ; et ensuite avec beaucoup de révérence, ils lui ôtèrent sa chemise pour lui en mettre une blanche. Je vous laisse à penser, Monsieur, quelles pensées cela peut exciter dans l'imagination de ceux qui en font les cérémonies, et des assistants qui en sont les spectateurs. Il est vrai que cette statue n'est pas une nudité. L'ouvrier qui y a travaillé a été plus modeste : il l'a faite habiller. Mais cet acte d'habiller et de déshabiller la représentation d'une femme, est quelque chose qui offense les esprits tant soit peu chastes et honnêtes. J'avoue qu'ils font cette cérémonie avec beaucoup de respect extérieur, si ce n'est qu'on veuille l'appeler plus proprement idolâtrie ; car ils baisent chaque harde qu'ils lui ôtent, et à toutes les fois ils fléchissent les genoux en terre devant la statue et l'adorent. Le peuple qui est là présent à genoux se bat la poitrine, et on entend des soupirs et des gémissements dans la chapelle de tous côtés, avec des paroles entrecoupées : «Sainte Vierge de Lorette aidez-moi», «Mère de Dieu exaucez-moi», et d'autres semblables exclamations. Lorsque la statue est nue le bruit redouble, et à mesure qu'on la rhabille il diminue. Je ne saurais m'imaginer quelle peut être la cause de ce changement de ton, si ce n'est que quand la statue est dépouillée elle frappe davantage leur imagination, et leur fait croire qu'ils voient la Vierge en personne, et que c'est alors le temps de la prier plus ferventement. On la revêtit d'un habit vert entièrement riche. C'était un ouvrage à fleurs sur fond d'or. Le voile qu'on lui mit sur la tête était encore plus précieux, car outre qu'il était de la même étoffe, il était tout semé de grosses perles fines ; après quoi on lui mit sur la tête une couronne d'or chargée de pierres précieuses d'un prix inestimable. On lui mit ensuite son collier, ses pendants d'oreilles et ses bracelets de diamants, et plusieurs grosses chaînes d'or au col, où étaient attachés un grand nombre de cœurs et de médailles d'or, qui sont des présents que des reines et des princesses catholiques y ont envoyés par dévotion, pour témoigner qu'elles voulaient être esclaves de cette statue. Tout l'ornement de l'autel était également somptueux et magnifique. Ce n'était que vases, bassins, lampes, et chandeliers d'or et d'argent enrichis de pierreries. Tout ceci à la faveur d'une grande quantité de cierges qui y brûlent jour et nuit, rendait un éclat dont la beauté ravissait l'âme par les yeux. Je ne m'étonne point de ce que quelques-uns assurent qu'ils ressentent dans ce lieu une dévotion extraordinaire. Car outre que l'on ne peut pas y entrer sans penser à Dieu, puisqu'on a déjà l'imagination préoccupée que c'est là, la chambre où le Verbe éternel a pris chair humaine, c'est que c'est le propre des plus resplendissantes créatures d'élever notre cœur au Créateur, plus que ne le font les plus obscures et les plus ordinaires, particulièrement si leur éclat est joint à la nouveauté. Si on lève les yeux au Firmament dans une nuit sereine, lorsqu'il est tout semé d'étoiles, cette vue élève notre âme à l'Éternel et nous fait dire : Quam augusta est Domus Dei ! De même des gens qui ne sont pas accoutumés de voir tant de luminaires, tant d'or, d'argent, et de pierres précieuses qui rehaussent l'éclat l'un de l'autre ; lorsqu'ils entrent dans cette chapelle de Lorette où ils trouvent toutes ces choses réunies ensemble, ils ne peuvent pas naturellement qu'ils n'en soient émus. Les naturalistes remarquent que les pierres précieuses sont la plupart extrêmement amies du cœur de l'homme. Elles le recréent et le réjouissent par une vertu secrète et sympathique qu'elles ont en elles-mêmes. Il y en a un nombre presque infini de toutes les sortes dans cette chapelle ; qui peut douter qu'elles ne fassent une grande impression sur les cœurs ? Ce qui étant pris par quelques personnes simples et ignorantes pour une grâce de Dieu toute particulière attachée à ce lieu, leur fait croire que c'est un continuel miracle. Les extravagances qui se commettent dans ce lieu-là, font bien voir que Dieu ne s'en mêle point. Ils baisent les murailles tout autour de la chapelle ; ils lèchent les briques avec leurs langues, ils y font toucher leurs chapelets ; ils prennent un fil, et l'ayant tourné tout autour de la chapelle comme pour en prendre la mesure, ils s'en font ensuite une ceinture qu'ils disent servir contre les sorciers et contre toutes sortes de maux. Les prêtres cependant ne s'oublient pas de leur profit. Ils ont des gens de tous côtés dans la chapelle et dans la grande église qui pressent le peuple à faire des aumônes et à faire dire des messes à la Madonna. On paie les messes un écu pièce. Ils promettent qu'ils les feront dire toutes à l'autel de la Vierge qui est dans la chapelle. Il est constant qu'ils reçoivent plus de cinquante mille messes tous les ans ; cependant il n'est pas possible d'en dire plus de dix mille chaque année sur cet autel ; ainsi tous les autres qui ont donné leur argent, sont nécessairement frustrés de leurs intentions. Les personnes riches sont de grands présents à la statue de bois de la Vierge qui est dans la chapelle, qui est appelée sans aucune addition ou modification «La Sainte Vierge de Lorette». Ils lui donnent des colliers et des bracelets de perles et de diamants, des cœurs d'or, des médailles, des chandeliers, des lampes, et des tables en relief d'or et d'argent, d'une grandeur et pesanteur prodigieuse. Plusieurs lui envoient des anneaux et de très précieux joyaux pour l'épouser. Elle a plus de cinquante robes d'un prix inestimable, sans celles que l'on défait tous les jours au profit des prêtres, lorsqu'elles lui ont un peu servi. De sorte qu'elle est aujourd'hui la plus riche catin de l'univers, et le morceau de bois le plus richement paré qu'il y ait dans le mode. C'est à cette statue que furent adressées ces litanies si fameuses, et si fort en usage dans l'Église de Rome, que l'on appelle communément, les Litanies de la Vierge, ou bien, les Litanies de Notre-Dame de Lorette, où elle est appelée Reine des Anges, Mère de la Grâce Divine, Porte du Ciel, Aide des Chrétiens, Refuge des Pécheurs, etc. Tous ces précieux ornements et ces beaux titres, n'empêchent pourtant pas les vers de faire leur office. Je vis lorsqu'on la changeait d'habits, que le bois en était tout vermoulu et tout percé de vers. C'est ainsi que ce bois qui est supposé exaucer les vœux de tant d'idolâtres, porte sa condamnation avec lui, et ne peut pas se défendre de la corruption. Les papes qui tirent plus d'or et d'argent ce lieu-là que d'aucun autre endroit du monde, y ont aussi donné le plus d'indulgences ; ils ont accordé à cette chapelle tous les privilèges qu'ils ont à leur Saint-Pierre de Rome. Les grands pénitenciers et les confesseurs qui sont des Jésuites, y absolvent de toutes sortes de cas, réservés même aux papes. Comme c'est un lieu qui est dans les territoires de leur Sainteté, il leur est indifférent que ce soit là que l'on se fasse absoudre ou à Rome, parce que leur profit ne leur saurait manquer ; mais je ne doute point que si les anges prenaient encore la peine de transporter cette chapelle dans les états de quelque prince étranger, qu'ils ne révoquassent incontinent tous leurs pardons. Ils ont un très grand soin de conserver cette chapelle dans son entier ; et tous les foudres du Vatican sont lancés contre ceux qui entreprendraient d'en détacher quelque petite pierre ou d'en gratter les murailles ; il est permis de les lécher : mais non pas de les mordre. La conséquence de ceci est que selon le principe de Rome : Pars sumitur pro toto. Quand on a le doigt ou quelque autre petite partie d'un corps saint, c'est autant que si on l'avait tout entier. Il s'ensuit de même que qui aurait un petit morceau de la Santa Casa, pourrait aller faire bâtir une chapelle dans quelque pays étranger, et y faisant enchâsser le morceau de brique, la rendre aussi considérable que celle de Lorette, et par ce moyen épargner à beaucoup de gens la peine d'aller si loin en pèlerinage. Vous pouvez par là concevoir le grand désavantage qu'il en arriverait aux papes, et le grand intérêt qu'ils avaient de faire attacher, comme ils ont fait de tous côtés dedans et dehors la chapelle, et dans la grande église qui l'environne, les anathèmes et les excommunications qu'ils ont prononcées contre ceux qui seraient assez téméraires que d'en enlever la moindre parcelle. Nonobstant comme ils n'ont pas cru que ceci fut encore assez fort pour s'assurer de leur grand trésor, ils ont eu recours à la ruse, et ont fait publier faussement que Dieu avait puni de mort subite plusieurs personnes qui avaient eu la hardiesse d'en détacher des pierres ; que d'autres étaient demeurés immobiles jusqu'à ce qu'ils eussent voué de reporter ce qu'ils en avaient pris ; enfin que les anges arrachaient les pierres des mains de ceux qui emportaient, pour les remettre en leur place. On y montre entre autres deux briques qui sont attachées dans une des murailles de la chapelle avec deux morceaux de fer, pour les distinguer des autres. L'une qu'un seigneur polonais avait emportée dans le dessein de faire bâtir une chapelle semblable à celle de Lorette, en son pays ; on dit qu'il fut arrêté par une force invisible, dans son voyage, qui le rendit immobile, et fut obligé de renvoyer la brique qu'il avait prise à Lorette ; après quoi il lui fut aisé de poursuivre son chemin. L'autre fut prise par un seigneur espagnol dans le même dessein ; les anges le poursuivirent, et après l'avoir bien battu, lui ôtèrent la pierre et la reportèrent à Lorette. Ces miracles ici, et plusieurs autres semblables et aussi ridicules, sont imprimés et affichés en plusieurs endroits de l'église pour être lus par les voyageurs. Pour moi, Monsieur, je puis vous assurer que ce sont là tout autant de grandes menteries, forgées et inventées par les papes, pour tâcher de persuader par la ruse leurs Catholiques romains, qu'ils ont la Santa Casa toute entière, et qu'il ne faut pas croire qu'il y en ait la moindre partie dans aucun endroit de la terre habitable. Ce qui me fait avancer ceci avec tant de confiance, c'est que moi-même qui vous écris, j'ai détaché un morceau considérable de cette muraille de Lorette, et l'ai emporté avec moi sans que les anges m'aient battu, ni qu'aucune vertu invisible m'aie rendu immobile. Si les gardiens de cette chapelle n'ont pas fait reboucher le trou, je suis sûr qu'on l'y doit voir encore. On commence tous les jours, à deux heures après minuit, à dire des messes à cet autel de la Vierge. Je m'y rendis environ sur les trois heures, et n'ayant trouvé que très peu de personnes dans la chapelle, je me tins à l'entrée, où je ne pouvais pas être aperçu, ayant tout le monde devant moi, et personne à mes côtés ou derrière. Alors avec un fer je rompis un morceau de la muraille et l'emportai avec moi. J'ai voyagé depuis par toute l'Italie ; j'ai été en France et en Allemagne, et grâces à Dieu, jamais aucun accident fâcheux ne m'est arrivé. Jusqu'à ce qu'enfin, étant ennuyé d'avoir cette pierre dans ma poche, et la considérant comme une charge inutile, je la jetai dans les champs par mépris, et comme par indignation de ce qu'elle avait reçu des adorations qui ne sont dues qu'à Dieu seul. Il faut avouer que je fus un peu étonné à deux journées de Lorette, proche de Tolentino, en allant à Rome. Il tomba une si grosse pluie pendant deux jours, et les torrents se grossirent si fort, qu'ils inondèrent une grande partie de la campagne. En passant sur un vieux pont, une des arches émue par le pas de mon cheval, tomba avec un bruit effroyable dans l'eau, à deux pas de moi. Alors je retournai bride bien vite la moitié du pont en arrière ; et au même moment la pierre que j'avais prise à Lorette me revint en pensée. Je délibérais si je devais retourner pour la reporter : mais consultant sur ceci la raison, plutôt que le présent accident, je fis les réflexions suivantes. Premièrement, je considérai que s'il était vrai que Dieu fût si jaloux de conserver cette chapelle dans toutes ses parties, Il n'aurait pas permis que le lambris qui en était une partie si considérable, fût pourri et tombé ensuite ; au défaut de quoi, comme j'ai dit ci-dessus, on y a fait une voûte. En second lieu, je pensai en moi-même, que la crèche de Bethléem et le Saint-Sépulcre n'étaient de rien inférieurs en dignité à cette petite maison de Nazareth, et que cependant Dieu les avait laissés entre les mains des infidèles ; et qu'ainsi ce que l'on disait du transport de la Santa Casa, ne pouvait être qu'une fable. Enfin, comme j'avais moi-même été témoin de tant de fourberies et de mensonges que les prêtres de l'Église de Rome inventent pour avancer leurs profits, ce me fut une raison assez forte pour ne point ajouter foi à tous ces miracles prétendus. Ils ne sont inventés que pour conserver la chapelle de Lorette dans le territoire du pape, ou au moins pour mettre les esprits dans une certaine disposition, que quand il arriverait dans quelque guerre que quelque prince étranger s'en emparât et la fît transporter dans son pays, ils crussent néanmoins que les anges l'auraient rapportée. Et alors ils dénieraient hardiment que ce prince, que je suppose, eût la véritable. Tout ceci me fit conclure qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans la chute de ce pont ; qu'il était tombé par sa propre caducité, ou que la rapidité des eaux en avait sapé les fondements. Ainsi j'allai chercher un autre endroit pour passer l'eau, et continuai mon voyage, par la grâce de Dieu, fort heureusement. Si je m'en fusse retourné reporter la pierre à Lorette et raconter ce qui m'était arrivé, les prêtres n'auraient pas manqué de crier miracle. Ce serait publié partout. On aurait fait un tableau de cet accident, que l'on aurait mis au nombre de plusieurs autres de cette sorte qui sont attachés aux murailles de l'église. On aurait distingué ce morceau de pierre avec des fers pour le montrer aux étrangers et aux pèlerins. Cependant l'expérience et le temps m'ont fait voir que Dieu n'avait point entrepris cette cause, et que la chute de ce vieux pont était purement casuelle.
Avant que de quitter Lorette, je vous dirai en général que le trésor qui y est conservé, est inestimable. Un pape étant averti qu'on en avait donné connaissance aux Turcs, et qu'ils projetaient déjà d'y venir faire une descente, fit entourer la ville de fortes murailles et de bons bastions, où il fit planter plusieurs pièces de canon. Il craignait assurément que les anges ne fussent pas si zélés à défendre le trésor, qu'ils l'étaient à défendre les briques de la Santa Casa. Il est aisé de remettre des pierres où il en manque, et de dire que les anges les ont rapportées : mais si les Turcs venaient une fois à enlever les pierres précieuses du trésor, il ne serait pas si facile de faire le miracle. Les Jésuites qui ne manquent pas de s'emparer de tous les bon postes, ont obtenu les confessionnaux dans cette église, et à certaines heures du jour ils s'y rendent pour entendre les confessions en toutes sortes de langues. Ils ont une adresse merveilleuse pour attraper de l'argent des étrangers. Ils en demandent à toutes les personnes qui vont à confesse à eux, sous prétexte d'en vouloir assister les pauvres pèlerins : mais ils retiennent tout de leur côté, et ne leur donnent au plus que quelques sols de temps en temps. Ils se servent pour cela de leur restriction mentale ; ainsi que m'a assuré un Jésuite qui était sorti de leur Société. Car comme ils ont fait vœu de pauvreté personnelle — c'est-à-dire, de ne posséder rien en particulier, mais tout en commun — ils prétendent être les premiers pauvres, et même pèlerins, parce que tout homme est pèlerin sur la Terre. Ainsi ils se donnent les aumônes à eux-mêmes, et croient par là avoir satisfait à l'intention de ceux qui leur en ont confié la distribution. Un pauvre prêtre savoyard qui était réduit dans un pitoyable état, m'étant venu demander l'aumône, je l'adressai à un de ces Jésuites, que je savais avoir reçu ce matin-là soixante écus d'un homme riche à qui j'avais parlé moi-même. Le Jésuite lui dit qu'il était fort fâché de ne le pouvoir pas assister, parce qu'il y avait longtemps qu'on ne lui avait confié de charités, et le renvoya de la sorte sans lui rien donner.
De quelque côté que l'on se tourne dans cette sainte ville de Lorette, on ne voit que des gens qui vous demandent de l'argent. Les prêtres vous en demandent pour faire dire des messes. Les Jésuites pour faire des aumônes à la manière que je viens de dire. Une infinité de porteurs de boîtes qui font des collectes pour la chapelle, sont incessamment à vous importuner dans les rues et dans l'église pour mettre dans leurs boîtes. Les marchands de la ville qui sont tous des vendeurs de médailles et de chapelets, vous appellent de tous côtés pour venir acheter de leurs bagatelles. Une infinité de vagabonds en habit de pèlerins, vous viennent demander la passade et vous coupent la bourse s'ils peuvent. Enfin les cabaretiers et les hôtes vous vendent leurs denrées à un prix exorbitant. Ils s'excusent sur ce que le pape met de si grands impôts sur tout ce qui entre dans Lorette, qu'il leur est impossible de se sauver autrement. De sorte que le tout bien considéré, le pape est le plus grand exacteur de tous. Ne voilà-t-il pas un lieu bien rempli de sainteté pour en faire la ville chérie de la Sainte Vierge ? Et ne voilà-t-il pas un peuple bien élu pour obliger Dieu à faire tant de miracles pour lui conserver la possession de cette maison, que les Catholiques romains prétendent être celle où le Verbe s'est fait chair ?
On voit une infinité de petits tableaux attachés aux murailles de la grande église, où sont dépeints les miracles que la Sainte Vierge a faits en faveur de ceux qui ont fait vœu d'y aller en pèlerinage. À cette occasion je vous dirai de quelle manière les miracles se sont encore tous les jours en Italie, et ce que c'est que ces miracles. J'en ai remarqué trois causes principales. La première est l'avarice des gens d'Église. La seconde, la ruse de certains gueux. Et la troisième c'est l'erreur populaire, jointe à une coutume que les prêtres ont introduite d'envoyer des tableaux aux églises qui représentent les dangers dont ils ont échappé. Pour ce qui est de la première cause qui est l'avarice des prêtres et des religieux, qui sont les deux ordres qui partagent le Clergé, il n'y a point de meilleure invention pour la contenter après le Purgatoire, que celle de publier de temps en temps quelques miracles, qu'ils disent avoir été faits dans leurs églises. Je dis après le Purgatoire, qui est à la vérité une source plus abondante de richesse pour eux, parce que la chose est plus générale. Tous les hommes doivent mourir ; et tous les prédestinés, selon leur doctrine, doivent passer au moins par les flammes du Purgatoire pour quelques heures ou quelques jours. Il n'y a eu, disent-ils, que la Sainte Vierge qui par un privilège tout particulier en a été exempte. Ceci fait qu'il n'y a point de Catholiques romains qui ne donnent de l'argent pour faire dire des messes, et des prières pour les âmes de leurs parents et amis défunts, ou qui ne fasse des legs ou des fondations pour en faire dire pour soi-même après sa mort. Mais pour ce qui est des miracles cela n'arrive que dans de certains cas particuliers. Cependant comme la vie humaine est sujette à beaucoup d'accidents fâcheux, on serait bien aise d'être assuré de quelque miracle dans l'occasion. C'est ce qui fait que ceux de la Communion de Rome à qui leurs prêtres en promettent à tout moment, pourvu qu'ils soient dévots à la chapelle d'un tel saint miraculeux qu'ils disent avoir dans leur église, ou qu'ils se fassent écrire en quelqu'une de leurs confréries, se laissent aisément persuader de leur donner l'argent qu'ils demandent. Néanmoins il est nécessaire de temps en temps de réveiller l'attention des peuples par le récit de quelque nouveau miracle, et c'est ce qu'ils font avec beaucoup d'adresse. La plus commune voie dont ils se servent, c'est d'aller visiter les malades, et de leur porter du vin, ou de l'eau, ou quelque morceau de linge qu'ils ont béni au nom du saint, ou de la sainte, auquel ils veulent attribuer le miracle. Si la personne malade après s'en être servi revient en santé, comme cela se peut faire fort naturellement, puisque nous voyons qu'il arrive tous les jours que les personnes les plus désespérées des médecins réchappent, alors les prêtres attribuent le recouvrement de sa santé au saint de leur église. Ils en demandent attestation à celui qui était malade ; ils en font grand bruit dans les villes ; ils le prêchent le dimanche publiquement en chaire. De même, si quelque personne est sur le point de faire un voyage, ils la vont trouver, et lui font faire un vœu à quelque saint de leur église. Ensuite s'il arrive que cette même personne ait dans le voyage quelque fâcheux accident, comme quelque tempête en mer, ou quelque roue de carrosse qui se rompe sur le chemin, et qu'elle en réchappe avec la santé et la vie, comme arrive même fort souvent aux plus scélérats, alors elle en attribue la cause ou à la sainte d'une telle église. À son retour elle ne manque pas d'en aller avertir les prêtres ou les moines, qui commencent de nouveau à faire grand bruit, à crier miracle, et à prêcher que rien n'est plus efficace contre les tempêtes et contre tous les malheurs qui peuvent arriver sur les grands chemins, que de s'adresser au saint de leur église, et d'y faire dire des neuvaines et des messes, comme a fait la personne qui est depuis peu de retour, et à laquelle le miracle est arrivé. D'autres qui ont la conscience plus large et qui croient qu'il est permis de mentir pour rehausser l'honneur de leurs saints, supposent hardiment des miracles, et se produisent eux-mêmes pour exemple ; disant qu'ils ont eu des révélations, ou que ces saints leur sont apparus, ou les ont guéris de leurs infirmités. Le peuple qui se laisse aveugler par l'apparence extérieure de piété de ces gens-là, ne prend pas la peine d'examiner les choses plus avant, et les croit sur leur parole. Il y a des gens qui connaissent naturellement deux ou trois jours auparavant quels temps il doit faire ; comme par les douleurs que font les cors au pied, on peut savoir s'il pleuvra, ou s'il fera beau temps. Un certain père de l'Ordre des Servites à Vincence, homme de mauvaise vie, qui entretenait trois femmes débauchées à Venise, dont il avait eu plusieurs enfants, après avoir gagné un mal qu'il n'est pas honnête de nommer, ne manquait pas d'en ressentir de plus vives atteintes trois jours avant qu'il dût pleuvoir. Il fit une sécheresse extraordinaire de trois mois, qui porta un extrême dommage à tous les fruits de la terre. Enfin le temps étant prêt de changer, le père ne manqua pas d'en avoir à l'ordinaire de tristes avertissements. Il était sacristain d'une église appelée la Madonna di Monte Berico, qui est à une demi-lieue de la ville de Vicence, sur une agréable colline, où l'on conserve une image miraculeuse de la Vierge. Comme il vit que la dévotion s'était déjà beaucoup ralentie, et qu'il manquait d'argent, il entreprit de la rallumer. Pour cet effet, se servant de la conjoncture du temps, il envoya dire au podestà ou gouverneur de la ville de Vicence, qu'étant la nuit en prière devant l'image de la Vierge, dont il avait l'honneur d'être sacristain, elle lui avait dit avec une voix intelligible et un agréable souris, qu'elle portait beaucoup de compassion aux afflictions de son peuple pour la grande sécheresse qui désolait la campagne ; et que si les habitants de la ville de Vicence faisaient dans trois jours une procession générale à son église, elle ouvrirait les cataractes du Ciel et ferait pleuvoir abondamment. Le gouverneur fit publier aussitôt un ordre pour faire la procession au jour que le bon frère avait marqué. Le temps ne manqua pas à se changer et à favoriser ses vœux. À peine la procession fut-elle arrivée à moitié chemin, qu'il tomba une si grosse pluie, que tous qui y étaient en furent percés, et arrivèrent avec grande peine à l'église, où ils chantèrent des hymnes à la Vierge en action de grâces. Ce miracle s'étant divulgué dans le pays, attira pendant deux mois une infinité de peuple à cette image miraculeuse. Le dévot sacristain voyant que sa bourse était remplie, alla le Carnaval suivant à Venise pour s'y divertir, et rendre ses maîtresses participantes de son bonheur. Il leur communiqua le bon succès qu'avait eu sa ruse. Mais quelque temps après, l'une d'entre elles ayant été mal satisfaite, le trahit comme une autre Dalila, et découvrit sa fourberie. Dans un autre pays, on aurait pu lui faire porter la peine de son imposture : mais en Italie c'est une fort bonne excuse que de dire, que l'on n'a prétendu en cela que d'avancer l'honneur de la Vierge.
Une autre adresse des prêtres que j'ai découverte, et sur laquelle peut-être peu de gens avant moi ont fait réflexion. C'est qu'ils ont coutume de conter aux enfants une infinité de fausses histoires et de contes faits à plaisir touchant des apparitions et des miracles qui n'ont jamais été. Pour mieux vous expliquer ceci, vous saurez, Monsieur, qu'en Italie, tous les dimanches, et toutes les fêtes de l'année, à une heure après midi, on fait le catéchisme aux enfants dans toutes les églises. Pour les y faire venir plus volontiers, les prêtres, après leur avoir expliqué un point de doctrine, leur content toujours à la fin quelque histoire plaisante, avant que de les renvoyer à la maison. Ces petits Italiens les écoutent avec beaucoup d'attention, et les vont ensuite raconter ay logis à leurs mères. J'ai remarqué que ces prêtres prennent ordinairement leurs sujets sur quelque miracle qu'ils disent avoir été fait dans leur église. J'entrai une fois dans une chapelle où l'un de ces jeunes catéchistes instruisait les enfants. La chapelle était dédiée à S. Martin. On dépeint ordinairement ce saint à cheval qui coupe avec son épée la moitié de son manteau pour la donner par aumône à un pauvre. C'est dans cette posture que sa statue qui était d'un très beau marbre blanc le représentait sur l'autel de cette chapelle. Le catéchiste se mit à raconter à ces enfants une assez plaisante histoire de cette statue. Il leur dit qu'un bon curé de cette paroisse l'avait souvent vu descendre de dessus cet autel et courir la poste hors de l'église ; qu'il avait pris un jour la liberté de lui demander où il allait. Saint Martin lui dit qu'il allait aider un fort honnête homme qui avait fait dire plusieurs messes à son autel ; que cet homme étant tombé dans un bois entre les mains des voleurs, était en grand danger de sa vie ; mais qu'il espérait arriver à temps pour le secourir, et qu'à son retour il lui dirait le succès de son voyage. Le catéchiste embellit ce récit avec des circonstances si ridicules qu'il était impossible de s'empêcher de rire : car il décrivit tout le voyage de S. Martin sur ce cheval de marbre, comme il galopait par-dessus les villes. Ces pauvres enfants écoutaient cela avec un silence et une attention merveilleuse. La conclusion de cette histoire fut que quiconque avait une grande dévotion à cette chapelle et y faisait dire des messes en l'honneur de S. Martin, pouvait s'assurer de ne jamais périr sur les grands chemins par la main des voleurs. Le lendemain j'eus occasion de parler à ce jeune ecclésiastique, et je le fis ressouvenir de son S. Martin de Marbre qui courait la porte. Il me dit en riant : Que voulez-vous, Monsieur, c'est la coutume de ce pays ici de raconter de semblables histoires aux enfants, lorsqu'ils viennent aux catéchismes ; car sans cela ils n'y viendraient pas. Il n'est pas possible de leur en dire toujours de véritables, et on est obligé quelquefois d'en composer quelqu'une. Les choses ne sont mauvaises qu'autant qu'elles peuvent produire un mauvais effet : ces sortes d'histoires n'en peuvent produire avec le temps qu'un très bon, qui est de leur inspirer une grande confiance aux saints, de les porter à les prier, à faire dire des messes en leur honneur. Ne voilà-t-il pas une morale bien fine et des enfants bien instruits : On les appelle à l'École de la vérité, et on ne leur débite que des mensonges ? Cependant il n'y a rien qui fasse plus d'impression dans les esprits, et dont l'on se ressouvienne mieux que de ce que l'on a appris de jeunesse : tous ces sots discours ne laissent pas de produire un grand effet et de passer avec le temps pour des vérités dans l'esprit des Papistes, qui sont d'ailleurs accoutumés à croire une infinité d'absurdités, et de contradictions dans la Transsubstantiation qu'ils soutiennent, et c'est là apparemment ce qui a rempli l'Italie de fables et d'histoires si impertinentes et si ridicules. Ces peuples néanmoins en sont si infatués que si quelque honnête homme amateur de la vérité, voulait en faire une trop curieuse recherche, ou les désapprouver, ils le tiendraient pour un hérétique : comme un certain qui fut mis à l'Inquisition pour avoir dit qu'il ne croyait pas ce que l'on disait de l'âne de S. Antoine de Padoue qui s'était mis à genoux pour adorer l'hostie à la confession des Protestants.
De cette première cause des miracles, qui est l'avarice des gens d'Église, je passe à la seconde, qui est la ruse de certains gueux. La pauvreté est une source de bénédictions à ceux qui la savent supporter patiemment, la recevant de la main de Dieu, et en s'en faisant un bon usage. Mais elle est aussi un abîme de misères et de malheurs pour ceux qui la reçoivent dans un esprit contraire, et je ne crois pas qu'il y ait une méchanceté égale à celle d'un méchant pauvre. Un méchant pauvre n'a point de conscience, il est dans la disposition de tout entreprendre pour se tirer de la misère de sa condition. Il s'en trouve plusieurs de cette sorte en Italie qui ne vivent que de ruse et d'adresse. Il y en a qui ont la patience de contrefaire les boiteux, paralytiques, ou aveugles cinq ou six ans durant, pour aller faire ensuite un miracle dans quelque église, attribuant leur délivrance à quelque image de la Vierge ou à quelque saint. Le profit qui leur revient de cela est que le peuple, étant informé du miracle qui leur est arrivé, les croit être de fort bonnes personnes et de grands amis de Dieu, puisqu'ils en ont reçu des faveurs si signalées. C'est ce qui porte les gens à leur faire de bonnes aumônes, pour avoir part à leurs prières. Quelque personnes riches et dévotes en prennent même fort souvent le soin, et font qu'il ne leur manque rien tout le reste de leur vie. Les prêtres et les moins leur donnent aussi leur entretien, lorsqu'ils ont donné du crédit à quelqu'une de leurs chapelles, et qu'il leur en revient un profit considérable. On m'a montré plusieurs de ces pauvres-là dans les couvents, qui vivent présentement parmi les domestiques fort à leur aise, et sans rien faire.
La troisième source d'où procèdent les miracles en Italie, c'est une erreur populaire qui s'y est glissée ; et qui a pris présentement de si profondes racines qu'il est comme impossible de l'extirper : C'est qu'au moindre petit accident qu'il arrive aux Italiens, et la moindre maladie qu'ils ont, ils font un vœu à quelque statue ou image de la Vierge, ou quelque autre saint pour en être délivrés. Toutes sortes de mauvaises rencontres ne sont pas fatales à la vie, et toutes les maladies ne sont pas mortelles. C'est ce qui fait qu'ils en réchappent fort souvent : mais par une superstition étrange, au lieu d'en attribuer la gloire à Dieu seul, qui est le Seigneur de la vie et de la mort, ils attribuent le recouvrement de leur santé, ou la délivrance du danger où ils étaient, aux statues ou images auxquelles ils ont fait vœu. Pour rendre leur reconnaissance plus authentique, suivant la mauvaise coutume qui s'est introduite, ils font faire un tableau où est représenté ce qui leur est arrivé, et eux dans l'acte d'implorer la statue ou l'image, qui pour cet effet est dépeint dans un des coins du tableau, et vers laquelle ils tendent les bras ou les mains jointes avec ces trois lettres : P. G. R. ; qui signifient en italien Per Grazia Ricevuta — Pour une grâce reçue. On voit en Italie généralement de ces sortes de vœux dans toutes les églises. Il y a toujours là quelque idole miraculeuse qui reçoit les encens, et à laquelle on attache les tables des naufrages. On n'a que faire de tapisserie dans ces sortes de chapelles, car tous ces petits tableaux joints l'un à l'autre couvrent toutes les murailles. On y en voit de toutes sortes de façons : les uns représentent des gens poursuivis par des assassins ; d'autres qui ont reçu des coups poignard ; et d'autres battus sur mer par de furieuses tempêtes. Il y a en même de fort scandaleux ; car on y voit des carrosses de messieurs et de dames qui renversent les uns sur les autres ; des filles forcées par leurs amants, et des femmes en couche représentées dans leurs lits d'une manière fort lascive et luxurieuse. Un seigneur italien me disait qu'il allait fort volontiers entendre la messe aux autels où il y en avait le plus, parce qu'ayant là de quoi repaître son imagination, elle ne lui semblait pas si longue. Ces tableaux qui ne sont que de simples vœux, ont acquis peu à peu tant de crédit sur les esprits du peuple, qu'ils passent présentement pour de véritables miracles. Les prêtres et les moines qui écrivent les histoires des lieux de dévotion qui leur appartient, ne font point de difficulté de les citer sur ce pied-là : De sorte que l'on conte aujourd'hui en Italie les miracles par ces sortes de tableaux ; et plus une statue ou image en a autour d'elle, plus elle est estimée miraculeuse.
Je vous rapporterai à ce sujet un tableau que quelques jeunes moines de l'abbaye de San Vittorio de Milan firent faire du temps que j'y étais. L'accident qui leur arriva fût tel. On dorait la voûte d'une des ailes basses de l'église. Ces moines, par curiosité, tandis que les ouvriers étaient allés dîner montèrent au nombre de sept ou huit sur l'échafaud pour considérer l'ouvrage. L'un d'entre eux, plus étourdi que les autres, mit le pied sur une planche qui n'était pas bien assurée et tomba sur le pavé de l'église. Tous les autres étant effrayés, et croyant que tout l'échafaud allait tomber, se jetèrent sur les échelles et se laissèrent couler en bas sans se faire aucun mal. Il n'y eût que ce pauvre misérable qui était tombé avec la planche qui fût froissée. On l'enleva dans un pitoyable état, et il fût obligé de garder deux ou trois mois le lit avant que d'être entièrement remis. J'étais présent lorsque l'accident arriva, et je ne vis rien dans tout ce qui se passa de très naturel. Celui qui tomba se fit un mal proportionné à la hauteur dont il était tombé ; et les autres ne se firent point de mal, parce qu'ils se coulèrent tout doucement en bas par moyen des échelles. Il n'y a point là de miracles. Cependant, comme l'échafaud était dressé devant la chapelle du bienheureux S. Bernard de Sienne, ces moines conclurent qu'il fallait que ce saint les eût aidés. Ils firent faire un tableau de leur chute, où le saint était dépeint en un coin qui leur tendait les bras. Ils publièrent partout dans la ville que ce saint les avait soutenus en tombant. Le cardinal-archevêque en fut informé, et un chacun les congratula du bonheur qu'ils avaient d'être si fort dans les bonnes grâces de ce saint-là. De ceci, Monsieur, et de tout ce que je vous ai rapporté ci-dessus sur le fait des miracles, vous pouvez comprendre de quelle force sont ces belles légendes des vies des nouveaux saints de l'Église de Rome, de quel poids doivent être toutes ces grandes listes de miracles qui les accompagnent, et qui en font presque toute la substance. Ils ont tous rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, l'usage de la langue aux muets ; ils ont fait marcher droit les boiteux ; enfin ils ont préservé de toutes sortes d'accidents et guéri de toutes sortes de maladies. Mais quand on vient à l'examen de tout cela, tout s'en va en fumée : et tout ce réduit, au plus, à quelques petits tableaux, que quelques superstitieux, qui ont cru sans fondement en avoir reçu des grâces, ont fait faire. Cependant quand on envoie ces légendes-là dans les pays étrangers qui suivent la Communion de Rome, cela fait grand bruit. On considère cela comme des miracles qui ont été bien avérés, et dont il y a eu des preuves et des témoins suffisants. On reproche aux Protestants qu'il ne se fait point de miracles chez eux, et on veut que ce soit là un argument invincible pour prouver qu'ils sont dans l'erreur. Un Jésuite (1), dans une oraison latine qu'il fit dans la cathédrale de Strasbourg, un peu après que les Français en eurent pris possession, s'écria en ces mots : Quid dubitamus de falsitate religionis eorum apud quos cessavit propheta et sacerdos, et miracula periere ? — Doit-on douter de la fausseté de la religion de ceux, chez qui les prophéties, le sacerdoce et les miracles ont cessé ? Les Protestants lui auraient pu répondre avec vérité, que l'on n'a aucun sujet de douter, qu'une religion si pleine de superstition, et de faux miracles, comme est le papisme, ne soit très fausse. La profession d'un véritable Chrétien doit être de vivre selon l'Évangile, et non pas de le confirmer par miracle. C'est l'ouvrage de Dieu seul, et on ne se le doit point reprocher les uns aux autres. Nous voyons tous les jours que des joueurs de gobelets, quoique l'on sache qu'ils trompent, et qu'on regarde ce qu'ils font avec toute l'attention possible pour en découvrir l'artifice, sont néanmoins si adroits qu'ils se moquent de nous à nos yeux : et on en croira aveuglement aux Italiens qui ont la subtilité en partage ? Sic notus Ulißes ? Pour moi dans le temps où nous sommes, je ne croirai jamais de miracles, lorsque je pourrais découvrir par ma raison que le fait est falsifiable par les hommes. On tient que corps de S. Nicolas de Bari, dans la Pouille, est miraculeux, et qu'il dégoûte continuellement de son tombeau une huile fort salutaire pour les malades : mais c'est assez que je sache que les hommes y peuvent mettre de l'huile, et le faire adroitement couler, pour n'y point reconnaître de miracle. J'ai vu quelquefois de pauvres pèlerins qui retournaient de ce pèlerinage et qui avaient de petites bouteilles toutes pleines de cette huile, qui leur avaient coûté beaucoup d'argent. Ils les voulaient ensuite donner pour un morceau de pain, et personne n'en voulut. Ce qui fait voir que les Italiens avec toute leur bigoterie, n'y croient pas eux-mêmes. De même à Naples, les prêtres montrent une bouteille, qu'ils disent être pleine du sang de S. Janvier, archevêque de cette même ville. Lorsqu'ils l'apportent, ce sang prétendu y est congelé ; et quand ils l'approchent du corps de ce saint, il se liquéfie peu à peu. Pour ceci, il me suffit aussi pour n'y pas ajouter foi, de savoir que cette liqueur peut-être congelée, comme on fait les sorbets, et se résoudre ensuite par la chaleur du lieu où on la vient montrer, et des mains de ceux qui la manient. On voit à Padoue le tombeau de S. Antoine de Padoue qui rend une odeur assez douce entre l'ambre et le musc. Les frères de ce couvent disent qu'elle sort des os de S. Antoine qui y sont renfermés. Mais le témoignage de ces gens-là, qui y sont intéressés, ne me satisfait pas ; tandis que je saurai qu'ils le peuvent eux-mêmes graisser avec des quintessences odoriférantes, comme il est certain qu'ils le font, parce que cette odeur est la même que celle des chapelets parfumés que l'on vend dans les boutiques à Padoue. Dans le même lieu, on montre dans un beau cristal, appuyé sur un superbe piédestal d'or, extrêmement bien travaillé, la langue du même S. Antoine, qu'ils disaient avoir été trouvée dans son tombeau avec le privilège de l'incorruption ; les autres chairs qui environnaient les os ayant été corrompues. Ils ont l'effronterie d'assurer que cette langue, pour avoir été le fléau des Sacramentaires (2) de son temps, est conservée dans son entier, comme un perpétuel miracle pour rendre témoignage de la Transsubstantiation. La plupart des légendes de Rome, disent qu'elle est aussi fraîche que lorsqu'elle était vivante : mais cela est très faux, car je l'ai vue et elle est sèche. Ceux qui ont l'art d'embaumer les corps, et de les dessécher, peuvent conserver une langue de cette manière plusieurs années, et même plusieurs siècles, sans qu'il y ait rien d'extraordinaire.
Voilà, ce me semble, Monsieur, les plus fameux miracles de l'Italie, que les Catholiques romains prétendent être si palpables et sensibles, qu'on ne saurait les dénier sans démentir les sens et la raison. J'y ajouterai encore trois corps de saintes qui sont conservés incorrompus, et que j'ai vus tous trois. L'un est de sainte Rose de Viterbe ; l'autre est de sainte Claire de Monfaucon ; et l'autre de sainte Catherine de Bologne. Ces corps ont été conservés en leur entier, mais sans aucune beauté. Ils sont desséchés comme du carton, et extrêmement noirs. Ils font peur à les regarder, quoiqu'on les ait habillés avec de riches robes, et qu'elles aient plus de joyaux, de perles et de diamants que n'en ont les reines au jour de leur couronnement. Quelques-uns font grand cas de ces sortes d'incorruptions ; et je les estimerais aussi, si les corps restaient beaux, avec un teint frais, et une couleur naturelle : mais d'être si sec, si noir et si hideux, il vaudrait mieux, ce me semble, entrer dans la voie universelle de la chair : et je ne vois pas que Dieu eût fait en cela une grande grâce à ces bonnes Béates, de les conserver dans un état propre à faire horreur à la nature, et à épouvanter les hommes. Les ouvrages de Dieu sont parfaits : Il ne fait jamais une grâce à demi, et s'Il donnait l'incorruption à des corps, Il leur conserverait aussi toutes les qualités naturelles qui leur conviennent dans cet état. C'est pourquoi je ne crois pas que l'on doive attribuer les incorruptions défectueuses des corps de ces saintes, qu'à l'adresse de ceux qui les ont desséchés ou embaumés. On voit à la Chartreuse de Venise le corps d'un noble Vénitien, qui a été embaumé et conservé dans son entier depuis plus de cent ans. Il n'a jamais passé pour un saint. Cependant je l'ai trouvé incomparablement plus beau que les corps de ces trois Béates, quoiqu'il soit beaucoup plus négligé ; car on l'a laissé dans un vieux coffre de bois qui ne ferme point, et où tous ceux qui vont à la Chartreuse le voient et le touchent. Mais les corps de ces Béates sont dans des chapelles extrêmement sèches, et où les grands luminaires qui y brûlent jour et nuit, purifient l'air de toute sorte d'humidité et d'impureté. J'ai vu aussi en France, à Vendôme, dans l'église collégiale du château, le corps de Jeanne d'Albret [1528-1572], qui mourut une très zélée Protestante il y a plus de cent ans. Son corps a été fort bien embaumé ; et si on le levait présentement du lieu où il est, qu'on l'habillât, et qu'on le conservât dans un lieu bien sec, il serait assurément plus beau que celui de ces religieuses. Cependant je suis sûr que les Catholiques romains ne diront pas qu'elle est une sainte.
Puisque me voilà sur le chapitre de ces Béates, je vous dirai que j'ai lu plusieurs fois l'Histoire de leurs vies, et de plusieurs autres, dans les légendes de l'Église de Rome : mais je n'ai rien vu de plus ridicule. Et même j'ai reconnu que ce sont ces prophétesses dont le Jésuite parlait à Strasbourg et que les Protestants n'ont point : Apud quos cessavit propheta. Presque toutes les religieuses, lorsqu'elles sont arrivées à un état que l'on appelle de perfection, se mêlent de prophétiser. Pour mieux comprendre ceci, vous saurez qu'à Rome on a divisé la vie spirituelle en plusieurs états, comme une maison qui a plusieurs étages : le bas, le milieu et le haut. Il y a un état qu'ils appellent actif ; c'est le plus bas, et qui consiste seulement dans l'action, et à régler les opérations des sens selon la loi de Dieu. Le second est l'état contemplatif, qui consiste dans la méditation des choses qui n'ont aucune communication avec les sens. Le troisième est un état extatique et abstrait purement passif, où l'âme ne fait rien ; mais par une simple application, adhérence, et union à l'essence Divine, reçoit sans aucune action, affection, ou contemplation de sa part, les impressions de Dieu. Il y en a peu qui arrivent à ce haut étage : mais lorsqu'ils y sont une fois venus, s'ils profèrent quelque parole, ou font quelque action, ce n'est plus eux qui parlent ou qui agissent, mais c'est Dieu qui parle et agit en eux. Pour eux ils ne partent jamais de leur union. On observe tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent en cet état, parce que tout est Divin. S'ils parlent des choses passées, ce sont de révélations ; et s'ils parlent des choses futures, ce sont des prophéties. C'est par cette porte que sont entrées dans l'Église romaine tant de nouvelles connaissances que l'on y croit aussi fermement que l'Évangile, quoiqu'elles n'aient point d'autre fondement que le cerveau échauffé de ces Béates. Plusieurs d'entre elles ont écrit elles-mêmes leurs révélations, comme sainte Brigitte, sainte Melchide, sainte Catherine de Sienne, sainte Gertrude, et plusieurs autres. Par le moyen de ces saintes, l'Église romaine a reçu toutes les particularités de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Combien il reçut de coups dans Sa flagellation ; combien il tomba par terre sous le pesant fardeau de Sa Croix ; combien d'épines percèrent Son sacré chef ; et combien de crachats il reçut sur Sa sainte face. Par la même voie, ils ont découvert tout ce qui se passa en la crèche de Bethléem ; comme la Sainte Vierge prit le voile de sa tête et en fit des langes au petit Jésus ; ce qu'elle dit, et ce qu'elle fit avant que d'accoucher ; et une infinité d'autres particularités qui ne se voient point dans l'Évangile. Par là, ils ont eu connaissance du grand mystère de l'Assomption de la Vierge, lorsqu'elle monta en corps et en âme au Ciel, le discours qu'elle fit aux Apôtres, comme elle s'élevait peu à peu en l'air en leur donnant des bénédictions. Enfin presque toute la nouvelle doctrine du papisme est découlée de cette source seconde, qui n'est pas encore tarie, et qui durera tant qu'il y aura dans cette Église, de ces sortes de prophétesses. Pour donner plus de poids à ces imaginations, ces Béates assuraient que Jésus-Christ leur apparaissait fort souvent, et leur était devenu extrêmement familier ; qu'il leur parlait comme un époux parle à son épouse, et qu'elles prenaient occasion dans sortes de familiarités de Lui demander tout ce qu'elles souhaitaient savoir. Jésus-Christ apprit lui-même à sainte Catherine de Sienne à lire ; il venait souffler le feu, il balayait sa chambre, comme on le voit en l'histoire de sa vie ; c'est pourquoi elle avait occasion de lui parler souvent. D'autres recevaient des visites de Jésus-Christ, qui les venait visiter accompagné de Sa sainte mère et de Ses apôtres. Ils avaient de grandes conférences ensemble ; et ces saintes qui les écoutaient discourir, découvraient beaucoup de secrets et de mystères. Elles les ont ensuite communiqués aux papes et à l'Église ; et c'est ce qui fait aujourd'hui une grande partie de la différence qu'il y a entre la doctrine des Papistes et celle des Protestants : Apud quos cessavit propheta. Il n'y a point de couvent de religieuses en Italie, qui n'ait encore aujourd'hui quelque prophétesse ; et c'est toujours quelque vieille mère qui a été deux ou trois fois supérieure, et qui ne pouvant faire autre chose, s'applique à la vie unitive. Dans un séjour assez long que je fis à Vicence, j'allais voir fort souvent l'abbesse des religieuses de Saint-Thomas. Je lui demandai une fois l'état où étaient ses religieuses. Elle me dit qu'elle en avait quarante-quatre dans la vie active, trois dans la contemplative, et une dans la vie mystique ou unitive. Une jeune comtesse qui était dans le même couvent, et qui était entretenue par quatre ou cinq galants qui la venaient voir à la grille, n'était encore que dans la vie active.
Je ne m'engagerai pas plus avant pour le présent à vous parler des religieuses d'Italie. Je pourrais vous entretenir une autre fois plus à loisir. Je retourne à ces Béates dont les corps sont restés incorrompus. Elles étaient toutes trois arrivées à l'état unitif, et ont toutes trois fait des prophéties. Sainte Rose de Viterbe fut longtemps à importuner les religieuses dominicaines de la même ville, de la recevoir, et de lui donner l'habit de l'Ordre. Mais ces nones voyant qu'elle était extrêmement pauvre, et ne pouvait point comme les autres apporter de l'argent au couvent, la refusèrent, et ne voulurent pas même la recevoir au nombre de leurs sœurs converses. La sainte voyant le refus qu'on lui faisait, leur dit, qu'elles ne voulaient point d'elle en vie, mais qu'elles seraient bien aises de l'avoir morte. Cette prophétie se vérifia ; car Rose étant morte en odeur de sainteté : et plusieurs miracles à l'italienne s'étant faits à son tombeau, les religieuses demandèrent son corps qui leur fut octroyé. Le grand nombre de messes que l'on y fait dire, et les grandes aumônes que les voyageurs et les pèlerins y laissent, fait qu'ils la considèrent aujourd'hui comme leur plus grand trésor. Cette prophétie de sainte Rose tait fort facile à faire. Elle savait qu'elle était assez suffisamment entrée dans la bonne opinion du peuple pour être estimée comme une sainte après sa mort. Elle connaissait de plus, que les corps saints ne sont jamais sans un grand profit ; que les religieuses de ce couvent, aussi bien que les autres d'Italie, étaient fort avaricieuses, et qu'en vertu de vœu qu'elle avait fait à S. Dominique, elles ne manqueraient de demander ses reliques. C'est pourquoi elle pouvait prophétiser à coup sûr. La Béate dont on voit le corps à Montfaucon a quelque chose d'assez remarquable. On montre tous les instruments de la Passion de Notre-Seigneur, que l'on dit qui furent trouvés dans Son cœur après Sa mort. Ils sont de chair desséchée de même que Son cœur. Ils sont fort confus, et on ne peut pas les distinguer tous. On montre trois petites boules de chair, que l'on de même qui furent tirés de Son cœur. L'une de ces boules étant mise dans une balance pèse autant que les trois ensemble, et les trois ensemble ne pèsent plus qu'une. C'est ce qui leur fait dire que Dieu a bien voulu imprimer dans le cœur de cette sainte un vestige de la Très Sainte Trinité. Car de même que ces trois boules, quoique différentes en nombre, ne font qu'un poids, et que le poids d'une seule n'est pas moindre que celui de toutes les trois ; aussi quoiqu'il y ait trois personnes dans la Sainte Trinité, il n'y a pourtant qu'une Essence, et l'une de ces personnes n'est pas moindre en perfections divines que les deux autres. J'ai vu ces trois boules, mais bien loin que l'on permette d'en faire l'expérience, l'on ne permet pas même d'y toucher avec le doigt pour sentir si c'est de la chair ou non. Un chacun sait qu'une imagination forte est capable de faire d'étranges opérations dans un corps. On voit tous les jours des enfants qui viennent au monde marqués des envies de leurs mères, qui sont des effets de l'imagination. Il se peut faire que cette Béate se soit imaginée si fortement tous les instruments de la Passion, qu'ils lui soient restés gravés dans le cœur, il me semble que c'est faire à la nature une violence qui ne peut point être agréable à Dieu qui en est l'Auteur. Pour ce qui est de sainte Catherine de Bologne ; elle s'est rendue particulièrement fameuse pour sa vie abstraite. L'histoire de sa vie dit qu'elle était dans une continuelle union avec Dieu. Le docteur Molinos n'était pas éloigné de cette unitive, car c'est ce qu'il appelle oraison de repos (3). Je ne doute point qu'il n'eût été un jour un des saints de Rome, si l'obéissance aux supérieurs et particulièremnt au pape, n'y eût point été intéressé. Le pape peut permettre tant qu'il vous plaira de s'unir à Dieu, pourvu néanmoins que cette union n'empêche pas qu'on lui obéisse plus qu'à Dieu même. Je ne doute point à la vérité qu'il ne puisse y avoir encore aujourd'hui des âmes parfaites qui sont ravies jusqu'au troisième Ciel, comme un S. Paul ; mais ce sont des grâces extraordinaires, qui ne sont dûes à aucun effort que la nature puisse faire pour les acquérir. Mais quand je considère que les Catholiques romains ont fait un état fixe de cette union ; qu'ils en donnent les règles ; et qu'il suffit, selon eux, de se mettre entre les mains d'un de ces docteurs mystiques et unitifs, et suivre ses directions pour y arriver. Quand je considère ceci, dis-je, je ne puis que condamner leur erreur. C'est une impiété d'attacher les opérations divines au caprice des hommes ; de donner des règles pour acquérir par mérite ce qui n'est donné que par grâce, et de se faire soi-même le dispensateur des dons célestes, comme ces sortes docteurs prétendent le faire. De plus les mauvaises conséquences qui s'en ensuivent sont très pernicieuses aux âmes. Premièrement, cette seule assurance que l'on reçoit de ces gens-là, que l'on est dans la vie unitive, et que tant d'autres ne sont que dans la contemplative ou dans l'active, qui lui sont beaucoup inférieures, est capable d'inspirer beaucoup d'orgueil. En second lieu, cela peut beaucoup décourager ceux qui sont nécessairement engagés dans la vie active, de savoir qu'il y ait des états si parfaits au dessus d'eux, auxquels il ne leur est pas permis d'arriver, parce que ces docteurs ne les y veulent pas admettre. Troisièmement, c'est que cela donne entrée à beaucoup de superstitions et d'erreurs ; car les Actifs ne prennent pas la peine d'examiner ce que disent les Contemplatifs, ni ceux-ci ce que disent les Unitifs. Ils se reposent ainsi les uns et les autres sur ces derniers, qui sont la plupart des têtes folles, des gens extravagants dans leurs pensées, qui croient que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font est de Dieu. Il est évident que l'opinion de la Transsubstantiation n'est venue que de leurs caprices, par l'impropriété, l'abus et la confusion des termes ils se servent pour s'expliquer. Car de même qu'ils appellent leur vie mystique tantôt union, unité, identité, confusion de l'âme avec Dieu, d'autrefois perte de l'âme en Dieu, pure vue de Dieu, possession paisible de Dieu, et beaucoup d'autres que l'on peut voir dans les livres qui traitent de la vie mystique, dont les uns sont très faux et impiés, comme ceux d'unité, d'identité, de confution et de perte ; et tous les autres n'appartiennent qu'à la vie future : de même, dis-je, qu'ils se servent de ces termes pour signifier une simple adhérence, complaisance et acquiescence de notre âme au bon plaisir de Dieu, qui n'est point identifiante ; aussi anciennement ils appelèrent la Sainte Cène, union réelle de Jésus-Christ avec nos âmes, et le pain que l'on y donne, vérité, réalité, substance du corps de Jésus-Christ, qui n'y est néanmoins qu'en figure ; et enfin quand l'erreur a été bien enracinée, ce beau grand mot de «Transsubstantiation» est venu, qui fait présentement la principale différence entre les Papistes qui la soutiennent, et les Protestants qui la combattent. Il ne faut pas s'étonner si une erreur d'une telle conséquence, s'est glissée dans l'Église romaine sans faire grand bruit : Car, premièrement, elle n'allait point contre l'autorité du pape ; et ensuite, c'est qu'il n'était pas permis au peuple d'examiner ce que disaient ces mystiques. De même qu'encore aujourd'hui en Italie, si l'on parle à un Contemplatif, ou à un Unitif, pour les contredire en quelque chose, ils vous répondent fort librement que ce n'est pas là votre affaire ; qu'il faut les en croire là-dessus ; et qu'ils sont mieux instruits que vous dans les voies de Dieu, puisqu'il y a tant de temps qu'ils sont entrés dans la vie mystique.
Je n'ai guère vu de ces sortes de mystiques qui ne soient extrêmement superbes. Ils se regardent comme des aigles qui prennent leur essor dans le plus haut de l'air ; et les autres hommes, comme des bêtes qui rampent sur la terre. Une vie commune et humble, pleine d'affabilité, de bénignité et de douceur pour le prochain aura toujours pour moi plus d'attraits que tous ces grands alambiquements d'esprits qui inspirent tant d'orgueil : et s'il plaît à Dieu de m'élever à ce haut état de contemplation et d'union, ce sera Son ouvrage, et non pas aucune règle ni direction que les hommes m'en puissent donner. En Italie, on en fait comme un métier ; et si l'on ne se met entre les mains de ces docteurs mystiques, qui prétendent être de vieux routiers dans le chemin du Ciel, et qui sont les professeurs de l'art d'y conduire les âmes, on ne doit pas espérer d'y arriver jamais. Ces professeurs sont ordinairement de vieux Jésuites, de vieux Capucins, ou de vieux Pères de la Mission qui ne pouvant plus courir dans les pays étrangers, en Hollande et en Angleterre, pour y pervertir les Protestants, s'appliquent dans leurs couvents à faire les pères séraphiques, pour se faire suivre d'une troupe de dévots et de dévotes qu'ils entretiennent matin et soir dans leurs églises. Lorsqu'ils sont dans leurs assemblées, ce ne sont que des soupirs, gémissements et paroles entrecoupées, bien autres que ceux des Quakers en Angleterre ; et en cela, ils n'ont rien assurément à se reprocher. Le directeur est assis dans son confessionnal, au milieu de tous ces gens-là, qu'il appelle ses fils et ses filles spirituelles. Là, comme dessus un trône, il juge en dernier ressort, de leurs soupirs et de leurs pensées, s'ils viennent de Dieu, du Diable, ou de leur amour-propre. Les jeunes filles, ou les femmes mariées, ne se trouvent guère à ces sortes d'assemblées ; parce qu'elles se sont ordinairement les jours ouvriers, et que ces jours-là les Italiens les tiennent enfermées sous la clef. Mais ce sont des veuves ou de vieilles filles qui n'ont personne qui les commande. On les appelle en Italie Béates, Bonnes Sœurs, Dévotes, et quelquefois par dérision Bigotes. Les pères directeurs sont fort zélés pour leur avancement dans la vie mystique, et ne les abandonnent point, qu'ils ne les aient dépouillés si fort de l'amour des biens et des richesses de ce monde, que pour s'en décharger elles n'en aient fait la cession à leur couvent. Alors elles sont arrivées à la perfection ; ils les appellent «sœurs» ; ils leur donnent à entendre qu'ayant donné leurs biens à leurs monastères, c'est tout autant que si elles avaient fait profession parmi eux ; ils leur donnent de leurs habits, qu'ils appellent «petits scapulaires», qu'elles portent par-dessus leurs corps de jupes. En vertu de ces petits morceaux d'étoffe, elles sont rendues participantes de tout le bien qu'ils font, de toutes les grâces, privilèges, bénédictions et indulgences accordés à leur Ordre. Quand elles sont mortes, ils enterrent dans leurs églises, et ils tâchent s'ils peuvent, pour encourager les autres, de les faire passer pour des saintes. Il est même assez facile de le faire : car pour cet effet, la première personne malade qu'ils vont visiter, ils lui font un ample récit de l'état de perfection où était arrivée Madame une telle qui a été enterrée depuis peu dans leur église ; qu'ils ne doutent point qu'elle ne soit une grande sainte ; et que si le malade la prie et l'invoque avec confiance, ils croient qu'elle fera un miracle en sa faveur. Ils s'offrent même quelquefois de bénir du vin, du sirop, ou quelque autre liqueur au nom de la sainte ; ou d'y tremper quelque harde qui lui a servi, comme sa discipline ou son chapelet. Après quoi ils donnent cette liqueur à boire au patient. S'il réchappé de sa maladie, c'est un miracle pour la sainte : on en fait faire un petit tableau, que l'on porte à son tombeau. Et s'il arrive que le patient meure, ou que sa maladie tire trop en longueur, il n'en est jamais dit un mot, et on attend une meilleure occasion. Ceux qui ont quelque connaissance de l'Italie, savent que je n'avance rien ici qui ne soit très véritable. De là on peut concevoir de quelle manière sont entrés dans l'Église de Rome, tant de nouveaux saints et saintes à qui l'on a présentement érigé des autels. Il ne sert de rien ici d'alléguer, qu'à Rome on prend tant de précautions pour examiner les faits, dans les procès-verbaux que l'on fait de leur canonisation, qu'il est impossible que rien échappe à la connaissance de ceux qui en ont la charge. On ne connaît que trop le grand pouvoir que l'or et l'argent ont à Rome. L'on ne canonise jamais un saint, que cela n'apporte à ces gens-là des sommes immenses. Si on forme quelques difficultés, ce n'est que pour faire redoubler l'argent.
Mon dessein était de ne vous entretenir dans cette Lettre que des pèlerinages ; mais à l'occasion de ces trois saintes, dont les corps sont incorrompus, j'ai fait cette digression. Pour achever seulement en peu de mots ce qui me restait à dire sur mon premier dessein ; c'est que tous les autres pèlerinages d'Italie, excepté celui de Lorette, de Rome, et de S. Antoine de Padoue, sont fort peu considérables. Quelques pèlerins vont au Santuario di San Michele sul Gargano dans la Pouille : d'autres à la Basilica di San Nicolas à Bari. Mais il n'y va presque que des gueux. Car comme le chemin est peu fâcheux depuis Naples ; qu'il faut passer de hautes montagnes, et que les habitants de ce pays-là sont presque tous des voleurs ; les seigneurs italiens se donnent bien de garde d'y aller promener leurs dames avec leurs beaux bourdons de diamants. La délicieuse marche d'Ancône est bien plus propre et plus sûre pour ces sortes de pèlerins et de pèlerines. Le pèlerinage de S. Antoine de Padoue, dans l'agréable pays des Vénitiens, leur est aussi beaucoup plus propre. Il n'y a guère d'Italiens qui n'en fasse le voyage de trois ans en trois ans. Plusieurs y vont même régulièrement tous les ans. Ce saint a acquis tant de crédit en Italie, qu'il y va de pair avec la Vierge et avec Dieu même. Quelques-uns l'ont appelé avec beaucoup de raison le Dieu de l'Italie : Italia Deus. Quand un Italien a juré par Sant' Antonio, c'est le plus grand serment qu'il pût faire. Au lieu que dans les autres pays l'on a coutume de dire «J'espère aller en un tel endroit un tel temps, si Dieu me conserve la vie ; Je ferai ceci ou cela, s'il plaît à Dieu», ils ont coutume de dire «J'irai là, et ferai cela s'il plaît à la Vierge et à S. Antoine». Leur plus commune interjection lorsqu'ils sont dans quelque danger, surprise, ou admiration, c'est de dire : Madonna Santissma ! ou Sant' Antonio ! Et par un blasphème étrange, quoiqu'ils en fassent un grand point de dévotion, ils l'impiété de dire : «J'espère en S. Antoine que je ne périrai jamais». On l'appelle Il Santo — «Le Saint», sans queue — qui est un grand honneur, mais qui n'est dû qu'à Dieu seul, auquel les anges crient incessamment : Saint, Saint, Saint. Il n'y a point d'églises en Italie, qu'il n'y ait un autel dédié à S. Antoine de Padoue. On invoque ce saint particulièrement pour les choses perdues. On rapporte à ce sujet, l'histoire suivante. Un riche marchand vénitien étant en pleine mer, laissa par mégarde tomber dans la mer un diamant d'un très grand prix. Étant de retour à Venise, il alla à Padoue, et eut recours al Santo. Il pria les frères de ce couvent de lui dire une neuvaine de messes, et de joindre leurs prières aux siennes pour recouvrer son diamant. Le neuvième jour, la neuvaine étant finie, le marchand voulut donner à dîner à tous les frères du couvent. Il acheta entre autres choses, un fort gros poisson qu'il leur envoya. Le frère cuisinier l'ayant effondré, trouva dans ses entrailles le diamant que marchand avait laissé tomber dans la mer. Il lui fut rendu tout aussitôt, et grâces furent rendues au saint de ce qu'il avait exaucé leurs vœux. Cette histoire est rapportée tout entière dans la légende de sa vie. Mais ne vous semble-t-il pas, Monsieur, qu'elle ait été faite à dessein par ces bons frères, pour porter les gens à leur donner à dîner et à leur faire faire dire des neuvaines ? On en rapporte une autre assez plaisante, qu'ils se donneront bien de garde de mettre dans leur légende. I Frati del Santo passent sans contradiction pour les plus débauchés de Padoue, même plus que les écoliers de l'université. Un de ces bons frères ayant sollicité pendant plusieurs mois une jeune demoiselle, elle succomba enfin à tentation. Mais un moment après, elle eut un regret si sensible de sa faute, qu'elle en était inconsolable. Le frère s'en étant aperçu, trouva encore le moyen de la persuader, que si elle lui donnait quelque somme considérable pour faire des messes à S. Antoine, le saint lui rendrait la virginité qu'elle avait perdue. Ainsi outre qu'il avait satisfait sa passion, il eut encore de l'argent d'elle pour se divertir ailleurs. Je ne voudrais pas vous obliger à croire cette histoire, n'ayant pas des garants suffisants pour la croire moi-même. Seulement je suis sûr que ces bons frères, à la faveur de leur S. Antoine, font d'autres tours qui valent bien celui-là. Je pourrai vous en entretenir plus au long dans quelqu'une de mes Lettres. Je finis celle-ci en vous assurant que je serai toute ma vie, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Il s'agit du docteur Ulrich Obrecht (1646-1701), jurisconsulte et philologue français ; celui-ci abjura le luthéranisme entre les mains de l'abbé Jacques-Bénigne Bossuet en 1684, et fut nommé par Louis XIV préteur royal de Strasbourg le 31 mars 1685.
2. Sacramentaires : nom donné aux hérétiques qui ont enseigné des erreurs touchant à l'Eucharistie. Ne pas confondre ce mot avec son homonyme qui désigne le livre liturgique ancien réunissant toutes les parties récitées ou chantées par le célébrant.
3. Miguel de Molinos (1640-1696), fondateur du quiétisme ; la bulle Cœlestis Pastor, rendue par le pape Innocent XI le 2 septembre 1687, et lue dans l'église dominicaine de Santa Maria sopra Minerva le jour suivant, prononcée soixante-huit propositions de Molinos d'être hérétiques, erronées, suspectes, scandaleuses, etc.
CINQUIÈME LETTRE.
Des fêtes et des confréries d'Italie, etc.
Il ne s'est rien passé de considérable dans mon voyage, depuis Lorette jusqu'à Rome ; excepté l'accident qui m'arriva, et que je vous ai rapporté dans ma précédente. J'y arrivai vers Noël ; j'y passai toutes les fêtes, et m'y tins tout le Carême suivant jusqu'à Pâques. Ma principale occupation pendant ce temps-là, fut d'aller aux fêtes, d'entendre les sermons, et de me trouver aux confréries. C'est ce qui sera aussi le sujet de cette présente Lettre.
Le mot de «fête», dans sa propre signification, est pris dans l'Église romaine pour ces jours que l'on observe plus religieusement que les autres dans l'année, en l'honneur de la Vierge, de quelque mystère, ou de quelque saint, et que l'on appelle en anglais holydays. Il y a des fêtes universelles, et d'autres particulières. Les universelles sont observées généralement dans tous les pays qui professent le papisme ; et ils sont obligés ces jours-là, sous peine de péché mortel, d'aller à la messe. Les particulières sont seulement gardées dans de certaines provinces, villes, paroisses, ou chapelles. Comme à Rome il y a un nombre prodigieux d'églises et de chapelles, c'est tous les jours fête dans plusieurs endroits de la ville. Mais il y a en Italie une autre sorte de fêtes que je pourrais appeler «fêtes galantes». C'est lorsque quelques personnes riches, ou de qualité, entreprennent à leurs frais et dépens de faire chanter en musique, les premières et secondes vêpres, et la messe en l'honneur de quelque saint ou sainte. Je leur donne le nom de fêtes galantes, non pas tant pour la musica — c'est-à-dire pour ces beaux accords de voix, et concerts d'instruments qu'on y entend — que pour le signore — je veux dire pour les dames qui y sont invitées, ou qui s'y trouvent ordinairement.
Après m'être délassé quelques jours à Rome, je sortis pour voir les curiosités et antiquités de cette grande ville. M'étant trouvé le soir à la Piazza Navona, je passai par devant une fort jolie église que l'on appelle Santa Maria della Pace. Le portal, qui d'ailleurs est d'une superbe structure de marbre blanc, était magnifiquement paré avec de beaux tableaux, et plusieurs figures faites avec de petits voiles de soie, de la façon de Bologne. Cela me donna la curiosité d'y entrer. J'y vis une assez belle compagnie de jeunes messieurs, qui avaient fait faire comme un trône pour eux, dans un endroit de l'église où ils pouvaient voir plus facilement les entrants et les sortants. C'était l'un d'entre eux qui faisait faire cette fête en l'honneur de sainte Agnès. Quoique ce ne fût pas le jour de l'année qui lui est consacré, qui est le 21 janvier, selon le nouveau Calendrier : mais il y avait un autre mystère caché là-dessous que nous découvrirons tout présentement. Ces jeunes seigneurs faisaient faire chacun à leur tour les fêtes de leurs maîtresses. Ils étaient au nombre de huit. Les quatre premiers avaient déjà fait leur tour dans d'autres églises, et c'était celui du cinquième. Il était de la famille de Carpegna, et son amante s'appelait Agnese Victorini. L'église de la Pace est extrêmement bien ornée d'elle-même. Elle est dorée et peinte de tous côtés, comme le sont presque toutes les églises de Rome. Cependant pour en rehausser encore davantage la beauté, et faire quelque chose de particulier au sujet de la fête, on avait fait ériger des arcs triomphaux au milieu de l'église, où l'on voyait toute l'histoire de sainte Agnès représentée, et qui par sa constance triomphait des tourments et des tyrans. Toute cette histoire était représentée au naturel avec de petits voiles de soie. Ces voiles sont de différentes largeurs et il y en de toutes sortes de couleurs. On sait ce que l'on doit payer pour une centaine d'aunes mises en œuvre ; et l'on en prend ce que l'on veut. Il y a des gens à Rome, et par toute l'Italie, que l'on appelle addobbatori, ou orneurs d'église. Ils fournissent eux-mêmes les voiles, et ils sont extrêmement ingénieux et habiles à les ployer en toutes sortes de figures. On avait été trois semaines à dresser l'appareil dont je parle. On avait élevé deux théâtres aux deux côtés du chœur, qui étaient historiés tout au tour avec ces mêmes voiles. L'un était pour la musique des voix, et l'autre pour celle d'instruments ; et chaque chœur était composé de cinquante musiciens. De plus il y avait dans une petite loge, proche de l'autel, quatre musiciens que l'on appelle voix seules, que l'on disait être les quatre meilleurs musiciens qu'il y eût à Rome ; qui devaient chanter l'un après l'autre les motets. Ils ne vont point chanter en aucun endroit, qu'on ne leur donne à chacun au moins quarante écus par motet. Les Italiens aiment par-dessus toute autre nation les concerts ; et ceux d'entre'eux qui ont l'oreille plus délicate, suivent par tout ces excellents musiciens. De sorte qu'il y eut un grand concours à cette église. Lorsque j'entrai, la musique n'était pas encore commencée, et je pris ma place près du trône de ces messieurs. Ils paraissaient être dans quelque sorte d'impatience de faire commencer les vêpres ; car il était près de six heures du soir, et il y avait déjà près d'un quart d'heure que tous les cierges étaient allumés, et tous les musiciens étaient à leurs places. Quelques enfants qui avaient compté les cierges qui brûlaient, disaient qu'il y en avait quatre cent quarante d'une cire extrêmement blanche. Cependant ces messieurs n'osaient pas faire commencer la cérémonie, parce que la belle Agnese pour qui elle se devait faire, n'était pas encore arrivée. Comme ils étaient bien aises de n'être pas entendus, ils se servaient du peu de français qu'ils avaient appris pour parler entre eux. Le principal qui faisait la dépense, pour désennuyer les autres, leur disait que son Agnese ne pouvait pas beaucoup tarder ; qu'il avait envoyé un de ses laquais pour le venir avertir sitôt qu'elle sortirait du logis ; qu'elle savait l'heure, et qu'ayant promis de s'y trouver, elle ne manquerait pas à sa parole. Quelques-uns disaient qu'ils craignaient que la mère, qui était d'une humeur mal aisée et capricieuse, ne l'a retint au logis ; et lui conseillaient d'envoyer un autre laquais, pour dire à la mère que si elle ne laissait venir sa fille, elle s'en repentirait. Lorsqu'ils étaient en consultation sur ce point-là, le premier laquais arriva, qui fit entendre à son maître qu'Agnese était proche de l'église. Incontinent on fit signe aux musiciens de se tenir prêts ; et dans le moment qu'Agnese mit le pied dans l'église, à un autre signe qui leur fut fait, ils entonnèrent la première antienne de vêpres du commun des vierges : Haec est virgo sapiens et una de numero prudentum [Voilà une vierge sage et prudente]. Ces messieurs changèrent alors leurs inquiétudes, en un excès de joie qu'il était facile de lire sur leurs visages. J'entendais qu'ils disaient que les dames prenaient souvent plaisir de se faire attendre par leurs amants, pour rendre ensuite leur venue plus agréable ; et que parce qu'elle les avait fait attendre, ils l'en aimaient davantage.
Je n'aurais pas reconnu cette belle idole parmi la grande quantité de dames qui entraient à tous moments, si le jeune monsieur qui avait préparé tant d'encens pour elle, ne fût allé lui-même pour la recevoir et la conduire à sa place. Elle me paraissait fort modestement habillée, ayant la tête couverte d'une grande écharpe noire qui lui descendait presque jusqu'aux pieds. Elle avait tout le visage caché, comme les dames romaines ont coutume de l'avoir lorsqu'elles paraissent en public. Sa mère la suivait, étant aussi la coutume du pays que les filles vont devant, et les mères après. Il y avait proche du trône de ces messieurs un prie-Dieu préparé pour elle, couvert d'un fort beau tapis de velours bleu avec des franges d'or, et de gros coussins richement brodés, où elle vint se mettre à genoux avec sa mère. Je me trouvai fort proche d'elle, et je remarquai pendant toute la musique, qu'elle avait un très grand soin, sous prétexte d'attacher des épingles à sa tête, de découvrir une partie de son visage en faveur de ces messieurs, qui avaient presque toujours les yeux arrêtés sur elle. Elle leur souriait de côté, et leur faisait des signes des yeux. Elle avait le sein scandaleusement découvert, et comme il n'y avait que son voile de tête qui descendait par-dessus pour le couvrir, elle savait si bien le faire jouer, qu'il aurait fallu être aveugle pour ne le pas tout entrevoir.
Pendant tout ce temps-là, la musique faisait des merveilles, et tous les motets qu'on chantait, quoique tirés la plupart du Cantique des cantiques, avaient plus de rapport à cette jeune demoiselle, qu'à sainte Agnès dont on prétendait célébrer la fête. Je jetai par hasard les yeux sur un tableau de cette sainte, que l'on avait mis sur l'autel où l'on devait dire les messes le lendemain, et je reconnus que c'était le propre visage d'Agnese Victorini, excepté qu'on l'avait environné de rayons à la façon des saintes, et qu'on avait dépeint auprès d'elle un petit agneau, comme on a accoutumé de dépeindre sainte Agnès. Je reconnus par là que ce jeune monsieur n'avait rien oublié pour témoigner sa dévotion à sa dame, et que pour la faire adorer de tout le monde, il l'avait placée sur les autels.
Vers le milieu de vêpres, deux de ces messieurs prirent un grand bassin plein de fleurs, pour aller présenter des bouquets aux dames qui étaient dans l'église. C'était des œillets, des boutons de roses et des fleurs d'orange
mêlés ensemble — car à Rome on peut avoir toutes sortes de fleurs en toutes les saisons de l'année. Ils étaient liés
avec un petit cordon d'or, auquel était pareillement attaché un fort beau nœud de rubans d'environ trois ou quatre aunes. Chaque bouquet pouvait revenir à deux écus. On présenta le premier à la belle Agnese. Je m'aperçus qu'il y avait un petit billet au milieu des fleurs, qu'elle tira tout aussitôt, et le mit dans ses heures pour le lire. Il ne me fut pas possible de savoir ce qu'il contenait ; et quoique je fusse tout proche d'elle, et qu'elle l'ouvrit bien environ vingt fois pendant le service pour le relire, il ne me fut jamais possible d'en déchiffrer que ces deux mots, mia diva [ma déesse]. Sitôt que les bouquets eurent été distribués, on vit voler des hautes galeries de l'église en bas, un très grand nombre de papiers imprimés, que le peuple s'efforçait de ramasser. C'était des sonnets à louange de sainte Agnès, mais qui réfléchissaient assurément davantage sur la dame, que sur la sainte. Car il n'était parlé que de victoires. Ce qui s'accordait parfaitement bien avec le nom de Victorini.
La musique dura près de quatre heures, et il était fort tard lorsque l'on en sortit. Le concert était si charmant, qu'il ne me semblait pas qu'il y eût plus d'une demi-heure que j'étais dans l'église. J'y retournai le lendemain, et j'assistai à tout l'Office qui fut célébré avec toute la pompe et la solennité que l'on aurait pu désirer. On célébra tout le matin un grand nombre de messes, et plusieurs abbés, pour faire honneur au jeune Carpegna et à sa dame, vinrent dire la messe à cet autel, devant la belle image. Au commencement de la grand-messe, on vit voler du haut des galeries, d'autres sonnets ; les uns à la louange de sainte Agnès, et les autres à la louange de ce jeune monsieur qui faisait faire la fête. Les prêtres de cette église qui se trouvaient fort obligés à lui, de ce qu'il avait bien voulu faire choix de leur église pour cette solennité — ce qui leur apporte toujours un profit considérable — avaient fait faire ce sonnet pour exalter sa grande dévotion et son mérite. Il y a des gens en Italie que l'on appelle virtuosi, ou poètes, qui vivent du métier de louer les autres ; c'est-à-dire de faire des sonnets. Ils sont même assez à bon marché ; car quand on leur a donné le sujet, pour un écu on en peut avoir un bien fait, et il ne coûte plus qu'à le faire imprimer.
Il était une heure après midi lorsque l'Office du matin acheva. Les dames se retirèrent à leur logis proche de l'église de la Pace où ils avaient envoyé de bonnes provisions pour un dîner. Les musiciens se retirèrent dans la sacristie, où quelques heures après on leur envoya de grand plats chargés de viandes, du vin de toutes sortes de façons, et des eaux sucrées et rafraîchissantes. Le billet portait que les secondes vêpres devaient commencer à trois heures. Je me rendis à l'église vers ce temps-là : mais l'on ne faisait encore que d'envoyer aux musiciens à manger, et l'Office ne commença qu'à cinq heures. On y observa le même ordre que le soir précédent, si ce n'est ce que les motets et les antiennes étaient changées. Mais on y ajouta une cérémonie pour les dames, qui fut qu'outre les bouquets, on leur présenta avant que de sortir de grands bassins de confitures sèches, dont elles remplirent leurs mouchoirs, et elles s'en retournèrent ainsi chargées de fleurs et de fruits à leurs logis. Le jeune Carpegna tout glorieux d'avoir si bien rempli toutes les parties de la fête, reçut les applaudissements de ses compagnons, et un autre qui était en tour, donna l'assignation pour le dimanche suivant à l'église de Sant'Andrea della Valle, où il faisait préparer toutes choses pour y célébrer une fête de sainte Catherine. J'ai bien voulu, Monsieur, m'étendre à vous décrire toutes les particularités de cette fête. Non pas que ce soit là un fait particulier qui soit rare et extraordinaire. Je vous rapporte seulement celui-ci pour mille que j'ai vus et qu'il serait superflu de vous rapporter ; et il n'y a rien de plus commun en Italie : mais ç'a été pour vous en donner une idée plus distincte lorsque vous entendrez parler de ces fêtes d'Italie. J'ai demeuré sept ans dans ce pays-là, et il ne s'est point passé de semaine que je ne me sois trouvé à quelqu'une ; c'est pourquoi j'en puis parler suffisamment. J'ajouterai seulement à la honte des Catholiques romains que c'est à ces sortes de fêtes-là que la jeunesse se corrompt. Les femmes débauchées ont des gens qui les avertissent des endroits où il y a des fêtes, et elles ne manquent pas de s'y trouver à troupes fort lascivement habillées. Pour ce qui est des autres femmes et filles, comme le seul prétexte qu'elles peuvent avoir pour obliger leurs pères ou leurs maris de les laisser sortir, est celui d'aller à l'église, elles soupirent incessamment après ces sortes de fêtes. C'est là qu'on donne les rendez-vous ; qu'on fait courir secrètement les billets ; qu'on fait l'amour avec les yeux ; et qu'on parle par les gestes : en un mot que l'on conclut tous les marchés infâmes. Je n'avance rien ici que ce que leur proverbe italien porte : Chi manda la sua figliola ad ogni festa, in poco tempo ne fa una puttana — qui veut dire que ceux qui envoient leurs filles à toutes les fêtes, en font en fort peu de temps des putains. Les filles et les femmes se rangent des deux côtés de l'église, et les messieurs se promènent dans le milieu pour les regarder sous le nez. Ils s'entre-poussent entre eux ; ils rient ; ils parlent tout haut, et tiennent des discours indignes de la sainteté du lieu où ils sont. Le Saint Sacrement ou l'Hostie qu'ils croient être le véritable corps vivant de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est la plupart du temps exposé sur le grand autel, ou à quelque chapelle particulière pour rendre la solennité plus grande ; mais ils y ont si peu d'égard, qu'ils lui tournent le dos pour voir les dames ou les musiciens en face. Cela fait bien voir qu'ils n'y croient que fort légèrement. Au moins leurs œuvres démentent ouvertement leur croyance.
Les prêtres trouvent leur profit dans les fêtes, parce qu'on leur paie bien cher les cérémonies qu'ils sont, et leurs messes, et qu'on les traite bien ensuite. Dans les couvents particulièrement, on fait fort souvent des fêtes : car ou ce sont des religieux rentés, comme le sont généralement tous les moines ; ou ils sont partie rentés, et partie ils vivent d'aumônes, comme tous ceux que l'on appelle frères ; ou bien ils vivent entièrement d'aumônes, comme les Capucins et autres mendiants. Tous ces gens-là s'efforcent de faire des fêtes dans leurs églises, mais pour des fins fort différentes. Les moines en font pour faire paraître leurs richesses et leur grandeur. Toute la cérémonie se fait à leurs propres dépens, et ils font ce que l'on appelle un «pontifical», qui est la chose la plus pompeuse et la plus magnifique que l'on puisse voir. Je tâcherai de vous en faire ici la description le plus exactement qu'il me sera possible. Pour cet effet je prendrai un de ceux que j'ai vus dans la célèbre abbaye de San Michele in Bosco à Bologne, où j'ai enseigné pendant deux ans. Ce sont des moines olivétains (1). L'abbé n'est pas commendataire, mais bénit et régulier, et il peut officier pontificalement. Il fit publier son pontifical dans Bologne, trois semaines avant la fête du bienheureux Bernard Tolomei, fondateur de leur Ordre. La fête arrivait à un jeudi : Ainsi l'on commença les premières vêpres le mercredi au soir. L'église est un bijou pour la délicatesse des marbres, des jaspes, et des porphyres qui entrent dans sa structure. Les dorures et les peintures y sont d'un prix inestimable. La voûte est toute dorée, et toutes les murailles de l'église. Le grand autel, et tous les petits autels des chapelles sont de pierres précieuses. Les chaires du chœur sont d'un bois rapporté, où toute la vie de S. Benoît, et plusieurs histoires de la Bible sont représentées. Toutes les balustrades de fer qui ferment le chœur et les chapelles sont toutes dorées et fort délicatement travaillées. Le pavé est de carreaux de marbre blanc et noir : De manière que l'on ne voit pas un seul endroit dans toute l'église qui ait besoin d'un ornement étranger. Cependant l'abbé fit venir des plus habiles orneurs d'église, pour faire des machines avec des voiles de soie de Bologne. On en historia toutes les fenêtres et les murailles de l'église. C'était une dépense tout à fait inutile ; car assurément ce qui était caché par ces voiles, était beaucoup plus beau et plus précieux que les voiles mêmes. Il fit mettre tout autour de l'église des bras d'argent, et des flambeaux de même matière sur toutes les corniches et les cordons de l'église, pour soutenir une infinité de cierges de cire blanche qui devaient brûler pendant tout l'Office. Le grand autel était chargé d'argenterie, qui avait été tirée du trésor de cette abbaye pour la mettre en vue de tout le monde. Vers les trois heures après midi, l'abbé accompagné de tous les moines, ayant à sa suite plusieurs messieurs de ses parents et de ses amis, s'achemina pour aller à l'église. Il était revêtu des habits de son Ordre, et distingué des autres religieux par son anneau, son camail, et son bonnet quarré. Les moines de cette abbaye ont coutume d'entrer à l'église par la porte du cloître qui est proche du chœur : Mais pour faire une plus belle figure, et faire voir leur abbé avec plus de pompe et de majesté, ils sortirent ce jour-là hors du monastère, et firent une promenade dehors, pour ensuite entrer par la grande porte qui est au bas de l'église. Lorsqu'ils entrèrent, les cloches, l'orgue, et les autres instruments musicaux sonnèrent la marche ; et eux ils se donnèrent des airs en marchant, qui découvraient plus la vanité de leurs cœurs, que cette majesté qui convient aux ministres des autels. Étant entrés dans l'église, l'abbé fit faire halte devant la chapelle de Saint-Bernard, qui est au bas de l'église, et s'agenouilla sur des coussins de velours violet richement brodés, posés sur un prie-Dieu couvert d'un grand tapis de même étoffe, bordé de riches franges d'or. Alors les musiciens chantèrent un motet à la louange du saint ; après quoi l'abbé fut conduit à son trône, que l'on avait élevé au côté du grand autel. Il était couvert au-dessus d'un superbe dais, et entouré de plusieurs sièges très richement parés, pour tous les officiers qui devaient servir au pontifical. Y étant arrivé, il s'assit, ayant deux autres abbés de ses amis à ses côtés ; et aussitôt quatorze religieux s'étant revêtus de leurs surplis, allèrent prendre sur des tables préparées proche le grand autel, les ornements qui devaient servir à l'habiller. Ils se rangèrent ensuite les uns après les autres, et formèrent comme une grande queue : le premier portait dans un grand bassin d'argent doré, les bottines abbatiales ; le second dans un autre bassin, les souliers abbatiaux d'un velours violet richement brodés ; un troisième portait l'amict ; le quatrième l'aube, qui était, comme l'amict, d'un toile très fine, bordée tout autour et aux manches d'un très beau point de Venise, d'un pied de largeur ; le cinquième suivait avec un fort riche ceinture de soie blanche extrêmement bien travaillée ; un sixième portait l'étole ; le septième et le huitième chacun une tunique de taffetas blanc ; le neuvième venait avec la chape, qui était comme l'étole d'un drap d'or, et les côtés étaient relevés en broderie avec fort belles figures, composées de semences de perles avec des agraffes d'or ; le dixième portait une petite croix de diamants, estimée deux mille écus ; l'onzième portait dans un grand bassin de vermeil doré les gands abbatiaux ; le douzième l'anneau abbatial, qui était une améthyste d'une extraordinaire grandeur ; le treizième suivait avec le mitre toute semée de perles et de pierres précieuses ; enfin, le quatorzième et le dernier portait la crosse abbatialle ou bâton pastoral. Chacun d'eux s'approchant de l'abbé dans son trône, fléchissait les genoux devant lui, et après avoir délivré ce qu'il portait, entre les mains des abbés assistants qui revêtaient leur prélat ; en lui faisant une autre génuflexion pour l'adorer, ils se retiraient en bel ordre. À chaque ornement qu'on lui mettait, il y avait des oraisons particulières que les abbés assistants récitaient, et que le prélat officiant lisait lui-même dans le livre du pontifical, qui était soutenu par deux religieux, et deux autres revêtus de surplis et de tuniques, tenaient des chandelles de cire pour l'éclairer, tandis que le maître des cérémonies tournait les feuillets. L'abbé étant entièrement revêtu, ayant la mitre en tête, s'assit au milieu des deux abbés assistants, dans son trône ; et aussitôt les officiers qui devaient servir dans la cérémonie, se rangèrent auprès de lui. Ces officiers étaient quatre chantres revêtus d'aubes et de chapes ; quatre sous-chantres, revêtus de surplis, deux diacres revêtus d'étoles et de tuniques, deux sous-diacres revêtus de tuniques, deux céroféraires pour porter les chandeliers, et deux thuriféraires revêtus de surplis, avec leurs encensoirs d'argent pour donner de l'encens ; un autre officier pour soutenir la crosse abbatiale, et le maître des cérémonies avec sa verge. Tous ces officiers ne devaient servir que jusqu'à la moitié de vêpres ; auquel temps, comme s'ils eussent été bien fatigués, d'autres encore plus magnifiquement parés, devaient les venir relever, et servir jusqu'à la fin de l'Office. La musique était fort nombreuse et extrêmement bien choisie. L'abbé entonna le premier verset de vêpres, et elles furent continuées par la musique et par les chantres, avec des cérémonies que je ne m'arrêterai pas ici à vous décrire.
Ce peu suffira pour vous donner une idée de cette grande majesté et pompe extérieure avec lesquelles sont célébrées les fêtes dans les églises d'Italie. Je vous prie même de considérer que le modèle que je vous en ai donné n'est que d'un abbé officiant ; car si c'est quelque évêque, ou archevêque qui officie, c'est quelque chose de bien plus magnifique : et si c'est un cardinal ou le pape qui célèbre, toutes les cérémonies sont portées au plus haut point d'élévation et de grandeur où elles peuvent arriver. Je me souviens d'avoir lu dans un célèbre auteur protestant anglais, les éloges qu'il donne à ceux de la Communion de Rome sur ce point des cérémonies. Il dit qu'en cela ils sont uniquement recommandables, qu'ils n'épargnent rien pour la dépense, et la solennité de leurs fêtes. Pour moi qui me suis assez particulièrement appliqué à rechercher le principe d'où procèdent tant de faux brillants, dont on se sert dans l'Église romaine, pour éblouir les yeux, j'ai reconnu que ce n'était point ce grand zèle pour la maison de Dieu qui en était le motif, mais seulement l'intérêt, la vanité, et l'amour-propre comme je découvris dans cette occasion. L'Office de vêpres finit à six heures du soir, après quoi l'abbé et ses officiers s'étant déshabillés, ils allèrent dans la sacristie, où il y avait de grandes tables dressées, chargées de confitures sèches et liquides, de langues de bœuf, de saucissons de Bologne, et de pâtisserie fine. On fit entrer toutes les dames et les messieurs de qualité qui étaient dans l'église. Comme j'avais un libre accès dans cette abbaye et que j'étais même en quelque façon de la famille, puisque j'y enseignais publiquement les humanités, et avais un honnête entretien et la table de l'abbé, j'entrai aussi dans la sacristie, et eus même le pouvoir d'y faire entrer quelques Français de ma connaissance, qui se trouvent présentement à Londres. Les messieurs et les dames ne manquèrent pas de donner de grands éloges à l'abbé sur sa belle mine dans l'habit pontifical, et sur sa bonne grâce à officier. Les autres moines s'étant accotés des dames qu'ils connaissaient, entrèrent dans des discours dont je ne pus pas être témoin. Je sais seulement que leur beauté les avait si fort charmés que durant un mois après, ils ne pouvaient s'en taire. Ils les avaient si bien étudiées qu'ils savaient rendre compte de toutes les étoffes, rubans, et dentelles qu'elles portaient sur elles. L'abbé s'approcha de deux dames de qualité. C'était une marquise, et une comtesse, et leur demanda si l'envie ne leur était point venue de persuader quelqu'un de leurs enfants de se faire religieux de son Ordre. La marquise lui répondit qu'elle y penserait, et la comtesse témoigna que véritablement elle avait été si extrêmement satisfaite du pontifical ; que cela s'était fait avec tant de pompe et de majesté, qu'elle en était toute ravie, et qu'elle voulait absolument que son fils prit l'habit de l'Ordre. Elle assura l'abbé que les Jésuites faisaient tout leur possible pour l'attirer à eux, mais qu'elle romprait toutes leurs mesures, et qu'elle espérait que son fils se comporterait si bien dans le monastère, qu'elle aurait un jour la consolation de le voir un abbé de l'Ordre et officier pontificalement.
Tous ces bons religieux après les fatigues des cérémonies de l'église prenaient encore celle de servir ces belles dames à table, et de leur tenir compagnie ; plus heureux mille fois en cela que tant d'autres séculiers italiens qui n'ont pas le moyen de faire des fêtes pour voir leurs dames, et qui ne peuvent presque jamais trouver l'occasion de leur rendre de semblables services. Il est vrai que quelques-unes d'entre'elles étaient parentes. Mais toujours c'est une grande satisfaction de trouver l'occasion de les traiter aux dépens de l'abbaye, ce qui ne se peut faire que dans ces sortes de cérémonies : car en tout autre temps, s'ils le veulent faire, il faut qu'il leur en coûte à chacun leur argent. Les dames étaient de si bonne humeur, et si satisfaites, qu'elles ne manquèrent pas de demander à l'abbé quand il ferait un autre pontifical. Il leur promit d'en faire un autre, le jour de sainte Françoise Romaine [9 mars].
Il n'est pas possible, Monsieur, que vous ne remarquiez dans tout ce que je vous ai rapporté touchant la solennité de cette fête, quels pouvaient en avoir été les motifs. L'abbé y trouvait sa gloire à paraître revêtu en pontife, avec tant d'ornements pompeux, parmi tant d'adorations et d'encens qui lui étaient présentés. Il y trouvait aussi son profit. Car il prenait de là occasion de solliciter les personnes de condition, éblouies par cette grande splendeur, de faire prendre à leurs enfants l'habit de son Ordre. Je sais quel avantage il y a pour un abbé, et pour les principaux officiers d'un monastère, lorsque des enfants de qualité prennent l'habit. Ils ne les reçoivent point à la profession que les parents ne leur fassent auparavant des présents fort considérables, outre la pension annuelle qu'ils sont obligés de donner à leur fils : et plus ils sont élevés en dignité, plus les présents qu'ils font sont considérables. Les autres religieux trouvent dans ces fêtes leur satisfaction. Leurs yeux y sont repus par le superbe appareil de leurs églises, et leurs oreilles par la douceur de la musique. Le festin et la conversation des dames n'en sont pas le moindre charme. Enfin il y a bien de l'apparence que l'honneur de Dieu et le zèle de Sa sainte maison ne sont que l'objet le plus éloigné de ces pompeuses solennités. Je vous ai déjà dit dans une de mes Lettres que je craignais de passer dans votre esprit pour un censeur sévère qui se plaît à expliquer dans un sens rigoureux des actions, qui d'ailleurs pourraient recevoir quelque favorable interpretation. C'est pour cela que je fais toujours suivre les raisons qui me portent à faire ces sortes de jugements ; et je ne doute point que si vous les considérez bien vous-même, vous n'y reconnaissez beaucoup de modération dans mes expressions. Pour donc appliquer ceci au présent sujet, je vous dirai que la fête de sainte Françoise Romaine étant proche, auquel jour l'abbé avait promis aux dames un pontifical, on disposa toutes choses avec encore plus de pompe et de splendeur que l'on n'avait fait pour la S. Bernard. On avait fait venir des musiciens de Florence, et de Venise, qui étaient arrivés depuis deux jours au monastère, et que l'on traitait fort splendidement. La veille de la fête, l'abbé et les religieux faisaient des vœux au Ciel pour que temps fût beau ; et parce que l'air était extrêmement clair et serein, il y avait toutes les apparences du monde qu'il continuerait de même : c'est ce qui les remplissait d'une joie inexprimable. Il n'y eut qu'un bon vieux frère convers qui sentant le mal que lui faisaient ses cors au pied, s'obstina à dire qu'il pleuvrait le lendemain. L'abbé sortit lui-même après souper pour astrologuer quel temps il ferait ; et voyant le Ciel si pur et si étoilé, dit qu'il n'y avait rien à craindre, et que le frère était un turba festa — c'est-à-dire un trouble-fête. C'est ce qui fit que les moines se retirèrent ce soir-là fort joyeux. Mais comme ce n'est pas aux hommes de connaître les temps et les saisons que Dieu a seule réservés dans Son pouvoir ; vers le minuit le temps se changea, et le lendemain matin il tomba une si furieuse pluie, qu'il était impossible de mettre le pied dehors dans être tout trompé. L'orage dura jusqu'au soir, et jeta la consternation dans les esprits de ces pauvres religieux. Ils parurent tous pâles le lendemain matin, et firent bien voir qu'une passion traversée est capable de faire grands changements dans le corps humain. Quelques-uns murmuraient ouvertement contre le ciel, de ce qu'il troublait presque tous les ans leur fête de sainte Françoise, et d'autres conservaient encore quelque peu d'espérance que la pluie pourrait cesser dans quelques heures : mais c'était en vain ; le ciel était trop obstiné, et l'orage bien loin de cesser ou de diminuer, s'augmenta de plus en plus. L'abbé voyant qu'il n'y avait point de remède, envoya l'ordre à la sacristie, de resserrer les ornements du pontifical. Il ordonna que la musique se ferait, parce que les musiciens étaient présents, et qu'on les avait déjà la plupart payés. Mais il défendit d'allumer les grandes rangées de cierges qui avaient été disposées autour de l'église, et de brûler les encens qui avaient été préparés pour les autels. Enfin, excepté la musique, l'Office se fit fort simplement et comme à l'accoutumée. L'abbé n'y parut point : et toute cette grande pompe et solennité s'en alla en fumée.
Je vous prie présentement, Monsieur, de tirer vous-même une raisonnable conséquence de tout ce procédé. Croyez-vous en vérité que Dieu, ou la sainte, fut l'objet de tout ce grand appareil ? Dieu est immense et présent en tous lieux, soit qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas ; et la sainte est supposée être au Ciel toujours la même : D'où vient donc que la solennité se change, si ce n'est parce que les messieurs et les dames qui avaient été invités, et pour qui elle se devait faire, ne s'y pouvaient pas trouver ? Sublata causa toillitur effectus [La cause supprimée, l’effet disparaît. Peut-on tirer une conséquence plus juste, et plus propre aussi à fermer la bouche à nos adversaires de la Communion de Rome qui nous objectent leur service divin avec tant de pompe ; et trouvent si fort à redire à la modestie et simplicité du nôtre ? Lorsqu'ils célébrent leurs matines les grandes fêtes pendant la nuit, à peine allument-ils deux cierges sur l'autel — parce que personne n'y vient, disent-ils — et pendant le jour, à cause qu'ils s'y trouve une abondance de monde, ils en allument trois ou quatre cents. Ne peut-on donc pas avec beaucoup de raison, leur reprocher que toutes leurs fêtes et solennités ne sont que pour satisfaire leurs plaisirs, leur vanité, ou leur avarice ? Que Dieu par conséquent les abhorre, bien loin que ce soit une preuve de la vérité de leur religion ? Cependant j'avoue que c'est une grande illusion et une pierre de scandale à bien des gens, qui ne considèrent en fait de religion que ce qui frappe les sens. J'ai connu en Angleterre un Papiste qui s'était rendu Protestant depuis plusieurs années, et il me dit qu'il s'en retournait en Italie pour rentrer dans la Communion romaine. Sa raison était que l'Office divin n'était pas célébré ici avec tant de solennité que dans son pays. Je suis surpris de ce qu'il n'était pas persuadé par la force de son argument à se faire Juif ; car les Juifs ont encore plus de superstitions et de cérémonies que l'Église romaine. Ou plutôt je m'étonne de ce qu'il ne considérait pas que toutes ces cérémonies et simagrées étant des choses arbitraires qui dépendent de la volonté des hommes, si les Protestants voulaient, ils en institueraient encore de plus magnifiques que celles de Rome, et pourraient faire paraître tous les jours leurs évêques aussi pompeusement habillés que le pape l'est le jour de la Saint-Pierre ? Et s'ils n'en font rien, c'est qu'ils sont bien persuadés que ce qui plaît aux yeux des hommes, n'est pas toujours agréable à ceux de Dieu, qui demande la pureté de nos cœurs, et non pas la pompe de nos vêtements, et à qui le serveur de nos oraisons est plus acceptable que tous les encens. Le service qui se fait dans leurs églises n'est pas tout à fait destitué d'ornements : les ministres ont des habits qui les distinguent des autres dans leur ministère, mais sans superstition. On n'attribue à ces habits aucune vertu divine qui rende ceux qui les portent plus saints : au lieu que dans l'Église romaine, si un prêtre célébrait la messe sans ceinture, sans amict, ou sans manipule, et cela volontairement, ils soutiennent qu'il fait un péché mortel.
Je reviens à nos fêtes ; et après vous avoir parlé de celles de nos moines rentés, je passe à celles que font les autres religieux qui sont en partie rentés ou qui ne le sont point du tout, et qui sont connus en Italie sous le nom de frati. Dans mon séjour à Rome, j'allai à la Santa Maria sopra Minerva, qui est un fameux couvent de Dominicains. C'était un samedi, et on y célébrait une fête en l'honneur du Rosaire de la Vierge. J'appris que les principaux de cette confrérie s'assemblaient tous les samedis et faisaient chacun à leur tour la fête du Rosaire. Les Italiens dans ces sortes de choses se piquent extrêmement d'honneur, et n'épargnent rien pour se surmonter les uns les autres en magnificence ; c'est une émulation qui reste entre eux, et que je ne crois pas que l'on doive attribuer si facilement à vertu, puisqu'ils peuvent repaître autant en cela leur vanité, que dans les superbes cavalcades qu'ils font, et dans lesquelles ils tâchent semblablement de se surpasser les uns les autres. Les religieux, ou frati, ont dressé une forme de fêtes à leur avantage. Les moines, comme j'ai déjà dit, les font à leurs dépens et pour leur gloire : mais ceux-ci les font toujours aux dépens d'autrui et pour l'intérêt de la bourse. Les lois qu'ils ont établies sont que celui qui fait célébrer la fête, doit envoyer par avance de l'argent suffisamment pour payer toutes les messes de religieux du couvent ce jour-là. En second lieu il doit faire toute la dépense de la décoration de la chapelle, ou de l'église où se fait la fête. En troisième lieu, il est obligé d'envoyer un dîner splendide à tous ces bons frères. Quelques-uns d'entre eux appellent pour cette raison ces fêtes-là, «des vaches à lait».
Pour ce qui est des frères que l'on appelle mendiants, comme sont les Capucins et quelques autres qui vivent d'aumônes. Comme ils ne peuvent en vertu de leur vœu de pauvreté en commun, recevoir aucun argent pour les messes, il y a cette différence, qu'au lieu de le leur mettre entre les mains, il faut l'envoyer à celui qu'ils appellent leur père temporel. C'est un séculier qui manie leur argent pour eux, et auquel ils en font rendre compte tous les mois jusqu'au dernier denier. Leur patriarche, S. François, ne s'était pas avisé de cette finesse-là, et il n'en fait aucune mention dans sa Règle ; mais ces bons pères sont bien plus raffinés que lui. Ils ne s'appuient pas si fort sur la Providence divine qu'ils ne croient la leur beaucoup plus sûre. Les temps ont changé, disent-ils, et les séculiers ne sont plus si charitables que du temps de S. François. Pour moi j'oserai leur soutenir, que s'ils vivaient avec autant de frugalité que leurs anciens — qui ne sont pourtant pas de grande antiquité — ils trouveraient encore assez de superstitions, de bigots et de bigotes, qui leur fourniraient de quoi suffire à une diète pénitent. Mais qui voudrait prendre plaisir à s'incommoder pour engraisser des fainéants, qui ne font rien que roder par les maisons pour remplir leur ventre, menant une vie scandaleuse comme ils font. Il est vrai que par leur artifice ces gaillards-là ne manquent de rien, et une des meilleures inventions qu'ils aient encore trouvée pour se faire bien traiter, ç'a été leurs fêtes.
Comme une fête régulière — j'entends par là une qui est marquée dans le Calendrier — ne vient qu'une fois l'année, ils ont inventé les confréries, qui sont des pépinières de fêtes pour eux, et qui leur en produisent plusieurs toutes les semaines. Une confrérie selon la définition qu'ils en donnent, est une association de plusieurs personnes qui s'unissent ensemble pour rendre dans de certains temps réglés un culte religieux à Dieu, à la Vierge ou à quelque saint d'une manière qui n'est pas connue à tous. Mais dans le fonds c'est l'art le plus sûr et le plus fin dans l'Église romaine pour attraper de l'argent. C'est toujours quelque bon père raffiné dans le métier d'attirer les gens, qui en est le directeur. Il faut s'adresser à lui pour y être admis, et pour se faire écrire dans le livre ; en entrant, il en coûte pour le moins un écu, et tous les ans à ce jour-là, il faut venir se faire renouveler dans le livre, et payer de nouveau : autrement l'on vous efface ignominieusement, et l'on appelle cela chasser de la confrérie — c'est-à-dire qu'il n'y a plus là de prières pour vous, et que vous n'êtes plus participant aux indulgences. De plus il faut payer tous les mois quelque argent pour ce qu'ils appellent le luminaire de la chapelle où est érigée la confrérie. Dans la grande quantité de ceux qui s'y enrôlent cela produit une prodigieuse somme d'argent. Les moindre confréries sont de trois ou quatre cents personnes. Il y en a de mille, de deux ou trois mille. J'en ai vu plus de vingt mille sur le livre de la Confrérie du Scapulaire des Carmes de Milan ; et dans celui de la grande Confrérie du Rosaire de S. Jean, et Paolo de Venise, on m'a assuré qu'il y a plus de quarante mille confrères. Quand chacun ne donnerait par mois qu'un sol pour le luminaire, il est impossible de brûler de la cire pour tout cet argent-là, et tout cela va au profit des frati. Ils sont continuellement autour des plus riches de leurs confréries, pour leur persuader de faire des fêtes du saint ou de la sainte, en l'honneur de qui l'agrégation a été faite. J'étais un jour en la compagnie d'un comte italien qui était de la Confrérie du petit Scapulaire de la Vierge, érigée dans le grand couvent des Carmes à Rome. Le père directeur de la confrérie s'approcha de lui, et lui dit en riant : Comte Giovanni, j'ai de grandes plaintes à vous faire de la part d'une de vos bonnes amies. Le comte croyant que ce fût d'une de ses maîtresses, lui demanda de qui ? Le directeur lui dit, que c'était de la part de la Sainte Vierge, et qu'il ne devait point douter qu'elle ne fût fort en colère contre lui, de ce qu'il y avait si longtemps qu'il n'avait point fait faire la fête du Saint Scapulaire. Le comte s'excusa sur quelques affaires qui lui étaient survenues, et pria le directeur de lui envoyer la semaine suivante la liste de ses religieux. Le comte me dit ensuite, que c'était autant que s'il lui avait dit qu'il ferait faire la fête du Scapulaire la semaine suivante ; parce que l'on a coutume dans de semblables occasions, d'envoyer au convent autant de couples de chapons et de bouteilles de vin qu'il y a de religieux, outre l'argent pour payer les messes. Et ainsi en lui demandant cette liste, cela en voulait dire assez. Aussi le père s'en alla-t-il fort content, disant qu'il trouverait bien les moyens d'apaiser la bonne amie. Le comte me dit après, que cette fête-là lui coûterait beaucoup ; parce que le billet que le directeur de la confrérie envoyait, montait ordinairement bien haut, tant pour le luminaire, que pour les musiciens et les orneurs d'église.
Pour donner plus d'occasion à ces fêtes, ils ont déterminé un jour dans la semaine pour assembler leurs confréries : celle du Rosaire se fait tous les samedis ; celle du petit Scapulaire ordinairement les jeudis ; celle du S. Sacrement aussi les jeudis ; celle du Cordon de S. François les vendredis ; celle de l'Annonciade les mercredis ; celle de S. Antoine les mardis ; et enfin, les lundis sont particulièrement destinés pour les confréries des âmes du Purgatoire. De sorte qu'en voilà pour tous les jours de la semaine ; sans conter beaucoup d'autres particulières dont je ne sais pas moi-même le nombre. Celles-ci n'étant que les plus générales. Or, les religieux directeurs de ces confréries s'efforcent de tout leur pouvoir, de faire célébrer aux dépens des séculiers chacun de ces jours-là de la semaine, avec autant de pompe et de solennité que les fêtes annuelles et principales des mêmes confréries, qui n'arrivent qu'une fois tous les ans, aux jours que les papes les ont confirmées. Elles ne se trouvent pas toutes dans une même église, ni dans un même Ordre. Car le Rosaire appartient aux Dominicains ; le petit Scapulaire, aux Carmes ; le Cordon de S. François, aux Franciscains ; l'Annonciade, aux Soccolans ; S. Antoine de Padoue généralement à tous les religieux qui vivent sous la Règle de S. François ; et les âmes de Purgatoire non seulement à tous les ordres religieux, mais aussi à toutes les paroisses et églises gouvernées par les prêtres séculiers.
Il faut avouer que les gens de la Communion de Rome aiment bien leur aveuglement, de ne vouloir pas ouvrir les yeux pour voir comme ces gens les trompent. Car qui a-t-il de plus ridicule que toutes ces sortes de confréries-là ? Parce que S. François portait une ceinture de corde, ils ont érigé une confrérie en l'honneur de cette corde. Chaque confrère pour cet effet porte une petite corde sur soi. Ces petites cordes ou cordons ne sont pas semblables à celle que portait S. François, que j'ai vue à Assise, et qui est comme une grosse corde de puits : mais ils sont délicatement travaillés, et noués fort artificiellement, en différents endroits. On les bénit publiquement avec beaucoup de cérémonie et d'oraisons. Après quoi, ils ont la vertu, disent-ils, d'effacer les péchés véniels, de chasser les diables et les tentations fâcheuses de la chair.
La plupart des dames en Italie portent le cordon de S. François. Elles en font un tour autour de leur corps, et les bouts pendent jusqu'au bas de leurs jupes. Ils sont tous pleins de jolis petits nœuds, et elles s'en servent de contenance et pour badiner, comme les demoiselles anglaises font avec leur éventail, ou avec leur masque. S'il était vrai que ces cordons eussent la vertu de réprimer les tentations de la chair, les dames italiennes qui en portent de si beaux, devraient être les plus chastes de l'univers. Cependant je suis sûr que ce n'est pas là la louange qu'on leur donne. Ce cordon néanmoins est quelque chose de si saint, que l'on en fait de grandes fêtes dans les églises des Franciscains toutes les semaines. Les papes ont donné de grandes indulgences à tous ceux qui s'enrôleront dans cette confrérie du Cordon. Il n'y a que les Protestants qui ne jouissent point de tous ces beaux avantages-là, parce qu'ils trouvent que ce sont des folies. Et en effet je crois qu'ils ont fort bonne raison de le croire, et que le plus sûr est de croire avec eux, que la seule chose qui nous peut faire résister aux tentations et éviter les péchés, c'est la grâce de Dieu, et que c'est par elle seule que nous resterons victorieux du Démon, de la chair, et du monde, sans avoir recours à des cordes et à des cordons.
La Confrérie du Rosaire n'est pas moins superstitieusement établie. Depuis que le salut de l'Ange Gabriel à la Vierge a passé dans l'Église de Rome pour la plus sainte prière qu'on lui puisse faire, les Pères dominicains qui prétendent être les plus grands favoris de la Vierge, pour avoir quelque dévotion particulière qui les distingue du commun, ont inventé ce que l'on appelle aujourd'hui le rosaire, qui n'est qu'un agrégat d'Ave Maria. Il y en a dix dizaines ; et au bout de chaque, ils y ajoutent l'oraison dominicale ou Pater. Pour réciter le nombre juste — car si l'omettait seulement un Ave Maria on perdrait toute l'indulgence — ils ont mis en usages les patenôtres, en anglais rosary beads, sur lesquelles ils comptent les prières qu'ils récitent.
Comme l'on croit dans l'Église romaine que les éléments, et choses matérielles dans les sacrements, sont non seulement des signes, mais des causes physiques instrumentaires, qui produisent la grâce dans les âmes : car ils disent que l'eau dans le baptême, l'huile dans l'extrême-onction, et la matière présentée dans les ordres produisent physiquement la grâce dans les âmes ; aussi c'est à ces sortes de beads, de bois, de verre, ou de quelle matière qu'ils puissent être, que les papes ont attaché les grâces et les privilèges du rosaire. De sorte qu'une personne qui réciterait les prières ordonnées et établies pour le rosaire, et n'aurait pas ces patenôtres, quand bien même il les compterait sur ses boutons ou sur ses doigts, il ne gagnerait pas pour cela l'indulgence. Il faut que les patenôtres s'y trouvent, lesquelles comme causes instrumentales produisent la grâce dans les âmes.
Presque tous les Italiens ont toujours un chapelet sur eux, dans leur poche, ou à leur col entre leur pourpoint et leur chemise. Les dames le portent au bras. C'est aujourd'hui un ornement pour elles, comme le sont les colliers et les bracelets de perles et de diamants. Elles vont bien quelquefois sans éventail et sans masque, mais jamais sans chapelet. Les plus communs pour les femmes de basse condition, sont de corail ou d'ambre : mais les dames de qualité en ont de pierres précieuses, ou de pâtes odoriférantes, ornés avec de beaux rubans, et garnis de plusieurs belles médailles d'or et d'argent. Les femmes les plus débauchées auraient honte de sortir sans avoir leurs grands chapelets à leurs bras, qui leur pendent jusqu'aux pieds. Ce n'est pas qu'elles aient grande dévotion à le dire, mais c'est que c'est une contenance dont elle ne sauraient se passer, et elles ne font point de difficulté de demander à leurs amants un chapelet pour le prix de leur commerce infâme. Le petit scapulaire ou habit de la Vierge, est une pièce de même valeur, et appartient aux Carmes, puisque c'est leur propre habit auquel ils font rendre tant de respects et d'adorations. Ces pères originairement étaient des ermites qui se retirèrent sur le mont Carmel. Ils prétendent que la Sainte Vierge leur apparut, et leur donna la forme de l'habit qu'ils devaient porter, qui est une veste et un scapulaire de couleur brune, et une chape blanche, et qu'elle leur dit que tous ceux ou celles qui porteraient cet habit, seraient bénits d'elle, et de son fils Jésus-Christ, et ne mourraient jamais en péché mortel.
Comme il n'était pas possible de persuader tout le monde de se faire Carme pour en porter l'habit, ils ont trouvé le moyen de couper leurs vieux habits en petits morceaux carrés de la grandeur de quatre ou cinq doigts, qu'ils donnent aux séculiers pour porter sur eux. Ils ont des gens qui les vendent à la porte de leurs églises quatre ou cinq sols la pièce. C'est la meilleure invention qu'ils pussent trouver pour se défaire de leurs vieux habits à grand prix, et être toujours bien habillés comme ils le sont. Car je n'ai guère vu de Carmes qui n'aient toujours de fort bons habits neufs. Il est vrai qu'il s'en vend de fort jolis, travaillés en soie, et richement brodés d'or et d'argent pour ceux qui non contents de ces dévotions folles, veulent encore qu'elles soient accompagnées de beaucoup de vanité. Mais toujours le fonds doit être une pièce de ces vieux habits des Carmes. Ils ont érigé des confréries en l'honneur de ce saint habit. Ils en font de grandes fêtes toutes les semaines avec de belles musiques, et ils ont des messes particulières pour cet habit.
Pour ce petit scapulaire, aussi bien que pour le rosaire, le cordon, les patenôtres bénites et les médailles de Notre-Dame de Lorette, c'est la même chanson. Il remet les péchés véniels. Il fait qu'on ne peut mourir en péché mortel, et qu'on ne reste que fort peu de temps ou point du tout dans les flammes du Purgatoire. Je vous prie de vous représenter un pauvre Catholique romain avec ce beau harnais-là autour de lui ; ayant un de ces petits scapulaires sur le dos, un cordon de S. François autour de sa ceinture, un rosaire ou grand chapelet dans sa main, quantité de médailles, de pâtes bénites, d'images, de petites oraisons écrites, et d'os de saints à son col, sur son estomac ou dans ses poches ; se tenant sûr que par le moyen de tout cela, il évitera non seulement l'Enfer, mais encore son prétendu Purgatoire. Ne pourrait-on pas écrire au-dessus de lui en gros caractère, ERRO & SUPERSTITIO ? Figurez-vous d'un autre côté un bon Protestant qui négligeant toutes ces choses-là, s'applique entièrement à bien vivre, et met toute son espérance en Dieu seul et aux mérites de son Seigneur Jésus-Christ ; et puis dites-moi franchement et sans biaiser celui que votre esprit vous dicte, qui a le plus de raison et qui est le mieux fondé ?
Cependant cette erreur et superstition, est si fort enracinée dans l'esprit des Papistes, qu'il n'y a presque pas moyen de les désabuser, tant leurs moines et leurs prêtres les ont bien enchantés. J'ai connu en Allemagne un capitaine allemand qui ne croyait pas beaucoup à toutes ces confréries et dévotions-là. J'étais en pension chez lui à Mayence. Toutes les fois qu'on en parlait il découvrait l'aversion qu'il en avait, et disait avec beaucoup de raison que ce n'était là que des adresses des prêtres et des moines, pour attraper de l'argent, et qu'il croyait que Dieu les en châtierait bien rigoureusement dans l'autre monde, aussi bien que ceux qui se laissaient abuser par ces folies-là. Ce capitaine tomba malade d'une maladie étique. Environ trois ou quatre heures avant qu'il mourît, je me trouvai dans sa chambre ; et comme il avait le sens et la parole toujours libre, il discourait lui-même des choses de la vie éternelle, et exhortait comme un bon père ses enfants qui étaient autour de son lit, à une vie honnête et véritablement chrétienne. Sur ces entrefaites, un père dominicain introduit par la dame du logis entra dans la chambre — c'était le directeur de la Confrérie du Rosaire avec un grand chapelet — il s'approcha du lit du moribond et l'exhorta à se faire enrôler dans la confrérie. Le malade le pria de ne point interrompre l'exhortation qu'il faisait à ses enfants, qui pourrait être plus profitable que son rosaire, les paroles d'un père mourant à ses enfants leur restant ordinairement imprimées dans l'esprit tout le reste de leur vie. Le Dominicain s'obstina à poursuivre son entreprise, et il lui répétait sans cesse que s'il mourait sans se faire écrire dans la confrérie, il resterait longtemps en Purgatoire ; que là il aurait le temps de s'en repentir tout au long. Le malade lui dit si vous croyez que ce soit une si bonne chose pour mon âme, que ne m'y écrivez-vous donc ? Le père n'étant pas encore content de cela, poursuivit toujours à l'épouvanter. De sorte que le patient effrayé par les paroles terribles de ce père, cria à sa femme : Qu'on lui donne un écu et qu'il m'écrive. Alors le père lui ayant donné le chapelet, se retira, et dit à la dame en sortant, que s'il n'était point venu, son mari serait mort comme un chien. On ne revit plus le père depuis, et ce pauvre monsieur mourut trois ou quatre heures après, avec son grand chapelet au col. Pour moi je me serais extrêmement étonné, de voir qu'un homme qui avait témoigné toute sa vie tant d'aversion pour ces sortes de superstitions, y eût lui-même ensuite succombé un moment avant sa mort : Je m'en serais, dis-je, étonné, si je n'avais entendu l'effroyable discours que lui fit ce Dominicain ; qui prenait occasion de la faiblesse de sa maladie, pour lui imprimer dans l'esprit des frayeurs paniques ; car il disait des choses si épouvantables, qu'à l'entendre parler, si cet honnête homme-là n'eût donné son consentement pour être écrit dans la confrérie, et un écu au bout, c'était fait de lui, et il aurait été damné à tous les diables.
Voilà, Monsieur, l'usage, qui se fait des confréries, et où se terminent toutes ces dévotions affectées des Papistes. Cette manière est si ample, et je sais tant d'histoires sur ce sujet, que je ne finirais jamais si je voulais les raconter ; et je suis obligé pour ne pas trop grossir cette Lettre de les passer sous silence. Néanmoins je ne puis pas m'exempter avec raison, de vous dire un mot de la principale, qui est celles des âmes du Purgatoire. C'est la plus générale, parce qu'elle appartient à toutes les églises, et à tous les prêtres tant séculiers que réguliers. C'est là leur bonne mère nourricière. Car en Italie ce sont les morts qui font vivre les vivants. Les prêtres et les moines y sont comme des corbeaux qui s'engraissent de charognes mortes ; et c'est peut-être aussi ce qui leur inspiré cet esprit si cruel et si barbare qui leur fait souhaiter la mort de tout le monde. Je ne m'arrêterai pas ici à combattre la fausse opinion du Purgatoire ; c'est un point de doctrine qui n'entre point dans mon sujet : mais seulement je vous parlerai de l'usage qui s'en fait dans l'Église de Rome, et comme les prêtres et les moines l'ont entièrement tourné à leur profit.
J'avoue qu'une personne qui est persuadée qu'il y a un Purgatoire aussi terrible que les Catholiques romains nous le représentent, croit avoir un grand intérêt d'y penser, et dans cette persuasion-là je ne trouve point à redire qu'un Papiste réserve dans son testament quelque partie considérable de son bien pour faire dire des prières et des messes pour le soulagement de son âme après sa mort, et donne même quelque chose par charité pour en faire dire pour les autres ; mais lors qu'il y a de l'indiscrétion et de l'excès, et que cela se fait au grand préjudice du prochain, c'est
ce que je ne saurais approuver. C'est en cela que je me trouverai contredit par tout ce qu'il y a d'ecclésiastiques
dans la Communion de Rome ; car ils soutiennent que dans ce point-là, il ne peut y avoir ni indiscrétion, ni excès, ni préjudice ou dommage fait à qui que ce soit, appuyés sur ce principe — qu'ils entendent pourtant fort mal — que charité bien ordonnée commence par soi-même, Charitas bene ordinata incipia se ipsa. De sorte que selon eux, un père qui sans autre sujet déshéritait tous ses enfants pour donner tout son bien aux prêtres, pour faire prier Dieu pour son âme
après sa mort, ne leur fait point de tort, et ils le feraient passer pour un homme qui n'aurait point consulté la chair ni le sang, lorsqu'il s'agissait de penser au bien de son âme. Je vous rapporterai sur ce sujet une histoire dont le souvenir m'afflige encore, parce que c'est la ruine de quelque personnes que je connaissais particulièrement.
Dans un second voyage que je fis à Rome, je pris mon logis chez une fort honnête veuve qui était bien à son aise, et à qui son mari avait laissé beaucoup de bien. Comme elle n'avait point d'enfants, elle avait retiré chez elle deux de ses sœurs, et elle les entretenait fort charitablement de tout. Les Pères jésuites qui savent beaucoup mieux combien il y a de veuves à Rome, que de chapitres dans la Bible, avaient mis celle-ci sur leur rôle, et lui faisaient fort la cour pour avoir son bien. Son confesseur qui peut-être souhaitait de la faire aller bientôt dans l'autre monde, lui ordonna dans les plus grandes chaleurs de l'été de faire le voyage de Lorette. Elle s'en acquitta et retourna fort malade à Rome, où les médecins désespérèrent de sa santé. Elle fit son testament, par lequel elle léguait tout son bien à ses deux sœurs à la réserve de deux cents livres qu'elle assignait pour faire dire des messes pour elle après sa mort. Les
Pères jésuites en eurent connaissance, et ne manquèrent pas de se rendre sur l'heure auprès de leur dévote. Ils
n'oublièrent rien pour tâcher de la persuader à changer son testament. Ils lui représentèrent que c'était la plus grande folie du monde que de donner à des parents, qui ordinairement étaient des ingrats ; qu'elle devait ronger uniquement à se procurer à elle-même du bien dans l'autre monde ; qu'elle pouvait s'assurer que ses sœurs ne donneraient jamais un sol pour faire prier Dieu pour elle ; et que bien loin de cela, ils avaient découvert qu'elles lui portaient une haine secrète et mortelle, et que — par un trait d'une vengeance italienne — elles seraient bien aises de la laisser longtemps en Purgatoire. Enfin ils ajoutaient que ces filles-là avaient l'esprit trop mondain, et seraient apparemment un fort mauvais usage du bien qu'elle leur laisserait ; et que de leur laisser de l'argent c'était mettre un couteau entre les mains d'un enfant ou d'un fou qui pourraient s'en blesser. De même, disaient-ils, elle donnerait à ses sœurs les moyens d'offenser Dieu et de se damner, et elle en serait responsable devant lui ; que ses sœurs savaient travailler et pourraient ainsi gagner honnêtement leur vie du travail de leurs mains, ce qui leur ferait
en même temps éviter l'oisiveté, mère de tous vices. Toutes ces belles raisons étant déduites avec beaucoup
d'artifice et de rhétorique, persuadèrent la pauvre dame, qu'une fièvre violente et les douleurs de la mort rendaient encore plus appréhensive des peines du prétendu Purgatoire. Elle révoqua son testament, et n'en faisant qu'un article, elle donna tout à la maison professe des Pères jésuites de Rome, afin que ces pères fissent prier Dieu pour elle. La dame mourut au milieu de quatre Jésuites. À peine lui eurent-ils fermé les yeux qu'ils chassèrent les deux sœurs du
logis, et s'emparèrent de tout ce qu'elle avait. Ces pauvres demoiselles les larmes aux yeux, demandèrent qu'on leur donnât au moins quelques hardes de leur sœur, qui pouvaient être quelques coiffes ou quelques dentelles. Les Jésuites les leur refusèrent, disant qu'ils ne pouvaient pas disposer de la moindre petite chose ; que tout devait être converti en argent pour faire prier Dieu pour l'âme de leur sœur qui était présentement dans les feux du Purgatoire, et qu'ainsi ils ne pouvaient pas en conscience la priver du moindre des rafraîchissements qu'elle avait si sagement ordonnés pour elle-même. Ces deux pauvres filles se retirèrent fort affligées, et j'ai appris depuis que l'une morte à l'hôpital, et l'autre pressée par la nécessité s'était laissée débaucher, et menait présentement une vie scandaleuse à Rome. Ne voilà-t-il pas un bel usage de la doctrine du Purgatoire dans ces misérables Jésuites. Je ne m'arrêterai pas à en représenter la difformité. Ce fait-là découvre suffisamment par le seul récit qu'on en fait.
Pour faire mieux valoir cette fausse dévotion, et fournit toutes sortes de moyens pour la multiplier, ils enseignent en Italie, que non seulement les âmes du Purgatoire sont aidées par les prières et par les messes des prêtres, mais encore ils disent, que par ce même moyen elles deviennent aidantes. Elles aident les hommes sur la Terre dans tous les besoins. Si l'on a quelque procès, ou quelque mauvaise affaire, ou que l'on prétende arriver à quelque charge ou dignité, le plus sûr moyen pour cela, disent-ils, est d'avoir recours à ces âmes souffrantes, et de leur faire dire des messes. Alors par reconnaissance elles aplanissent toutes les difficultés, elles disposent l'esprit des juges, et font gagner l'amitié des Grands. Si quelqu'un va en voyage, il n'y rien de plus commun en Italie que de lui dire : Allez, que la Sainte Vierge, S. Antoine de Padoue, et les âmes du Purgatoire vous accompagnent partout, et vous délivrent de tous dangers. Jusqu'aux petits écoliers qui vont en classe aux Jésuites, on leur enseigne que pour se lever le matin à l'heure, il faut qu'ils se recommandent le soir aux âmes du Purgatoire. Cependant quelle apparence y a-t-il que ces pauvres âmes qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes puissent aider les autres ? J'ai vu des femmes débauchées venir effrontément dans les sacristies demander qu'on leur dise des messes pour les âmes du Purgatoire, pour recouvrer la grâce de leurs amants, et pour avoir plus de pratique. Elles ne sont pas mieux instruites que cela : Le pouvoir des âmes du Purgatoire est estimé si étendu et si général, qu'elles croient même pouvoir obtenir de Dieu, par leur moyen, des choses illicites. Si l'on demande qui entretient cette ignorance-là ; ce sont les prêtres et les moines, et le motif pour lequel ils le font n'est autre que leur intérêt. Ils s'accordent tous parfaitement bien dans la doctrine du Purgatoire, mais dans le partage de l'argent destiné pour les prières, ils sont tout les uns contre les autres. C'est à qui attraper de son côté.
Un noble Vénitien racontait un jour dans une compagnie où j'étais le divertissement qu'il avait pris sur ce sujet. Il avait été nommé exécuteur d'un testament et fait tuteur d'un pupille. La dame qui était morte avait laissé de l'argent pour faire dire deux mille messes pour elle. Les religieux et les prêtres ne manquent pas de savoir par le moyen de leurs émissaires lorsqu'une personne de qualité meurt, afin de se prévenir les uns les autres s'ils peuvent, et se faire donner les messes. Les Jésuites comme les plus habiles vinrent les premiers se présenter au noble Vénitien : et comme ils ont coutume de faire, ils se mirent sur leurs propres louanges, et dirent qu'il n'y avait point de religieux dans l'Église de Dieu, qui célébrassent les messes avec plus de modestie et de dévotion qu'eux ; et que le grand zèle qu'ils portaient pour la prompte délivrance de l'âme de la défunte, les portait à lui venir demander d'acquitter les deux mille messes laissées par son testament. Ils dirent que c'était une honte de voir comme les autres religieux et prêtres séculiers depêchaient les messes, avec tant de précipitation, qu'une messe ne durait pas plus d'un demi-quart heure ; et que sans doute Dieu en était plus déshonoré qu'honoré. Le noble Vénitien leur dit qu'il était bien aisé de voir le grand zèle qu'ils avaient pour l'âme de sa parente, quoi qu'il ne fût pas si fort persuadé de l'indévotion des autres ecclésiastiques qu'ils le lui voulaient donner à entendre ; qu'ils pouvaient dire des messes pour la défunte ; et que bien qu'il sût qu'il n'était pas permis aux séculiers selon leurs constitutions de recevoir le moindre argent pour les messes, cependant pour ne les pas entièrement refuser, il leur donnerait de l'argent pour en dire cinquante. Les Jésuites fort fâchés de n'avoir pas attrapé les deux mille se retirèrent. Les sacristains des Pères dominicains furent introduits ensuite. Ils représentèrent qu'ils avaient dans leurs églises de San Pietro di Castello et de SS. Giovanni et Paolo plusierus autels privilégiés — ce sont des autels auxquels les papes ont attaché tant d'indulgences, que lorsqu'on y dit seulement une messe pour une âme du Purgatoire, ils croient qu'elle est infailliblement délivrée. Ils représentèrent de plus que tous les autres religieux ne faisaient point de difficulté de faire chanter une grande messe qu'ils faisaient valoir pour cent messes basses ; mais que pour eux ils promettaient de les dire toutes, et que de plus pour obliger davantage la défunte, ils en feraient dire plusieurs sur le grand autel privilégié de leur chapelle de Santo Rosario. Le noble Vénitien sans beaucoup s'arrêter à tout ce qu'ils disaient, ne les traita pas mieux que les Jésuites. Il leur accorda quelques messes, et les renvoya. Un très grand nombre de sacristains d'autres maisons religieuses suivirent les uns après les autres, tous pour demander les deux mille messes. À les entendre tous parler ils étaient tous plus saints que les autres. Tous les autres, selon eux, étaient gens sans conscience, qui mangeaient l'argent des messes sans satisfaire aux obligations. Le Vénitien leur donna à tous néanmoins un fort bon nombre des messes. Il en restait encore cinq cents. Il envoya sur le soir un de ses valets à la Piazza San Marco, pour avertir les prêtres séculiers — qui s'y promènent ordinairement pour s'informer où ils pourront trouver de l'argent pour leurs messes — que le lendemain matin son maître se trouverait à la place pour distribuer des messes. Il ne manque pas d'y aller avec 500 billets — car c'est la manière de donner les messes en Italie ; on donne un billet, ensuite de quoi il faut aller dire la messe, s'écrire sur le livre de la sacristie, et reporter ensuite le même billet à celui qui l'a donné pour recevoir l'argent. Il monta aux Procuraties de San Marco, qui sont des bâtiments qui entourent cette Piazza, et là il prit plaisir de leur jeter les billets du haut des fenêtres en bas. Il y avait bien les trois ou quatre cents prêtres qui attendaient. Sitôt qu'ils virent voler les billets, ils se mirent en devoir d'en attraper chacun le plus qu'il pourrait. Ils s'entre-poussaient, ils s'entre-jetaient dans la boue. Ils se battaient, s'arrachaient les cheveux, se déchiraient leurs rabats et leurs soutanes, pendant qu'une foule de peuple les regardait faire et riait.
L'on ne saurait mieux se figurer toute cette action, qu'en se représentant une populace, ou plutôt une canaille à qui on jette quelques pièces de monnaie des fenêtres, comme j'ai vu ici que quelques personnes de qualité faisaient au jour de couronnement de leurs Majestés le roi Guillaume et la reine Marie (2). C'était là justement ce qui se passait parmi ces bons prêtres de l'Église romaine. Comme plusieurs d'entre eux avaient laissé tomber leurs manteaux et leurs chapeaux dans la foule, quelques autres plus adroits et qui aimaient mieux avoir un chapeau ou un manteau qu'un billet, les ramassaient, et se les étant mis par dessus les leurs, s'en allaient avec deux manteaux. Les billets ayant été ainsi distribués ou plutôt le sort et la fortune les ayant partagés, ces prêtres s'en allèrent chacun de leur côté dire leurs messes.
Vous trouverez peut-être étrange, Monsieur, le récit que nous fit ce noble Vénitien ; cependant vous ne devez point faire de difficulté de le croire dans toutes ses parties. Les prêtres et les moines ne sont qu'un lorsque l'intérêt commun les unit ensemble, et ils sont tous les uns contre les autres lorsque le moindre intérêt particulier les partage.
Pour ce qui est de ces prêtres qui se battaient dans la place pour attraper des billets, ce n'est pas une chose nouvelle en Italie, je l'ai vu de mes propres yeux plus de cent fois. Ils font bien plus, car dans les sacristies étant revêtus des ornements sacerdotaux ils se battent quelquefois pour aller dire la messe les uns devant les autres, et se disent des injures atroces. Les Italiens les excusent en cela, même avec beaucoup de bonté ou plutôt avec trop d'indulgence. Que voulez-vous, disent-ils, ce sont de pauvres prêtres qui vivent de leurs messes et qui n'ont rien autre chose. Quand cela leur manque tout leur manque, ils font donc bien de s'efforcer de les avoir. Cependant je m'étonné que les évêques n'y mettent pas ordre, et de ce qu'ils ordonnent tant de prêtres dans les pourvoir de bénéfices. Il n'y a rien de plus scandaleux dans un clergé que de voir ceux qui en sont membres, être obligés par nécessité de substituer de faire des actions basses et indigne de leur caractère. Ce déshonneur doit rejaillir avec beaucoup de raison sur les chefs ; et il met évidement au jour ou leur négligence à y remédier, ou leur peu de charité à en vouloir procurer les moyens.
La plupart de ces pauvres prêtres en Italie ne vivent que de leurs messes, ou de vol, quand la messe leur manque. Ils dérobent tout ce qu'ils peuvent dans les églises mêmes, les calices, les nappes d'autel, les cierges, les livres et tout ce qui leur vient sous les mains. C'est pourquoi on peut bien croire ce que disait ce noble Vénitien, que quelques-uns dans la foule avaient dérobé des manteaux. Une autre chose qui est mentionnée dans son discours, et sur quoi je vous prie de faire quelque réflexion, c'est sur la division de ces religieux qui allaient demander les messes. Ils s'entre-accusaient les uns les autres de mauvaise conscience et de mauvaise foi à s'acquitter des messes dont ils avaient reçu l'argent. Ce que le Dominicain disait du Cordelier, le Cordelier le disait du Dominicain, et ainsi des autres, et en cela ils disaient tous la vérité.
C'est une chose de pratique en Italie que si l'on envoie de l'argent à un couvent pour faire dire une centaine de messes, ils n'en font chanter qu'une avec diacre et sous-diacre. C'est le prieur or gardien du couvent qui la chante. On appelle cela une messe chantée, une grand-messe, une messe solennelle ; et ils soutiennent qu'une de ces messes-là vaut autant que plusieurs basses. Ils appellent cela faire une «réduction». Mais je vous prie, Monsieur, que peut contribuer ce chant et ces cérémonies à rendre une messe autant efficace que cent ? Je sais qu'un Protestant peut donner la solution de ceci, en disant qu'une messe est autant que cent, et cent ne sont pas plus qu'une, parce que toutes ne valent rien. Mais vous qui êtes un Catholique romain, qu'avez-vous à répondre ? Si vous avez quelque peu de bonne foi, il faut avouer que vos prêtres et vos moines ne sont pas seulement contents pour satisfaire leur avarice de se servir de la doctrine du Purgatoire pour porter les séculiers à donner leur argent pour faire célébrer des messes, mais qu'ils veulent encore s'exempter par cet artifice de la réduction, de la peine de les dire. Le défunt pape Innocent XI [mort le 12 août 1689] n'était pas favorable à la réduction ; car ayant su que les Pères carmélites de Naples avaient fait célébrer une messe en musique, pour s'acquitter de toutes les messes dont ils étaient redevables, il envoya une commission pour examiner les registres et livres de la sacristie. On y trouva quarante mille messes qui n'étaient point acquittées. Innocent en ayant eu la connaissance, ne crut pas qu'un si grand nombre de messes pût être satisfait par une seule, tant solennelle qu'elle pût être. Il leur fit faire que puisqu'ils avaient reçu l'argent, ils les devaient dire au plutôt, et que comme ils n'avaient pas assez de prêtres dans leur couvent pour les célébrer, ils devaient prendre des prêtres séculiers pour leur aider. La chose ayant été divulguée dans Naples, plusieurs prêtres étrangers allèrent se présenter pour la célébration. On les admit pendant quinze jours, pendant lesquels ils dirent bien environ quatre mille messes à plusieurs autels. Les pères les payèrent à la moitié de ce qu'ils les avaient reçues. Au bout de trois semaines, quelques prêtres que je connaissais me vinrent dire, qu'étant allés se présenter, on les avait refusés, et on leur avait dit que toutes les messes étaient célébrées. Cependant c'était une chose manifestement impossible. Mais c'est qu'il leur fâchait de répandre cet argent au dehors, et ils ne voulaient pas s'en défaire. Ils dirent pour leur excuse, qu'ils avaient célébré des messes à leur autel privilégié. C'est là un autre stratagème qui ne cède en rien à la réduction, et contre lequel les papes n'ont rien à dire, parce qu'ils contrediraient eux-mêmes le pouvoir qu'ils prétendent avoir dans le Purgatoire. Ces autels privilégiés sont, comme j'ai déjà dit ci-dessus, des autels auxquels il y a de grandes indulgences attachées. Il en coûte de l'argent à Rome pour les obtenir ; mais ensuite cela en fait venir bien davantage. Une messe célébrée à ces autels, à un tel jour de la semaine, qui est ordinairement le lundi, délivre infailliblement une âme du Purgatoire. Celui qui dénierait cela, serait tenu pour un hérétique, et mis à l'Inquisition comme s'il avait dénié une des vérités fondamentales du christianisme. Sur ce principe donc, voici comme ils raisonnent ; et dans la supposition qu'ils font, l'argument me semble assez fort : le pape donne, disent-ils, un privilège à un de nos autels, et déclare que quand on y fera dire une messe pour une âme du Purgatoire ; cette âme-là, quand bien même elle serait la plus endettée de tout le Purgatoire, en sera au même moment infailliblement délivrée. Le pape est infaillible dans tout ce qu'il dit, particulièrement dans ce qui concerne les choses de l'autre monde. On nous envoie d'autre part de l'argent pour célébrer tant de centaines ou de mille messes pour l'âme de monsieur ou de madame une telle : Que faut-il faire ? Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora (3). Nous ferons dire une messe à notre autel privilégié, qui délivrera infailliblement le monsieur ou la dame du Purgatoire ; et nous ne dirons pas les autres, parce qu'étant ordonnées pour la même fin, elles seraient superflues et inutiles. C'est pourquoi voilà bien de l'argent fort aisément gagné, et notre conscience fort en repos. Cet argument fut une fois industrieusement poussé contre les Jésuites de Rome. Un riche marchand leur avait légué par testament tout son bien pour faire dire tant de milliers de messes pour retirer son âme du Purgatoire après sa mort. Son plus proche parent qui de droit devait être son héritier, ayant eu connaissance du testament ne perdit de temps sitôt qu'il fût mort. Il s'en alla aux Jésuites, et leur donna de l'argent pour dire une messe à leur autel privilégié, pour l'âme du défunt. Il y assista lui-même, et prit une attestation par écrit d'eux comme ils l'avaient dite. Il s'en alla ensuite faire arrêt sur tous les biens de son parent, et prétendit que la clause du testament étant satisfaite, ils devaient retourner dans leur canal naturel, c'est-à-dire au légitime héritier ; qu'il prouverait que son parent était en Paradis ou en Enfer, et qu'il n'avait plus besoin de messes. La chose fût portée au barreau, et plaidée avec beaucoup de chaleur de part et d'autre, les Jésuites demandeurs, et le marchand défendeur. Mais cette affaire passait par les mains d'une cour ecclésiastique, où tous les juges étaient parties, qui auraient condamné ce qu'ils font eux-mêmes tous les jours. On jugea en faveur des Jésuites sous prétexte que l'Église doit toujours être favorisée. Cependant il est évident dans le fond que le marchand avait raison, et qu'on ne pouvait pas le condamner sans injustice.
Je reviens à nos confréries. Il n'y a point de si petit village en Italie où il n'y ait une confrérie pour les âmes du Purgatoire, et pour le moins une vingtaine de prêtres qui vivent dessus fort à leur aise. Outre l'argent de leurs messes qui ne leur manque pas, ils ont encore des gens qui vont par les maisons et par les rues avec des boîtes, et demandent à tous ceux qu'ils rencontrent, avec beaucoup d'importunité, qu'on leur donne de l'argent pour les âmes du Purgatoire. Les prêtres partagent ensuite entre eux ce qu'ils ont dans la boîte. Dans plusieurs endroits d'Italie, particulièrement dans les grandes villes, pour avoir un revenu fixe, ils donnent la dévotion à ferme à quelqu'un ; comme je l'ai vu à Milan dans cette fameuse confrérie des âmes du Purgatoire, érigée dans l'église de San Giovanni delle Case Rotte. Je crois que le fermier, qui est un séculier, donne quatre mille écus tous les ans aux prêtres de cette église ; et il fait son profit du reste. Il tient pour cet effet plus de quarante porteurs de boîtes qui sont tous habillés de blanc, et portent sur leurs petits manteaux blancs, les armes de la confrérie pour les distinguer. Ils leur donnent à chacun la valeur de treize sols par jour, et ils doivent courir par toutes les rues de la ville avec leurs boîtes, pour demander de l'argent pour les âmes du Purgatoire. Ce sont des gens choisis, rusés et habiles dans leur métier de demander. Ils sont quelquefois si importuns et si impertinents, qu'ils suivent la longueur de deux ou trois rues une personne sans la quitter, afin de l'obliger par leurs importunités de leur donner. Il y a du danger de les rudoyer ; car ils ont la malice de dire, qu'ils voient bien que vous méprisez les âmes du Purgatoire ; et ils pourraient vous faire des affaires à l'Inquisition. Le fermier des âmes du Purgatoire a toutes les clés de ces boîtes, et ils sont obligés une ou deux fois la semaine de les lui porter. Quand ils les apportent bien pleines, il leur donne quelque chose davantage que leur paie ordinaire afin de les encourager à bien faire la quête. Il tient dans toutes les hôtelleries, auberges, cabarets, tavernes et autres lieux publics des boîtes. Ceux qui ont voyagé en Italie savent que l'hôte apporte ordinairement à la fin du repas la boîte des âmes du Purgatoire, afin de prier les voyageurs de mettre quelque chose dedans. Au temps de la récolte des fruits les fermiers du Purgatoire ont des gens qui vont à la campagne pour faire la quête pour les âmes. Ils ont de grands chariots et demandent de tout ce que l'on a recueilli, du blé, du vin, du bois, du riz, du chanvre, jusqu'à des œufs et des poules. Après quoi ou ils les mangent, ou ils les vendent pour faire de l'argent. Comme ces pauvres gens de la campagne sont extrêmement simples et ignorants, ceux-ci qui sont fins et rusés leur donnent à entendre tout ce qu'ils veulent, et les abusent extrêmement. J'entendis une fois une pauvre paysanne qui donnait du chanvre, et elle disait qu'elle était fâchée de ce qu'elle ne pouvait pas en donner suffisamment pour faire une grande chemise. Un des quêteurs lui dit qu'on en ferait une petite pour une petite âme du Purgatoire. Ils riaient en derrière de la simplicité de cette bonne femme, mais pas un d'eux n'avait la charité de l'instruire. L'ignorance dans l'Église romaine passe pour simplicité ; et c'est à cette simplicité ignorante ou à cette simple ignorance qu'ils attribuent cette béatitude de l'Évangile (4) : «Bienheureux sont les pauvres d'esprit». Cependant il me semble que cette pauvreté d'esprit se doit entendre d'une simplicité sans malice et sans ignorance, et d'un esprit candide et ouvert, où il n'y a point de duplicité ni de fourbe ; ou bien de ceux qui n'ayant pas le cœur attaché aux richesses de ce monde, sont véritablement amateurs de la pauvreté évangélique. Mais pour dire la vérité, c'est que la simplicité ignorante est plus profitable aux prêtres et aux moines de l'Église romaine. Plus les gens sont idiots, et plus il leur est facile de les tromper et de tirer de l'argent de leurs mains.
Voilà, Monsieur, une partie de ce que j'ai observé sur l'usage qui se fait de la doctrine du Purgatoire en Italie. Je pourrais vous rapporter ici plusieurs exemples sur chaque différent sujet qui est traité dans mes Lettres : mais je n'en choisis ordinairement qu'un, et fort rarement deux ; encore c'est lorsque quelque circonstance particulière, qui mérite d'être rapportée, m'y oblige. Il me reste encore à dire un mot de leurs peintures du Purgatoire, avant que de fermer ma Lettre. Il n'y a point d'églises ou de chapelles en Italie, où il n'y ait quelque grand tableau qui représente le Purgatoire. Les âmes y sont dépeintes comme des corps nus de jeunes hommes et de jeunes femmes, avec quelques flammes qui les environnent. Ces flammes ne brûlent pas : mais je doute fort que ces nudités infâmes n'allument des incendies dans les cœurs. Un Italien ayant fait dépeindre sa dame dans les flammes du Purgatoire, où il l'avait fait mettre parce qu'elle lui avait refusé quelques faveurs, fit écrire ces deux lignes au bas du tableau : S'è così piacevole di vederla in Purgatorio, Che cosa sarebbe di vederla nel Cielo? Sa pensée était : Si c'est une chose si agréable de la voir en Purgatoire où les flammes couvrent quelque partie de sa nudité, quel plaisir n'aurait-on pas de la voir dépeinte dans un Ciel où elle n'aurait rien qui la cachât ? C'est là la manière de représenter dans l'Église de Rome le Jugement universel, ou les âmes bienheureuses en Paradis. Ils posent publiquement ces tableaux-là sur les autels, et le peuple les a devant les yeux quand il entend la messe. Je sais qu'ils disent, que c'est pour imprimer davantage dans l'imagination ces grandes vérités du christianisme. Comme si des Chrétiens ne devaient se conduire que par imagination, et jamais par la raison. Ils veulent qu'on soumettre sa raison en toutes choses, et n'épargnent rien pour fortifier l'imagination. Tout le contraire des Protestants qui négligent les choses matérielles qui frappent si fort les sens pour adorer Dieu en esprit et en vérité et Lui rendre un culte raisonnable.
Ils pratiquent en Italie avec leurs tableaux une chose qui fait horreur. Quand ils conduisent un pauvre criminel au supplice, il a toujours deux prêtres à ses côtés qui lui tiennent un tableau du Purgatoire devant les yeux. Ils montent même dans l'échelle et sur l'échafaud avec lui pour lui tenir le tableau jusqu'à ce que l'exécution soit faite, et ils ne lui parlent d'autre chose. N'est-ce pas là en vérité redoubler l'effroi à de pauvres gens que la mort épouvante déjà si fort ? La même chose se pratique envers tous les agonisants. On leur met au pied de leur lit un tableau du Purgatoire, entre deux cierges allumés, pour le faire paraître avec plus d'éclat, et on exhorte le malade à avoir toujours les yeux dessus. Quelques-uns sont obligés de prier qu'on leur parle de la bonté et miséricorde de Dieu, parce qu'ils sont déjà assez épouvantés de Sa justice. Mais c'est la plupart du temps en vain. Car les prêtres sont si accoutumés à leurs chansons du Purgatoire, qu'ils y retombent tout aussitôt d'eux-mêmes, et ne sauraient parler d'autre chose. Pour moi je crois qu'après avoir parlé à un malade de la justice de Dieu à punir le péché dans l'autre monde, par les peines éternelles de l'Enfer, afin de lui faire sérieusement penser aux affaires de sa conscience ; il est expédient ensuite de lui parler de miséricordes du Seigneur pour relever son espérance et enflammer Sa charité. Nous craignons Dieu, parce qu'il est juste à punir : mais nous l'aimons, parce qu'il est bon à pardonner ; et il vaut mieux sans doute que les derniers moments de la vie d'un Chrétien soient employés à l'aimer, qu'à être si fort effrayé de Ses jugements. C'est ce qui en a jeté plusieurs dans des craintes qui allaient jusqu'au désespoir. Mais encore une fois, c'est que la doctrine du Purgatoire n'a pas tant été inventée pour le bien des mourants et des morts, que pour celui des vivants : je veux dire de ces bons prêtres qui ne songent qu'à se divertir et à prendre leurs aises pendant leur vie. Il me resterait à parler du principal moyen dont ils se servent pour établir et maintenir leur doctrine du Purgatoire, qui est de la prêcher avec un zèle incomparable. Je me souviens aussi que je vous ai promis au commencement de cette Lettre, de vous écrire de la manière de prêcher en Italie : mais comme ma Lettre est déjà assez pleine, et que cette manière est fort étendue, je la réserverai pour la première occasion. Cependant je vous prie de croire que je resterai toute ma vie, vôtre, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Les Olivétains furent fondés à Aconna, dit aussi Monte Oliveto, en 1319 par Giovanni Tolomei (futur bienheureux Bernard Tolomei), Ambrogio Piccolomini et Patrizio Patrizi ; leur Congrégation fut approuvée par le pape Jean XXII en 1324.
2. Le jour du couronnement du roi Guillaume et de la reine Marie fut le 11 avril 1689 : ainsi, quelle que soit l'année, le 11 avril était «jour de couronnement» jusqu'à la mort de Guillaume le 19 mars 1702.
3. Guillaume d'Occam, Summa totius logicae, I, 12, c. 1325 : Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora — «C'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre» ; c'est-à-dire le fameux «rasoir d'Occam», dont le sens est les entités ne devraient pas être multipliées sans nécessité.
4. Saint Matthieu 5:3, «[Jésus dit à ses disciples :] Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux !» : cf., Saint Luc 6:20, «Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit : Heureux, vous êtes qui êtes pauvres, parce que le Royaume de Dieu est à vous !»
SIXIÈME LETTRE.
Du déplorable abus qui se fait de la prédication en Italie, etc.
Vous savez, Monsieur, que ce qui soutient l'Église, et qui en est comme l'âme et la vie, ce sont les sacrements et la parole de Dieu. C'est pourquoi il est de la dernière conséquence que ces deux choses y soient fidèlement et décemment administrées ; Et je prendrai toujours pour une marque de la véritable Église, la fidèle dispensation qui s'y en fait. Ce fut là le motif, étant à Rome, qui me porta à examiner particulièrement la pratique de l'Église romaine sur ces deux points. Je ne crus pas pouvoir trouver un lieu plus favorable pour mon dessein que cette grande ville, qui se vante, si on l'en veut croire, non seulement de renfermer dans son sein la principale Église du monde ; mais encore qui s'attribue — je ne sais pas pour quelle raison — le nom de sainte, Roma Sancta. Pour ce qui est de l'administration des sacrements, je ne puis pas dénier qu'elle ne s'y fasse avec un très bel ordre et solennité, et même avec des cérémonies qui vont dans la superstition. Il faudrait ici vous parler de celles qui s'observent dans la consécration des prêtres, dans celles de l'Eucharistie, et des pompeuses préparations pour la Pâque qui se font la semaine sainte, et qui attirent par leur éclat et majesté une infinité d'étrangers, qui se rendent à Rome de toutes parts, sur la fin du Carême, pour en être les spectateurs. Et l'on dit ordinairement, que pour passer son temps agréablement en Italie, if faut se trouver au Carnaval et à l'Ascension à Venise ; l'Octave du Saint Sacrement à Bologne ; la Semaine Sainte à Rome. Ce serait encore ici le lieu de vous parler d'une infinité de sottises qui s'y pratiquent à certaines fêtes de l'année, comme à Noël, à l'Ascension, et à la Pentecôte : mais comme cela irait en longueur, je les passerai présentement sous silence, pour m'arrêter au point plus considérable, dont j'ai particulièrement résolu de vous entretenir, qui est l'usage qui s'y fait de la prédication. Autant qu'il y a de superstition et d'excès dans la pompeuse administration des sacrements, autant y a-t-il de défaut, de négligence, et de mauvaise foi dans la dispensation de la Parole. Pendant l'espace de sept ans que j'ai demeuré en Italie, dans toutes les villes où je me suis trouvé les Avents et les Carêmes, j'ai été à une infinité de sermons ; mais je n'ai jamais vu ou su qu'aucun curé, ou prêtre séculier ait prêché, excepté une fois un chanoine à San Giovanni in Laterano à Rome, et un cardinal le jour de Pâques dans la cathédrale de Milan. De sorte que si la parole de Dieu a souffert de la décadence, et en souffre encore considérablement tous les jours, on n'en doit pas accuser les prêtres séculiers d'Italie, qui ne prêchent point du tout, ou qui sont la plupart du temps si ignorants qu'ils ne le sauraient faire : mais la faute en doit être uniquement rejetée sur les moines, et autres religieux qui en exercent l'office. C'est ce me semble assez dire, que de vous faire savoir que les véritables pasteurs, qui sont les curés, ne paissent pas leur troupeau ; mais s'en déchargent sur des étrangers ; je veux dire sur des moines, qui songent plus à satisfaire leur intérêt et leur vanité, qu'au salut des âmes. Les moines se sont même si absolument mis en possession de ce ministère, qu'ils ne souffriraient pas un prêtre séculier prêcher dans sa propre église ; et si quelqu'un entreprenait de le faire, et qu'ils ne pussent pas le supplanter, ils emploieraient malicieusement toutes sortes de moyens pour le noircir dans l'esprit du peuple, et lui faire perdre son crédit et sa réputation. Il est vrai d'autre par que les curés, amateurs d'une vie douce et tranquille, ne se mettent pas beaucoup en peine de réclamer leur droit à la chaire. Ils disent eux-mêmes hautement que c'est le fait des moines de prêcher, parce que n'étant point engagés par leur profession dans les affaires et les embarras du monde, ils peuvent trouver dans leurs monastères le temps d'étudier, et d'apprendre leurs sermons ; mais que pour eux, étant tout occupés dans l'administration des sacrements, à entendre les confessions, et aux enterrements, ils n'ont pas le loisir d'y vaquer. De sorte qu'on voit fort peu de procès sur cette matière-là. Étant à Rome j'allais fort souvent au couvent de Santa Maria sopra Minerva pour entendre les sermons. Ce sont des Pères dominicains ; on les appelle aussi Frères prêcheurs, parce que dans la division des grâces et des dons du Saint-Esprit que les moines ont faite entre eux, ceux-ci ont pris hardiment le don de la prédication. Mais on voit bien que ç'a été une usurpation faite sans l'aveu du Saint-Esprit ; car je n'ai guère vu des moines réussir plus mal qu'eux dans ce ministère. Dieu ne veut pas que l'on tranche en maître de ce qui n'appartient qu'à Lui seul de donner. Les Jésuites ont pris le don des langues, et d'enseigner la jeunesse. Cependant l'expérience fait voir qu'ils en sont fort ignorants, et que les écoliers qui ont étudié dans les universités sous d'autres maîtres, sont incomparablement mieux fondés en doctrine que les leurs. Les moines de S. Benoît ont pris pour leur caractère la retraite et le silence, mais on ne voit point de gens battre plus le pavé dans les villes et à la campagne qu'ils le font. C'était donc un de ces vieux Frères dominicains ou prêcheurs, qui prêchait à la Minerva, mais il le faisait d'une manière si indigne que je ne sais comme je pus me résoudre de l'aller entendre plus d'une fois. Tout ce qu'il avait d'attirant, c'est que bien qu'il fut fort vieux, il était entièrement bouffon, et faisait rire ses auditeurs à gorge déployés. Il se promenait dans sa chaire — car en Italie elles sont extrêmement longues et larges. Il frappait des pieds et des mains. Il roulait les yeux dans la tête et faisait cent gestes ridicules. Je vous rapporterai ici un petit bout d'un de ses sermons dont je me souviens, afin que par ce petit échantillon vous puissiez juger du reste. Il voulait faire une application morale de l'histoire qui est rapportée dans le livre de la Genèse au chapitre 21, lorsqu'Abraham chassa la servante Agar hors de sa maison. Il commença de cette sorte. Messieurs, dit-il, suivez-moi, et venez-vous promener avec moi dans l'Écriture sainte. Alors faisant trois pas dans la chaire ayant une main à son côté, il s'arrêta tout court au quatrième, et comme un homme qui dans une affreuse solitude verrait de loin venir une femme, il s'arrêta fort longtemps sans rien dire, et regardant fort attentivement jusqu'à ce que l'objet fût plus proche, il commença à dire : Qui est-ce que je vois ? N'est-ce pas là une femme ? Et restant encore un grand espace de temps, il dit : Oh Dieu ! il me semble que c'est Agar la servante d'Abraham. Oui c'est elle-même. Holà ma bonne amie : Dieu vous garde. Que faites-vous ici toute seule dans un désert si écarté et si épouvantable à la Nature ? Faisant ensuite comme s'il l'eut regardée depuis les pieds jusqu'à la tête. Elle n'a pas volé son maître, reprit-il, comme beaucoup de nos servantes sont les leurs ; car elle est dans un fort pauvre équipage. Dis-moi, Agar, d'où vient donc que tu as laissé ton maître ? Ici faisant parler Agar toute affligée et toute épleurée ; que c'était à cause de la jalousie de sa maîtresse, il repartit en riant. Vraiment, voilà bien de quoi ? N'y a-t-il que cela ? Voilà qui est plaisant ! Madame Sara chasse sa servante, parce qu'elle est jalousie ! Viens, Agar : viens t'en avec moi ; je veux aller de ce pas parler à ton maître. Faisant après sept ou huit tours dans la chaire en grommelant : Sara chasse sa servante, parce qu'elle est jalousie, voilà de belles raisons ! Il s'arrêta après, et frappant deux grands coups sur la chaire : Holà, holà, dit-il ; À la porte ; Qu'on me fasse parler à Abraham. Puis faisant une grande révérence comme s'il eut vu Abraham, il lui dit : Abraham, pourquoi avez-vous mis Agar votre servante dehors ? Elle dit que c'est parce que votre femme est jalouse d'elle. Faisant ici parler Abraham ; Abraham lui répondit : Si j'ai chassé ma servante, j'en ai eu l'ordre de Dieu, et je ne suis pas obligé de vous en rendre raison. Et puis Agar ne vous a pas dit tout. Ce n'est pas pour la jalousie seulement ; mais c'est qu'elle a un petit garçon qui est extrêmement méchant. Il bat celui que j'ai eu de ma femme. Ils se hargnent continuellement l'un l'autre : ils s'entre-arrachent les cheveux : ils crient et font un bruit insupportable dans le logis. Ma femme en a parlé plusieurs fois amiablement à sa servante : mais Agar est devenue trop impertinente. Elle répond avec arrogance, et elle a trop de gueule. C'est pourquoi, et pour mettre la paix dans mon logis, j'ai été obligé de la mettre dehors. Ici le vieux Père dominicain roulant les yeux dans la tête, et ridant son front, comme tout en colère contre Agar. Agar, dit-il, tu ne me disais pas le plus fin. Tu fais comme nos servantes de Rome, quand elles sortent d'un logis ce n'est jamais leur faute. C'est que leurs maîtresses sont d'une fâcheuse humeur, elles sont capricieuses, elles sont jalouses. Mais à ce que je vois, c'est que tu voulais faire la maîtresse. Il y avait à ton occasion du bruit au logis. Je savais bien que la jalousie n'était pas une raison suffisante pour renvoyer une bonne servante ; car autrement toutes nos dames romaines qui sont extrêmement jalouses n'en pourraient jamais garder une. Mais il faut de plus que cette jalousie cause de la dispute et du bruit dans la maison entre le mari et la femme ou entre les enfants, et alors je suis de l'avis d'Abraham ; il faut chasser la servante — Ejice ancillam, et filium ejus (1). Le père, après avoir bien fait le bouffon sur cette histoire de la Bible, passa à une autre qu'il traita de la même manière ; faisant éclater tout le monde de rire. Après quoi, il tomba sur la dévotion commune à leur Ordre qui est le rosaire. Car ils font venir cela à toutes sortes de matières. C'était là sa façon de prêcher, et l'église était toujours pleine de monde. Les Italiens aiment fort les sermons qui font rire. C'est ce qui fait que la plupart des prédicateurs s'appliquent au style bouffon et burlesque.
Les Jésuites ont une autre manière de prêcher que je pourrais appeler un style poétique. Comme ils ont passé leur jeunesse à enseigner les humanités dans leurs collèges, ils ont la tête remplie des métamorphoses d'Ovide et des fables d'Ésope, et tous leurs sermons en sont farcis. S'ils parlent de l'incarnation du Verbe, ils croiraient n'avoir rien dit qui vaille, s'ils ne disaient que le divin Prométhée a porté le feu du Ciel en Terre ; c'est-à-dire à uni personnellement la Divinité avec l'humanité. Ils citent une infinité de passages tirés des auteurs profanes et des poètes, comme de Cicéron, de Virgile, d'Horace, de Martial, etc. J'en ai entendu qui ont cité les comédies de Térence et le De arte amandi d'Ovide. Mais fort rarement on les entend citer les Pères, et encore plus rarement l'Écriture sainte. Le grand commerce qu'ils ont dans le monde avec les personnes de qualité, fait que leurs mots sont extrêmement bien choisis, leur discours net et poli, quoique la solidité la plupart du temps y manque. Leur geste est assez bien compassé, et leur déclamation n'est pas mauvaise. Pour donner plus de crédit à leur Ordre qui est si nouveau et néanmoins si puissant, ils citent fort souvent le Livre des exercices de leur fondateur S. Ignace. C'est un assez pauvre livre, encore dit-on qu'il le déroba lorsqu'il était frère convers dans l'abbaye des Bénédictins du Mont Serra. Les Capucins ont une autre façon de prêcher. Leur style est stoïque, emphatique et fulminant. Ils ne prêchent ordinairement que des choses terribles, comme de la mort, du Jugement dernier, du Purgatoire, et de l'Enfer. Ils remplissent l'air d'exclamations, frappent des mains et des pieds dans la chaire. Ils se prennent par leur grande barbe, et crient avec un ton de voix qui effrayé tout le monde. J'ai remarqué que tous les chiens s'enfuient de l'église quand un Capucin prêche. Enfin presque tous les religieux ont une manière différente de prêcher, et presque tous des théologiens différents, qui sont tous opposés d'opinion les uns les autres. Les Cordeliers ont leur Duns Scot et S. Bonaventure ; les Dominicains S. Thomas ; les Jésuites leur Francisco Suárez, et ainsi des autres. Pour ce qui est de l'ordre des parties du sermon, c'est le même par toute l'Italie. Ils commencent tous par la salutation angélique ou Ave Maria. Ce n'est pas par l'invocation du Père céleste, ni par celle du Saint-Esprit, qui sont néanmoins les plus propres ou plutôt les seules et uniquement nécessaires. Mais la doctrine qu'ils prêchent est si corrompue et si pervertie qu'il ne faut pas s'étonner si l'introduction à leurs sermons s'en ressent. Dieu nous manifestant même en cela que ce qu'ils prêchent n'est point la pureté de Sa parole, et permettant que les inventions des hommes ne soient débitées que sous les auspices d'une créature. Après l'invocation de la Vierge, ils prononcent leur texte, qui est ordinairement un texte tiré de l'Écriture, et quelquefois un verset tiré de quelque prière de leur église ou un introït de messe. Ils ne citent le texte de l'Écriture qu'à demi, et dans un sens coupé, sans dire ni ce qui précède, ni ce qui suit, et qui devrait être rapporté pour faire un sens parfait. Ensuite ils font leur proposition, et entrent en matière, la traitant ordinairement tout de suite, sans divisions ou subdivisions. Il est vrai que tout le sermon est partagé en deux parties, mais la seconde n'est qu'un ramas d'exemples, d'histoires, ou de contes faits à plaisir pour divertir le monde. Entre la première et cette seconde, on ramasse les aumônes dans l'église pour les pauvres. Il y a des gens destinés pour cela, qui ont des bourses attachées à de grands bâtons avec de petites sonnettes au bout, et ils les font passer partout les rangs afin que l'on mette dedans. Le prédicateur pendant ce temps-là exhorte avec un zèle incomparable à l'aumône. Je n'ai jamais vu des gens plus enflammés de charité pour le prochain qu'ils le sont en chaire. Vous diriez qu'ils sont pères des pauvres. En cela il faut que je leur fasse justice, d'avouer que nos ministres protestants ne sont pas si bons avocats pour les membres nécessiteux de Jésus-Christ, et ne prennent pas la cause des pauvres avec tant de chaleur que ces gens-là le font. Je veux bien néanmoins, Monsieur, que vous sachiez que lorsque je loue vos moines d'Italie, ce n'est pas leurs personnes que je loue, c'est leur action, ou plutôt l'apparence extérieure de leur action. Car si nous coupons cette belle pomme en deux, nous y trouverons le ver qui la gâte en dedans. Je veux dire, pour faire court, que le motif qui les porte à recommander si sérieusement les pauvres, est un motif intéressé, ou plutôt ce n'est autre chose que leur propre intérêt. Vous saurez donc, Monsieur, que la moitié des aumônes que l'on recueille dans l'église, et à la porte pendant le sermon, appartient au père prédicateur. Il était impossible de porter ces impitoyables moines, ces cœurs de marbre et de bronze, qui n'ont que l'insensibilité et la cruauté pour partage. Il n'était pas, dis-je, possible de les porter à des sentiments de miséricorde et de compassion pour les misères du prochain, si les séculiers n'eussent trouvé moyen de joindre l'intérêt des prédicateurs avec celui des pauvres et de n'en faire qu'un. Voilà le grand ressort qui remue la machine, et qui fait que ces moines s'efforcent dans leurs sermons de donner de si présents motifs pour tirer l'argent des bourses. Il y en a même qui sont si téméraires et si insolents, que je m'étonne comme on ne les fait pas descendre de chaire. J'allai un jour de Carême entendre la prédication à Sant'Andrea della Valle à Rome. C'était un père franciscain qui prêchait. Il traitait de la prédestination. Après avoir dit que le nombre des prédestinés n'était pas si petit que l'on s'imaginait. Je parle, disait-il, parmi les Catholiques ; car pour ce qui est de tous les infidèles qui ne croient point en Jésus-Christ, aussi bien que tous les hérétiques, comme les Luthériens, les Calvinistes, les Zuingliens, etc. Notre mère la sainte Église catholique, apostolique et romaine, nous enseigne qu'ils sont tous indubitablement damnés, et nous devons le croire. Puis faisant une grande énumération de tous ceux qu'il croyait fermement sauvés, il mettait de ce nombre tous ceux qui étaient enrôlés dans la Confrérie du Cordon de S. François, qui est si particulière à son Ordre ; parce que, disait-il, il est impossible, selon les bulles que nous en avons des papes, que ceux-là puissent mourir en péché mortel. Il faisait la même grâce à tous ceux qui portaient l'habit de son Ordre ; et se mettait ainsi lui-même au nombre des prédestinés. Ensuite s'étant fait une question à lui-même, s'il n'y avait point quelques marques visibles sur la Terre, par lesquelles on pût connaître les autres prédestinés d'avec les réprouvés, il se répondit que oui. Entre autres je me souviens qu'il dit, que d'aimer le son des instruments et la musique s'en était une, mais que la principale de toutes était de faire l'aumône. C'était là le point auquel il voulait venir, et il prit de là occasion d'exhorter tout son auditoire à vouloir donner ce jour-là aux yeux de tout le monde des marques de leur prédestination en mettant abondamment dans les bourses. Et, pour lui, il dit qu'il voulait observer du haut de sa chaire, comme d'un lieu éminent tous ceux qui en donneraient des signes, et connaître par là les réprouvés d'avec les prédestinés. Il s'assit donc dans sa chaire, et se tut ; et ouvrant de grands yeux du côté qu'on portait les bourses, comme il eût vu que tout le premier rang s'était montré libéral : Bon, dit-il, voilà déjà tout un rang qui est prédestiné. Le second et le troisième ayant suivi de la sorte : En vérité, ajouta-t-il, je crois que tout mon auditoire sera prédestiné. C'est une grande consolation pour moi d'avoir prêché ici le Carême, et j'en rends grâces à Dieu, car c'est un signe que les pécheurs se convertissent. Par ce moyen, le père fit faire assurément une très abondante quête. J'observai pendant tout ce temps-là qu'il y avait là des gens fort embarrassés ; particulièrement quelques femmes qui n'avaient point apparemment de monnaie sur elles. Elles étaient devenues toutes rouges au visage, et pour éviter la confusion de paraître des réprouvées, elles ne laissaient pas d'étendre la main sur les bourses, comme si elles eussent mis quelque chose dedans. J'entendis un artisan dans l'église qui disait à un autre. Ce moine-là avec ses signes de prédestination m'a fait mettre un écu malgré moi dans les bourses : Je n'avais point d'autre monnaie sur moi, et si je n'eusse rien donné, cela m'aurait perdu de réputation. On m'aurait pris pour une âme damnée, et personne ne serait venu acheter à ma boutique. Le moine tout ravi d'avoir tant vu de prédestinés, commença joyeusement la seconde partie de son discours, et étant extraordinairement de bonne humeur, il fit le bouffon à merveilles. Après avoir rapporté plusieurs petites histoires fort divertissantes, il fit commencer la seconde quête pour les âmes du Purgatoire. C'est la coutume en Italie de faire deux quêtes pendant le sermon, l'une à la fin de la première partie pour les pauvres, et l'autre à la fin de la seconde pour les âmes du Purgatoire. Il se servit du même moyen qui lui avait déjà si bien réussi. Il remontra que ce n'était pas assez d'avoir montré sa charité aux vivants, qu'il fallait encore pour un signe achevé de prédestination, qu'elle s'étendit jusqu'aux morts ; c'est-à-dire jusqu'aux membres de l'Église souffrante, ainsi qu'ils appellent le Purgatoire. L'argent de cette seconde quête va aux prêtres ou aux moines à qui appartient l'église où on prêche : et pour encourager davantage le prédicateur à la faire, on lui en donne la quatrième partie. C'est ce qui les rend si zélés à exhorter les peuples en chaire. Il y en a que le zèle des âmes transportées si fort, que non contents d'avoir fait une quête en général sur ce sujet, ils en font deux autres de suite. La seconde est à l'intention de soulager l'âme du parent, ou de l'ami que chacun des auditeurs en particulier a plus d'obligation d'assister ; et ils font faire la troisième pour l'âme qui est la plus abandonnée des suffrages dans le Purgatoire, et qui n'a ni parents, ni amis pour prier Dieu pour elle. C'est ainsi que des hommes fous et téméraires exaltent imprudemment leur bonté par-dessus celle de Dieu même, croyant que si leur charité ne s'étendait à ces pauvres âmes infortunées, destituées de tout secours — comme ils disent — Dieu serait assez impitoyable et cruel pour les laisser souffrir un très grand nombre d'années, et même jusqu'au jour de Jugement universel, sans leur faire miséricorde. On m'a raconté qu'un bon paysan voyant que le prédicateur de sa paroisse, après avoir fait trois quêtes de suite, se disposait à en faire une quatrième pour l'âme qui souffrait le plus ; lui cria tout haut : Mon père, je vous prie de fermer votre Purgatoire, car si vous en faites encore sortir une âme, elle sera en danger de s'en retourner sans rien avoir ; pour moi je vous déclare que je n'ai plus d'argent. Je ne sais pas si l'histoire de ce paysan est véritable, mais je sais seulement qu'on aurait fort souvent grand sujet de leur crier la même chose. C'est durant que l'on fait cette collecte que tous ces bons pères prédicateurs disent tout ce qui leur vient en pensée pour fournir des motifs pour un œuvre si charitable. C'est là qu'ils débitent avec chaleur toutes leurs fables et contes du Purgatoire. J'entendis un père carme dans la paroisse de Santa Sofia à Venise, qui ayant fait faire de la main un grand silence à tout son auditoire, et prêtant attentivement l'oreille, comme s'il eût entendu quelque chose, il leur demanda s'ils n'entendaient pas un bruit sourd comme d'une voix confuse. Puis prêtant encore davantage l'oreille, il dit ; qu'il entendait les âmes du Purgatoire qui leur criaient de ne pas épargner leurs charités, et de les soulager par une abondante aumône. Et corrompant ici ce passage de l'Apocalypse (2) : Audivi sub altare animas interfectorum lamentium, vindica sanguinem nostrum Deus noster — J'ai entendu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués, crier, venge notre sang, ô Dieu. Il y changea la plupart des mots, disant : Audio sub altare animas defunctorum lamentium, refrigerate sanguinem nostrum fratres nostri — J'entends sous l'autel les âmes de Purgatoire qui crient : rafraîchissez notre sang, mes très chers frères. Je pris l'action de ce prédicateur pour une excellente figure de rhétorique, que l'on appelle fictio. Mais je suis sûr que plusieurs ne le prirent pas de même, et crurent véritablement que ce père avait entendu les âmes du Purgatoire sous le grand autel : et marque de cela, c'est que beaucoup de personnes se levèrent de leurs sièges pour regarder de ce côté-là. Le sermon étant fini, le prédicateur descend de chaire, et est conduit dans la sacristie, où l'on apporte les bourses. On les ouvre en sa présence, et on lui donne la portion qui lui appartient : semblables en ceci aux oiseaux de proie, ou aux chiens de chasse auxquels on fait une ample curée du gibier qu'ils ont pris.
Dans les endroits d'Italie qui confinent avec l'Allemagne, ou la France, le peuple ne se laisse pas si fort mener par le nez, que dans les provinces les plus intérieures et voisines de Rome. Les prêtres font bien tout leur possible pour faire valoir leur Purgatoire : mais les séculiers ne les regardent que comme des charlatans, qui débitent toutes sortes de menteries pour faire mieux acheter leurs drogues. Je fus prié une fois par le curé de Campodolcino, dans les Alpes, de prendre la peine de grimper sur la cime du mont Splügen, pour aller prêcher le jour de la Notre-Dame de la mi-août, à un petit village. J'y allai, et je fis tous mes efforts pour faire valoir la dévotion en faveur du curé : mais, pour tout cela, il ne me fut pas possible d'avoir autre chose que quelques livres de beurre ; quoique le curé m'eût fort prié de presser pour l'argent. L'argent est fort rare dans ces montagnes-là. Elles ne sont abondantes qu'en beurre, fromages, châtaignes et viandes salées ; et ces pauvres paysans apportent à l'église de ce qu'ils ont. Dans l'endroit où j'allai prêcher, ils n'y peuvent demeurer qu'environ deux mois dans le cœur de l'été. Après quoi le grand froid les en chasse, et ils vont demeurer dans un autre plus bas, où ils restent encore environ deux mois avec tout leur bétail ; et ils descendent comme cela par degrés jusque dans les vallées, où ils se tiennent pendant l'hiver.
Je reviens à nos prédicateurs. La seconde partie de leur sermon, comme j'ai déjà dit, n'est composée que de contes et de sottises. C'est ce qui fait que plusieurs personnes qui ne se plaisent pas à entendre conter des sornettes, et peut-être aussi pour n'être forcés par l'imprudence du prédicateur à mettre malgré eux dans les bourses, sortent de l'église sans avoir entendu la première partie. Cette première partie contient le corps et la substance de leur discours, et ceux qui font imprimer leurs Quadragésimaux et leurs Avents, pour ne pas déshonorer leur nom, ne font imprimer que celle-là, qu'ils trouvent moyen de diviser, et d'en faire comme deux parties. Les prédicateurs bouffons sont les plus suivis par la populace ; mais ceux qui prêchent par belles pensées sont les plus estimés, et les gens qu'ils appellent dotti ou virtuosi les vont entendre. Cette manière de prêcher par belles pensées consiste à ne rapporter presque jamais les choses dans leur sens naturel. S'ils allèguent un texte de l'Écriture, c'est dans un sens forcé, subtil, curieux, et recherché qui n'est point celui de l'Écriture. Et un prédicateur qui s'arrêterait au sens littéral ou au naturel, serait estimé pour simple, ignorant, et idiot, et à moins qu'il n'eût l'air bouffon il n'aurait que fort peu d'auditeurs. J'ai remarqué qu'ils ne prennent ordinairement dans le sens littéral que les paroles sacramentelles, Hoc est corpus meum — Ceci est mon corps. C'est là qu'ils s'obstinent opiniâtrement à la lettre. Encore ai-je entendu un père minime dans l'église de la Trinité-des-Monts à Rome, qui interpréta toute l'histoire de l'institution de la Sainte-Cène dans un autre sens. Il l'expliqua de l'aumône. Notre-Seigneur Jésus-Christ, dit-il, pour nous recommander davantage le soin des pauvres, voulut que la dernière action qu'il fit ici-bas sur la Terre, fût une action de charité et d'aumônes. Pour cette fin, n'ayant plus rien dans sa disposition qu'un pauvre morceau de pain qui Lui restait entre les mains, il le rompit et le donna à Ses disciples. La pensée fut trouvée belle. Cependant il est évident que ce n'est point là le sens véritable et naturel de l'Histoire sacrée. Car Jésus-Christ dans cette action, ne prétendit aucunement de faire l'aumône ; mais bien d'instituer un sacrement qui servît de soutien et de nourriture spirituelle à nos âmes. Ce moine reçut néanmoins de grands applaudissements de sa belle pensée, et il sut admirablement bien s'en servir pour la quête. Pour être plus féconds en belles pensées, les moines se retirent ordinairement dans des lieux plaisants, comme dans des jardins ou bocages, où ils vont méditer. D'autres vont dans des lieux obscurs et souterrains pour y rêver à leur aise. Plusieurs boivent de bon vin et en bonne quantité ; parce que selon le proverbe commun, Bonum vinum laetificat cor hominis [Le bon vin réjouit le cœur de l'homme]. Enfin d'autres suivent leur humeur particulière. Les supérieurs des maisons religieuses permettent à leurs moines qui prêchent, de faire tout ce qu'ils veulent, et d'aller où il leur plaît pour favoriser leurs belles pensées. On agit avec eux comme avec des femmes grosses, auxquelles on n'oserait rien refuser pour ne pas gâter leur fruit, qui sont leurs belles pensées. C'est cette grande indulgence qui fait que tant de moines en Italie s'appliquent à la prédication ; parce que s'étant une fois mis sur ce pied-là, ils sont exempts de toutes les observances de leur Règle. La manière de débiter en chaire leurs belles pensées est telle. Quand ils ont avancé quelque chose de curieux et qui surprend par sa nouveauté ; afin de faire voir que cela ne manque pas de solidité, ils s'efforcent pour l'appuyer davantage, de trouver dans l'Écriture des passages qui y soient favorables, et auxquels ils donnent la plupart, un tour aussi forcé qu'à celui qui sert de base et de fondement à leur pensée. Ils n'allèguent d'ordinaire que des bouts et des moitiés de versets, sans dire ni ce qui précède, ni ce qui suit, et ne citent que fort rarement les endroits d'où ils sont tirés. Ils se contentent de dire, «Comme il est écrit», ou, «Selon l'oracle du Saint-Esprit», ou «Comme il est rapporté dans les textes sacrés» ; et ils citent : mais il est impossible de s'éclaircir si ce qu'ils disent est fidèlement rapporté. Ainsi il est facile à ces corrupteurs de l'Écriture, pour faire valoir leurs belles pensées et beaux alambiquements d'esprit, de séduire un pauvre peuple qui n'a jamais lu dans la Bible, et à qui la lecture n'en est pas même permise. Après avoir tâché d'appuyer de cette sorte leurs belles pensées par l'Écriture, ils s'étudient encore de les fortifier par l'autorité des Pères. Ils mettent au rang des Pères non seulement les Anciens, comme S. Chrysostome, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, etc. mais encore les plus nouveaux, comme S. Thomas d'Aquin [1225-1274], le cardinal Bellarmin [1542-1621], etc. De sorte qu'ils ont un champ bien vaste et bien étendu pour aller à la picorée. Comme on dit ordinairement que les beaux esprits se rencontrent, cela flatte extrêmement leur orgueil, de faire voir au peuple, que ces beaux génies de l'antiquité s'accordent si bien avec les leurs. Quelques-uns ont la sotte vanité de dire en chaire, S. Augustin, ou, S. Ambroise était dans la même pensée que moi, lorsqu'il disait, etc. Ils citent aussi fort rarement les livres et les chapitres dont ils tirent les autorités qu'ils allèguent ; et ils se contentent de dire en général : «Comme dit S. Augustin» ; «Comme assure S. Ambroise». Cependant l'expérience fait connaître qu'ils en citent une infinité à faux, où ils les corrompent si fort, que si on les allait chercher dans la source ; je veux dire dans les endroits d'où ils les ont tirés, on aurait de la peine à les reconnaître. J'entendis un moine bénédictin prêcher dans l'église de Santa Prassede à Rome, qui après s'être objecté à lui-même ; pourquoi tant de personnes qui avaient recours à la Vierge dans leurs besoins, plusieurs néanmoins n'en recevaient aucune assistance : événement qui semblait directement opposé à la croyance de l'Église de Rome, que tous ceux qui s'adressent avec confiance à la Vierge, en sont infailliblement assistés ? Il se répondit, que c'était parce que ces sortes de gens-là n'élevaient par leurs cœurs vers elle. Ils n'élèvent, disait-il, que trop souvent leurs yeux, leurs mains et leurs voix vers Marie ; mais leurs cœurs sont rampants sur la Terre, et ils ne les élèvent jamais vers elles. Là-dessus il cita S. Jérôme : Si volumus exaudiri a Maria erigamus corda nostra a Mariam — Si nous voulons que Marie nous exauce, élevons nos cœurs vers Marie. J'avais lu S. Jérôme auparavant, et je l'ai lu encore depuis, ayant ce passage-là du Bénédictin fort bien imprimé dans ma mémoire : mais je ne l'y ai jamais trouvé, et assurément qu'on ne l'y trouvera pas. Mais le mystère de ceci que ce passage favorisait extrêmement la belle pensée de ce moine. On ne doit point s'étonner si les Catholiques romains se vantent qu'ils ont les Pères de l'Église de leur côté ; car quand ils ne les ont pas, ils les y font bien venir par force, et les y tirent, comme l'on dit, par les cheveux. Ils font comme un autre moine italien, qui ne pouvait faire accorder S. Chrysostome avec une belle pensée qui lui était venue dans l'esprit. Il se mit comme en colère, et changeant aussitôt deux ou trois mots dans le texte, qui en corrompaient presque tout le sens, il dit en un fort bas latin, mais fort expressif, Faciam te bene venire ; et il l'ajusta de la sorte à sa folle imagination. C'est ainsi que ces misérables moines font souvent dire à ces vénérables Pères de l'antiquité, ce à quoi ils n'ont jamais pensé, et ce qui ne se trouve point dans leurs écrits : et cela pour repaître leur folle vanité, et faire recevoir leurs propres rêveries pour des vérités authentiques, crues dans les plus purs siècles du christianisme. Pour donner encore plus d'éclat à leurs belles pensées, ils ne manquent pas de les accompagner de plusieurs belles figures de rhétorique. Ce ne sont que métaphores, allusions et allégories saintes ; avec une belle élocution, de beaux mots choisis, et presque tous opposés les uns aux autres : en quoi la langue italienne est fort féconde. Voilà la belle coupe d'or où le venin du mensonge et de l'erreur est distribué pour empoisonner les âmes. Voilà la grande porte par où tant d'opinions extravagantes et dangereuses sont entrées dans l'Église de Rome. Vous pouvez juger par la nature d'un tel pâturage, de la disposition du troupeau ; et de la qualité de ces nouveaux pasteurs — je veux dire les moines — connaître quel est l'état de cette pauvre bergerie. Ce sont des pasteurs qui tondent la laine et se repaissent du plus gras, et qui se soucient fort peu de salut des âmes, pourvu qu'ils satisfassent leur avarice et leur ambition. Le noble vénitien Loredan (3), si fameux en Italie par ses belles et curieuses compositions, écrivant à Almorò Grimani à Vérone, pour lui recommander un prédicateur de ses amis, s'exprime en ces termes dans sa lettre : Sene viene in cotesta città il Padre Fra Girolamo Olivi, à far pompa d'eloquenza nel Corso Quadragesimale — Le père Jérôme Olivi va à Vérone, pour faire pompe de son éloquence pendant le Carême. Il ne dit pas que ce moine va prêcher l'Évangile et s'efforcer de gagner des âmes à Jésus-Christ : mais il dit qu'il va faire pompe de son éloquence ; et en cela il exprime parfaitement bien le motif de tous ces moines dans leurs prédications. Je n'ai pas de termes pour vous exprimer, Monsieur, les cabales, les intrigues, les sollicitations et les brigues qu'ils font pour parvenir aux meilleures chaires ; c'est-à-dire à celles où il y a le plus d'argent ou le plus d'honneur à gagner. On y interpose la faveur des Grandes et des Princes, pour s'en assurer quatre ou cinq ans auparavant qu'elles soient vacantes. Il y a des chaires qui valent au prédicateur pour un Avent et un Carême, 400, 500, 600 écus ; d'autres mille écus, et plus : sans compter la part qu'ils ont à l'aumône. Pour ce qui est de celles où il n'y a que très peu de profit à espérer, il n'y a pas grande presse : et dans de pauvres paroisses à la campagne où il n'y en a point du tout, on ne trouve pas un misérable moine qui y veuille aller prêcher une seule fois. Point d'argent, point de sermon. On ne prêche ordinairement en Italie que l'Avent et le Carême. Pour ce qui est des autres fêtes et dimanches de l'année, il n'y a point de sermon dans les paroisses. On y chante de grandes messes en musique ; on y dit de longs offices ; mais on n'y entend point la parole de Dieu. On prêche néanmoins dans de certains couvents de moines, après midi, mais ce sont des prédications particulières à ces Ordres-là, et toujours sur le même sujet. Les Dominicains prêchent éternellement sur le Rosaire ; les Carmes, sur le Scapulaire ; les Franciscains, sur le Cordon de S. François ; les Soccolans, sur S. Antoine de Padoue. Ce sont des matières assez sèches d'elles-mêmes, et je m'étonne comme ils y peuvent fournir continuellement. Il est vrai que presque tout le sermon consiste à rapporter des miracles, qu'il est aussi aisé au prédicateur de forger que de débiter. Les Jésuites ont érigé dans leurs maisons, des congrégations qu'ils appellent de la Vierge, et ils y prêchent aussi les dimanches et les fêtes. Afin d'attirer toutes sortes de gens à eux, ils font une distinction des personnes. Ils ont une congrégation pour les artisans, une autre pour les écoliers, une troisième pour les marchands, et une quatrième pour les nobles. Ils prêchent aussi dans leurs églises, à de certains jours, pour préparer les gens à bien mourir. Ils se sont emparés de cette dévotion-là, qui leur est fort utile ; car on les va quérir aussi pour venir faire des exhortations aux malades, et à ceux qui font à l'article de la mort. Et c'est là le temps le plus propre pour eux pour se faire écrire dans les testaments.
Il y a une autre sorte de prédicateurs en Italie que je n'ai point vu dans aucun endroit où l'on professe le papisme. Ce sont des prédicateurs qu'ils appellent «Prédicateurs de la place». Pour mieux entendre ceci, vous saurez, Monsieur, que dans les villes d'Italie, vers le soir, quand la grande chaleur est passée, les Italiens de quelque rang ou qualité qu'ils soient vont se promener à la place. C'est là qu'ils donnent audience, et qu'ils traitent de leurs affaires. Si l'on veut trouver quelqu'un à ces heures-là, la première chose que l'on fait c'est de l'aller chercher à la place. Il s'y rend toujours une grande quantité de chanteurs de chansons, de joueurs de gobelets, de charlatans, de diseurs de bonne aventure, et d'autres sortes de gens qui trouvent leur avantage dans la multitude. Le monde ne manque pas de s'assembler autour d'eux pour en avoir du divertissement, et entre autres on y voit plus de prêtres et de moines que de séculiers ; car après qu'ils ont dit leurs messes le matin, il n'y a point de gens qui soient plus oisifs qu'eux le reste du jour. Lorsque les charlatans montent sur leurs théâtres, je ne sais par quel motif ou quel zèle, on voit venir en même temps un moine avec un grand crucifix que l'on porte devant lui, et une petite cloche que l'on sonne. Il monte dans une chaire portative préparée dans un des côtés de la place opposée aux théâtres des bateleurs, et là il commence à prêcher. Une foule de peuple accourt de tous les côtés de la place pour l'entendre. J'étais fort édifié au commencement que j'étais en Italie de voir tant de gens quitter les comédiens pour aller entendre le sermon : mais m'étant aussi approché pour les entendre, je vis que ces prédicateurs faisaient encore plus rire que les bateleurs, par leurs plaisants discours et gestes ridicules. Les charlatans sont les fous sur leurs théâtres, et eux ils sont bouffons dans leurs chaires. Tandis que ceux-là s'efforcent de vendre leurs drogues pour avoir de l'argent, ceux-ci font faire une quête dans la place au nom des pauvres, et ils recommandent l'aumône avec beaucoup de chaleur : mais tout l'argent qu'on ramasse est pour eux-mêmes. Je me trouvai une fois dans une compagnie de moines, qui assuraient impudemment, que ces sortes de sermons dans les places, étaient une preuve manifeste de la vérité de la religion romaine contre les hérétiques : puisqu'en cela s'accomplissait visiblement l'oracle du Saint-Esprit au livre de la sagesse, qui dit, que la sagesse crie dans les places publiques : Et que cela s'exécutait uniquement parmi les Catholiques romains, où la sagesse, c'est-à-dire la parole de Dieu, se faisait entendre en public par le moyen de ces prédicateurs des places. Pour moi, Monsieur, je suis persuadé que si la sagesse y crie, c'est pour demander vengeance à Dieu, de l'abus qui s'y fait du Saint-Évangile, que l'on y tourne en ridicule pour faire rire le peuple. On ne peut pas dire non plus, que la sagesse y fait entendre sa voix par rapport aux personnes de ces prédicateurs ; car la plupart sont des moines extrêmement débauchés. J'en ai connu un à Venise, qui était un misérable scélérat, lequel à la sortie de la chaire, allait dépenser l'argent de sa quête dans des lieux infâmes avec des vilaines. Les Catholiques romains ne savent à quoi se prendre pour donner des signes visibles de la vérité de leur Église. Ils en produisent d'autres pitoyables que celui-ci ; entre lesquels ils content une certaine coutume introduite en Italie, de faire prêcher publiquement des enfants dans les églises, depuis Noël jusqu'aux Rois. Ils prennent de jolis petits enfants de trois ou quatre ans, et ils leur font apprendre par cœur de petits sermons sur la naissance de Notre-Seigneur, qui peuvent chacun durer environ un quart d'heure. Ils les exercent de longue main à le dire avec bonne grâce ; et le jour de Noël, ils les font prêcher aux crèches que l'on dresse dans toutes les églises au temps de Noël. Ces petits enfants font toutes les cérémonies des prédicateurs. Ils commencent par leur Ave Maria ; puis ils font leur petite introduction, et ensuite une petite division. Après la première partie, ils font faire la quête. Tout le monde leur donne. Ensuite ils prêchent pour les âmes du Purgatoire. Sitôt qu'un a fini son sermon, un autre prend sa place, et en commence un autre. Et cela se continue tous les jours, depuis Noël jusqu'aux Rois. Ils commencent d'assez bon matin, et ils finissent bien avant dans la nuit. L'argent de leurs quêtes sert ensuite pour leur faire faire la collation, et leur acheter des sucreries. C'est ainsi que ces petits lionceaux font élever de bonne heure à la proie, pour dévorer ensuite — étant devenus grands prédicateurs — les aumônes qui sont données uniquement pour les pauvres. Cependant tout ce petit ménage ici, est expliqué par les Italiens comme un signe de la vérité de leur Église, et ils leur appliquent ce verset du psaume : Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem (4). Vous avez — l'expliquent-ils — perfectionné l'ouvrage de la prédication par la bouche des enfants. Ils disent qu'il n'y a que dans leur Église que cela se voit. Ceci me donne occasion de vous parler de cette grande marque de leur Église dont ils se vantent si fort, et qu'ils objectent aux Protestants avec tant de véhémence. C'est la mission de ces prédicateurs évangéliques qu'ils envoient dans les pays étrangers, au nombre desquels sont particulièrement comptés tous ces misérables Jésuites qui viennent en Angleterre. Je ne doute point qu'il n'y en ait encore aujourd'hui une grande quantité. Cependant je puis vous assurer que si les Jésuites d'Italie et des autres pays de la Communion de Rome envoyaient ici de leurs missionnaires à proportion de l'argent qui leur est donné pour cet effet, tous les pères de leur Ordre ne pourraient pas y suffire. Il n'est pas possible de s'imaginer les sommes immenses qu'on leur donne pour cette fin. C'est là le grand prétexte qu'ils prennent pour aller continuellement, comme ils font, dans les palais des Grands, dans les maisons des veuves et des personnes riches pour les faire contribuer à un si saint œuvre. Ils se contentent néanmoins d'envoyer un certain nombre de leurs Jésuites qu'ils entretiennent, et du reste de l'argent ils en font ériger toutes ces belles maisons, ou plutôt tous ces superbes palais qu'ils font bâtir pour eux. Aussi ne veulent-ils pas qu'on les appelle monastères ou couvents ; et ils en augmentent les fonds avec le même argument à proportion. Un pauvre capucin qui va demander l'aumône, est content quand on lui donne de quoi bien remplir son ventre : mais le prétexte des Jésuites est spécieux ; c'est pour la conversion des âmes, et il faut ouvrir la bourse toute grande : Ad majorem Dei gloriam — Pour la plus grande gloire de Dieu. Autrement ils ne sont pas bien satisfaits. Cependant nous voyons de nos yeux ce qu'ils font ici en Angleterre, où leur nom est devenu même abominable. Ce n'est pas tant pour leur application à convertir, ou plutôt à pervertir les âmes, que pour les artifices dont ils se servent pour troubler le repos du public. Comme il ne leur est pas possible de persuader les gens par la faiblesse de leurs pauvres raisonnements, ils tâchent de mettre tout un royaume en combustion, et d'armer les Protestants les uns contre les autres, afin que s'étant entre-tiré le sang des veines, quelque prince catholique puisse faire ensuite plus facilement main basse sur le reste, et exécuter ainsi par le fer, ce qui leur est impossible de faire par la raison. C'est ce que me disait un père jésuite à Milan il y a environ trois ans. Nos révérends pères jésuites d'Angleterre, disait-il, nous écrivent que les Anglais sont extrêmement opiniâtres à persister dans leur hérésie ; et que le seul moyen de les convertir, c'est de les exterminer. C'est à quoi nos pères travaillent puissamment, et nous espérons de voir bientôt que Dieu aura béni leur entreprise. Lorsque j'arrivai à Londres, il y a environ un an et demi, les Jésuites étaient devenus extrêmement insolents. M'étant trouvé dans quelques occasions de disputer contre eux, comme ils se voyaient pressés et ne pouvaient pas répondre, ils se mirent à railler, et à dire que tous mes beaux raisonnements ne m'empêcheraient pas d'être damné. Un autre plus rusé, et peut-être aussi plus malin, me dit qu'il avait par écrit dans son logis des arguments invincibles ; et que si je voulais prendre la peine d'aller chez lui, il résoudrait facilement toutes les objections que je lui faisais. Je n'avais garde de me fier à un si honnête homme, et je me contentai de lui dire, que je le priais d'aller prendre ses papiers, ou de me donner un autre rendez-vous que sa maison. C'est ce qu'il ne voulut point faire. Après quoi je m'aperçus que ces Jésuites entreprirent de me faire quitter Londres. Pour cet effet, comme ils ne pouvaient pas l'exécuter ouvertement par la force, et que je me tenais fort sur mes gardes, ils mirent à mes trousses un grand nombre de coupe-jarrets et de filous, qui me suivaient partout pour me surprendre : mais comme je n'allais jamais la nuit dans les rues, ces bons missionnaires ne purent exécuter leurs desseins ; et la Révolution [de novembre 1688] qui suivit un peu après, les obligea de penser à autre chose. On ne voit point que les Jésuites soient si empressés d'aller dans les autres pays protestants, comme ils le sont de venir en Angleterre. On n'en voit pas beaucoup en Suisse ni en Allemagne. C'est que ce pays-ci a un charme tout particulier pour eux. Il y a plus d'argent, et s'ils pouvaient devenir un jour confesseurs et directeurs de toutes ces belles dames anglaises, cela leur plairait fort. On sait d'ailleurs quelle vie ils mènent ici, et que ce n'est pas une vie pénitente. Je ne vois donc pas que leur mission doive être une marque si infaillible de la vérité de la religion romaine, comme les Papistes le prétendent. Et on pourrait à bien plus juste titre attribuer cette marque — si c'en doit être une au temps où nous sommes — à ces zélés ministres protestants, qui ayant déjà souffert la prison et l'exil pour la défense de l'Évangile, sont retournés secrètement en France dans le plus fort de la persécution, et sont allés dans des provinces où ils n'étaient point connus, pour fortifier et encourager leurs frères à la persévérance, et tâcher de relever ceux qu'une trop grande fragilité avait fait succomber. Il n'y avait point là d'avantages temporels à espérer, et ils pouvaient s'assurer que si on les eût pris sur le fait, on les aurait envoyés aux galères ou condamnés à la mort, comme il est arrivé à plusieurs d'entre eux. Mais pour les Jésuites, ils sont si fort persuadés qu'on ne leur fait rien souffrir ici sur le point de la religion, que nonobstant tous les arrêts du Parlement qui sont seulement pour prévenir leurs mauvais desseins, ils s'y tiennent encore fort librement. Cependant quand ils s'en retourneront en leur logis, ils ne manqueront pas de publier partout, comme ils ont coutume de faire, qu'on les aura fort persécutés, mis en prison, et tourmentés ; et qu'on les aurait mis à mort, mais que par l'intercession de la Vierge ou de quelque saint auquel ils se sont voués, ils ont été miraculeusement délivrés.
Je repasse présentement en Italie, où je trouve encore une autre sorte de missionnaires, qui ne sont pas pour les pays étrangers, mais pour l'Italie même. Ce sont des moines tantôt d'un Ordre, tantôt d'un autre, mais fort souvent des Capucins, et encore plus ordinairement de certains frères que l'on appelle les Pères de la Mission. Après qu'ils ont disposé un assez bon nombre de sermons sur différentes matières, ils écrivent à Rome pour demander au pape leur mission ; c'est-à-dire, permission d'aller prêcher leurs sermons dans de certaines villes, ou provinces, avec toutes les indulgences, et le pouvoir d'absoudre de plusieurs cas réservés que l'on a coutume d'accorder en ces sortes d'occasions. La première que je vis ce fut à Montefiascone, à deux journées et demie de Rome. C'était des Capucins qui la faisaient. Outre leur habit, qui est extrêmement grotesque, et leurs grandes barbes, ils avaient pris de grandes calottes rouges sur leur tête, pour signifier le zèle et l'ardeur enflammés de leur charité pour la conversion des âmes. Car c'est encore un signe de la véritable Église, que de même que le Saint-Esprit descendit visiblement en forme de langues de feu sur les têtes des Apôtres, il se trouve encore aujourd'hui dans l'Église de Rome, des têtes que le feu de la pourpre distingue des autres ; c'est aussi la raison pourquoi les cardinaux qui sont tout amour de Dieu, ou plutôt qui le devraient être, portent des chapeaux rouges, et le pape un bonnet de la même couleur. La curiosité me porta d'aller entendre prêcher ces calottes rouges. J'entrai dans l'église, et je vis un de ces prédicateurs en chaire, avec une grosse corde au col, et un grand crucifix entre ses bras, qui s'efforçait d'exciter des affections sensibles dans le cœur de ses auditeurs. Le principal but de ces gens-là, c'est de faire pleurer le monde. S'ils peuvent une fois obtenir cela, ils sont heureux ; et c'est tout ce qu'ils demandent. Car cela leur attire la réputation d'être de grands missionnaires, et des hommes véritablement apostoliques. Pour cet effet ils se servent des paroles les plus tendres et les plus affectives qu'ils puissent trouver pour exciter aux larmes. Le prédicateur que j'entendis paraphrasait l'histoire de la Passion de Notre-Seigneur. Après s'être efforcé de représenter Jésus-Christ comme le plus beau d'entre les hommes, il faisait paraître d'un autre côté les impitoyables bourreaux, qui liaient avec de grosses cordes ses belles mains blanches comme de la neige, et frappaient sur son beau visage vermeil parsemé de lis et de roses. Il accompagnait ses expressions d'un ton de voix tout à fait lamentable, et avec des gestes fort bien compassés et proportionnés au sujet. Je reconnus par là que ce père était un excellent déclamateur. Alors quelques bonnes femmes toutes émues de compassion — comme le furent autrefois les femmes de Jérusalem qui pleuraient en voyant Jésus-Christ aller au Calvaire et auxquelles Notre-Seigneur dît de pleureur sur elles-mêmes — firent entendre leurs soupirs, et un moment après le quartier des femmes étant tout en larmes, l'émotion passa jusque dans celui des hommes, et toute l'église fut remplie des gémissements et de soupirs. Ici le Capucin prenant occasion de pousser sa conquête, se mit à genoux, et posant son grand crucifix sur la chaire, il éleva ses deux mains au ciel, et d'une voix lugubre et effroyable, en serrant la corde qu'il avait autour du col, comme s'il eût voulu s'étrangler, il s'écria : Miséricorde, miséricorde. Il répéta ce même mot, toujours avec plus de véhémence, environ quarante ou cinquante fois, jusqu'à ce que tout son auditoire se fut mis à crier comme lui. Alors on entendit un bruit épouvantable qui dura bien un gros quart d'heure, jusqu'à ce que l'estomac n'y pouvant plus fournir, le bruit diminua par degrés, et il se fit un grand silence, qui donna lieu au père de reprendre son discours, qu'il continua presque dans les mêmes affections de tendresse jusqu'à la fin. Je ne prétends pas blâmer ici la sensibilité du cœur humain sur ce qui concerne la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; bien loin de cela, je souhaiterais qu'il fût en mon pouvoir de l'imprimer dans le cœur de tous les hommes. Mais toujours cela ne m'empêchera pas de dire, que ces affections-là passent ordinairement comme un éclair ; et que de bons motifs, bien solides que l'on donne dans un sermon pour porter le people à une vie véritablement chrétienne, restent longtemps dans l'esprit, et sont propres dans les occasions pour mouvoir la volonté ; et c'est ce que ces missionnaires-là ne font point. Aussi ne voit-on que les Italiens avec toutes leurs missions, en soient meilleures gens pour cela. Après trois semaines ou un mois que ces sortes de missions-là durent, ils vont planter avec beaucoup de solennité, à quelque endroit élevé proche des villes où on les a faites, une grande croix de bois de trente ou quarante pieds de haut, ad perpetuam rei memoriam. Cela se fait avec beaucoup de cérémonies et de superstition. Ils la vont tous adorer, ayant les pieds nus et la corde au col. C'est là que prédicateur ferme la mission en donnant une grande bénédiction au peuple, et toutes les indulgences que le pape lui a envoyées.
Je rencontrai une fois des missionnaires dans les montagnes de l'Apennin, qui venaient prêcher d'une ville dans le comté d'Ombrie. Un gros garçon qui les était allé conduire environ sept ou huit miles de chemin, et qui les avait portés sur ses épaules pour leur faire passer un ruisseau, assurait qu'il n'avait jamais rien senti de si léger, et qu'ils ne pesaient pas plus qu'une plume. L'hôtesse chez qui ils avaient logé, dit en riant que ce miracle-là la surprenait d'autant plus qu'elle leur avait donné un grand dîner avant que de partir, et que quand il n'y aurait que ce qu'ils avaient mangé, ils devaient peser quelque chose. L'endroit où je les rencontrai était un autre hôtellerie, où ils se faisaient encore préparer un second dîner.
Par là je compris que tous ces zélés missionnaires avec leurs cordes au col ne sont pas toujours les plus grands amateurs de la pénitence ; de même que les Pharisiens qui portaient écrits leurs fronts les Commandements de la Loi, n'en étaient pas les plus grands observateurs. Cependant c'est à ces sortes de missionnaires que les Catholiques romains assurent que le don de la prédication est particulièrement communiqué dans la division que le Saint-Esprit fait de ses grâces. Pour moi je croirai toujours que ce beau privilège appartient en premier chef aux évêques et aux ministres des églises. Ce sont là les véritables pasteurs que les brebis doivent écouter. Et l'on peut dire en un sens, que le ministère de la prédication a presqu'entièrement cessé en Italie ; où l'on n'entend quasi plus que la voix des étrangers ; je veux dire une infinité de misérables moines qui ne sont pas les curés des églises. J'ai déjà dit dans un autre de mes Lettres que durant l'espace de sept ans que j'ai demeuré dans ce pays-là je n'ai jamais prêcher aucun qui fût d'autorité ecclésiastique ; c'est-à-dire curé ou évêque, excepté le cardinal Visconti, archevêque de Milan (5), qui avait coutume de prêcher aux quatre fêtes principales de l'année dans son église cathédrale. Encore y trouvai-je un très grand inconvénient. Car ce cardinal-archevêque, pour prêcher avec plus de magnificence, et peut-être aussi par un motif de vanité, ne voulait pas permettre le jour qu'il prêchait, qu'on fit aucune prédication ni soir, ni matin dans Milan, qui est une ville extrêmement grande et peuplée. L'église est bien vaste. Cependant je ne crois pas qu'elle puisse contenir la cinquième partie des habitants dans une distance où l'on puisse entendre le sermon. De sorte qu'à la réserve d'un certain nombre de personnes, tous les autres sont privés ces jours-là d'entendre la parole de Dieu. J'allai une fois l'entendre prêcher à un jour de Pâques. Je puis dire que je le vis prêcher, mais je ne l'entendis pas. Le son de sa voix ne pouvait pas s'étendre jusqu'à moi, et à cause de la foule je ne pouvais m'approcher plus près. Il était magnifiquement revêtu de ses habits pontificaux, et avait la mitre en tête. Comme la chaire de Milan est fort spacieuse, il avait plusieurs chanoines assistants à ses côtés, revêtus aussi de superbes ornements. Après lui avoir bien vu branler la tête et remuer les mains, je sortis de l'église, sans qu'il m'eût été possible d'entendre un seul mot de tout ce qu'il avait dit.
Puisque je parle ici d'un jour de Pâques, je ne puis pas m'empêcher, Monsieur, de vous entretenir ici d'une plaisante, mais néanmoins fort détestable et abominable coutume, qui s'est introduite le saint jour de Pâques en Italie au sujet de la prédication. Ils disent que le jour de Pâques est un jour de réjouissance pour les Chrétiens. Haec est dies, quam fecit Dominus : exsultemus et laetemur in ea (6), et en effet c'en est un ; mais dans un autre sens qu'ils ne le prennent. Pour leur donner plus de divertissement, il faut ce jour-là que tous les prédicateurs pour gravés et modestes qu'ils puissent, êtres fassent les bouffons en chaire et comme une espèce de petite comédie. Afin que le monde puisse entendre le prédicateur avec plus de satisfaction, le sermon qu'il fait pendant tout le Carême le matin, se fait le jour de Pâques l'après-dîner ; parce que, comme dit le proverbe latin : Venter jejunus non delectatur musica (7). Le mot Alléluia est le texte que tous les prédicateurs prennent ; ce mot dans propre signification veut dire : «Louez le Seigneur». Mais le jour de Pâques en Italie, il veut dire : «Messieurs et Mesdames préparez-vous à bien rire». Ils entrent ensuite en matière, et racontent tout ce qu'ils peuvent de plus ridicule. Ces sermons-là servent tout le temps de Pâques d'un agréable entretien dans les compagnies, où chacun prend plaisir de raconter aux autres ce qu'il a entendu. M'étant trouvé un jour de Pâques à Bologne, j'allai entendre le sermon à l'église de San Pietro, qui en est la cathédrale. L'archevêque y était présent. Le prédicateur était un père succolan. Après avoir tourné plusieurs passages de l'Écriture saint en ridicule, il rapporta le second verset du chapitre 16 de l'Évangile de S. Marc, où il est dit que les Maries arrivèrent au Sépulcre après le soleil lève — Orto jam sole, comme il est écrit dans leur Vulgate. Ensuite il l'oppose au premier verset du chapitre 20 de l'Évangile de S. Jean, où il est dit qu'elles y arrivèrent de grand matin, lorsqu'il n'était pas encore jour. Il demanda ensuite, comme il était possible d'accorder ces deux Évangélistes qui semblaient se contredire (8). Pour lui il dit que sa pensée était que les Maries ne s'étaient levées que bien longtemps après soleil levé, et même bien près de midi. Car nous voyons, disait-il, que c'est encore bien matin pour nos dames italiennes qui ne viennent jamais à la messe les dimanches qu'il ne soit onze heures et demie ou midi. Là-dessus il décrivit tout le réveil d'une dame dans son lit : Comme il lui faut beaucoup de temps pour s'essuyer les yeux et se détirer les bras, et cent autres choses impertinentes qui faisaient extrêmement rire. Ensuite, comme ce père était fort fécond en belles pensées, il se reprit, et dit que véritablement les Maries s'étaient levées de fort bon matin, mais qu'il leur avait fallu tant de temps pour s'habiller et s'ajuster, qu'elles n'avaient pu sortir de leur logis que fort tard, et arriver au Sépulcre Orto jam sole. Ici il décrivit l'habillement des dames : Combien il faut de temps pour se coiffer, se farder, se mettre des mouches, et faire cent grimaces devant un miroir. Il les contrefaisait admirablement bien par ses gestes. Cette belle pensée fut suivie encore d'une autre. Je me reprends, dit-il, les Maries n'étaient pas si vaines que je viens de le décrire. Mais c'était des causeuses. Elles se levèrent et sortirent de leur logis de grand matin, mais auparavant qu'elles eussent dit adieu à tous leurs voisins et voisines, il se passa un temps considérable, et elles n'arrivèrent que fort tard au Sépulcre Orto jam sole. Là il s'étendit fort amplement sur le caquet des femmes, et dit des choses si ridicules que le cardinal-archevêque qui y était présent, riait lui-même à gorge déployée. Il continua ainsi son sermon de Pâques jusqu'au bout, en profanant d'une manière indigne un si saint jour, et la vénérable histoire de ces saintes femmes qui furent jugées dignes d'être les premiers témoins du plus grand mystère de notre foi, qui est la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ. J'entendis une autre année le jour de Pâques, étant à Venise, un Bénédictin génois qui, parmi un grand nombre de choses impertinentes, rapporta celle qui suit, qui vous fera juger du reste : Une jeune demoiselle, dit-il, nouvellement mariée s'affligeait extrêmement de ce que son mari lui disait souvent qu'il ne pouvait pas l'aimer, parce qu'elle n'avait pas les yeux noirs. Elle alla déclarer sa peine à son confesseur. Ce bon père qu'elle avait choisi pour directeur de sa conscience, lui dit qu'elle ne s'attrista pas, et que si elle voulait lui apporter tous ses joyaux, et de grandes pièces d'or que son mari conservait fort chèrement dans son cabinet, il lui obtiendrait de Dieu par ses prières d'avoir les yeux noirs. La demoiselle, dans l'ardeur qu'elle avait de devenir plus belle, ne manqua pas de suivre la direction du confesseur. Elle lui apporta les joyaux et les pièces d'or. Le mari ne les ayant pas trouvées, et connaissant par les réponses ambiguës de sa femme qu'elle était coupable, la battit à outrance pour lui faire confesser où elle les avait mis. Il la rendit toute noire de coups. La pauvre dame toute affligée, et les larmes aux yeux vint raconter son désastre à son confesseur, et lui redemander ses joyaux : mais le père les lui refusa, disant qu'ils étaient présentement à lui, puisque selon l'accord qu'ils avaient fait, il lui avait obtenu de Dieu la grâce qu'elle avait souhaitée d'avoir des yeux noirs. En effet la pauvre dame les avait tous pochés et noirs des coups que lui avait donnés son mari. Ne voilà-t-il pas une plaisante histoire et digne d'être rapportée en chaire au saint jour de Pâques ? Il y a même toute l'apparence que ce n'était là qu'un conte fait à plaisir. Ainsi ces vilains moines au lieu de prêcher la parole de Dieu au peuple, ne leur débitent ordinairement que des mensonges.
Je crois que vous ne serez pas fâché, Monsieur, d'une petite digression que je ferai ici au sujet d'une autre plaisante coutume qui s'observe en Italie, de bénir des œufs à Pâques, qui sont d'une grande vertu pour sanctifier les corps et les âmes. La veille et le jour de Pâques, tous les chefs de famille font porter à l'église de grands bassins pleins d'œufs pour les faire bénir. Il y a des prières exprès, de grands signes de croix et d'aspersions d'eau bénite que les prêtres font dessus. À chaque plat d'œufs qu'ils bénissent, ils demandent combien il y en a de douzaines, afin de savoir combien ils en retiendront pour eux. Ils en prennent quelquefois trois ou quatre par douzaine, selon qu'ils voient que les gens qui les apportent ont de quoi. Il y a quelquefois de pauvres gens qui pleurent lorsqu'ils voient que les prêtres leur en prennent trop, ou bien qu'ils leur prennent les plus gros. Ces œufs bénis ont la vertu de sanctifier les entrailles, et doivent être la première nourriture grasse qu'ils reçoivent après l'abstinence du Carême. Les Italiens s'abstiennent non seulement de viande pendant le Carême, mais encore d'œufs, de fromage, de beurre, et de toutes sortes de laitage. Les œufs étant bénis, chacun remporte son plat en son logis : et dans la plus belle chambre qu'ils aient, l'on fait dresser une grande table. Ils la couvrent de leur plus beau linge, et de fleurs. Ils mettent environ une douzaine de couverts tout autour, et leur grand plat d'œufs au milieu. Il y a du plaisir de voir ces tables-là dans les maisons des Grands ; car ils étalent sur des crédences tout autour de la chambre, toute leur argenterie, et ce qu'ils ont de plus riche et de plus beau, pour faire honneur aux œufs de Pâques, qui font aussi une fort belle figure ; car les coques en sont toutes peintes de différentes couleurs, ou dorées. Il y en a quelquefois vingt douzaines en pyramide, dans un même bassin. La table demeure toujours dressée toute l'octave de Pâques. Et tous les amis qui viennent rendre visite ce jour-là, sont invités à manger un œuf de Pâques, qu'ils ne doivent point refuser. Ensuite on leur sert de toute sorte d'excellent vin.
Je retourne présentement à la prédication. Il ne me reste plus rien à dire sur ce sujet, si ce n'est qu'il y a encore une autre sorte de prédicateurs qui ne prêchent qu'aux grilles des religieuses. Ce sont des prédicateurs en taille douce, des mines sucrées, et ordinairement de beaux jeunes moines. Car à moins que la beauté et la douceur ne se rencontrent dans un prédicateur, les religieuses qui ont la liberté de choisir le leur, n'en veulent point. Toute l'étude de ces gens-là est de trouver de beaux mots, des expressions tendres et affectives, et de se mettre continuellement sur les louanges des nonnes auxquelles ils prêchent. J'ai entendu plusieurs de ces sortes de prédicateurs ; mais entre autres un jeune moine à Milan qui prêchait aux Bénédictines du monastère majeur. À peine pouvait-il dire trois mots de suite, sans leur exprimer l'estime et l'amour qu'il avait pour elles. Mes très chères et aimables sœurs, que j'aime du plus profond de mon cœur, disait-il presque continuellement. De sorte qu'ayant compilé tout son sermon en moi-même, je vis qu'il ne se réduisait presque à autre chose qu'à dire, qu'il les aimait toutes du plus tendre de son âme. Lorsqu'une fois un moine peut arriver à être prédicateur des religieuses, et qu'il est goûté, il peut s'assurer d'être heureux, et de vivre dans une délicatesse et mollesse voluptueuse tout le reste de ses jours. Car les religieuses n'ont rien tant à cœur que de procurer à leurs directeurs et prédicateurs toutes sortes d'aises, afin de se les rendre plus indulgents. Elles leur donnent de grosses pensions tous les ans, les entretiennent de linge, les fournissent de toutes sortes de confitures sèches et liquides, et leur envoient tous les jours un plat ce qu'elles peuvent trouver de plus délicat, et que l'on appelle le plat du prédicateur. De sorte qu'il n'est pas difficile à ces beaux moines de témoigner en chair l'amour qu'ils ont pour les bonnes mères nourricières, et de s'étendre sur leurs louanges. Cette manière de louer en chaire, me fait ressouvenir d'une autre coutume introduite parmi les moines, de se louer publiquement les uns les autres à de certains jours de l'année. C'est ordinaire le jour de la fête de leurs bienheureux fondateurs. Par exemple, si c'est la fête de S. Ignace de Loyola, fondateur de l'Ordre des Jésuites ou Compagnie de Jésus, on fait ce jour-là le panégyrique de ce saint dans toutes leurs églises. Après avoir bien préconisé le patriarche, on passe à faire l'éloge de ses enfants ; c'est-à-dire de tous ceux qui suivent sa Règle, et spécialement des pères du couvent où l'on prêche. Or comme suivant le proverbe commun, Proprio laus sordet in ore — C'est une chose fort vilaine de se louer soi-même — ils prennent un religieux d'un autre Ordre pour venir prêcher ce jour-là dans leur église. Un chacun sait que tous les moines s'entre-haïssent mortellement les uns les autres. Cependant le désir d'être loués à leur tour, prévaut par-dessus leur haine, et leur fait entreprendre ces sortes de panégyriques. Le Dominicain loue publiquement le Jésuite, et le Jésuite le Dominicain ; et ainsi des autres. Ils conviennent tous que ces sermons-là sont les plus difficiles à faire, et que rarement on y réussit comme il faut ; soit que cela vienne de l'avidité trop insatiable que les uns ont d'être loués outre mesure ; ou du peu d'inclination que les autres ont de les préconiser, qui fait qu'au milieu des louanges qui leur sont données, on y découvre je ne sais quoi de contraint qui en découvre la fausseté. En effet, comment peut-on louer comme il faut des gens à qui l'on voudrait avoir arraché le cœur ? Un Cordelier prêchant le jour de S. François dans l'église de Santa Lucia des pères jésuites de Bologne, les loua assez plaisamment, en leur donnant des éloges entièrement opposés à ce qu'ils sont et à ce que tout le monde sait qu'ils pratiquent. Voyez-vous, dit-il, les Révérends Pères Jésuites de cette maison ; ce sont les meilleurs gens de la Terre. Ils sont modestes comme des anges : Ils n'ouvrent jamais les yeux pour regarder les dames dans l'église : Ils sont si amateurs de la retraite, qu'on ne les voit jamais dans les rues : Ils ont la pauvreté si fort en recommandation, qu'ils ne se soucient point du tout des richesses de ce mode : Ils ne vont jamais auprès des agonisants et des veuves pour se faire écrire dans les testaments : Ils ne s'intriguent point dans les mariages ; Et on ne les voit jamais faire la cour au cardinal-légat, ni au cardinal-archevêque. Il parcourut ainsi l'un après l'autre, tous les points de leur conduite. Tout le monde riait dans l'église, et les Jésuites étaient dans la dernière confusion. Le Cordelier ayant fini son sermon, descendit de chaire ; et au leur d'aller dans le couvent des Jésuites pour y faire la collation, selon la coutume des prédicateurs, il prit le chemin de la porte. Il craignait qu'ils ne lui donnassent la discipline ; et je crois même que pour éviter leur vengeance, il ne se laissa plus voir dans Bologne.
Voilà, Monsieur, ce que j'avais à vous écrire, touchant la façon de prêcher, et la conduite des prédicateurs en Italie. Il me resterait de leur opposer la manière de prêcher des messieurs nos ministres protestants, et leurs profondes et solides prédications. Mais afin que vous ne m'accusiez pas d'être trop attaché à louer ceux de mon parti, je me contenterai de vous dire, qu'ils annoncent au peuple avec beaucoup de modestie et de révérence la parole de Dieu ; et ce qui est principal, ils prêchent toujours la vérité et pureté de l'Évangile, dans laquelle je souhaite vivre et mourir. Je vous souhaite la même grâce, et suis, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Galates 4:30, «Chasse l'esclave et son fils ;...» : cf., Genèse 21:10, «Renvoie cette servante et son fils ;...»
2. À proprement parler, ce passage est une paraphrase de l'Apocalypse 6:9,10 : Cum aperuisset quintum sigillum vidi subtus altare animas interfectorum propter verbum Dei et propter testimonium quod habebant. Clamabant voce magna dicentes usquequo Domine sanctus et verus non iudicas et vindicas sanguinem nostrum. — «Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte : Jusques à quand, maître saint et véritable, différas-tu de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la Terre ?»
3. Pietro Loredan, doge de Venise dès 1567 jusqu'à sa mort en 1570 ; Almorò Grimani, frère du doge Marino Grimani et procureur de San Marco.
4. Psaume 8:3, «De la bouche des petits enfants, Même de ceux qu'on allaite, Tu tires ta louange...» : cf., Saint Matthieu 21:16, «Tu as tiré ta louange de la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?...»
5. Federico Visconti, naquit à Milan en 1617, fut élu archevêque de sa ville natale le 23 juin 1681, créé cardinal dans le consistoire du premier septembre 1681, et y mourut le 7 janvier 1693.
6. Psaume 118:24, «Voici la journée que l'Éternel faite : Livrons-nous-y à la joie et à l'allégresse.»
7. Venter jejunus non delectatur musica — «Ventre creux ne se délecte pas en musique» ; variante de «Ventre affamé n'a pas d'oreilles».
8. Saint Marc 16:2, «Le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever, elles [Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé] se rendirent au tombeau...» : cf., Saint Jean 20:1, «Le premier jour de la semaine Marie-Madeleine se rendit au tombeau de grand matin, comme il faisait encore obscur ; et elle vit la pierre enlevée de l'entrée du tombeau...»
SEPTIÈME LETTRE.
Des processions d'Italie, etc.
Ayant passé tout le Carême à Rome, j'en partis quelques semaines après Pâques, dans le dessein de m'en retourner en France. Je pris mon chemin par les terres du grand-duc de Toscane qui confinent avec celles de l'État ecclésiastique. On y entre par Radicofani, qui est un très haut escarpement, où il y a plusieurs grands bois tout autour, et c'est un lieu fort propre pour la chasse. J'y trouvai quelques cardinaux qui s'y divertissaient. De là on va en deux petites journées à Sienne. Sur toute la route je ne rencontrai que processions. C'est une coutume établie dans l'Église de Rome, de faire des processions après Pâques, qu'ils appellent Rogations. C'est afin d'obtenir de Dieu une bénédiction sur les fruits de la terre. L'année que je voyageai on en avait un besoin tout particulier, parce que la sécheresse était grande.
Une procession de la manière que les Papistes la définissent, est un acheminement du peuple d'une église à une autre, sous la conduite des prêtres, avec la croix et la bannière, pour y invoquer par l'intercession de quelque saint ou sainte, l'assistance extraordinaire de Dieu. La procession est quelquefois deux ou trois jours en chemin, avant que d'arriver au lieu où elle va. Et quand ils ont chanté leurs litanies, ils sont presque autant les fous que les pèlerins en leurs pèlerinages ; comme je vous l'ai déjà rapporté dans une de mes Lettres. C'est pourquoi je ne manquai pas de divertissement depuis Radicofani jusqu'à Sienne, où toutes ces processions s'acheminaient. Excepté que cela m'incommodait fort dans les hôtelleries ; parce que partout où ils passent ils y mettent la famine. Étant arrivé à Sienne, je m'informai de l'église où tout ce peuple allait en dévotion. L'on me dit que c'était à une église de Notre-Dame ; et que l'on y avait dévoilé une image miraculeuse de la Vierge, que l'on ne découvrait que de quarante en quarante ans. La curiosité m'invita à l'aller voir. La foule du peuple était si grande que j'eus bien de la peine à entrer dans l'église. On me dit qu'il y avait huit jours que le concours y était, depuis l'image était découverte ; et que dans huit autres jours on la devait recouvrir avec beaucoup de solennité. J'envisageai cette image, qui pouvait être d'un pied de largeur, et d'environ un pied et demi de hauteur. Elle représentait le visage d'une fille fort jeune ; et je n'y vis rien d'extraordinaire qui méritât qu'on lui rendît des adorations. Les prêtres qui desservent cette église de Santa Maria dell'Assunta, ne purent pas me donner une raison pourquoi l'on ne la découvrait que tous les quarante ans une fois. Ils me dirent seulement que c'était une coutume qui avait été observée de temps immémorial, et qu'ils croyaient bien que dans les commencements cela s'était fait par ordre de la Vierge.
J'ai vu en Italie une infinité de ces sortes d'images voilées, non seulement de la Vierge mais encore de crucifix, et de toutes sortes de saints et saintes, et je puis dire en vérité qu'à peine y a-t-il une église où il n'y en ait deux ou trois. On voit quelquefois dans un grand tableau où plusieurs saints sont représentés, un seul d'entre eux qui a le visage caché, et c'est là le saint mystérieux. Le secret de tout ceci, autant que je l'ai pu pénétrer, et que l'usage que les prêtres et les moines en font le fait voir, c'est que cela sert admirablement bien pour avancer leurs profits temporels. Les choses que nous voyons tous les jours de nos yeux deviennent trop communes, et font moins d'impression sur notre imagination. Il y a de certaines parties du monde où il y a six mois de nuit et six mois du jour, de sorte que toute l'année n'est qu'un jour et une nuit. Or, l'on dit que les peuples qui habitent ces contrées-là s'assemblent par troupes pour voir le soleil se lever : et dans ces pays ici où cet astre paraît tous les jours, nous ne voyons point que l'on s'empresse pour assister à son lever. De même, les images et les statues dans les églises de Rome ne feraient pas tant d'impression sur les esprits des peuples, et ne les émouvraient pas si puissamment à apporter leur argent, si les prêtres n'avaient trouvé les moyens de les rendre rares. Il semble même que le temps qu'elles ont été cachées les rend plus vénérables, et que les Catholiques romains s'imaginent, lorsqu'on les découvre, d'apercevoir dans ces tableaux, images ou statues quelque chose de plus divin qu'à l'ordinaire. Enfin, ils croient tous que lorsqu'on les découvre ici sur la Terre, les saints qu'elles représentent deviennent plus libéraux dans le Ciel et plus favorables à leurs vœux. Voilà où peut aller la superstition, ou plutôt la folie, lorsque ceux qui devraient être les plus zélés à la détruire, qui sont les gens de l'Église, sont les premiers à chercher les moyens de l'avancer. Le profit qui revient de ceci aux prêtres est grand, ainsi que vous pourrez comprendre de ce que je vous dirai à l'occasion de cette Notre-Dame de Sienne. Je séjournai neuf ou dix jours dans cette ville, et j'eus le temps d'aller plusieurs fois à cette église de la Vierge. Je ne saurais pas vous rendre un compte exact des présents que je vis y faire. Je vous dirai seulement que je ne crois pas qu'il entrât une seule personne dans l'église qui ne donnât quelque chose de fort considérable. Afin d'encourager davantage le peuple à être libéraux les uns à l'exemple des autres, les prêtres avaient eu l'adresse de disposer une place environnée de balustres proche de l'autel de la Vierge, où ils mettaient une partie des présents que l'on apportait. On y voyait une grande quantité de pièces de drap et de toile toutes entières, des mouchoirs, des chemises, plusieurs riches joyaux, et particulièrement une infinité de gros cierges de cire blanche dont les uns pouvaient peser cinquante livres — les moindres étaient de quatre ou cinq livres avec le nom de ceux qui les avaient donnés dessus. Pour ce qui est de l'argent monnaie, je crois que les prêtres le partageaient entre eux ; car quoique l'on mît incessamment dans les bassins, quelques heures après on les voyait vides. Quelques prêtres espagnols qui étaient de voyage, s'étant allés présenter pour dire la messe, reçurent dans la sacristie des bagues que des personnes de la campagne leur donnèrent, pensant que ce fussent les prêtres de l'église. On leur avait recommandé de les attacher au tableau ; mais ils les mirent dans leurs poches, et étant sortis de l'église, poursuivirent joyeusement leur voyage. L'un d'entre eux dit assez plaisamment, qu'il n'avait point de scrupule d'avoir fait ce vol, parce qu'il était dans une plus grande nécessité que l'image de la Vierge, qui n'avait besoin de boire ni de manger comme lui. Tous les habitants de Sienne et des environs s'assemblèrent le dimanche suivant en différents corps, selon qu'ils étaient distingués par leurs professions ou métiers, et tous firent une grande procession à l'église de Notre-Dame. Chaque corps marchait sous sa croix et sa bannière différentes, comme sous son propre étendard. Les savetiers, comme inférieurs à tous les autres, allaient les premiers ; l'écusson qu'ils avaient sur leur bannière était deux alênes en croix. Les cordonniers suivaient ; et tous les autres métiers ainsi par ordre. Après chaque bannière, suivait un homme avec un gros cierge de cire blanche, tant qu'il pouvait porter, qui était le cierge de la compagnie, tout doré et environné de rubans et de fleurs, avec un grand écusson dessus. Outre cela chaque membre de la société ou compagnie — ils les appellent società en Italie — avait son cierge particulier d'environ trois ou quatre livres. Après la croix, la bannière et le cierge, suivait un autre homme revêtu d'un surplis, qui portait une grande bourse au bout d'un beau grand bâton bien peint et bien doré. Dans cette bourse était renfermée la somme d'argent monnaie que chaque métier ou compagnie devait présenter à l'image de la Vierge. Il pouvait y avoir dans quelques-unes dix écus, dans d'autres vingt, plus ou moins, selon la capacité de chaque métier. Dans celle de la compagnie des marchands il y en avait bien deux cents, ainsi que je l'appris d'un marchand même.
Toutes ces confréries ne vont pas aux processions dans leur habit ordinaire, mais ils ont par-dessus de grandes vestes de toile de fin lin, teintes de différentes couleurs pour distinguer les compagnies les unes des autres. Ils portent par-dessus de belles ceintures, et sur l'estomac ou sur les bras les armoiries de leurs confréries. De plus ils ont une espèce de grand capuchon qui leur pend par derrière. Après la compagnie des marchands suivaient tous les Ordres religieux qui sont dans la ville et aux environs en très grand nombre. Ils marchaient selon l'ordre de leur antiquité ou réception dans la ville. C'est dans ces sortes d'occasions que l'on peut voir une fort plaisante bizarrerie d'habits. Les uns sont habillés de gris, les autres de brun, les autres noirs, d'autres blancs et noirs, etc. et tous avec leurs frocs et capuchons taillés en différentes manières, dont ils prétendent la plupart avoir reçu les modèles de la Vierge ou de Dieu même. Chaque Ordre allait sous sa croix et sa bannière : mais après la bannière on ne voyait ni cierge, ni bourse. Ils sont bien aises que les séculiers portent aux églises, et ils les y encouragent autant qu'ils peuvent : mais pour eux ils se donnent bien de garde de leur donner un seul denier. Il serait facile aux Italiens de faire réflexion sur ces choses-là s'ils voulaient, et cela leur crève même les yeux. Car en vérité, Monsieur, qui empêche tous ces moines-là qui sont tous si riches, et qui ont presque tous de grosses pensions et de l'argent en propre, qu'ils dépensent si prodigalement lorsqu'ils vont au cabaret et au bordel ; qui les empêche, dis-je, de faire aussi une bourse comme les séculiers, et d'avoir un gros cierge comme eux pour le présenter à la Vierge ? Mais c'est qu'ils ne sont pas d'humeur à porter de l'argent aux autres prêtres. Ils savent bien à quoi cela sert ; et si les séculiers avaient les mêmes pensées, ils les feraient passer au tribunal de la confession, pour des réflexions impies et sacrilèges.
Après les moines ou clergé régulier, suivait le clergé séculier qui sont les prêtres, les curés et les chanoines, ayant pareillement les mains vides. Le cardinal-archevêque était un peu indisposé, et sans cela je suis sûr que Son Éminence n'aurait manqué de s'y trouver aussi sans bourse et sans cierge. Les deux clergés étaient suivis des magistrats de la ville, et de tous les officiers de la judicature revêtus de leurs robes de cérémonies, avec leurs cierges et leurs bourses. Enfin toute la procession était fermée d'une troupe de jeunes messieurs et de gens d'épée. Tour cela s'achemina à l'église Notre-Dame, dans un fort bel ordre, au son des trompettes et des tambours, l'air retentissant d'ora pro nobis. Toute la cire et les bourses restèrent entre les mains des prêtres de l'église Notre-Dame. Vous pouvez juger de là quel avantage il leur en revient. Car, comme disait fort bien l'Espagnol, l'image n'a pas besoin de boire ni de manger, et il n'y a que les hommes qui puissent faire usage de l'or et de l'argent.
Deux ou trois jours après, comme les enfants se plaisent ordinairement à faire tout ce qu'ils voient faire aux grandes personnes, ceux de la ville s'assemblèrent par troupes. Les écoliers et les petites filles prièrent leurs maîtres et leurs maîtresses de les mener à la Notre-Dame. Ils firent des bourses où il y avait deux ou trois écus dedans. Deux jours après la grande procession, on ne pouvait presque aller dans les rues de Sienne ; car ces enfants, pour faire leurs bourses, tendaient à tous les coins de rue, de grandes cordes qu'ils tenaient par les deux bouts, afin d'obliger ceux qui voulaient passer de leur donner. Ils achetèrent ensuite des cierges, prirent des petites croix et des bannières, et s'en allèrent processionnellement à l'église. Les prêtres les reçurent aussi fort bien, et pleuraient de joie de voir de si beaux commencements dans des âmes si tendres et si innocentes. Le sixième jour on découvrit l'image avec une magnificence et une pompe tout à fait extraordinaire, et il y eut un concours de toute la noblesse de la ville et des environs. L'on avait été obligé de mettre des gardes aux portes de l'église, et on ne faisait entrer que les personnes les plus apparentes. J'entendis un vieux gentilhomme qui avec un grand sentiment de dévotion, remerciait Dieu tout haut, de ce qu'il avait eu le bonheur de voir vingt-deux fois en sa vie cette image miraculeuse de la Vierge. Cela me surprit d'abord ; car s'il eût été vrai que l'on n'eût découvert cette image que de quarante en quarante ans, et qu'il l'eût vue découvrir vingt-deux fois, il s'ensuivrait qu'il aurait été plus âgé que Mathusalem. Mais l'on me dit ensuite, qu'il ne se passait guère d'années que l'on ne la découvrit, selon que les besoins et nécessités publics l'exigeaient. Cela me fit comprendre la finesse des prêtres, qui pour mettre quelqu'une de leurs images en vogue, le cachent, et une chose si sainte qu'il n'est permis de la voir qu'une fois en plusieurs années. Quand ils voient ensuite que la dévotion a pris feu, et que leurs profits sont assurés, ils n'ont pas la patience eux-mêmes d'attendre si longtemps à faire voir les sacrés mystères ; mais ils prennent occasion de la première sécheresse, ou d'une trop grande humidité, de dire que la nécessité n'ayant point de loi, il faut découvrir l'image. Ainsi une image ou statue qui ne se devrait voir que de quarante en quarante ans, est mise au jour presque tous les ans. Cela leur acquiert même la réputation d'être honnêtes gens, pleins de compassion et extrêmement désireux de remédier aux misères publiques. Les moines et les prêtres s'accordent parfaitement bien sur ce point-là ; car ils ont tous quelque idole cachée dans leurs églises qu'ils découvrent de temps en temps chacun à leur tour : Hodie mihi cras tibi. Dans les monastères, où les abbés, prieurs ou gardiens sont triennaux, ils ont coutume de faire une grâce au public à leur première arrivée au monastère. Et c'est ordinairement ou de faire exposer le Saint Sacrement pendant trois jours, ou de faire dévoiler quelque image. L'idole n'en perd pas son crédit pour cela : cela passe pour une occasion extraordinaire, et ne laisse pas de passer dans l'esprit du peuple pour une chose qui ne se découvre qu'une fois en un certain nombre d'années.
Ce fut là le beau spectacle que j'eus à Sienne. Cette ville est aujourd'hui une des plus superstitieuses de toute l'Italie. On l'appelle par prérogative Sienne la dévote. Elle est aussi fameuse pour la pureté de sa langue ; car c'est là sans contredit où l'on parle le mieux italien. Après avoir visité tous les lieux de dévotion qui y sont, je poursuivis mon voyage. Je passai une seconde fois par la Toscane, et par Florence qui en est la capitale ; et me rendis ensuite en deux grandes journées à Bologne, qui est une fort belle ville. Elle se gouvernait autrefois en république : mais les papes l'ont réduite sous leur obéissance, et y entretiennent un légat pour y commander en leur nom. On voit sur la grande porte du palais du légat, qui est fort ancien, une statue de pierre qui représente une femme avec la tiare ou triple couronne papale sur la tête. Les Bolonais disent que c'est une figure de la religion : mais il y a quelque apparence que c'est une statue de la papesse Jeanne ; et ce qui peut favoriser cette pensée, c'est que les principales marques avec lesquelles les Papistes dépeignent la religion, ne s'y trouvent point ; savoir la croix dans une main, et le calice avec l'hostie dans l'autre.
Deux jours après mon arrivée à Bologne, j'allai voir la belle et célèbre abbaye de San Michele in Bosco, bâtie sur une agréable colline, à deux portées de mousquet de la ville. Il semble qu'on l'ait placée sur cette éminence pour la faire regarder et admirer de toute l'Italie. Elle est particulièrement renommée pour ses belles peintures ; Annibale Carracci, Guido Reni, et plusieurs autres fameux peintres, y ont mis comme en dépôt toute la délicatesse et perfection de leur art, pour le rendre plus recommandable à la postérité. Ce sont des moines olivétains qui vivent dans cette abbaye. Ils professent la Règle de S. Benoît, et sont habillés de blanc. Je m'étais arrêté à regarder les peintures des grottes ou du premier cloître qui est bâti en octogone, lorsque l'abbé se promenant après dîner avec quelques-uns de ses religieux, par une honnêteté extraordinaire s'approcha de moi, et prit la peine de m'expliquer lui-même les peintures, qui représentent quelques particularités plus considérables de leur législateur S. Benoît. Après quoi il me mena voir leur bibliothèque, laquelle est toute peinte et dorée avec de fort beaux livres, et qui est assurément une des plus belles que j'aie vues en Italie. Là, étant un peu entré en discours sur les livres, l'abbé me proposa si je voulais rester dans son abbaye pour enseigner les humanités et la rhétorique à ses religieux. Il dit qu'il me donnerait sa table et de fort bons appointements. Ce n'était pas mon dessein de rester en Italie, et je m'en retournais actuellement en France. Mais l'occasion se présentant si favorable, et ayant d'ailleurs assez d'inclination pour m'avancer dans la langue italienne ; après deux ou trois jours que je demandai à l'abbé pour y penser, j'acceptai ses offres. Il m'assigna un fort bel appartement, et me donna douze de ses jeunes religieux pour enseigner. Ils étaient presque tous comtes ou marquis ; car ces pères ne reçoivent parmi eux que des personnes de la première qualité. Je continuai deux ans entiers dans cet emploi, et ne manquai pas de recevoir mille honnêtetés de ces religieux pendant tout ce temps-là, et surtout d'expérimenter les bontés et générosités du prélat.
Vous ne pouvez pas douter, Monsieur, que je n'aie eu là une fort belle occasion de pénétrer tous les secrets de la moinerie. Car on agissait avec moi sans réserve ; et quoique je ne fusse pas l'un d'entre eux, je vivais néanmoins parmi eux, et rien ne m'était caché. C'est pourquoi j'en puis parler comme il faut ; et c'est ce que tâcherai de faire dans la première Lettre que je vous écrirai. Pour celle-ci, comme j'ai déjà commencé à vous parler des processions, je la continuerai sur le même pied, d'autant plus que je trouve ici assez de matière pour la remplir, et même assez curieuse. J'espère que le récit que je vous en ferai ne vous sera pas désagréable. Je commencerai par les processions qui se sont pendant l'Octave du Saint Sacrement à Bologne.
La fête du Saint Sacrement ayant été instituer pour faire triompher l'hostie en dépit des hérétiques, comme disent les Papistes, ils n'oublient rien pour rendre ce jour-là, et toute l'octave qui suit plus pompeuse et plus solennelle. Ils font de fort belles processions, et promènent l'hostie consacrée, qu'ils disent être le corps vivant de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par les rues avec un appareil et des cérémonies magnifiques. En France, l'on tend tout le dehors des maisons de belles tapisseries ; on jonche les rues d'herbes odoriférantes et de fleurs ; on dresse des oratoires ou reposoirs — comme ils appellent — pour faire reposer le Saint Sacrement, comme s'il était bien las ; on habille une infinité de petits enfants en anges pour lui jeter des fleurs, et lui donner de l'encens : enfin l'on fait dans les rues mille prosternations et adorations idolâtres. En Allemagne, ils garnissent toutes les rues, des deux côtés, de branches d'arbres avec leurs feuilles, et font de leurs villes comme de grandes forêts, ou plutôt comme de beaux jardins de plaisance, dont toutes les rues sont tout autant de grandes allées toutes vertes et à perte de vue. Mais l'Italie, comme la plus ingénieuse et aussi la plus superstitieuse, l'emporte de beaucoup par-dessus tous les autres pays catholiques romains. Bologne entre autres s'y est rendue remarquable par sa fameuse Octave du Saint Sacrement. Outre la grande procession générale qui se fait par la ville le jeudi après le dimanche de la Trinité — qui est le jour de la fête — où tout le clergé, tant régulier que séculier, et tous les magistrats de la ville assistent ; il y a chaque année trois paroisses destinées pour faire les préparatifs de l'octave. Quand elles ont fait leur tour, elle en sont quittés pour douze ou quatorze ans, jusqu'à ce que les autres aient fait aussi le leur ; car cela coûte extrêmement. Quinze jours ou trois semaines avant la fête, on barricade toutes les rues de ces paroisses, afin d'empêcher les charrettes et les chevaux d'y passer, et de donner lieu aux ouvriers de travailler. Le principal ouvrage qui donne le plus de peine, c'est de couvrir toutes les rues et les maisons de voiles de soie, qui sont de la manufacture de cette ville-là, et de les historier en figures. Toutes les paroisses, quand leur tour vient, s'efforcent de se surpasser les unes les autres par quelque nouvelle invention. Les unes font représenter avec ces petits voiles toutes sortes d'oiseaux ; les autres toutes sortes de bêtes à quatre pieds, de sorte qu'on n'en peut pas imaginer une seule qu'on ne l'y trouve. D'autres ont soin de faire représenter des chasses, des batailles, des triomphes ; en un mot une infinité de choses extrêmement plaisantes et curieuses à voir. De plus ils exposent dans les rues tous les plus beaux tableaux que les gens de la paroisse avaient dans leurs maisons, sans en excepter les profanes ; parmi lesquels on ne manque pas de voir plusieurs nudités infâmes, et des grotesques pour faire rire. Les Bolonais sont extrêmement curieux en peintures ; tous leurs cabinets, leurs salles et leurs chambres en sont pleins. Et comme ils les produisent dans les rues cette octave-là, on a la satisfaction d'y voir de fort belles pièces. De plus l'on dresse presque à tous les coins de rues des autels chargés de statues, d'images et de vases d'or et d'argent, et il y a toujours sur chaque autel quelque représentation au naturel de quelque mystère, ou de quelque saint ou sainte. Les maisons des grands seigneurs de ces paroisses sont toutes ouvertes ces jours-là, et ils ont eu soin de faire parer magnifiquement toutes leurs chambres, et d'y mettre en vue toutes leurs richesses. Il y en a quelques-uns qui sont si splendides et si libéraux, qu'ils donnent des rafraîchissements — qu'ils appellent sorbetti — à tout le monde, ou au moins aux personnes tant soit peu considérables. Et dans leurs courts ou leurs jardins ils ont des fontaines qui jettent du vin en abondance pour le menu peuple.
Toutes choses étant ainsi disposées, on fait la procession. C'est une œuvre qui sort de la main des prêtres, et ils épuisent tout leur esprit pour inventer quelque chose qui puisse plaire. Ils habillent plusieurs jeunes enfants en anges, leur attachant des ailes par derrière. Ils font plus de représentations de toutes les figures qu'ils croient avoir préfiguré Saint Sacrement, comme l'immolation d'Isaac, le sacrifice de Melchisédec, les pains de proposition, l'agneau pascal, etc. Ils représentent tous les prophètes et toutes les sibylles qui ont prophétisé de Notre-Seigneur. Ils font paraître ensuite la Vierge et les douze Apôtres, et Notre-Seigneur qui suit avec un pain dans Sa main, comme s'il le voulait rompre comme il fit dans la Sainte-Cène. Ensuite ils représentent beaucoup de leurs saints et saintes qui étaient les plus dévots au Saint Sacrement ; comme saint Thomas d'Aquin, saint Antoine de Padoue, sainte Rose de Viterbe, etc. Ce sont toutes figures vivantes ; c'est-à-dire de jeunes garçons et de jeunes filles les plus belles qu'ils peuvent trouver. Surtout j'y remarquai beaucoup de petits saints Jean-Baptistes. Pour faire de ces saints Jean-Baptistes, ils prennent de petit enfants de quatre ou cinq ans ; ils les mettent tous nus sans chemise, et ils n'ont qu'un petit ruban de couleur, qui leur passe en écharpe depuis l'épaule droite, et leur prend par-dessous la cuisse, de sorte que cela n'empêche pas de voir leur nudité. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on accuse les Italiens d'aimer également les deux sexes ; ainsi l'on ne s'étonnera pas de ce qu'ils ont tant de dévotion à ces petits saints Jeans. J'en comptai une fois jusqu'à vingt dans une procession, qui s'entre-suivaient les uns les autres. Ils tiennent d'une main une grande cire faite avec un roseau, et fort légère ; et de l'autre ils conduisent attaché en laisse, un petit agneau qui les suit. Après tout cet attirail, suivent les prêtres magnifiquement revêtus, et le Saint Sacrement qui est porté sous un riche dais, environné d'une infinité de jeunes garçons et de jeunes filles, habillés en anges, qui lui jettent des fleurs. Proche du dais il y a toujours une fort bonne musique, pour chanter les hymnes et cantiques du Saint Sacrement que l'Église romaine a composé en son honneur. Après le dais, suivent les principaux paroissiens, et après eux une foule de peuple. De cette manière ils promènent Notre-Seigneur — à ce qu'ils disent — par toutes les rues de la paroisse, et le font reposer à chaque bout de rue, sur tous les autels que l'on a préparés pour cet effet. La procession étant finie, on ne défait pas pour cela l'appareil des rues, mais on le laisse en son entier plusieurs jours, afin de donner le temps au peuple de la ville de le venir voir à son aise, et de faire le même tour qu'à fait la procession ; car en cela ils croient mériter beaucoup, et gagner de grandes indulgences. Tous les sbires du légat et de l'archevêque y restent toutes les nuits pour y faire la garde, afin que l'on ne dérobe rien. C'est particulièrement pendant les nuits que les messieurs et les dames s'y vont promener, parce que c'est alors qu'il y fait plus beau. Toutes les rues sont illuminées par une infinité de cierges et de flambeaux de cire blanche qui y brûlent de tous côtés, et qui rehaussent de beaucoup l'éclat de ce superbe appareil. C'est là qu'on fait l'amour à merveilles, qu'on donne les rendez-vous, et qu'on fait courir les billets ; et toujours quelque pauvre infortuné y reste sur le pavé la victime froide de la vengeance de ses ennemis, ou de la jalousie de ses rivaux. Toutes les courtisanes particulièrement, ne manquent pas de s'y rendre vers le soir, et d'y rester jusqu'à ce qu'elles aient attrapé leur proie. Enfin les plus innocents, ce semble, sont ceux qui y vont pour satisfaire leurs yeux, et contenter leur curiosité ; car pour de dévotion, on n'y en voit pas le moindre vestige. C'est ainsi que ces belles fêtes, instituées pour confondre les hérétiques, sont devenues en peu de temps, par un juste jugement de Dieu, des sujets de confusion pour les Papistes mêmes ; et je crains bien fort que Jésus-Christ ne leur dise à ce grand jour auquel il viendra juger les vivants et les morts, qu'il a eu leurs fêtes en horreur, et leurs encens en abomination ; parce qu'au lieu d'y avancer Sa gloire, comme ils semblaient se le proposer, ils n'y ont recherché qu'à satisfaire leur curiosité, leur vanité et leurs plaisirs infâmes.
J'ai vu plusieurs autres processions du Saint Sacrement à Venise, à Milan, et dans plusieurs autres endroits d'Italie : mais je ne m'arrêterai pas à les décrire, parce qu'elles se réduisent presque toutes à celles-ci ; excepté que l'appareil des rues n'est pas si beau, et ne reste pas si longtemps qu'à Bologne. Je ne trouve point que les prêtres avaient beaucoup de profit dans ces processions-là : au contraire ils y font de la dépense pour orner leurs églises et leurs autels. Mais d'ailleurs cela met beaucoup en crédit leur sacerdoce ; cela fait valoir leurs messes, et ils y paraissent avec tant de majesté et revêtus avec tant d'ornements pompeux, que le peuple en conçoit plus de vénération pour leurs personnes. Ils savent bien se récompenser de leurs frais dans d'autres occasions. Le dévoilement d'une image miraculeuse sert à les rembourser au double. Et c'est peut-être pour cette raison qu'à Bologne, fort peu de temps après l'Octave du Saint Sacrement, ils font cette grande cérémonie et procession de la Madonna di San Luca.
Pour vous en donner quelque idée, vous saurez, Monsieur, qu'à cinq miles de Bologne, sur une colline fort élevée, appelée la Colle della Guardia, il y a une église où l'on conserve une image de la Vierge, que les Papistes disent avoir été dépeinte par S. Luc. Les prêtres ont tant fait, qu'ils ont porté les magistrats à mettre la ville sous sa protection, et ils l'appellent leur patrone et leur conservatrice : Patrona et Conservatrix Bononia. Il y a une monnaie que l'on a fait battre en son honneur, où d'un côté cette image prétendue dépeinte par S. Luc est représentée, et de l'autre les armoires de la ville de Bologne ; ils l'appellent une madonnina. Les magistrats ont fait un vœu d'aller prendre cette image tous les ans, et de la promener en procession. Ils l'amènent de la colline Gardienne dans la ville, afin de lui faire bénir le peuple. Plusieurs jours auparavant l'ont fait de grandes préparations pour aller quérir en triomphe. Ils lui font faire un séjour d'environ huit jours dans la ville, pendant lequel on la fait changer de deux ou trois églises. Tout le monde y vient la visiter, et on lui fait de grands présents qui restent aux prêtres de ces églises-là ; et après qu'on l'a bien idolâtrée, on lui fait donner une bénédiction au peuple. Pour cet effet le tableau de la Vierge est attaché à de grands bâtons que des hommes soutiennent, et l'ayant élevée en haut, ils la font pencher vers le peuple, comme si elle les saluait ; après quoi ils élèvent un peu plus haut et la redescendent en bas ; puis ils la font aller à droit et à gauche, pour lui faire faire un signe de croix sur tout le monde qui est là présent, et c'est là la bénédiction. Pour la recevoir avec plus de révérence, tout le peuple se met à genoux, et la face contre terre. Pendant tout ce temps-là, les trompettes et les tambours font des merveilles. Après cette cérémonie, on la reconduit processionnellement sur la colline Gardienne. Elle y reste toute l'année, à moins que quelque calamité publique n'oblige les magistrats de permettre qu'on la mène extraordinairement en procession ; car alors ils croient qu'elle apportera du remède à tous leurs maux. Tous les samedis de l'année, il y a à cette image un grand concours de peuple, qui y va de Bologne et des environs.
Pour rendre le chemin plus commode, les Bolonais ont entrepris de faire un chemin couvert qui prend à la porte de la ville, et doit se terminer à celle de l'église où repose l'image. Il y en avait déjà plus de moitié de fait lorsque j'y étais. Ce sont de grandes arcades de briques fort larges et fort élevés, avec de belles voûtes toutes peintes. Ils sont pavés dessous fort proprement avec de grands carreaux de brique. Quand ce portique sera achevé, je crois que ce sera un des plus ouvrages que l'on puisse voir en Italie. Plusieurs seigneurs particuliers y ont signalé leur zèle, en ayant chacun fait faire plusieurs arcades à leurs dépens, sur lesquels ils ont fait dépeindre leurs armes. Cependant quoique cette entreprise soit si fort avancée, l'on craint de n'en pas voir la perfection, parce que ce qui reste à finir est le plus difficile, et ce qui coûtera davantage ; car il s'agit de faire aller ce portail sur la colline, toujours en montant jusqu'à la Notre-Dame de S. Luc ; et pour cela, il faut creuser bien avant pour trouver la terre ferme afin de poser de solides fondements. Un bon curé voyant que la dévotion a contribuer à la dépense était aussi fort refroidie, trouva lorsque j'étais à Bologne, un fort bon moyen pour réveiller les charités endormies. Il se servit de l'adresse suivante. Il avertit ses paroissiens, qu'il se sentait inspiré de la Vierge, de faire une procession à l'image miraculeuse avec douze chariots chargés de matériaux. Il les pria de vouloir montrer leur zèle à contribuer à une si sainte œuvre ; et que pour lui il prendrait le soin de mettre la procession en ordre, selon le modèle que la Vierge lui en avait donné en songe. Les paroissiens exécutèrent fort ponctuellement ce qu'il leur avait dit ; ils chargèrent quatre chariots de briques, quatre de chaux et quatre de sable. Après quoi le curé fit chercher partout des fleurs et des herbes odoriférantes, pour couvrir les chariots et faire des guirlandes aux bœufs qui les tiraient. Il leur fit dorer les cornes et les ongles des pieds. Il se mit à la tête du convoi avec la croix et la bannière ; et ayant disposé plusieurs jeunes filles avec des tambours de basque qui jouaient et dansaient autour des chariots, comme David fit autrefois devant l'Arche, il alla en cet équipage par toutes les rues de la ville de Bologne. Il eut l'approbation des Italiens, qui se plaisent aux choses nouvelles et bien inventées, et particulièrement où les femmes et les filles ont à faire quelque personnage. Cela eut un si bon effet, que tous les curés des paroisses résolurent de faire la même chose, et même de faire leur possible pour enchérir par-dessus. Quinze jours après l'on vit une procession générale de toutes les paroisses, avec plus de deux cents chariots chargés de briques, de chaux et de sable traînés par des bœufs avec des cornes dorées. Je n'ai jamais vu une procession si bizarre, ni plus divertissante. Tout cela s'achemina en fort bel ordre avec les croix, les bannières, les prêtres et les danseuses vers la Notre-Dame de S. Luc, et servit à faire construire un grand bout du portique. Lorsqu'il sera fini, qu'il pleuve ou qu'il vente, l'on pourra aller depuis Bologne, jusqu'au lieu de la dévotion sans se mouiller, ni se crotter ; car on y est autant à l'abri que dans une chambre (1).
Pour ne pas m'écarter du sujet de nos processions, je vous dirai, Monsieur, que les moines sont encore beaucoup plus inventifs que les prêtres sur cette matière-là. Il ne se passe presque point de fête ni de dimanche qu'il ne s'en fasse quelqu'une dans leurs monastères. Les Dominicains font tous les premiers dimanches du mois la procession du Rosaire. Les seconds dimanches de chaque mois, les Carmes font celle du petit Scapulaire. Les troisièmes dimanches, les Soccalans font celle de S. Antoine de Padoue. C'est dans ces processions-là des moines, que l'on voit en usage tout ce que la lubricité et la mollesse peuvent inspirer à des âmes efféminées ; bien loin d'être des occupations religieuses et de dévotion comme ils le prétendent. Par le peu que je vous en rapporterai, vous pourrez juger du reste.
Je commencerai par une procession du Rosaire que j'ai vue à Venise aux pères dominicains de Castello. Elle était ordonnée de cette manière. Après la croix et la bannière, marchaient environ deux ou trois cents petits enfants habillés en anges et en petits saints et saintes, entre lesquels ils n'avaient pas oublié plusieurs petits saints Jeans. Ceux-ci étaient suivis de trente ou quarante belles jeunes filles revêtues en saintes. L'une représentait sainte Apolline, et portait dans sa main pour être distinguée des autres, un bassin de vermeil doré où il y avait des dents. Une autre représentait sainte Luce, et portait dans un bassin deux yeux. Une troisième sainte Agnès ; elle tenait entre ses bras un petit agneau tout vivant. Et ainsi des autres, chacune avec sa marque de distinction. Il y en avait quelques-unes qui faisaient extrêmement rire ; surtout une sainte Geneviève : elle tenait un cierge allumé d'une main, et de l'autre un livre où elle lisait, ou faisait semblant de lire. Autour d'elle, il y avait sept ou huit garçons habillés en diables, tous noirs, avec de grandes queues, des visages tout à fait grotesques, et de grandes cornes. Ils faisaient mille postures, singeries et grimaces devant la sainte, pour tâcher de lui donner des distractions, en disant son bréviaire, et la faire rire. La fille qui faisait la figure de la sainte, avait été choisie d'un tempérament fort mélancolique, et faisait parfaitement bien son personnage. Elle regardait toujours dans ses heures, sans faire paraître le moindre sourire : mais tout le monde qui regardait passer la procession, éclatait de rire de voir les postures ridicules que faisaient ces petits diables, qui étaient assurément des plus impudents ; car quelquefois ils faisaient comme s'ils eussent voulu lever la cotte de la sainte. Cette sainte était suivie d'une autre qui n'était pas moins propre à faire rire. C'était une sainte Catherine de Sienne. Elle avait un joli petit enfant à son côté, qui représentait le petit Jésus, qui tenait d'une main un balai, et un soufflet de l'autre. Car ils tiennent que cette sainte, qui était une religieuse dominicaine, avait une si grande familiarité avec l'Enfant Jésus, que ce divin Enfant pour la soulager quand elle était lasse, venait balayer sa chambre et souffler son feu. Après ces bonnes saintes, venaient ce qu'ils appellent les figures, qui sont toutes les saintes femmes qui représentaient, selon eux, la Sainte Vierge dans l'Ancien Testament. On les avait élevées sur des brancards que des hommes portaient sur les épaules. On y voyait une Débora dans sa tente, avec Sisera à ses pieds, qui était un beau jeune garçon habillé en guerrier ; et elle avec un grand clou dans sa main, faisait comme si elle lui eût voulu percer la tempe. Après cette figure, venait une Dalila assise dans un fauteuil, avec un beau garçon entre ses genoux : elle tenait des ciseaux comme pour lui couper les cheveux. Après celle-ci, on voyait venir une Judith. C'était une fort belle figure ; car sur le brancard qui était fort large, il y avait plus de vingt personnes : Et cela représentait le retour de Judith en Béthulie avec la tête d'Holopherne ; lorsque les prêtres et le peuple allèrent pour la recevoir, et chantèrent un cantique à sa louange. Cette Judith était une des plus belles filles d'Italie, et fort lascivement habillée. Autour d'elle, sur le même brancard, l'on avait placé d'excellents musiciens qui chantaient des motets ravissants. Le brancard qui suivait, comme si l'on eût voulu opposer la laideur à la beauté, portait une vieille bonne femme toute édentée et fort laide, qui marmottait entre ses dents, et représentait Anne, mère de Samuel. Je m'étonnai qu'une femme de cet âge eût voulu monter sur un brancard. Après elle suivaient plusieurs autres brancards avec leurs différentes figures, jusqu'au nombre de dix-huit. Je ne m'arrêterai pas ici à vous les décrire, pour ne pas vous ennuyer ; je vous dirai seulement que la dernière de toutes, comme la chose figurée était la Sainte Vierge, était une très belle fille fort richement vêtue, avec un grand manteau royal. Elle tenait un grand rosaire ou chapelet dans la main gauche, et dans sa droite un sceptre. Elle avait une très belle couronne sur la tête, enrichie de perles et de diamants. Les personnes de qualité se font un mérite de prêter leurs joyaux pour orner les saints et les saintes des processions. C'est ce qui fait que l'on y voit souvent de grandes richesses. J'observai que lorsque cette demoiselle qui représentait la Vierge passa, portée sur son brancard, personne ne lui ôta le chapeau ; personne ne s'inclina ou se prosterna en terre pour l'adorer ou pour l'invoquer. Mais à quelque distance après, la statue de bois de la Vierge venant à passer — qui est celle qui est sur l'autel de la chapelle du Rosaire [dans l'église de San Giovanni e Paolo] des Dominicains de Castello — tout le monde se prosterna et se battait la poitrine, l'appelait Mère de Die, et l'invoquait. On lui faisait faire de temps en temps des inclinations et des bénédictions sur le peuple, de la manière que je vous ai dite en parlant de Notre-Dame de S. Luc de Bologne, lesquelles étaient reçues avec beaucoup de sentiment comme de grandes faveurs. Ayant appliqué mon esprit à rechercher quelle pouvait être la raison, pourquoi les Papistes ne rendent pas leurs adorations aux figures vivantes, qui néanmoins représentant la Vierge plus au naturel que des morceaux de pierre et de bois, et qu'ils sont si exacts à les rendre à ces statues inanimées. Après y avoir fait quelque réflexions, je n'ai pu m'imaginer autre chose, si ce n'est que notre nature ayant comme une horreur imprimée en elle-même, de rendre à la créature un culte qui n'est dû qu'à Dieu seul, les figures vivantes, et particulièrement l'humaine, découvrent davantage à nos sens leur être de créature, que ne font les insensibles, dans lesquelles on suppose plus facilement qu'il y a quelque vertu divine, secrète et adhérente. C'est ce qui est pourtant la dernière des folies, et la racine de l'idolâtrie. Je reprends le cours de notre procession. Cette statue de bois était portée au milieu des pères dominicains, qui pouvaient être au nombre de cent ; car comme ils ont plusieurs couvents dans Venise, ils s'entre-aident fort volontiers les uns les autres dans de semblables occasions. Il n'y avait rien de plus dissolu ni de plus effronté qu'eux. Ils avaient tous de grands rosaires autour de leurs bras ; mais pas un ne le disait, si ce n'est quelque pauvre vieux père qui n'était plus capable de faire figure dans le monde. Tous les autres se quarraient et marchaient d'une manière lascive avec leurs beaux habits blancs. Ils ne faisaient que causer et rire entre eux, et jeter les yeux deçà et delà sur les demoiselles qui étaient aux fenêtres ou dans les rues pour voir passer la procession.
Je crois, Monsieur, qu'il n'est pas fort nécessaire de vous faire faire beaucoup de réflexions sur ce procédé. Vous voyez assez par le seul récit que je vous en fais, à quoi peuvent aboutir ces sortes de processions. Ce ne sont que des amusements d'enfants, ou plutôt de sottes comédies pour de grands fous : mais qui exposent le christianisme à la dérision des athées et des infidèles. On m'a rapporté pour certain, que quelques marchands turcs qui virent passer cette procession, s'entre-disaient les uns aux autres : Avez-vous vu les folies ? Et, ne faudrait-il pas avoir perdu le sens pour se faire d'une telle religion ? Les Papistes se vantent comme d'une marque infaillible de la vérité de leur Église, qu'il n'y a point de société chrétienne qui s'emploie davantage à la conversion des infidèles, et qui y réussisse mieux qu'eux. Mais supposé que cela soit, on peut dire avec bien plus de vérité, qu'il n'y a point d'Église qui soit un plus grand obstacle à la conversion des infidèles que la leur, et que pour un qu'ils convertissent, ils en empêchent un million de se convertir, qui pourraient venir à la lumière de l'Évangile, s'ils n'avaient pas été les témoins oculaires des sottises qu'ils pratiquent. Ils font des choses qui font rougir même leurs Catholiques romains dans les pays étrangers où on leur en fait le récit. Les Papistes anglais prennent cela comme des exagérations ou des calomnies que l'on fait à ceux de leur parti pour le noircir. Tout ce que je puis dire à ces gens-là, c'est qu'ils prennent la peine d'aller en Italie eux-mêmes, et ils verront de leurs propres yeux encore plus d'extravagances que je vous en ai marquées dans mes Lettres. Les mêmes folies se pratiquaient anciennement en France parmi les Papistes ; mais la seule vue des Protestants qui étaient mêlés parmi eux, en a fait cesser une grande partie. C'est ainsi par une bonté toute particulière de Dieu, la seule présence des Protestants, porte une certaine bénédiction avec elle qui corrige le vice, confond l'erreur et inspire la vertu.
Je joindrai à cette procession que je vis à Venise, une autre que j'ai vue à Milan. C'était aux Carmes. Elle se faisait en l'honneur du petit Scapulaire dont je vous ai déjà parlé dans une de mes Lettres. Ce qu'il y avait de particulier en celle-ci, et que je toucherai seulement, pour ne pas vous faire une nouvelle description des anges et des figures, qui étaient de la même nature que celles que je vous ai rapportées : C'est que la plupart des jeunes demoiselles s'y trouvèrent dans leurs plus beaux habits et avec tous leurs joyaux. Elles marchaient quatre à quatre à la procession, avec de grands flambeaux de cire blanche qu'elles tenaient en leur main. Et elles chantaient des psaumes et des hymnes de la Vierge qui sont en usage dans l'Église romaine. Les femmes en Italie n'ont pas coutume de chanter dans les églises, cela leur étant défendu, à moins qu'elles ne soient religieuses. Les pères carmes s'étaient avisés d'introduire cette nouveauté dans leur procession, pour se donner à eux-mêmes la satisfaction d'entendre de si belles voix, ou au moins pour donner dans le génie des gentilshommes milanais à qui cela plaît extrêmement. Ils étaient rangés en haie des deux côtés des rues pour voir passer leurs dames, qui avaient le sein tout découvert, et marchaient avec un air de lubricité capable de donner bien de la dévotion à leurs amants. Il était environ une heure et demie dans la nuit lorsque la procession commença à marcher, et la lumière des cierges et des flambeaux rehaussait extrêmement l'éclat de cette troupe élite. On n'entendait de tous côtés que : Ah ! que voilà qui est beau ! La belle procession ! Que Madame la comtesse une telle a bonne grâce à porter son cierge ! Que celle-ci marche bien ! Que cet autre-là a la voix belle ! D'autres plus impertinents leur donnaient des mots à double entente en passant, qui au milieu d'un si saint exercice, ainsi qu'ils l'appellent, ne marquaient que trop la profanation de leurs cœurs. Après les dames marchaient les pères carmes deux à deux ; de sorte que toute cette procession n'était composée que de femmes et de moines, avec une statue de bois qui représentait la Vierge, et qui suivait après, à laquelle on rendait les adorations ; chacun se mettant à genoux dans les rues lorsqu'elle passait, pour recevoir les salutations et bénédictions que les bons frères carmes qui la portaient lui faisaient faire. Les moines et les prêtres se plaisent extrêmement de faire de semblables processions chacun dans leurs églises ; parce qu'ils y paraissent avec une pompe et un éclat qui donne dans les yeux, et fait que les simples s'imaginent voir en leurs personnes quelque chose de plus qu'humain, et qui n'est pourtant dans le fond qu'une folle vanité, et une pure illusion de l'esprit du monde.
Ils ne sont pas si échauffés à se trouver à de certaines processions qui sont pénibles, et auxquelles les dames ne peuvent pas se trouver si commodément. C'est ce que j'observai à Milan au temps des Rogations, qui viennent la semaine de l'Ascension. On a coutume dans tous les pays qui suivent la Communion de Rome, de faire ces trois jours-là des processions ; c'est-à-dire, d'aller avec la croix et la bannière d'une église à une autre pour faire des prières. Or à Milan la procession commence à une heure après minuit, et ne finit point qu'à deux heures après midi. Tous les prêtres de la ville, et des environs sont obligés de s'y trouver : on n'en excepte pas même les prêtres étrangers qui sont dans la ville. Ils doivent tous se trouver précisément à l'heure, au son de la grosse cloche, à la cathédrale pour se ranger sous la croix et la bannière. Or comme le grand attrait y manque, les prêtres aimeraient mieux dormir la grasse matinée, que de prendre la peine de s'y trouver. Mais le cardinal-archevêque Visconti, quoiqu'il n'y aille pas lui-même, a trouvé le moyen de les y faire aller. Par son ordre, tous les sbires de l'archevêché, renforcés de ceux de la ville, au nombre de plus de cent cinquante, armés de mousquetons, de pistolets et de baïonnettes, se diviser en plusieurs bandes de cinq ou de six, et vont par toutes les rues de Milan pour chasser les prêtres qui ne sont pas à la procession. Ils vont chercher jusque dans leurs maisons, et s'ils en trouvent quelques-uns, ils les lient avec des cordes les mains derrière le dos, et les traînent ainsi avec infamie par les rues, dans les prisons de l'archevêché. Quand ils sont arrivés aux portes des prisons, les sbires les fouillent, et après les avoir fort indignement traités, ils prennent tout ce qu'ils trouvent sur eux, et les jettent dans un cachot, où ils restent jusqu'à ce qu'on les fasse comparaître devant le tribunal de l'archevêché. Ils en sont pourtant quittés à la fin pour une petite réprimande et pour payer vingt écus au cardinal. Les prêtres, voyant qu'il n'y avait pas moyen de s'absenter de la procession, avaient trouvé le secret de se la rendre un peu plus douce. La procession va dans une seule matinée à dix ou douze églises, où elle entre, et s'arrête un temps considérable pour y chanter. Mais comme les prêtres qui sont en si grand nombre n'y peuvent pas tous contenir, la plupart sont obligés de rester dehors dans les rues autour de l'église. Ils trouvèrent donc le moyen d'entrer dans les prochains cabarets, et de s'y faire bien traiter pendant que leurs confrères chantaient à l'église ; après quoi ils les allaient relever, et l'Office se faisait de meilleur courage. Mais la chose étant trop vilaine et trop scandaleuse aux yeux du peuple, et quelques plaintes en ayant été faites à l'archevêque, il ordonna qu'une trentaine de sbires côtoieraient la procession, et feraient la recherche dans les cabarets. De sorte que les pauvres prêtres étant suivis de si près, ne peuvent plus aller boire le petit coup. Il y en a néanmoins plusieurs qui portent des bouteilles de vin dans leurs poches et sous leurs surplis, et ayant prié quelques-uns de leurs camarades de se tenir autour d'eux, ils se baissent pour n'être pas aperçus des sbires, et boivent fort adroitement. Lorsque la procession entre dans quelques églises de moines, les prêtres se jettent dans le couvent qui est tout proche, et là les moines traitent ceux de leur connaissance, et leur donnent à boire et à manger tant qu'ils veulent. Les sbires n'ont pas le pouvoir de les aller chercher là, et ils n'y seraient pas bien reçus.
La procession étant arrivée à une certaine église déterminée par l'archevêque, les douze préfets ecclésiastiques des douze portes de Milan qui sont des archiprêtres, et qui ont tout le clergé partagé entre eux, s'assemblent dans une grande place ; et chacun d'eux ayant une liste de tous les ecclésiastiques qui sont sous sa juridiction, ils les appellent tout haut les uns après les autres par leurs noms. Ils sont tous obligés de répondre, et de venir se présenter. Si quelqu'un y manque, on le marque, et on lui envoie ce même jour-là un billet à sa maison pour payer les vingt écus pour son absence. Toute la cérémonie et le tour des églises étant fini, la procession s'en retourne à la cathédrale. Il est environ trois heures après midi quand elle rentre, et au son de la grosse cloche, chacun a la liberté de s'en retourner chez soi, et les sbires n'ont plus le pouvoir de les prendre. Le monde rit de les voir passer, et courir comme ils font pour aller dîner ; car ils n'ont jamais été si affamés. On voit que ces processions des Rogations leur déplaisent extrêmement parce que, premièrement, il n'y a rien à gagner. En second lieu, les dames n'y vont point. Troisièmement, il n'y a ni anges, ni figures, ni rien qui les puisse divertir et faire rire. En quatrième lieu, ils n'y peuvent pas aller revêtus d'ornements pompeux, mais simplement avec le surplis et le bonnet carré ; c'est ce qui fait que les séculiers ne font pas la moindre démarche pour les aller voir passer. Cinquièmement, la procession leur étant commandée sous de rigoureuses peines, c'est alors qu'ils ont moins d'attrait pour y aller ; car autant que les prêtres aiment de commander impérieusement aux autres, autant ont-ils de répugnance à obéir. En dernier lieu, il y a un peu d'incommodité à souffrir. Il faut qu'ils se lèvent de bon matin, qu'ils fassent bien des tours, et qu'ils chantent beaucoup sans boire et sans manger. C'est ce qui est fort contraire à leur humeur. Ils aiment bien mieux ces charmantes processions du Saint Sacrement. Celle du dévoilement de quelque image miraculeuse, ou le procession du Santo Chiodo qui se fait à Milan en été, où non seulement tout le peuple de la ville, mais encore tout ce qu'il y a de noblesse dans les villes et les provinces circonvoisines, s'y rend en foule pour la voir passer. Là il ne faut point de sbires pour les forcer d'y aller. Le cardinal y est lui-même en personne, et porte la relique du Saint-Clou. Leur tradition porte que c'est un des clous qui percèrent les membres adorables de Notre-Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il fut attaché en Croix, et que le Grand Constantin par honneur fit mettre à la bride de son cheval. On le voit au travers d'un beau cristal posé sur un grand piédestal d'or pur parfaitement bien travaillé, et tout orné de pierres précieuses. C'est assurément une des plus belles pièces qu'on puisse voir, et si pesante que le cardinal avait bien de la peine à la soutenir. Ce clou est courbé comme ayant été mis en œuvre dans le fer de la bride. La réflexion que j'ai faite sur ce clou, est que par l'histoire même que les Papistes en font, il paraît que les reliques, et spécialement les instruments de la Passion de Notre-Seigneur, auxquels ils prétendent présentement que l'on doit rendre un culte de lâtrie (2), ne recevaient pas anciennement les honneurs divins ; puisque Constantin, ainsi qu'ils l'avouent, fit mettre ce clou à la bride de son cheval, qui n'était pas un honneur fort considérable. Il ne le fit pas élever sur les autels, comme il l'est à présent, et l'on ne fléchissait pas les genoux devant lui, comme les Papistes le pratiquent aujourd'hui ; car autrement il s'en serait suivi que partout où le cheval de Constantin aurait passé, l'on se serait prosterné en terre. C'est ce qui est absurde, et ce que l'histoire de ce grand empereur ne nous fait point connaître.
Puisque je suis insensiblement tombé sur les processions qui se font à Milan, je ne puis m'empêcher de vous faire la description d'une des plus fameuses qui s'y pratiquent la nuit du Vendredi saint. Cela se fait aux flambeaux, dans l'ordre qui suit. Après la croix et la bannière suivent les porteurs de croix. Ce sont des gens qui portent de grandes croix sur leurs épaules, de la longueur de quinze ou vingt pieds. Elles sont fort grosses, et fort pesantes en apparence : mais elles sont creusées par dedans, et ce ne sont que fort minces, collés ensemble. Cependant je veux bien croire qu'à cause de leur longueur et largeur, elles font raisonnablement la charge d'un homme, et même qu'elles embarrassent assez ceux qui les portent. Aussi disent-ils qu'ils font cela par un esprit de pénitence, et pour imiter Notre-Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il porta Sa croix au Calvaire. Ils sont bien au nombre de trois ou quatre cents, et la plupart d'entre eux ont la corde au cou, et de grosses chaînes aux pieds qui traînent sur le pavé et font un bruit épouvantable. Ils ont le visage caché avec de grands capuchons. Ces porteurs de croix me font ressouvenir de certains hérétiques dont le cardinal Baronius parle dans ses Annales Ecclésiastiques (3), et que l'on appelait Cruciferi. Ils avaient pris à la lettre ces paroles de l'Évangile [de S. Luc] : «Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple.» C'est pourquoi ils avaient chargé de grosses croix sur leurs épaules, et courant comme des fous par les montagnes et dans les déserts, ils ne les quittaient point que la faim, la soif et la lassitude ne leur eût fait rendre l'esprit. Il est vrai que ceux qui se trouvent aux processions dont je parle, n'en viennent pas à ces extrémités : mais toujours il y a quelque sorte de ressemblance dans leur action.
Au milieu de ces porteurs de croix, on portait dans un brancard, une figure de Notre-Seigneur allant au Calvaire. Après ces porteurs de croix suivaient les disciplineurs. Ils avaient de même le visage couvert avec leurs grands capuchons ; et ayant le dos tout découvert, avec de grosses disciplines qu'ils tenaient des deux mains, ils se battaient continuellement, et faisaient découler le sang de leurs épaules d'une manière qui faisait horreur à la nature. On portait de même au milieu de ces fouetteurs, qui étaient un très grand nombre, une figure de la flagellation de Notre-Seigneur attaché à la colonne. Ensuite on voyait venir plusieurs compagnies de soldats, qui portaient leurs mousquets et leurs piques la pointe renversée en bas, et leurs étendards de même. Tous les tambours étaient couverts de drap noir, et ils les battaient par-dessus le drap, ce qui rendait un son fort lugubre. Après les soldats suivait une figure vivante de Notre-Seigneur ; c'était un jeune homme, revêtu d'une grande robe de pourpre, avec une couronne d'épines sur sa tête, et qui portait une grande croix sur ses épaules. Il y a environ une vingtaine de garçons de lui habillés en Juifs, qui faisaient cent postures et grimaces ridicules. On ne pouvait pas s'empêcher de rire à un spectacle qui aurait dû attendrir les cœurs, parce que rarement les représentations saintes chez les Papistes sont exemptes de profanation. On ne se mettait point à genoux devant cette figure parce qu'elle était vivante. Elle était suivie de toutes les confréries de la ville qui sont en très grand nombre. Ils marchaient deux à deux avec des cierges allumés en leurs mains, et après eux suivait une autre figure de Notre-Seigneur dans le tombeau. Lorsqu'elle passa, quoique'elle ne fût que de bois, tout le mode se mettait à genoux dans les rues pour l'adorer. Autour de cette statue marchait une troupe de dames habillées de deuil, qui tenaient leurs mouchoirs à leurs yeux comme si elles eussent pleuré. Après ces femmes on voyait venir les prêtres, et après eux une statue de la Vierge percée au cœur de sept grandes épées qui y étaient attachées ; ils appellent cela une «Notre-Dame de Pitié». Partout où elle passait, on lui faisait les mêmes adorations qu'à celle de Jésus-Christ même. Une foule de peuple fermait ensuite la procession.
Je sais que les Papistes excuseront ces sortes de processions, et même les exalteront par-dessus les nues, disant que ce sont de saintes représentations qui rafraîchissent dans nos esprits l'idée de ce qui se passa autrefois sur le Calvaire. Mais pour moi je crois que le temps qu'ils emploient à disposer et mettre en ordre ces sortes de processions, et que les autres mettent à les voir passer, serait beaucoup mieux employé à lire et à méditer avec respect, chacun chez-soi, sur la véritable histoire de la Passion de Notre-Seigneur pour en tirer des affections saintes. C'en serait là un moyen bien plus efficace que d'habiller un homme en Jésus-Christ, dont on fait comme une farce pour faire rire le peuple ; car c'est là la conclusion de tout. C'est de même que quand ils représentent cinq semaines après Pâques, l'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ au Ciel. Ils ont une grande statue de bois qui le représente. Ils l'attachent avec de grosses cordes par la tête, et à midi, le jour de l'Ascension, au son de toutes les cloches, en présence de tout le peuple ; des gens qui sont sur les voûtes de l'église tirent peu à peu les cordes et l'élèvent en l'air. Les prêtres pendant ce temps-là chantent l'antienne Viri Galilaei, quid admiramini aspicientes in coelum. Quand la statue est prête d'entrer dans le trou qu'on a fait exprès dans la voûte, il y a des hommes qui jettent du haut des galeries de l'église, environ vingt ou trente sceaux d'eau sur le nez de ceux qui regardent. Il y en a qui sont tous trompés, et tout le monde rit à gorge déployée. C'est là la fin de la belle cérémonie ou sainte représentation, ainsi qu'ils l'appellent.
J'ai vu pratiquer ceci particulièrement en Allemagne. J'y ai vu aussi un grand nombre de porteurs de croix et disciplineurs, comme en Italie. On pourrait croire aussi ces gens-là seraient animés d'un grand esprit de dévotion et de mortification. Mais m'étant appliqué à pénétrer ce que c'en est, j'ai reconnu que la plupart le font par intérêt, et sont payés pour se fouetter ; parce que ce serait une honte, si dans une procession de Carême ou de la semaine sainte, il n'y avait pas un grande nombre de fouetteurs et de porteurs de croix. D'autres le font parce que leurs confesseurs le leur enjoignent par pénitence. Je ne sais pas pourquoi les prêtres se font tant d'honneur de cela ; mais je les ai vus souvent s'entre-reprocher les uns aux autres, qu'il n'y avait point ou fort peu de disciplineurs dans leurs processions. Il se peut faire que par une sotte vanité, ils croient que la gloire de ces sortes de pénitences publiques, rejaillit sur eux comme en étant les auteurs ; et ils se glorifient ainsi, comme l'oiseau de la fable, d'une chose qui ne leur appartient pas. Ils sont bien aises de voir les autres se fouetter, mais pas un d'eux n'en veut donner l'exemple ; et je n'ai jamais vu ni moines, ni prêtres se fouetter en public. La plupart de ces fouetteurs et porteurs de croix, pour se rendre la pénitence plus tolérable, s'enivrent avant que d'aller à la procession. Il en arriva un grand inconvénient à Mayence du temps que j'y étais. Plusieurs de ces porteurs de croix étant ivres, jetèrent au milieu d'une procession leurs croix dans les rues, et s'assirent dessus, disant qu'ils les avaient assez portées, et qu'il fallait qu'elles les portassent à leur tour. Et plusieurs disciplineurs se mirent à chanter, à danser, et à rendre par la bouche le vin qu'ils avaient pris. La plupart étaient écoliers des Jésuites, et leurs régents les avaient forcés à cette mortification involontaire.
Par là, Monsieur, vous voyez que les Papistes veulent avoir toutes choses à leur fantaisie. Ils ont tantôt fait un nouvel Évangile. Ils interprètent les choses si matériellement, qu'à la fin ils tâcheront de persuader au peuple que porter la croix en ce monde, c'est d'aller en procession avec de grosses croix de bois sur les épaulés ; et ils soutiendront conséquemment que c'est hérésie de croire avec les Protestants, que la véritable mortification est celle d'un cœur contrit et humilié, d'une âme saintement affligée et repentante. Il est comme impossible de faire avouer aux Jésuites, et aux prêtres de l'Église romaine qui viennent en Angleterre, que ces sortes de sots exercices de dévotion, sont aujourd'hui la plus grande occupation de leurs Catholiques romains dans les endroits où ils prévalent par leur nombre. Ils sont si honteux d'avouer leurs folies, qu'il n'y a aujourd'hui presque tous les voyageurs qui les en puissent convaincre, en disant qu'ils ont vu de leurs propres yeux, ce que ces autres-là dénient impudemment par leurs bouches. C'est par un effet de cette même honte que quelques Jésuites italiens et allemands, traitèrent en ma présence de calomnie, un certain chapitre d'un livre, qui traitait d'une dévotion qui se pratique encore tous les ans en Italie et en Allemagne, au temps de Noël, qui est d'aller dans les églises remuer le berceau du petit Enfant Jésus. Cependant il n'y a rien de plus vrai, et je l'ai vu faire plusieurs fois. Ils font sur un autel, ou dans une chapelle de leurs églises, une représentation de l'étable de Bethléem, avec de grandes figures qui représentent la Vierge, S. Joseph, et l'Enfant Jésus couche dans Sa crèche. Les Italiens excellent particulièrement en ces sortes de représentations, et en font leur divertissement tout le temps de Noël, et les femmes ont permission d'aller d'église en église pour les voir ; et c'est là encore où se font les bons coups. Il y a assurément quelque chose qui recréé fort les yeux. On y voit des rochers, des fontaines, des forêts, des plaines fort naturellement représentées, et les bergers qui y paissent leurs troupeaux. On les voit venir de toutes parts par des défilés, pour faire des présents à l'Enfant Jésus. Tout cela est fort naturellement représenté, et il y a toujours quelque chose de plaisant pour faire rire. Mais le point principal où je veux venir, c'est qu'au berceau de l'Enfant Jésus, il y a plusieurs grands rubans ou cordons attachés, que le monde qui est là présent et à genoux, prend et tire fort dévotement pour faire remuer le berceau, de même que nous voyons que les nourrices ont coutume de faire quand elles bercent leurs enfants. Ensuite ils chantent ce qu'on appelle en italien la nà, nà, qui sont des chansons dont on se sert pour endormir les enfants : Dors mon petit Jésus, dors mon amour, dors nà nà, nà nà. Ce qui me surprenait c'était de voir quelquefois de vieux hommes, ou de vieilles femmes, se lever tout en colère lorsqu'elles entendent trop de bruit dans l'église, et dire que l'on se taire, parce que l'on réveiller l'Enfant Jésus, qui n'est pourtant qu'une petite figure de bois ou de carton peint. Enfin il y en a qui se déchaussent en entrant dans l'église, de peur de l'éveiller. Pendant tout ce temps-là les moines et les prêtres rient eux-mêmes en derrière, dans leurs sacristies, de toutes ces folies. Je ne les ai jamais vu prendre les cordons pour branler le berceau, et je suis sûr qu'ils auraient de la confusion de le faire. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils l'entendent, quand ils disent que cela ne se fait point, parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes ; mais ils sont bien aises de voir le peuple occupé à cela pour leur donner du divertissement. Et ce petit jeu n'est pas même sans quelque profit pour eux : car il y a bien des gens qui apportent, les uns des œufs frais, les autres des poulets et des chapons pour faire des bouillons à la Vierge. Ils les mettent dans la sainte étable, proche de la statue. D'autres apportent des fromages et de grandes bouteilles de vins qu'ils mettent proche de S. Joseph. Enfin d'autres jettent des pièces de monnaie dans un grand bassin que les prêtres tiennent là exprès, et qui doivent servir, à ce qu'ils disent, pour les nécessités de l'Enfant Jésus.
Je me trouvai un jour à Mayence dans la sacristie des pères jésuites, avec cinq ou six de ces bons pères. Nous prenions plaisir à voir les présents que l'on venait faire à la crèche. Un pauvre paysan entre autres, apporta avec une grande simplicité et dévotion, une botte de foin, et la mit dans la sainte étable, entre le bœuf et l'âne. Les Jésuites qui s'en aperçurent, se dirent les uns aux autres : Fi, fi, il faut ôter cela vîtement ; cela ruinerait tout ; ils n'apporteraient plus que de l'herbe : Il vaut bien mieux qu'ils apportent de bons jambons et des langues de bœuf pour S. Joseph. Le sacristain courut pour l'ôter : mais le paysan s'y opposa, disant qu'il ne voulait pas que l'âne et le bœuf mourussent de faim. On lui dit pour l'apaiser, que l'Enfant Jésus ferait un miracle, et les soutiendrait par Sa vertu Divine. C'est ainsi que pour un misérable intérêt, ils abusent le pauvre peuple et le tiennent dans l'ignorance ; dont pour comble de malheur ils en font une vertu, qu'ils appellent simplicité et innocence. C'est à ces sortes de crèches, où j'ai dit dans ma lettre précédente que l'on fait prêcher de petits enfants. J'ai fait cette petite digression dans celle-ci qui ne vous sera peut-être pas désagréable.
Je reprends présentement le cours de nos processions, ou plutôt je finirai cette Lettre comme je l'ai commencée, en vous rapportant un autre dévoilement d'une image de la Vierge que j'ai vue à Milan, et que l'on disait qui ne se faisait que de cinquante en cinquante ans. Tous les corps de la ville et des environs l'allèrent visiter en procession, avec des cierges, des bourses, des présents, et des cérémonies presque semblables à celles que je vous ai déjà rapportées. Ce qu'il y a seulement de particulier, c'est que pendant tout le temps que l'image fut découverte, il y eut un grand concours de personnes possédées, et les prêtres étaient fort occupés dans tous les endroits de l'église à les exorciser. Les Papistes soutiennent que dans l'ordination leurs prêtres reçoivent la vertu de chasser les diables des corps, et que la pratique fait voir qu'effectivement ils y réussissent. Pour moi j'ai bien vu de ces sortes de possédés, et je me suis fort appliqué à les examiner ; mais je n'y ai rien découvert qui put me persuader que ce fût plutôt des opérations du Démon, que d'une forte imagination ou de quelque maladie violente. De plus, je n'ai presque jamais vu que des femmes possédées, et je voudrais bien savoir pourquoi le Diable les possédait plutôt que les hommes : mais la véritable raison de ceci, est qu'en Italie, les femmes sont particulièrement sujettes d'entrer dans des frénésies et étranges imaginations. Leurs pères et mères, ou leurs maris, les tiennent toujours enfermées dans des chambres ou dans des greniers, sans leur permettre de sortir que pour aller quelquefois à l'église. Comme avec cela, elles sont d'un tempérament fort chaud et amoureux, un objet agréable qu'elles auront vu par hasard de leurs fenêtres, ou à la messe, les transporte si fort qu'elles en sont toutes possédées, et non pas du Démon. Elles y pensent fortement jour et nuit, et la force de leur imagination faisant une merveilleuse impression sur les esprits vitaux, elle les échauffe et les confond ; et de là s'ensuit le désordre dans le corps, et les convulsions. L'église dont je parle était remplie de ces sortes de possédées. J'aperçus entre autres dans une des chapelles une fort belle demoiselle qui se battait continuellement la poitrine avec la main, et criait comme si elle eût senti quelque chose qui l'étouffait. Elle avait plusieurs autour d'elle qui lisaient les exorcismes. Surtout il y avait là un fort joli prêtre qui faisait des merveilles. La possédée n'en voulait qu'à lui ; et lorsqu'il la touchait, le Diable vaincu apparemment par la force de ses exorcismes, cessait de la tourmenter. Je m'étonnai de la liberté que ce jeune monsieur prenait avec sa possédée ; car quelquefois il la tenait embrassée par le corps, il lui maniait les bras, et lui donnait presque continuellement de petits soufflets sur les joues. Ils disent que le Diable, qui est un esprit orgueilleux, ne peut pas souffrir qu'on l'humilie ; c'est pourquoi ils ont coutume de souffleter et d'injurier les possédées. Les autres prêtres qui étaient autour de celle-ci, étendaient quelquefois la main pour la souffleter, mais la possédée entrait en rage et ne pouvait pas les souffrir ; de sorte qu'ils étaient obligés de se contenter d'injurier le Diable, tandis que le jeune prêtre le battait sur les joues de la demoiselle. Ce procédé excita même de la jalousie entre eux, et un des vieux prêtres dit au plus jeune avec une raillerie piquant : Dom Pietro, je vois bien que ce Diable n'en veut qu'à vous, et je crois que vous vous accorderiez bien ensemble. Enfin n'en déplaise aux prêtres de l'Église romaine, on ne voit pas pouvoir absolu qu'ils prétendent avoir sur les diables, si bien avéré qu'ils voudraient bien le donner à entendre au peuple. J'ai bien vu des possédées et des exorcismes : mais je n'ai jamais vu de délivrance. Je sais que l'on dit qu'il y a plusieurs gueux qui contrefont les possédés, afin de pouvoir obtenir par ce moyen une bonne subsistance ; et ceux-là, je ne doute point que les prêtres ne les délivrent tous. Cela donne beaucoup de crédit aux images mystérieuses que l'on ne découvre que de cinquante en cinquante ans.
Je laisse ici les possédés, pour venir enfin à la conclusion des processions papistes. Ils les définissent, comme j'ai déjà au commencement de ma Lettre, un acheminement du peuple d'une église à une autre, sous la conduite des prêtres, avec la croix et la bannière, pour invoquer l'assistance extraordinaire de Dieu. Mais en vérité, Monsieur, suivant tout ce que je viens de vous en rapporter, ne vous semble-t-il pas qu'elles seraient mieux définies, de magnifiques promenades inventées pour mettre en crédit les moines et les prêtres, et abuser le peuple à leur profit ? Nous n'avons aucun exemple de ces sortes de processions dans premiers siècles de l'Église. C'est une invention du cerveau des papes, et je crois que S. Grégoire le Grand fut le premier qui les institua dans un temps de peste. Elles se firent de son temps avec assez de modestie et de simplicité : mais ensuite le luxe et l'ambition des ecclésiastiques les ont si fort amplifiées, qu'il est aisé de juger qu'elles ne servent que pour leur donner de l'avantage et les faire triompher par-dessus les séculiers. Elles servent mêmes comme des marques publiques d'honneur pour les distinguer entre eux. Il n'y a rien dont ils soient plus jaloux que d'avoir la préséance dans les processions : les prêtres et les moines s'entre-plaident cruellement sur ce sujet ; et quelquefois il s'y passe bien du désordre, comme il arriva il a quelques années à Dijon, ville de Parlement en France, où les moines de S. Benoît ayant entrepris d'aller en procession avec de grosses cannes en leurs mains, comme une marque d'autorité sur le reste du Clergé, et dont ils se servaient quelquefois pour faire avancer les prêtres ; les chanoines de la Sainte-Chapelle se soulevèrent, et il y eut avec les croix et les bannières une furieuse escarmouche. L'ordre de la procession est que les moins considérables marchent les premiers, et les plus élevés en dignité suivent après ; de sorte que l'évêque marche le dernier de tous. Les Jésuites étant venus si nouvellement dans l'Église de Rome, et ne pouvant pas obtenir le premier rang dans les processions, y ont renoncé absolument et ne s'y trouvent point. Il n'y a qu'à Venise où le Sénat les oblige d'y aller : Et pour n'être point mêlés parmi les prêtres, ou parmi les moines, ils ont choisi dans la marche d'aller parmi les gens de métier. Les savetiers, les cordonniers et les tailleurs vont les premiers ; ensuite viennent les Jésuites, qui sont suivis des autres métiers.
Je finirai ici ma Lettre, et sans vous arrêter par une longue morale, je dirai seulement qu'étant une chose manifeste et visible, que ces sortes de processions dans l'Église de Rome, ne se font que pour servir à l'ambition et à l'intérêt temporel des ecclésiastiques ; les meilleures processions que l'on puisse faire ne sont pas d'aller d'église en église, mais de vertu en vertu jusqu'à la montagne du Seigneur qui est l'éternité bienheureuse. Optima processio fit procedere de virtute in virtutem usque ad montem Domini.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Le Porticato di San Luca, le portique le plus long du monde (3,7 km ; 666 arcades et 15 chapelles), fut construit de 1674 à 1739 d'après le dessein de l'architecte Giovanni Monti.
2. Le culte de lâtrie n'est dû qu'à Dieu : par contraste, le culte de dulie est celui adressé aux saints.
3. Cesare Baronio, naquit à Sora le 30 août 1538, fut nommé confesseur du pape Clément VIII en 1594, créé cardinal dans le consistoire du 5 juin 1596, nommé bibliothécaire du Vatican en 1597, et mourut à Rome le 30 juin 1607 ; celui-ci est l'auteur des Annales ecclesiastici en douze tomes (1588-1607).
HUITIÈME LETTRE.
De la corruption des prêtres et moines italiens
dans leurs dévotions et dans leur morale, etc.
Je vous ai déjà fait connaître dans ma dernière Lettre qu'un séjour de deux ans que je fis à Bologne dans l'abbaye de San Michele in Bosco m'avait fourni une occasion fort favorable de pénétrer dans la conduite des moines. J'aurais pu y rester plus longtemps, si les persuasions d'un noble Vénitien n'eussent prévalu sur mon esprit pour me faire aller à Venise. Il semble même que la Providence divine m'y conduisit pour y exposer de plus près à mes yeux la manière de vivre des autres ecclésiastiques, que l'on appelle prêtres séculiers. Ce n'est pas que j'en fusse fort ignorant auparavant, ayant toujours été élevé parmi eux, et l'un d'entre eux ; mais c'est qu'il y a quelque différence assez considérable entre les ecclésiastiques en Italie, et ceux qui vivent en France où j'ai reçu mon éducation. Les premiers vivent sans contrainte, et sans être beaucoup observés de ceux de leur nation, qu'ils ont corrompus aussi bien dans la morale que dans les dogmes, ainsi que je vous déduirai plus particulièrement dans la suite. Et les seconds, je veux dire les ecclésiastiques de France, ont appris l'art de dissimuler et se tiennent mieux sur leurs gardes, pour être moins exposés à la censure des Protestants qui éclairaient leur conduite de toutes parts.
Étant à Venise je fus assez heureux pour m'attirer la protection de quelques personnes des plus considérables dans la République, et en moins d'un mois de temps je me vis pourvu de trois petits bénéfices dans trois églises différentes. Cela me donna lieu de converser avec une infinité d'ecclésiastiques de toutes sortes de nations, qui viennent dans cette ville de liberté pour y jouir des douceurs de la vie. Après trois ans de séjour que j'y fis, j'entrepris un autre voyage de Rome, attiré par les promesses d'un cardinal qui mourut huit jours après que j'y fus arrivé. Cette mort ayant déconcerté les espérances que j'avais de faire un plus long séjour en cette ville, j'en partis quelques mois après pour m'en retourner à Venise, après avoir fait auparavant le voyage de Naples (1). Je passai à mon retour par Milan, sans aucun dessein d'y rester : mais la persuasion de quelques seigneurs milanais, l'emporta sur ma première résolution. L'abbé de la grande San Vittorio, entre autres, me fit des offres si considérables pour m'engager à venir demeurer dans son abbaye, et prendre le soin d'enseigner ses religieux, comme il savait que j'avais déjà dans l'abbaye de San Michele de Bologne du même ordre, que je me laissai aller à ses persuasions. Je me trouvai par ce moyen-là engagé de nouveau avec les moines.
Si je vous marque ici quelques endroits d'Italie où j'ai demeuré, et quelques emplois que j'y ai eus, ce n'est pas, Monsieur, dans le dessein de m'en faire un honneur particulier, ni pour m'en vanter ; mais c'est seulement pour vous faire connaître que si je parle présentement des prêtres et des moines de l'Église de Rome, je peux le faire savamment, ayant eu occasion de faire plusieurs remarques, que beaucoup d'autres qui ont écrit ne pouvaient pas faire. J'ai eu d'autres emplois en Italie, et en Allemagne, dont je pourrais me vanter davantage ; mais comme ils ne font rien au sujet que je traite, je les passe sous silence. Il est vrai qu'il ne serait pas quelquefois hors de propos de faire paraître au public que l'on avait dans les pays étrangers quelque emploi, et que l'on y pouvait subsister honnêtement ; afin de réfuter par là les calomnies que les Papistes ont coutume de jeter sur les prêtres de leur parti qui les abandonnent pour aller satisfaire leur conscience dans les Églises réformées. Ils disent ordinairement ou que ce sont des vagabondes, ou des gens qui n'avaient pas de quoi vivre parmi eux, et à qui leur condition est devenue odieuse faute de quelque bon bénéfice pour la soutenir ; ou enfin ils disent que ce n'est que le libertinage qui les fait changer. Cette dernière accusation, comme la plus odieuse, m'obligea lorsque j'étais en Italie, de prendre des attestations de bonnes mœurs, dans tous les endroits où j'ai fait quelque séjour, pour avoir en main les moyens de m'en défendre si quelqu'un avait assez de malice pour vouloir me mettre de ce nombre. De sorte que je peux parler par la grâce de Dieu ouvertement, et me mettre à couvert des langues envenimées. J'avoue néanmoins que le sujet de cette dernière Lettre, est beaucoup contre mon humeur et inclination naturelle de parler des vices et défauts des autres : Cependant j'ai considéré que si Jésus-Christ a si souvent déclamé contre l'hypocrisie des Scribes et des Pharisiens de Son temps pour l'instruction salutaire des peuples ; l'on peut aussi dans de certaines occasions, mettre au jour les défauts de ceux qui sont non seulement les corrupteurs de la morale, mais encore des dogmes et de la doctrine du Saint Évangile ; afin que l'on s'en puisse mieux garder : Cavete a fermento Phariseorum (2). Par là on verra aussi à quoi sert tout ce grand argent qui revient aux prêtres de l'Église de Rome, de leurs subtiles inventions et artifices de dévotion, dont je vous ai entretenu dans mes Lettres précédentes. Car enfin l'or et l'argent ne sont que pour le service des hommes ; et l'on peut juger par l'usage qu'ils en font, de la fin qu'ils s'étaient proposée lorsqu'ils cherchaient les moyens de l'acquérir. M'étant donc particulièrement appliqué en Italie, à rechercher à quoi les prêtres et les moines employaient leurs vastes revenues, j'ai reconnu que c'est pour satisfaire chacun leurs passions dominantes. Quelques-uns sont si idolâtres du trésor, que plus ils accumulent, moins ils pensent posséder, et meurent ainsi comme de petits Crœsus, pour ne pas dire comme de mauvais riches, au milieu de leurs richesses, dont ils n'ont pu être séparés que par la mort. C'est dans ces pays-là le cri commun des pauvres, qu'il n'y a rien de plus dur, de plus insensible, et de plus impitoyable que le cœur des gens d'Église. C'est peine perdue que de s'adresser à eux pour leur demander l'aumône ; on n'en a que des refus, et même des paroles de mépris et fort rebutantes. De sort que leur avarice est comme un gouffre où tout se perd, et dont rien ne sort. J'ai connu des prêtres qui avaient des coffres pleins d'or, et qui néanmoins s'épargnaient un morceau de pain. Quelques-uns avaient l'adresse de faire passer leur sordide avarice, pour un amour qu'ils avaient pour la mortification et pour l'abstinence : mais comme bien loin de donner un denier d'aumône, on voyait qu'ils ne pouvaient pas souffrir qu'on la leur demandât ; de là on pouvait conclure, qu'une si belle vertu comme est l'abstinence, ne pouvait pas habiter dans des cœurs si avares : Sublevamen pauperis sit absitinentia jejunantis. D'autres emploient leur argent à bâtir des palais. Je dis palais ; car quoiqu'il serait beaucoup plus sortable à leur condition de se faire bâtir des maisons ou quelque reste d'humilité chrétienne si convenable aux ministres des autels se fît reconnaître, ils n'épargnent rien pour ériger de superbes fabriques qui font honte aux palais des plus grands princes. Pour preuve de ce que je dis, on n'a qu'à jeter les yeux sur tous les monastères d'Italie ; et ceux qui ont voyagé dans ces pays-là, savent que le plus beau palais qui se trouve proche de l'église, est toujours la maison du curé.
D'autres font servir leurs revenus à se faire bien traiter et à se divertir. Comme ils n'ont point de familles, ce serait profaner, disent-ils, les dons de Dieu — c'est-à-dire les grands biens que leurs messes leur ont acquis — s'ils ne les employaient à se faire du bien en ce monde ; Eux, qui en font tant aux âmes du Purgatoire dans l'autre. C'est ce qui fait qu'on voit leurs tables si bien couvertes, et qu'ils se traitent entre eux tour à tour si splendidement. C'est aussi ce qui a donné lieu à cette expression si commune en Italie, lorsqu'on parle d'un morceau friand et délicat ; on l'appelle un boccone di cardinale — un morceau de cardinal. Ce que je dis des dépenses de la bouche, se doit aussi entendre de toutes les autres choses requises pour mener une vie délicieuse. Ils se les procurent avec une superfluité qui n'est pas excusable.
Pour voir un abrégé ou plutôt le comble de la vanité, de la lasciveté et de la mollesse, il suffirait de jeter les yeux sur la Cour de Rome. Cette cour n'est que composée que de prêtres et de moines, et elle se vante de surpasser en pompe et en magnificence celle des plus puissants monarques de la terre : On y voit des évêques qui ont deux ou trois évêchés, et des abbés qui ont cinq ou six abbayes. C'est comme un déshonneur à un ecclésiastique de n'avoir qu'un bénéfice, et à moins qu'il ne soit d'un grand revenu, il fait pauvre figure à la cour des prêtres. La vanité de cette cour est montée à un tel excès que les membres qui la composent bien loin d'en rougir en font leur principale gloire. Un cardinal ou un évêque ne fait pas une partie de chasse, et ne donne pas un dîner à un de ses confrères qu'il faut que cela se fasse savoir à toute la terre. Toutes les gazettes qui nous viennent de Rome ne sont presque remplies que de ces sortes de vanités. On y voit toujours que Monsieur le cardinal un tel a été rendre visite à cet autre ; qu'un tel a été à l'opéra, ou a fait faire une nouvelle livrée et s'est fait accompagner d'une suite de tant de carrosses, J'ai pris souvent plaisir lorsque j'étais à Rome de voir les dimanches au matin les cardinaux aller au Vatican lorsque le Saint-Père y tient chapelle. Ils sont comme autant de poupées rouges dans leurs carrosses ; et toutes leurs créatures sont autour d'eux avec un air extrêmement efféminé. Il faut avoir une grande foi pour croire que tous ces gens-là s'étant ensuite assemblés dans une chambre, le Saint-Esprit se trouve au milieu d'eux pour donner la loi à toutes les consciences. Si s'assembler avec tant d'ambition et de vanité est s'assembler au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a paru dans un état si humble n'est pas venu en ce monde au même nom. Chaque cardinal a son neveu ou plus proche parent auprès de lui qui tient son bonnet rouge à la portière du carrosse. C'est un grand honneur pour lui et la marque qu'il est la créature la plus chérie du cardinal. C'est le népotisme dont on a tant entendu parler du temps d'Innocent XI et que ce pape, qui était dans sa morale un homme assez sévère, prétendait extirper ayant commencé cette réforme dans sa propre maison. Cependant nous voyons sur quel pied les choses ont été rétablies depuis. Tous les efforts du pauvre Innocent XI n'ont été que comme un peu d'eau jetée sur un feu rouge qui ne sert qu'à le rendre encore plus en feu. Et pour moi je ne saurais concevoir comme une Église où la chair et le sang prévalent si fort, puisse se vanter que les portes de l'Enfer ne prévaudront jamais contre elle.
Le népotisme n'a pas seulement lieu dans la Cour de Rome, mais soit par imitation ou par inclination qui est naturelle de faire du bien à ceux qui nous sont liés de consanguinité, on le voit régner dans tout le reste des ecclésiastiques où l'avarice et l'amour des plaisirs n'ont pas tant d'ascendant. Ils ne songent qu'à enrichir ceux ou celles de leurs familles qui leur donnent le plus dans le génie. J'avoue que c'est encore là la plus louable et aussi la plus innocente de toutes leurs dépendances ; car enfin il y a là-dedans quelque apparence de charité ; mais dans le fond ce n'est pas une vertu chrétienne, puisqu'elle nous est commune avec les païens. Les Turcs font du bien à leurs parents et à leurs amis aussi bien que les prêtres de l'Église de Rome, et peut-être leur en font-ils aussi pendant leur vie, ce que ces derniers font fort rarement, puisqu'ils ne disposent ordinairement de ce qu'ils ont en faveur de leurs familles que lorsqu'ils se voient prêts d'en être séparés par la mort. Le népotisme est donc un gouffre qui engloutit une grande partie des biens des ecclésiastiques. Mais il y a un autre abîme qui en absorbe bien davantage, et d'une manière qui fait honte à leur profession et même à la nature : en un mot, le grand commerce qu'ils ont avec les deux sexes. Tout le monde sait qu'il n'est pas permis aux prêtres et aux moines de l'Église romaine de se marier, et qu'ils protestent contre le mariage dans la réception de leurs ordres, et dans leurs professions, comme contre une chose qui rend, disent-ils, l'homme souillé, pollue et incapable de servir décemment aux autels. Sur ce principe ils ne se marient point, et l'on brûlerait tout vif un prêtre qui serait convaincu d'avoir violé cette loi. Cependant ce n'est pas qu'ils ne voient bien qu'ils ont conté sans leur hostie, et leur entreprise est toute autre dans la pratique, qu'elle ne l'était dans la spéculation. Ils n'ont pas plutôt fait leur vœu de chasteté, qu'ils s'étudient de tout leur pouvoir à trouver les moyens de le rompre. Ils se font fermés volontairement la porte d'un mariage honnête et légitime ; c'est pourquoi il ne leur reste plus que celle de la fornication, de l'adultère, de l'inceste, du rapt, et des sacrilèges pour satisfaire leur concupiscence et assouvir leurs plaisirs infâmes. Pour en venir à bout, il faut de l'argent, parce que le sexe corrompu est doublement intéressé à leur égard. On ne leur fait pas si bon quartier qu'aux autres ; et les femmes débauchées ont l'effronterie de leur dire, que puisque d'avoir affaire avec eux, est un plus grand péché, il est juste aussi qu'ils leur fassent de plus grands avantages. L'ecclésiastique trouvant donc que le monde lui est assez incivil de ce côté-là, et gémissant de ce que sa condition l'oblige à ne pouvoir pas s'en passer, résout de son côté de lui être également rude. Il ne dirait pas une messe, ni une oraison, et ne ferait point un pas pour qui que ce soit, qu'il n'en soit bien payé. Si on l'appelle pour baptiser un enfant, pour exhorter un malade, ou pour enterrer un mort, il demande auparavant ce qu'on lui donnera, et fait son marché avant que de s'engager. Les confréries, les fêtes, les processions, les bénédictions, les dévotions pour les âmes du Purgatoire, sont sollicitées avec la dernière vigueur, comme un moyen très prompt et efficace pour remplir la bourse. Il n'y a rien qui les incommode davantage, que la pensée où est la plupart du sexe, que d'avoir affaire à des gens consacrés à Dieu comme ils le sont, c'est un sacrilège et le plus grand de tous les crimes. C'est là ce qui s'ensuit véritablement de leurs principes ; mais néanmoins c'est ce qu'ils tâchent d'amoindrir le plus qu'ils peuvent. Ils ne parlent jamais contre la lubricité, l'incontinence, l'adultère, etc. Et s'ils en disent quelque chose, c'est sans invective, et ce n'est que pour tâcher de diminuer l'horreur qu'on pourrait en concevoir. Quelques-uns ont l'impudence que ce sont là les plus innocents de tous les vices ; et que Dieu voyant qu'ils naissent et croissent avec nous, et ont leur principe dans le sang et le corps qui nous environnent, les excuse et pardonne fort facilement. Ils disent que ce sont là les arguments de la fragilité humaine, et que pourvu que l'on reste convaincu de sa faiblesse, qu'on s'en confesse, et qu'on s'en humilie, c'est assez ; un Ave Maria, ou un signe de croix avec un peu d'eau bénite, est toute la pénitence que l'on ordonne ces sortes de crimes. On traite fort doucement les séculiers sur ce point-là dans les confessions, et particulièrement les femmes ; afin, disent les prêtres, que la confusion qui en est inséparable ne les décourage pas de s'en confesser avec toutes les circonstances. Mais dans la vérité, c'est afin de se rendre les séculiers plus indulgents dans leurs censures, et de n'être pas eux-mêmes observés de si près lorsqu'ils commettent les mêmes fautes. La confession auriculaire et secrète, est le moyen le plus commode que les prêtres aient en main pour préparer leur proie. C'est là qu'ils mettent les femmes à la question, et que les accoutumant peu à peu de la jeunesse à parler avec confidence de leurs transgressions, ils leur font perdre enfin la honte naturelle qu'elles ressentiraient autrement d'en faire la moindre ouverture. Lorsqu'ils ont reconnu leurs inclinations et leur faible ; s'ils les reconnaissent d'un tempérament amoureux, il leur est facile de parler pour eux-mêmes et de s'insinuer. Il est évident que l'on ne voit presque que des femmes aller à confesse. Les hommes n'y vont ordinairement qu'une fois l'année, vers le temps de Pâques. La raison en ayant été une fois demandée en ma présence, une personne d'un fort bons sens répondit, que l'on ne voyait que des femmes à confesse parce que les hommes confessaient ; mais que si les femmes confessaient, il était à présumer que l'on n'y verrait que des hommes. La raison de ceci est, que les femmes trouvent la plupart, du plaisir à s'aller confesser ; étant bien assurées que les confesseurs leur feront des questions qui leur déplairont d'autant moins, qu'elles sont sûres que si elles s'émancipent dans leurs réponses, le secret de la confession les mettra à couvert. Il a y en a même une infinité qui se prévalant du secret de ce tribunal, et encouragées par les exhortations des prêtres de ne rien retenir de caché, non pas même les pensées des honnêtes qu'elles pourraient avoir à l'égard de leurs personnes, leur déclarent ingénument qu'elles les aiment, qu'elles ne sauraient ni jour ni nuit se les ôter de leur esprit, et que leurs tentations amoureuses sont si violentes, que si Dieu n'y met la main, ou si les ministres n'en ont compassion, la tête leur tournera infailliblement.
Les hommes ne vont pas souvent à confesse, particulièrement les Italiens, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse beaucoup de questions sur leurs amours. Un père capucin qui était extrêmement laid, et avait la mine d'un satyre avec sa grande barbe, me disait un jour en riant que son confessionnal servait d'épouvantail aux femmes ; mais qu'en échange il était le confesseur des amants jaloux. Sa pensée était que les femmes ne voulaient aller se confesser à lui, parce qu'il était laid ; et que les hommes y allaient volontiers, parce qu'ils le jugeaient comme incapable de leur faire aucun tort en devenant leur rival. Un confesseur qui a envie de se prévaloir de la fonction de son ministère, trouve bien les moyens par les questions qu'il peut faire, et auxquelles son pénitent est obligé de répondre, de découvrir qu'elle est la dame dont le gentilhomme parle ; et il ne lui est pas ensuite fort difficile de faire ses tentatives. Un jeune noble Vénitien ayant été interrogé en confession un peu trop indiscrètement, par un moine où demeuraient ses maîtresses, jura qu'il ne se confesserait jamais sur ce point-là, qu'à l'article de la mort, ou bien lorsqu'il serait las d'elles, et lorsqu'il n'y aurait plus de danger pour lui d'avoir un compétiteur. J'ai su de la bouche de plusieurs dames, que les confesseurs les étaient allées trouver dans leurs maisons, se servant des lumières qu'ils avaient par le moyen de la confession.
Cette confession est un des nouveaux sacrements de l'Église romaine, et on voit à quel usage profane elle sert, et l'intérêt que les prêtres et les moines ont de le conserver. C'est ce qui les fait protester si hardiment contre le mariage dont ils se soucient fort peu ; la nature de l'homme étant d'ailleurs si corrompue que la transgression lui semble plus douce que ce qui est honnête et légitime. Il me souvient d'une sentence qu'un abbé régulier d'un monastère d'Italie me dit un jour parlant des femmes : Melius est habere nullam quam aliquam. Lui ayant demandé en quel sens il l'entendait : il répondit que c'était parce que celui qui n'était pas attaché à une, en pouvait avoir plusieurs. C'était là une fine morale, et la pratique de ce prélat était entièrement conforme à sa doctrine. Il entretenait plus d'une vingtaine de femmes du revenu de son abbaye. Il avait plusieurs maisons de campagne, et il en avait fait autant de bordels infâmes pour lui et pour ses amis. Il les y régalait splendidement et les dépenses excessives qu'il y faisait l'avaient surnommé le libéral. Mais il n'en était pas de même à l'égard des pauvres fermiers qui travaillaient à faire valoir son bien, et à cultiver ses terres. Il était un exacteur insupportable à leur égard, et à peine pouvaient-ils se faire payer d'une partie de l'argent qui leur était dû. S'en voyant si maltraités, ils résolurent un jour d'avoir leur vengeance et de jouer un malicieux tour à leur maître. Ils savaient que l'archevêque était ennemi juré des moines et des abbés, et qu'ils le trouveraient dans la disposition de favoriser leur entreprise. Ils allèrent lui faire rapport de la vie scandaleuse que menait cet abbé qui était actuellement à trois lieues de Bologne dans une de ses fermes avec trois jeunes demoiselles, qui ne faisaient qu'un lit avec lui toutes les nuits. L'archevêque ne perdit point de temps. Il envoya le même soir toute sa maréchaussée composée du bargello ou prévôt, et de soixante sbires ou sergents bien armés pour se saisir de l'abbé et des femmes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent à la maison de campagne de l'abbé justement un moment après qu'il s'était mis au lit. Les fermiers qui avaient le mot et aussi toutes les clefs des portes, firent entrer le prévôt et les sbires à droite route dans la chambre du prélat, qui fût fort épouvanté de cette visite à laquelle il ne s'attendait pas. Il demanda à composer avec le prévôt et les archers, comme il avait déjà fait en d'autres rencontres. Il leur ouvrit une bourse pleine d'or. Mais les ordres étaient trop exprès, et les fermiers qui par vengeance avaient sollicité la prise de leur maître, étaient là présents, qui n'auraient pas manqué de donner une bonne information de tout ce qui se serait passé à l'archevêque. Ainsi le prévôt et les sbires, gens d'ailleurs qui ont l'âme extrêmement basse et avare, montrèrent une résolution forcée de ne point se laisser corrompre par l'argent. Ils lièrent l'abbé, tout nu qu'il était, sans lui permettre de mettre sur son corps qu'une robe de chambre. Ensuite l'ayant fait monter avec les trois femmes ses concubines dans un vieux chariot qu'ils trouvèrent dans la basse-cour, ils les lièrent tous ensemble dos à dos, et les traînèrent ainsi en triomphe, ou plutôt avec la dernière ignominie, jusqu'à Bologne devant l'archevêque. Il était environ minuit lorsqu'ils y arrivèrent, et l'épaisseur des ténèbres épargna beaucoup de confusion au pauvre abbé. L'archevêque le voyant en cet état se mit à rire, et dit en raillant que puisqu'il ne lui était permis de prendre connaissance des affaires des moines, il voulait faire l'honneur que de les faire eux-mêmes juges des actions de leurs confrères. Il donna ordre qu'on le conduirait à l'heure même dans cette posture à San Michel in Bosco, abbaye du même Ordre distante une portée de canon de la ville. Il était environ une heure après minuit lorsque tout ce beau train y arriva. Les sbires frappèrent avec tant de force à la grande porte du monastère, et firent une telle huée que l'abbé fut obligé de se lever et d'aller lui-même accompagné de tous ses moines, à la grande porte, où il vit un spectacle auquel il ne s'attendait pas. Il refusa d'abord de reconnaître le vieux abbé pour son confrère, sous prétexte qu'il était en robe de chambre, et n'avait pas l'habit de l'Ordre ; et il ne voulait pas le recevoir. Sur quoi les sbires lui dirent, qu'ils allaient donc le remmener à l'archevêque, qui aurait son de lui envoyer quérir ses habits, et de le lui renvoyer le lendemain en plein midi, habillé en prélat, avec ses vilaines. L'abbé voyant bien qu'il n'y avait rien à gagner qu'une confusion redoublée, commanda à ses religieux de l'aller délier. Il l'admit au-dedans, et fit mettre les femmes en liberté. Cet abbé eut pour pénitence de l'affront et du scandale qu'il avait causé, de rester quinze jours au monastère sans sortir dehors. Cela lui fut d'autant plus facile à exécuter, que le récit de cette galante histoire s'étant répandu dans Bologne, il aurait eu trop de confusion de se faire voir sitôt dans les rues. Le général qui l'aurait pu déposer de sa charge d'abbé, jugea qu'une si légère faute n'en valait pas la peine ; et ainsi par un esprit de charité, qui ne veut pas que l'on fasse à autrui ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fît, particulièrement lorsque l'on se trouve dans les mêmes circonstances ; se contenta de le faire changer pour quelque temps d'abbaye, et il le fit venir auprès de lui au mont Olivet où il faisait sa résidence.
J'ai rapporté cette histoire avec fidélité, comme en ayant été en partie témoin oculaire, parce qu'elle arriva du temps que je demeurais dans l'abbaye de San Michel in Bosco. Cela me donna occasion de faire une assez plaisante découverte. Lorsque les sbires arrivèrent à l'abbaye, un jeune religieux tout épouvanté, et craignant qu'on ne vint faire la visite dans les chambres où il entretenait depuis trois semaines une jeune demoiselle, s'en vint directement à moi, et sans beaucoup examiner à qui il s'adressait, il me pria pour l'amour de Dieu, de retirer sa dame dans une des chambres les plus secrètes de mon appartement, jusqu'à ce que l'orage fût passé. Nonobstant toutes les instances qu'il m'en fît, je ne trouvais pas à propos d'exposer mon honneur pour sauver le sien ; et sachant d'ailleurs combien il est dangereux de rebuter entièrement un Italien, particulièrement un moine, je l'adressai fort doucement à l'apothicaire, qui était un jeune homme de son pays, et qui n'était pas si scrupuleux. Le jeune homme la reçut fort volontiers, et l'enferma dans une des grandes armoires de l'apothicairerie, où elle resta le reste de la nuit, et le jour suivant, avec des frayeurs mortelles. Le jeune religieux vint le lendemain me faire ses excuses ; et comme il était apparemment fâché de m'avoir donné occasion, par les ouvertures qu'il m'avait faites, de croire que les autres étaient meilleurs que lui, il me découvrit des choses que je n'avais pas encore pénétrées depuis six mois que je demeurais dans cette abbaye. Il me dit que la plupart des autres religieux avaient leurs putains, qu'ils entretenaient dans leurs chambres. Ils les faisaient venir de temps en temps ; les uns les gardaient huit jours, les autres quinze, et un mois, selon l'accord qu'ils avaient fait avec elles, et que leur argent pouvait suffire. Ce n'est pas que l'abbé n'en eût connaissance : mais la coutume avait réduit parmi les choses à un tel état, qu'il était obligé de fermer les yeux à tout, et de se contenter des présents qu'ils lui faisaient de temps en temps. L'heure la plus propre pour introduire leurs dames était au commencement de la nuit. Elles se rendaient dans un endroit qu'on leur avait marqué précisément à une telle heure ; et les moines qui les avaient fait venir, leur portaient des capuchons et des frocs, et les habillaient en moines comme eux. Après quoi ces bons frères rentraient tous sans distinction, dans le monastère, en plus grand nombre qu'ils n'avaient sorti. Je m'étais plusieurs fois étonné auparavant, de voir passer dans les dortoirs de certaines figures de moines que je n'avais jamais vues, et l'on m'avait toujours donné à entendre, que c'était des moines étrangers qui étaient arrivés au monastère.
La plupart des chambres des religieux sont doubles, ce qui est une commodité pour recevoir leurs femmes. Les abbés en font leur profit, et un religieux ne peut pas avoir une de ces chambres doubles qu'il ne leur paie environ cent écus. Ils savent bien à quel usage elle doit servir ; mais pourvu que leurs religieux se comportent d'une manière que les séculiers ne puissent pas avoir la connaissance de leurs mauvais déportements, ils n'y prennent pas garde, et cela n'empêche pas qu'ils ne les avancent aux charges de la religion autant que s'ils étaient les plus honnêtes gens du monde. Je connaissais à Venise un chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Sauveur qui était un jeune homme assez savant, qui enseignait publiquement la philosophie. Il entretenait la plus infâme courtisane de toute la ville qui servait de modèle aux peintres de l'Académie. Il y avait plus d'un an que le commerce durait, et son abbé lui donnait tous les soirs du Carnaval, permission de s'habiller en masque, et l'aller prendre pour la mener à l'opéra ou à la comédie. Après quoi, ou il la menait dans sa chambre dans le monastère, ou il allait passer le reste du jour chez elle. Tandis que la chose fut secrète et ne fit point d'éclat au dehors, l'abbé laissa toujours faire le jeune religieux sans le reprendre ; et même comme il lui portait de l'affection, il avait déjà disposé toutes choses pour le faire élire abbé ; lorsque par un malheur pour ce jeune moine, un grand nombre d'artisans qui demeuraient dans la rue de la courtisane, et qui en avaient reçu apparemment quelque déplaisir, virent par vengeance faire leurs plaintes au monastère. L'abbé s'étant mis en devoir de les adoucir, et voulant excuser son religieux, ils s'aigrirent davantage ; et le dimanche suivant, ils s'assemblèrent dans l'église, proche de la chapelle où ils savaient que le jeune religieux avait coutume de célébrer la messe. Leur dessein était de l'affronter publiquement, et de lui empêcher le passage à l'autel. Mais l'abbé en ayant eu avis, leur envoya une pièce d'argent pour les faire retirer, ainsi qu'ils firent. Ce prélat néanmoins voyant que la chose était publique, se déclara dès lors contre le jeune religieux ; et quoiqu'il ne lui eût jamais fait jusqu'alors la moindre réprimande pour le remettre dans son devoir, il écrivait au père général de l'Ordre pour le faire casser aux gages. Quinze jours après il arriva un ordre pour lui ôter sa lecture de philosophie, et le reléguer dans un petit monastère à la compagne. Son crime autant que je le puis connaître, n'était pas d'avoir entretenu le commerce infâme, qui depuis un an n'était que trop connu à son supérieur, mais c'était d'avoir eu le malheur de le faire éclater en public. L'Italie sans contredit passe pour un pays extrêmement corrompu : mais ce sont assurément les prêtres et les moines, ces gens qui ont voué une chasteté éternelle, qui ont attiré sur elle le juste reproche qu'on lui en fait. Les richesses immenses qu'ils possèdent leur sont une occasion de scandale ; et les femmes qui n'en sont pas ignorantes, s'estiment heureuses d'entre dans leur amitié, étant un proverbe en Italie, qu'une putain de prêtre et de moine ne manque jamais de rien.
Les moines, outre le vœu de chasteté, ont fait encore celui de pauvreté, et pour cette raison ils ne devraient pas avoir de l'argent en propre : mais l'avarice des papes les a rendus propriétaires. On a beau couvrir l'institution des Ordres monastiques avec le beau prétexte de mener une vie plus parfaite et plus chrétienne, le principal motif et qui persévère encore aujourd'hui, ç'a été l'enrichissement des papes et des prélats de la Cour de Rome. Que l'on cherche tant que l'on voudra dans les cloîtres cet esprit de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que l'on y professe, on l'y trouvera moins assurément que dans plusieurs familles de séculiers : mais les papes y trouvent toujours de l'argent quand ils veulent. Ils n'instituent de nouveau Ordres, que parce qu'ils savent qu'ils ne dureront pas longtemps sans tomber en décadence, et que leur chute, par le moyen de la suppression, leur sera infiniment avantageuse. Il n'y a pas bien longtemps qu'un pape en supprima trois tout d'un coup ; savoir l'Ordre de S. Jérôme, celui des Jésuates et celui des Eaux, qui professaient aussi la même Règle (3). L'institution de ce dernier fut assez plaisante, et la fin n'en a pas été moins ridicule. Les premiers pères de cet Ordre inspirés, comme ils disaient, par le Saint-Esprit, se mirent à distiller des eaux pour le service des pauvres malades, et de cette distillation d'eaux qui faisait leur caractère de distinction, on les appela Padri dell'acquavita — Pères de l'eau-de-vie. Peu de temps après toute cette spiritualité alambiquée, se réduisit à ne distiller des eaux que pour les dames, pour leur faire venir les mains blanches, et conserver ou augmenter leur beau teint. Ces trois Ordres étaient devenus extrêmement riches et scandaleux lorsque le pape les supprima et réunit au Saint-Siège toutes leurs possession, et donna leurs églises à d'autres moines qui dans le fond n'étaient pas meilleurs qu'eux. C'était les réduire bien bas que de les dévêtir ainsi de tous leurs revenus, et leur faire pratiquer effectivement, quoique fort à contrecœur, leur vœu de pauvreté, les réduisant à la besace et à l'aumône de leurs parents. C'est ce qui rend ces sortes de suppressions si formidables aux moines ; et les papes qui n'en sont pas ignorants, n'ont qu'à les en menacer, lorsqu'ils veulent tirer d'eux des sommes d'argent considérables, ainsi que le dernier pape, Innocent XI, a fait plusieurs fois aux Ordres des chanoines réguliers, et à plusieurs congrégations de l'Ordre de S. Benoît. Celle du mont Olivet lui envoya pour une seule fois, un présent de cent mille écus pour apaiser la colère de Sa Sainteté. Il n'y avait pas longtemps qu'un autre pape leur avait fait trouver quatre cent mille écus ; et comme il leur était impossible alors de trouver dans le peu de temps qui leur était prescrit tant d'argent monnaie, il leur permit d'engager les fonds et d'aliéner les terres de leurs monastères. Ils le firent, et se servant adroitement de la conjoncture, ils demandèrent au pape, qui était alors en bonne humeur de ce qu'ils se disposaient à lui donner tant d'argent, qu'il leur fût permis de recevoir des pensions de leurs parents, et de posséder des terres en propre. C'était autant que demander qu'en faisant vœu de pauvreté, il leur fût permis de n'être pas pauvre. Et c'est ce que ce pape eut la conscience de leur accorder, aussi bien qu'à toutes les autres maisons religieuses dont il tira de l'argent. Voilà ce qui rend aujourd'hui les moines d'Italie si pécunieux et à leur aise ; car outre qu'ils reçoivent chacun d'eux une honnête subsistance de leurs monastères, ils ont encore de grosses pensions annuelles de leurs familles, dont ils disposent à leur volonté, et pour satisfaire leurs plaisirs. J'en ai connu qui avaient douze mille livres de pension.
Les cardinaux, qui voient que les papes tirent un avantage si considérable des ordres religieux, s'efforcent aussi de leur côté d'en tirer du profit. Ils leur vendent leur protection pour de l'argent. Chaque Ordre a un cardinal protecteur à qui il fait une pension annuelle de trois ou quatre mille écus. C'est afin d'en être protégé dans l'occasion en Cour de Rome. Les abbés de la Congrégation du Mont-Olivet, voyant qu'Innocent XI était résolu ou faisait semblant de les vouloir supprimer, eurent recours à leur protecteur le cardinal Facchinetti (4). Ils lui écrivirent une lettre, dans laquelle ils lui exposaient le grand danger où était leur Congrégation, et le suppliaient d'employer tout son crédit auprès du Saint-Père, pour la conservation de leur Ordre, et qu'en considération d'un service si signalé, ils augmenteraient sa pension de mille écus tous les ans. J'étais présent lorsque le cardinal ouvrit la lettre, et voyant la promesse qu'on lui faisait de mille écus d'augmentation, il s'écria un sentiment fort tendre : Ma chère Congrégation de Mont-Olivet, je ne souffrirais pas qu'il soit dit, qu'il te soit arrivé un si grand affront tandis que je serai ton protecteur. Il envoya immédiatement son secrétaire au Vatican, pour savoir s'il pourrait avoir audience du pape sur un sujet fort pressant, et de grande importance. Elle lui fut donnée justement à temps lorsque l'on travaillait actuellement à dresser la forme de la cassation de l'Ordre. Son Éminence se jeta aux pieds de Sa Sainteté, et lui dit comme en pleurant, que s'il passait plus avant dans sa résolution, il l'allait mettre au tombeau. Le pape le releva avec beaucoup de bonté, et comme il était son ancien ami, il ne voulut pas l'affliger. Il lui promit qu'en sa considération l'Ordre ne serait point supprimé ; et en effet l'on voit qu'il subsiste encore aujourd'hui, quoique les moines n'en soient pas meilleurs qu'au temps qu'on le voulait supprimer.
On aurait lieu de s'étonner, de voir que l'on souffre qu'il y ait tant de monastères et de couvents en Italie remplis de gens qui faisant vœu d'obéissance ne font que leur volonté, qui professant la pauvreté sont plus propriétaires que les gens du monde ; et qui enfin ayant consacré leur chasteté à Dieu, mènent la vie la plus libertine et plus scandaleuse que l'on se puisse figurer. On aurait lieu, dis-je, de s'en étonner, si l'on ne savait qu'à Rome l'or y est plus puissant que Dieu même. Y a-t-il rien de plus infâme que la vie des moines ? Qu'on aille à Rome, à Venise, et dans les principales villes d'Italie au temps de carnaval, on ne voit que des moines en masques dans les rues avec des courtisanes. Tous les théâtres des comédies, des opéras, et tous les lieux publics où l'on joue en sont pleins. Ils font même gloire de tous ces excès qui devraient les confondre. J'ai connu une infinité de moines qui en temps de carnaval s'approchaient de moi, et ôtaient leurs masques pour se faire reconnaître. Ils menaient chacun leurs demoiselles par la main. Et le lendemain dans les sacristies tout leur entretien, avant que d'aller à l'autel pour dire la messe, était des débauches qu'ils avaient faites le jour précédent, et de celles qu'ils devaient encore faire le même jour. Je me souviens d'une histoire que me raconta un jour un de ces bons moines, laquelle pour quelques circonstances assez rares et particulières mérite bien que je vous en fasse le récit. C'est à Venise qu'elle s'est passée. Ce moine rapporta qu'il y avait trois semaines qu'il lui était arrivé une très heureuse aventure ; savoir qu'en allant le soir à la comédie, il avait rencontré une dame de qualité en masque, qui était autant qu'il l'avait pu conjecturer depuis, une noble Vénitienne. Comme elle était seule et qu'elle s'adressait à lui plus qu'il ne s'adressait à elle, il la prit d'abord pour une femme publique, et dans cette pensée il la pria d'aller avec lui à la comédie. La dame accepta volontiers ses offres. La comédie étant finie le religieux s'offrit de la reconduire chez elle ; et elle qui ne demandait pas mieux fit aussitôt signe aux gens qui l'attendaient à la rive avec sa gondole, de la venir recevoir. Le moine entra avec elle, et trouva au fonds de la barque un gentilhomme masqué qui le reçut fort civilement. La dame craignant que la peur ne l'eût saisi, lui dit de ne rien craindre, et commanda aux barquerolles de voguer. Il était environ une heure après minuit. La lune était dans le défaut, et l'air étant tout couvert de nuages empêchait qu'on ne pût rien entrevoir à la lueur des étoiles. On lui fit faire tant de tours et de détours dans les canaux de Venise, qu'il ne lui fût pas possible de s'imaginer en quel endroit de la ville il était. Tout ce qu'il pût reconnaître, c'est que l'on fit arrêter la gondole à la porte de derrière d'un grand palais, et aussitôt plusieurs laquais masqués vinrent éclairer avec des flambeaux, et on le conduisit par un escalier secret dans une grande salle en haut, où il trouva encore quelques personnes masquées. Quoique ce moine fût un jeune homme fort résolu, il avoua qu'il fût saisi d'une frayeur extrême, particulièrement lorsqu'il vît que la dame s'était retirée, et l'avait laissé seul avec le gentilhomme et quelques valets masqués ; et il ne s'attendait rien moins qu'à la mort. Mais le gentilhomme d'un autre côté fit tout son possible pour le rassurer. On couvrit la table d'un fort beau dessert, et on lui servit de plusieurs sortes d'excellents vins. Après quoi on lui montra un fort beau lit, où on lui dit de s'aller coucher. Le moine voyant qu'il y avait danger à ne pas obéir fit tout ce qu'on voulait de lui. Sitôt qu'il fut au lit, on éteignit le feu et tous les flambeaux dans la chambre, et un moment après la dame entra et alla se coucher avec lui, lui donnant mille assurances qu'il ne lui arriverait point de mal. Le religieux fut gardé et servi pendant quinze jours consécutifs de la manière que je viens de dire, sans qu'il pût reconnaître où il était, ni aucun des gens qui l'accompagnaient ou le servaient. Tout ce qu'il pût conjecturer par les discours de la dame fut : Que comme elle ne pouvait pas avoir d'enfants de son mari, il avait consenti pour se venger des plus proches parents, à qui il ne voulait pas que succession tombât après leur mort, qu'elle trouvât les moyens d'avoir un héritier, et qu'ils n'avaient jugé de personne plus propre pour ce dessein que de se servir d'un jeune moine bien fait comme lui. Ainsi après beaucoup de civilités et de bons traitements, mais aussi après un horrible péché, il fut congédié. On lui donna la valeur de cinquante guinées en or ; et l'ayant fait rembarquer une nuit, après plusieurs tours et détours qu'on lui fit faire, on le remit à peu près à l'endroit où on l'avait pris, sans qu'il lui ait jamais été possible de rien découvrir davantage. Il racontait lui-même cette aventure avec un transport de joie, qui marquait bien, quoiqu'il fût sur le point d'aller dire la messe, qu'il n'aurait pas été fâché de se trouver encore dans de semblables circonstances.
Un autre moine n'eut pas une si bonne fortune que celui-ci. Une dame de qualité l'avait introduit en l'absence de son mari, et peut-être dans la pensée aussi de lui donner un héritier ; mais par malheur le mari étant retourné à l'improviste, le bon frère fut surpris et pris sur le fait. Le gentilhomme lui donna une des chambres de son logis pour prison, et l'y fit garder quinze jours jusqu'à une certaine fête, où l'on devait faire une procession générale. La procession devait passer par devant son logis. Le gentilhomme ayant donc pris son temps, il le fit fouetter par quatre de ses laquais, et justement au milieu de la procession lorsque les pères carmes passaient qui était l'Ordre religieux dont ce frère était, il le fit mettre dehors tout nu avec un grand écriteau sur le dos, et l'obligea de s'enfuir au travers de la procession. Cela causa un grand scandale. Et les pères carmes qui s'y trouvaient les plus affrontés, portèrent leurs plaintes à l'Inquisition, prétendant que le gentilhomme était un hérétique ennemi des Ordres religieux, qui ne cherchait qu'à en prostituer l'honneur : mais cet honnête homme sut fort bien se défendre, et justifier son procédé contre la malice diabolique de ces moines.
Je pourrais vous rapporter ici une infinité d'histoires curieuses des amours et des intrigues des moines et des prêtres, si je ne savais qu'il est du devoir d'un honnête homme, de ne parler qu'avec beaucoup de modération, d'un vice dont la découverte est également dangereuse à celui qui l'a fait, et à ceux à qui elle est faite. Je vous dirai seulement pour trancher court sur ce point ici, que je n'ai jamais conversé avec un seul moine ou avec un seul prêtre de l'Église romaine, autant de temps qu'il en fallait pour les fonder un peu, que je n'aie reconnu à la fin qu'il avait des pratiques secrètes avec les femmes, ou ce qui est pire, et que je ne voudrais pas nommer, qui n'ait été adonné au vice abominable de la sodomie. Plusieurs d'entre eux étaient des saints en apparence. Ils ne parlaient que de la Sainte Vierge et du Purgatoire, et je ne recherchais leur amitié que parce que je les croyais d'abord gens de bien. Mais quelque temps après je reconnaissais à mon grand regret, que je m'étais trompé dans la bonne opinion que j'avais conçue de leurs personnes.
Je connaissais à Venise un procureur d'une maison religieuse qui était l'homme qui avait la physionomie la plus avantageuse du monde. J'étais édifié de voir avec quelle modestie et humilité extérieure il était habillé. Au lieu que la plupart des autres moines d'Italie portent de belles étoffes lustrées, de beaux chapeaux, des bas de soie, et des souliers mignons, celui-ci n'avait rien que de fort simple, et portait un grand vieux chapeau d'un pied et demi de bord qui lui pendait de tous côtés, avec un grand chapelet de bois à sa ceinture. Il avait avec un air et un port qui ne respirait que la dévotion, et sa messe, que les autres expédient en moins d'un quart d'heure, durait toujours une heure et demie. Il aimait aussi les livres ayant passablement bien étudié. Ces bonnes qualités jointes à quelques autres qu'il possédait encore et à un fort bon renom qu'il s'était acquis, quoique ce fut par son hypocrisie, furent les motifs qui me portèrent à rechercher son amitié. Je m'estimai de rencontrer beaucoup de facilité dans l'exécution de mon dessein et pendant sept mois de conversation que j'eus avec lui, je ne reconnus rien que de fort honnête dans ce religieux. Il semblait même qu'il eût comme un esprit de prophétie ; car ce qu'il avait prédit de la délivrance de Vienne et de l'entière déroute des Turcs fut fort ponctuellement accomplie [le 12 septembre 1683]. Il aurait été à souhaiter pour lui, qu'il eût aussi bien prévu les mauvaises conséquences que devait attirer sur lui la vie licencieuse et débordée qu'il menait secrètement, pour tâcher d'y remédier. Ce bon moine en apparence, que j'estimais comme un homme venu du Ciel, fut obligé par un accident qui lui arriva, de me découvrir toute sa mauvaise vie. Une femme débauchée qu'il avait entretenue pendant plusieurs années, avait enfin résolu de le perdre de réputation. Sachant mieux qu'aucun autre combien ce moine hypocrite était amateur de la vaine gloire, il y avait déjà quelques mois qu'elle le menaçait de le décrier s'il ne lui donnait l'argent qu'elle lui demandait. Elle avait déjà tiré en deux fois cent écus, et était venue pour la troisième lui demander une pareille somme. Il n'aurait avancé de rien de la lui donner ; car la femme n'aurait pas manqué quinze jours après, de lui venir faire les mêmes menaces, qui étaient de déclarer en présence du prieur du couvent et de tous les religieux, que celui-ci entre les mains de qui tout l'argent du monastère passait, avait non seulement forcé sa fille, mais encore abusé un de ses garçons de la manière la plus abominable. Le moine avouait que véritablement il avait eu affaire à l'un et l'autre, et à la mère aussi ; mais qu'il n'avait pas été le premier, puisqu'il y avait longtemps qu'ils menaient une vie prostituée, et qu'il les avait bien payés ; que cependant pour obvier à son imprudence, il me priait de l'aller avertir sérieusement, que si elle ne se contentait de l'argent qu'elle avait reçu de lui, il était dans résolution de la faire tuer. Je fus si éloignée de lui offrir en ceci mes services, que je conçus dès lors horreur de sa personne, et pris résolution de ne jamais plus le voir. J'eus néanmoins la curiosité avant que de me séparer de lui, de lui demander pourquoi il allait vêtu d'un habit si grotesque avec son grand chapeau, lui qui d'ailleurs aimait si fort à courtiser les femmes. Il me répondit qu'il s'était toujours bien trouvé de cet habit-là, parce qu'étant officier du monastère, lorsqu'il allait pour se faire payer des rentes, on en avait plus de respect pour lui : et cela lui aidait aussi à faire sa bourse particulière. Il m'expliqua de quelle manière cela se faisait. Comme nos monastères ne sont jamais sans procès, dit-il, on sait ce que coûte une assignation, une poursuite, un contrat, une quittance, et cent autres formalités que les gens qui plaident savent : il suffit que je fasse voir lorsque je rends mes contes, que j'ai faire tant d'assignations, de consultations, de quittances, etc. et qu'ainsi cela monte à tant d'argent. C'est là mon profit ; car quelquefois je n'ai rien déboursé. Je vais chez l'avocat, chez le procureur, et chez le notaire avec mon grand chapeau : Je fais là le pleureux, et représente le plus qu'il m'est possible la pauvreté du monastère, d'une manière que je porte le plus souvent à compassion, et ainsi ils ne prennent point d'argent de moi, ou bien ils se contentent de peu de chose. De sorte que cela reste dans ma bourse, et je ne suis pas obligé d'en tenir compte à mes supérieurs, étant un fruit qui provient de mon fonds et de ma propre industrie. Mais si j'allais me présenter à ces gens de palais, poursuivit-il, avec un petit chapeau et un habit bien propre, ils diraient : Voilà de bons gros moines qui sont bien à leur aise et qui ont de quoi ; et ainsi ils me feraient payer toutes choses en rigueur : Pour ce qui est des femmes, je suis toujours sur que si ma personne ne leur plaît pas, mon argent leur plaira, et qu'ainsi je serai toujours bienvenu auprès d'elles. Je vis par là que tous ces grands chapeaux, ces vieux capuchons, ces barbes de Capucins, et ces grands collets de Jésuites ne doivent pas êtres des preuves certaines — comme quelques-uns le prennent — que ceux qui les portent sont d'honnêtes gens. Cette connaissance que j'ai eue de leurs désordres, a servi aussi à me convaincre, que le vice de l'impureté est celui qui règne le plus parmi eux ; et que de tous ces voueurs de chasteté, il y en a fort peu, et peut-être point du tout qui l'observent en vérité ; parce que Dieu ne donnera jamais Sa bénédiction aux confiances folles, ni aux vœux téméraires.
De tout ceci, il n'est pas mal aisé de comprendre comme les ecclésiastiques peuvent employer leurs vastes revenus, ce vice de la chair étant un de ceux qui demande le plus de frais pour l'entretenir. Il est vrai que tous les prêtres et les moines ne sont pas également riches. Il y en a plusieurs à qui les bénéfices et les pensions manquent, et qui par conséquent n'ont pas les moyens de faire de grandes dépenses : mais cependant ils en font à proportion. J'en ai vu plusieurs qui n'avaient que l'argent de leurs messes ; ils se laissaient presque mourir de faim pour épargner quelque petite chose, afin d'aller tous les quinze jours, ou une fois tous les mois aux femmes publiques. Il y en a d'autres qui ont l'âme si vile, qu'ils apprennent des métiers et les exercent secrètement pour gagner quelque argent. J'en ai connu qui étaient menuisiers, d'autres tailleurs, et quelques-uns qui rhabillaient des souliers. Beaucoup de gens les font travailler, parce qu'ils font les choses un peu à meilleur marché que les autres. Il y en a même qui apprennent à travailler pour les femmes, comme à faire leurs manteaux et corps de jupes, pour avoir occasion de les aller voir chez elles. Quelques-uns professent de dire la bonne aventure ; et d'autres sont de véritables nécromanciens. Enfin d'autres n'ont pas seulement l'âme basse, mais encore sacrilège : Car quoique selon leurs principes, célébrer plusieurs fois la messe en un jour, soit une des plus grandes profanations que l'on puisse faire ; ces prêtres et moines qui sacrifient toute sorte de religion à leur propre intérêt, passent volontiers par-dessus ce point ici, et disent quelquefois trois ou quatre messes par jour, en différents endroits. Un jour de fête j'entendis de grand matin dans l'église de San Marco à Venise, la messe d'un pauvre prêtre que je connaissais ; et ayant eu occasion la même matinée d'aller à Murano, qui n'est éloigné qu'une petite lieue de Venise, en traversant par une église, je vis le même prêtre qui célébrait encore une autre messe. Deux heurs après je fus obligé de passer à un endroit qu'on appelle la Giudecca, et là je trouvai encore le même prêtre qui célébrait dans un couvent de religieuses. Ce prêtre s'étant tourné au Dominus vobicum de la Messe, me reconnut, et voyant qu'il était découvert, il entra dans une si furieuse crainte et inquiétude durant tout le reste de sa messe, qu'il ne savait presque plus ce qu'il disait, ni ce qu'il faisait. Il omit une partie des collectes et des bénédictions accoutumées ; et après avoir consacré le calice, il s'oublia de l'élever en haut pour le faire adorer du peuple, selon la coutume. La messe étant finie, il se déshabilla avec une précipitation extraordinaire, prit son chapeau et son manteau, et s'enfuit sans demander la paie de sa messe. J'aurais pu le faire arrêter : mais comme c'était une matière d'Inquisition, et que ce tribunal ne m'a jamais plût, je ne le voulus pas faire. Et d'ailleurs je savais qu'il n'était pas le seul, et qu'une infinité d'autres font le même métier tous les jours.
Ma plume est lasse de rapporter des actions scandaleuses et infâmes. Cependant comme il n'y a point de mal dont on ne puisse tirer un grand bien, je souhaite, Monsieur, que de ce que je vous ai écrit ci-dessus, et dans toutes mes Lettres précédentes, vous puissiez au moins en tirer celui-ci, d'être convaincu que le premier argument qui a donné lieu à mes Lettres, et sur lequel vous vous appuyez si fort pour vous confirmer dans la religion romaine, est bien pauvre, bien faible et bien dangereuse ; Qu'il n'est pas possible que ce grand nombre de moines et de prêtres qui tiennent le gouvernail de votre Église soient dans l'erreur, et qu'ainsi l'on peut bien s'en reposer sur eux. C'est là un de ces arguments qu'on appelle : Circulus vitiosus — Un cercle vicieux. Les séculiers s'en reposent pour les matières de la Foi sur les prêtres et les moines : Et en divisant maintenant les prêtres et les moines comme on les divise à Rome — savoir en prêtres en deçà, et en prêtres au-delà des Alpes — on voit que les seconds s'en reposent sur les premiers qui sont les Italiens, et ceux-là en croient entièrement à ceux de Rome, savoir à ce nombre d'ecclésiastiques qui sont autour du pape, et qui passent dans leur esprit pour de grands docteurs. Ceux-ci d'un autre côté ne s'en reposent pas tant sur leur science, qu'ils savent être fort médiocres, que sur le grand nombre de prêtres et de séculiers qui les en croient. C'est ce qui fit dire un jour en chaire, à un de leurs grands prédicateurs, qu'un argument invincible pour prouver la vérité de la Transsubstantiation, était le grand nombre de ceux qui la croyaient, en comparaison du petit qui la déniaient ; que leurs Catholiques étant vingt contre un, devaient être estimés les plus forts. Je ne m'arrêterai pas ici à vous montrer combien ces arguments tirés du nombre ou de la dignité des personnes sont faibles ; il me suffit d'avoir exposé à vos yeux ce que j'ai pu découvrir moi-même de la mauvaise foi de vos pasteurs, et de l'intérêt temporel qu'ils ont de vous abuser et de se tromper eux-mêmes en vous trompant. Car de même qu'ils sont bien aises de servir à la multitude, d'argument de ce qu'elle croit ; aussi Dieu permet que la même multitude leur soit un argument de ce qu'ils croient. Si un aveugle mène un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse, et si un en mène vingt, ils y tomberont tous ensemble. Il vaut bien mieux s'appuyer surtout ce que nous avons de plus fixe, qui sont les Écritures, pour tâcher d'en pénétrer le véritable sens, que de mettre sa confiance sur les hommes, qui aveuglés par leurs intérêts ou par leurs passions, peuvent nous aveugler nous-mêmes et nous tromper. Je finirai cette relation de mon voyage, ou plutôt des remarques que j'ai faites en Italie, par le récit de quelques petites circonstances qui méritent d'être rapportées.
De Milan je pris mon chemin vers le lac de Côme où j'embarquai pour aller pour aller dans la Valteline, et de là je repassai pour une seconde fois la montagne de Splügen où j'allai rendre visite au curé de Campodolcino, mon ancien ami, qui était un docteur de Milan. Il fût surpris de me revoir et d'apprendre que mon dessein était de faire encore un autre voyage aux Grisons et en Suisse. Il m'avertit fort sérieusement de me donner de garde des hérétiques, et de ne converser que le moins que je pourrais avec eux. Je lui dis qu'il serait assez difficile dans uns pays où ils sont si fort mêlés avec Catholiques, de les éviter, et même de les reconnaître. Il me répondit là-dessus, que je les reconnaîtrais tout aussitôt par leurs manières de parler. Vous ne serez pas, dit-il, un demi-quart d'heure dans leur compagnie, que vous entendrez sortir de leurs bouches quelqu'une de ces paroles : La pureté de l'Évangile ; la liberté des enfants de Dieu ; la vérité écrite, le Testament de Jésus-Christ ; et autres mots semblables, qui tendent à exalter la Sainte Écriture par-dessus l'autorité du Saint-Siège. Bien loin que cette notion que ce bon docteur me donna des Protestants me fit concevoir du mépris pour leurs personnes, j'y remarquai quelque chose de beau, qui me les rendit encore plus aimables. Je méditai en passant par les Alpes, que ce qu'on leur objectait comme un crime, pourrait bien faire leur apologie. Comme j'entretenais mon esprit dans ces pensées, j'aperçus de loin une troupe de petits enfants qui accouraient d'un petit hameau qui était sur la montagne, pour me venir demander l'aumône. Je remarquai que ces enfants ne me demandaient l'aumône qu'au nom de Dieu et pour l'amour de Jésus-Christ. Par là je reconnus qu'ils étaient Protestants ; et quoique je n'eusse pas alors de monnaie pour leur faire grand bien, ils ne laissèrent pas de me donner mille bénédictions, et s'en retournèrent fort paisiblement. J'avançai mon chemin, et comme les Catholiques sont mêlés dans ce pays-là avec les Protestants, j'arrivai en descendant dans un autre petit hameau, d'où il sortit aussi des enfants pour venir demander la charité. Ils la demandaient pour l'amour de la Très Sainte Vierge, de S. Antoine de Padoue, et des âmes du Purgatoire. Ils ne voulurent pas se contenter du peu que j'avais donné aux autres, et ils me suivirent avec importunité plus d'un quart de lieue, en récitant un grand nombre d'Ave Maria et de prières pour les morts. Après quoi, voyant qu'ils ne pouvaient rien avoir davantage, ils changèrent leurs oraisons en mille malédictions, et prirent des pierres en leurs mains qu'ils me jetèrent en s'enfuyant. Je connus par cette action, que ces petits Catholiques-là n'étaient pas si bien élevés que les enfants des Protestants, et que la doctrine qu'on leur enseignait, ne produisait pas un si bon effet, que la pureté de l'Évangile dans les autres.
Je continuai ainsi ma route par le pays des Grisons et des Suisses, et sans m'arrêter à l'avis du curé de Campodolcino, je conversai indifféremment avec les Protestants et avec les Catholiques. Je sais qu'il est bien difficile qu'un peuple divisé de religion, quoique sous les mêmes lois et un même gouvernement, comme sont les Suisses, s'entre-aiment parfaitement. Mais j'observai que les Papistes parlaient avec beaucoup plus d'aigreur contre les Protestants, que ceux-ci contre eux ; quoique ces derniers en eussent assurément beaucoup plus de sujet ; car c'était au temps que la persécution était poussée avec le plus de fureur. Je fus soit édifié de plusieurs protestants réfugiés en Suisse, qui bien loin de se plaindre des misères qu'ils avaient souffertes, s'exhortaient par des paroles tirées de la Sainte Écriture, à supporter patiemment toutes les autres que leur exil pourrait leur causer. Ils ne pouvaient même souffrir que l'on parlât mal de leurs persécuteurs, et témoignaient de ne souhaiter rien tant, sinon qu'il plût Dieu de leur pardonner et de les convertir. Un vieux gentilhomme reprit en ma présence avec beaucoup de charité, un jeune soldat français, de ce qu'il s'emportait de paroles contre le roi de France [Louis XIV] ; et lui demanda si la lecture de la Bible lui avait appris cela. Le jeune homme en demeura confus, et le pria d'excuser cette faute, qu'il n'avait commise que par le chagrin de se voir réduit à mener la vie de soldat, après avoir perdu tout son bien.
Me trouvant en Suisse et si proche de Genève, j'y allai passer trois ou quatre jours. J'étais logé chez une bonne veuve fort zélée Protestante. Je m'y trouvai plusieurs fois engagé à disputer sur les matières de la religion. Comme je défendais alors une faible cause, j'éprouvai que les arguments que l'on me proposait étaient faux ; et quoique je ne me rendisse pas d'abord, on remarqua la modération avec laquelle je donnais mes réponses : ce qui fit dire à un des ministres qui s'y trouva, qu'il serait à souhaiter que tous les prêtres de l'Église romaine eussent autant de retenue, parce que cela donnerait plus de lieu de mettre la vérité au jour ; mais qu'ordinairement par leurs emportements, leurs paroles de mépris et leurs injustices, ils rompaient toutes leurs disputes lorsqu'ils se voyaient un peu trop pressés. Ils en agirent assurément avec moi avec beaucoup de civilité ; et après la dispute ils firent préparer une fort belle collation, à laquelle ils m'invitèrent ; me priant seulement, par un certain reproche qui ne me déplût pas parce que je le trouvai juste, de vouloir faire réflexion que leur esprit n'était pas semblable à celui des Papistes : Car, Monsieur, me dirent-ils, vous savez que si nous avions autant disputé en France ou en Italie pour soutenir nôtre croyance, comme vous avez disputé ici pour soutenir la vôtre, on nous maltraiterait, on nous mettrait en prison, et on nous brûlerait tout vifs ; mais pour nous, bien loin d'en venir à des extrémités si barbares, nous ne vous en regarderons pas même de plus mauvais œil, et vous ne recevrez de nous que les meilleurs traitements que nous serons capables de vous faire. Il me sembla apercevoir dans cette conduite, cet esprit de bonté et de douceur avec laquelle Jésus-Christ et les premiers prédicateurs de la Foi convertissaient les infidèles et les pécheurs. L'idée m'en est toujours restée depuis dans l'esprit, et m'a fait appliquer ensuite avec des dispositions plus désintéressées, à lire les livres des Protestants, et à peser leurs raisons. Et les ayant trouvées solides, appuyées sur la parole de Dieu ; et les pratiques de la Réforme conformes à celles des premiers siècles de l'Église, Dieu m'a fait assez de grâce pour disposer ma volonté à les embrasser en abjurant toutes les erreurs de l'Église romaine, auxquelles j'ai renoncé, et renonce de tout mon cœur ; vous souhaitant par charité le même bonheur, comme étant, etc.
_____________________________________
[Notes de bas de page.]
1. Voir Gabriel d'Emillanne, Observations on a Journey to Naples. Wherein the Frauds of Romish Monks and Priests are Farther Discover'd, Londres, Clavell, 1691 — «Observations sur un voyage à Naples, où les tromperies des prêtres et des moines de l'Église romaine sont découvertes davantage.»
2. Cf., Saint Matthieu 16:11, Cavete a fermento Phariseorum et Saduceorum. — «Gardez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens.»
3. Les Jésuates de S. Jérôme, qu'on appelait aussi les Clercs apostoliques de S. Jérôme, furent fondés à Sienne entre 1360 et 1364 par le marchand Giovanni Colombini ; leur Ordre fut approuvé par le pape Urbain V en 1367 ; à l'origine ces moines suivaient la Règle de S. Benoît, et ensuite celle de S. Augustin. Le pape Clément IX dissoudra l'Ordre le 6 décembre 1668, à cause des couvents vides pour manque de vocations, des discordes au sein de la compagnie entre laïques et prêtres, et des richesses accumulées par la distillation des herbes. Les Jésuates s'établirent à Venise vers 1390, à l'église de Santa Giustina, puis à Santa Agnese et enfin à San Gerolamo où, grâce à une donation du marquis Francesco I Gonzaga, ils purent ériger un couvent dès 1423 et recevoir l'investiture officielle du pape Alexandre VI ; leur église fut dédiée à Santa Maria della Visitazione par l'évêque Jean de Tibériade le 21 décembre 1524 ; suit à la dissolution de l'Ordre en 1668, leurs biens furent confisqués par la République vénitienne ; et, en 1669, le couvent et l'église furent achetés par les Dominicains.
4. Cesare Facchinetti, naquit à Bologne le 17 septembre 1608, fut créé cardinal dans le consistoire du 13 juillet 1643, et mourut à Rome le 31 janvier 1683.
[Notes]
1. Gabriel d'Emilliane, Histoire des tromperies des prestres et des moines de l'Eglise romaine, où l'on découvre les artifices dont ils se servent pour tenir les peuples dans l'erreur. Et l'abus qu'ils font des choses de la religion. Contenues en huit lettres ; Ecrites par un voyageur pour le bien du public, Rotterdam, Acher, tome I et tome II, 1693 ; le dédicataire est «Monseigneur de Bentin, Comte de Portland», c'est-à-dire William Bentinck (1649-1709), et l'avant-propos au lecteur est signé «G. D'E. E. A. P.», qui représente «Gabriel d'Emilliane Ecclesiae Anglicanae Presbyter» (pasteur de l'Église anglicane). Cette première édition publiée en français est une traduction fidèle de l'original en anglais : Gabriel d'Emilliane, The Frauds of Romish Monks and Priests,..., Londres, Clavell, 1691.
2. Quelques détails biographiques sur Gabriel d'Émilliane (c. 1655-1714).
3. Transcription et notes par Dr Roger Peters [Home Page (en anglais)].
[Octobre 2006]